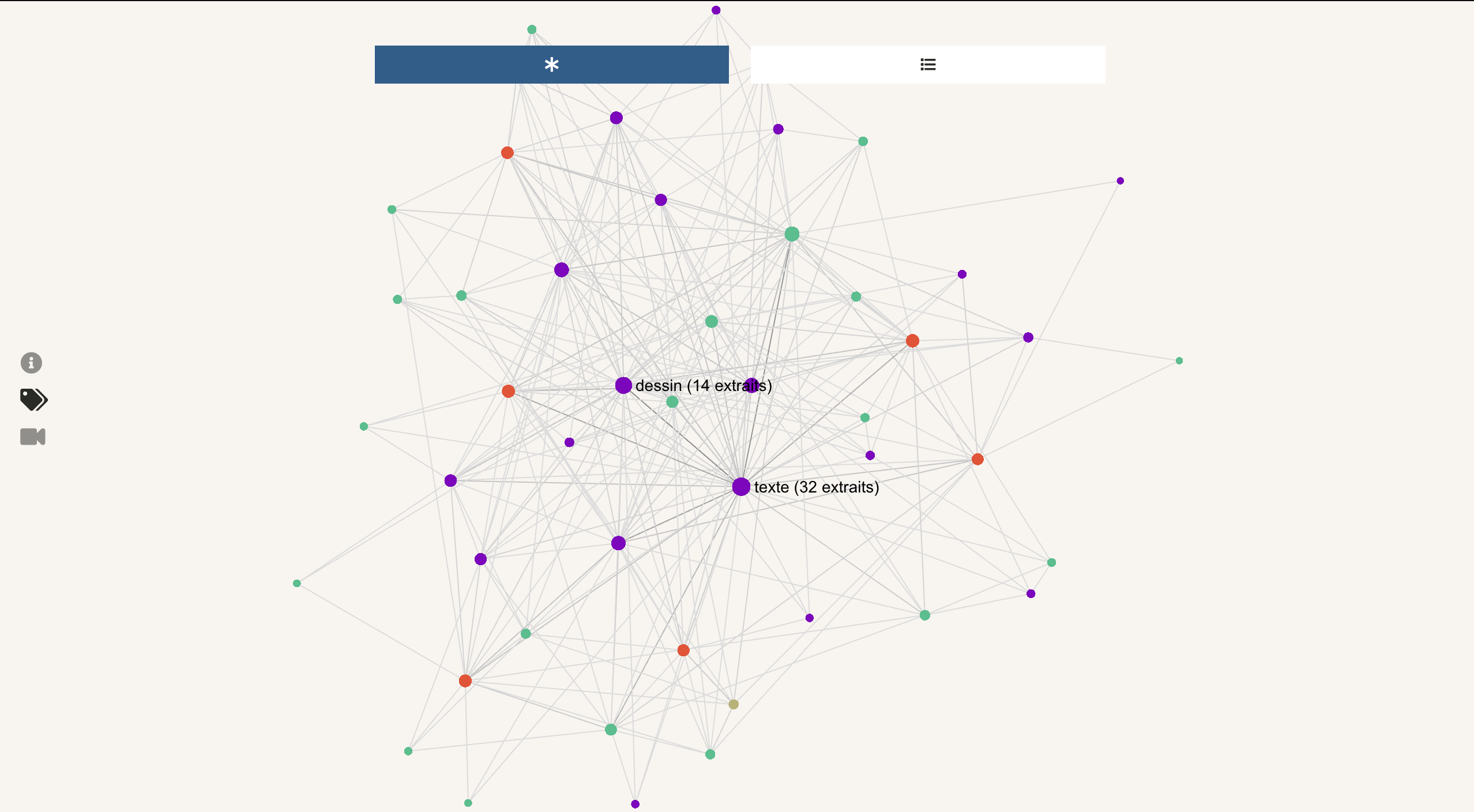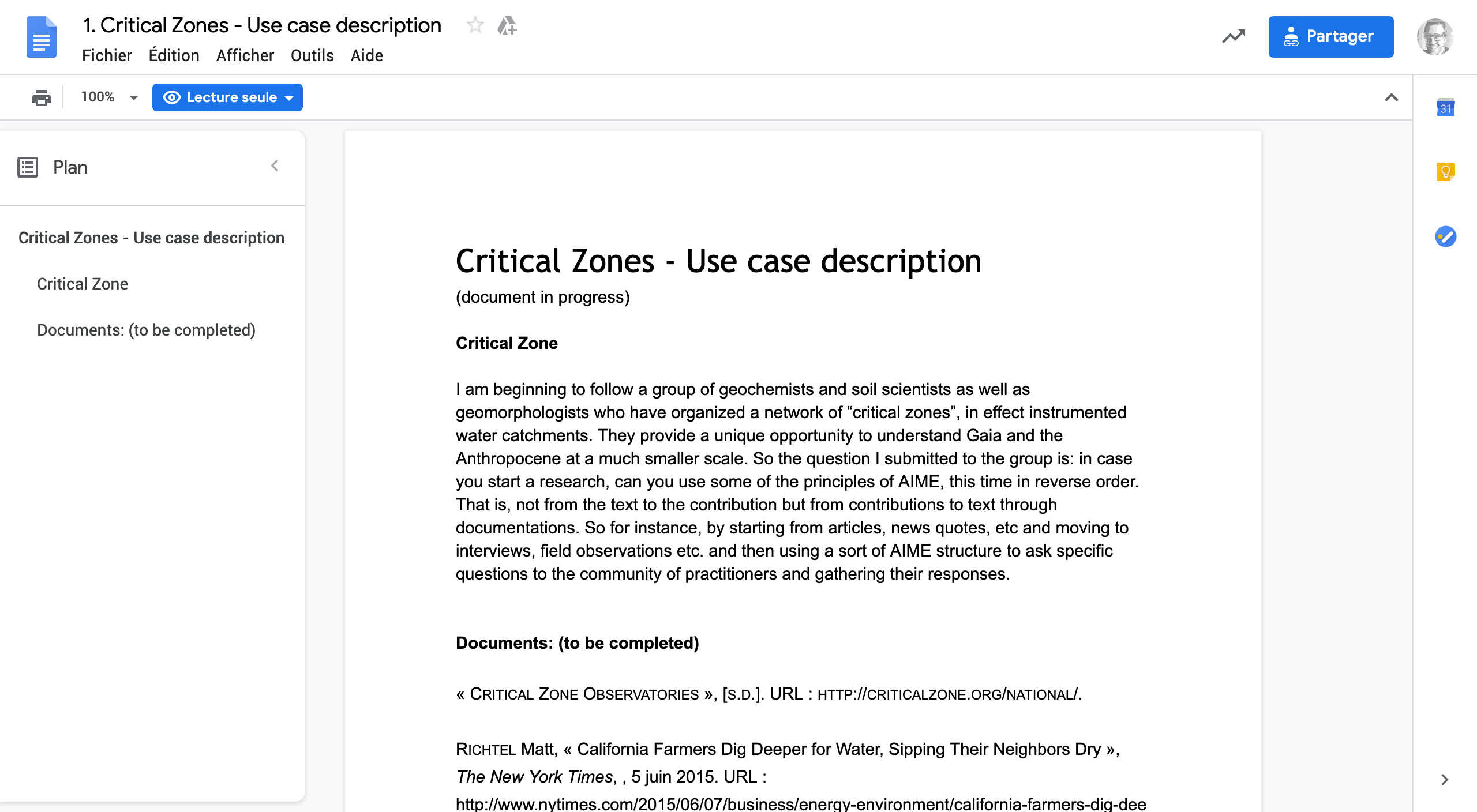Chapitre 5. Le design des formats, entre équipement et perturbation
— Maintenant que je suis revenu [au médialab de Sciences Po] après ces six mois d’absence, j’aimerais vous présenter les expérimentations que j’ai faites depuis que je suis parti. Le projet Peritext – fortement développé grâce à mon dernier séjour parmi vous – a donné naissance à un logiciel qui s’appelle Ovide. Il permet de produire de manière différenciée et maîtrisée (sur le plan du design) une série d’éditions imprimées et web à partir d’écrits de recherche communs. […] Il permet pour l’instant de fabriquer des éditions imprimées, des éditions web en plusieurs colonnes, des éditions web sous forme de cartes...
— Ah, mais en fait tu as refait EME ! [rires]
— Qu’est-ce qui te fais dire ça ?
— Eh bien le multi-supports, les colonnes, la version numérique qui permet de séparer vocabulaire, texte et documents. C’est EME quoi, mais pour tout le monde, non ?
— Et la dimension contributive ? et la relation aux modes d’existence ? et les rencontres physiques ? il n’y a pas tout ça dans ce logiciel !
— Oui OK, bon disons que tu l’as industrialisé. Tu as repris ce qui pouvait l’être et tu veux le généraliser via un nouvel outil, ce n’est pas ça ?
Ainsi commençait l’une des présentations que j’ai faite en 2018 lors d’un déjeuner d’équipe au médialab de Sciences Po, dans les sous-sols du 13 rue de l’Université à Paris. Ce court extrait démontre de manière assez édifiante qu’à travers le dialogue qui s’opère entre situations de recherche spécifiques et conventions partagées, les formats vacillent continuellement entre le statut de produits – résultats d’une démarche située – et le statut de cadres – stabilisés dans des normes et des habitudes reconnaissables, de telle manière qu’ils précèdent les pratiques de recherche et relient les contextes d’énonciation. Le passage du format-produit au format-cadre, tel qu’on l’a observé dans les chapitres précédents, permet en ce sens d’éprouver la capacité des formats à être reconnus et interprétés, mais également traduits, modulés, combinés. Ce sont alors le « contenu », la temporalité et les modalités des pratiques de publication en SHS qui se trouvent questionnés et reconfigurés à chaque itération d’un tel mouvement de vacillement.
Dans ce cadre, les pratiques de création et de conception qui touchent les formats de publication affectent les pratiques de recherche sur un plan technique, épistémologique et social. Comme le propose Olivier Quyntin, les formats ainsi travaillés par l’art et le design permettent une « médiation seconde » qui les rend apparents et « saisissables en tant que tels » pour l’analyse, ce qui permet également d’agir sur la configuration des collectifs avec lesquels ils dialoguent, de sorte que « le changement de format modifie la chaîne des acteurs, la syntaxe et les valences des collectifs qui participent aux cours d’action, recartographie la connexion des sites et leur topologie » (Quintyn, 2015, p. 60). Cela dit, peut-être à la différence d’une pratique strictement artistique, les pratiques de design autorisent non seulement à rendre visibles, à perturber, et de ce fait à étudier les formats existants, mais également à stabiliser et développer des propositions de formats hybrides voire apocryphes capables de servir, et, pour cette recherche, à les introduire dans les espaces de communication et les communautés de pratique des SHS. Une pratique de design qui consiste à faire vaciller les formats entre les deux pôles du produit et du cadre, de l’intervention et de la proposition, de la perturbation et de l’équipement, permet alors d’aménager des espaces d’invention méthodologique et politique inédits, mais également de construire des espaces de réflexion et de discussion d’un genre particulier.
En ce sens, ce chapitre vise à reconstituer les modalités selon lesquelles les pratiques expérimentales déployées par les activités de design dans les collectifs de recherche des SHS peuvent contribuer à l’infrastructuration d’une pratique de fabrication critique collective et distribuée. Pour ce faire, il se fonde sur le corpus circonscrit des activités de design (numérique) de formats de publication expérimentaux que j’ai conduites dans le cadre de cette recherche. L’ensemble de ces expérimentations a été réalisé selon le projet initial de contribuer à l’équipement de pratiques de publication-comme-enquête – c’est-à-dire, d’une part, qui mobilisent de manière intime et diversifiée les matériaux de recherche dans l’écriture des documents-publications, et, d’autre part, qui font usage de la publication pour assembler des publics pluriels et contribuer à diverses formes d’enquête collective. Cela dit, les motivations de mes expérimentations n’ont pas été homogènes et elles ont évolué à travers le temps, selon différents types de relation entre design et enquête. Tout d’abord, j’ai commencé par mettre en œuvre un travail d’équipement de ma propre enquête sur l’EME en fabriquant des équipements me permettant de l’analyser, que j’ai ensuite progressivement stabilisé dans une série de propositions à visée instrumentale pour les collectifs des SHS. Puis j’ai évolué vers un registre davantage expérimental et réflexif, qui m’a permis d’interroger les pratiques de publication dominantes à la lumière de la reconstitution opérée par ma pratique.
La pratique de proposition matérielle que j’ai exercée, dans ce contexte, a davantage consisté à élaborer des moyens de publication, destinés à équiper les collectifs à l’œuvre dans la production des documents-publications – écrivains, éditeurs, designers, etc. – plutôt qu’à faire œuvre de design éditorial en fabriquant des éditions uniques et autres productions finalisées. En ce sens, la pratique du design a ici été saisie comme une pratique d’infrastructuration dans le sens défini dans le champ du design participatif par Pelle Ehn et Erling Björgvinsson (Bjögvinsson, Ehn, & Hillgren, 2012) ou plus récemment Carl Disalvo et Christopher Le Dantec (Dantec & DiSalvo, 2013), à savoir une démarche qui tend moins à fabriquer des systèmes immédiatement utiles qu’à « créer un terrain fertile pour soutenir une communauté de participants »1 (Dantec & DiSalvo, 2013, p. 244). Au fil des différentes situations que j’ai rencontrées dans le cadre de ma recherche, mes activités ont ainsi consisté à expérimenter des modèles de données décrivant la structure et l’organisation de nouveaux types de documents de recherche ; à concevoir et à implémenter un ensemble d’interfaces d’édition et autres middlewares intellectuels permettant d’écrire, de concevoir et d’éditer des publications ; à mettre en place une variété de « gabarits » et autres patrons graphiques et interactifs destinés à la production de publications imprimées et web, avec ou sans un objectif de publication spécifique ; enfin, à programmer une série de modules techniques au code ouvert publiés en ligne sous licence libre, et destinés à l’usage d’autres designers, développeurs et artistes2 .
Cette pratique du design centrée sur la fabrication de moyens n’a cependant pas été une pratique délocalisée, préoccupée par la définition de principes de conception ou encore par l’établissement définitif de modèles applicables à n’importe quel contexte éditorial ou n’importe quel projet de publication savante. Au contraire, elle a continuellement été située dans un ensemble de collectifs et de projets mobilisant les publications comme des pratiques d’enquête selon une diversité de modalités. Ainsi, il ne s’est pas agi pour moi d’opposer, dans ma pratique, la fabrication de prototypes expérimentaux et celle de produits industriels, mais plutôt de dessiner une trajectoire construite par une série de déplacements entre des moments plus ou moins stabilisés, à visée plus ou moins généralisante, et dans lesquelles j’ai moi-même joué un rôle différencié. Ma pratique a ainsi consisté à faire continuellement dialoguer l’expérimentation de situations de publication-comme-enquête spécifiques avec la production d’équipements visant à infrastructurer des situations analogues à venir.
Cette pratique infrastructurante et située du design a été construite par une série de traductions depuis une situation vers une autre, consistant à chaque étape de la trajectoire de recherche à reprendre certains éléments – principes de conception, modules de code, qualités plastiques ou interactives – pour les réadapter, les recombiner, les re-moduler, les augmenter, ou au contraire les simplifier. Ces multiples opérations de traduction peuvent être décrites comme une trajectoire d’enquête dans la mesure où elles opèrent comme autant de dérivations appliquées à l’objet initial d’une recherche – le terme de dérivation étant entendu dans son sens linguistique après la proposition de Carl Di Salvo concernant le fonctionnement d’un processus de recherche en design (DiSalvo, 2018). De la même manière que la dérivation désigne à la fois un processus et son produit, la série d’expérimentations que j’ai conduite peut alors être mobilisée dans l’écriture selon le double registre du cheminement méthodologique et intellectuel qu’elle a occasionné, d’une part, et des produits et autres équipements qu’elle laisse dans son sillage, d’autre part. En tant que trajectoires, ces expériences de conception et de fabrication permettent de documenter des techniques de recherche à l’intersection entre enquête et design, et peut-être de contribuer à la constitution d’une communauté de pratique préoccupée par le design des formats ddes publications en SHS. En tant que produits, elles constituent des propositions destinées à l’équipement des collectifs de recherche dans le sens de la poétique de la métamorphose documentaire esquissée au fil des chapitres précédents, tout autant qu’elles incarnent et questionnent les articulations des formats à l’œuvre dans le geste de la publication de recherche en SHS.
Le point de départ de ces multiples dérivations s’ancre dans l’expérience de terrain de l’EME. À partir de cette dernière, deux dynamiques m’ont conduit à développer des pratiques de design relevant de la proposition de nouveaux moyens de publication dans le cadre de ma recherche. Tout d’abord, j’ai produit des matériaux de recherche et me suis posé la question de leur mobilisation dans ma propre thèse, à la fois sur le registre d’un dialogue avec mes pratiques d’écriture, et sur celui de la mise en œuvre d’une démarche d’écriture multimodale jouant avec des techniques similaires à celles employées par ses objets d’étude. Ensuite, j’ai été conduit à reprendre et à réinvestir certains des éléments observés dans le cas spécifique de l’EME via une série de collaborations et de situations de recherche nouvelles. Ces multiples itérations, plutôt que d’opérer comme l’optimisation de principes ou de méthodes, ont provoqué la mise en lumière de plus en plus exacerbée des problèmes et des tensions à l’œuvre dans le design des formats de publication.
Ainsi, la première tension éprouvée dans ma pratique a résidé dans ses finalités, qui ont oscillé de manière permanente entre instrumentation et expérimentation. En effet, ma démarche a été instrumentale dans la mesure où elle a visé à équiper les collectifs de la publication en SHS « d’outils » et autres « infrastructures » méthodologiques et techniques. Ces outils et infrastructures furent développés pour répondre aux besoins de collectifs de recherche dans certaines situations dans lesquelles j’étais impliqué. En ce sens, elle a été conduite pour équiper au moins deux publics différents : celui des chercheurs – pour lesquels elle entendait favoriser des pratiques de publication-comme-enquête – et celui des designers, auxquels elle entendait donner des moyens – techniques, méthodologiques, conceptuels – permettant une meilleure invitation de pratiques de design dans les collectifs de recherche.
Cependant, ma pratique a également été expérimentale dans la mesure où elle a consisté par moments à explorer les qualités de mes productions pour elles-mêmes, à tester les potentialités de leurs modèles de données, à suivre les lignes de force de leurs interfaces, sans qu’un réel besoin d’instrumentation ne justifie de telles investigations. En ce sens, il s’est agi de fabriquer des moyens de publication non seulement pour équiper les collectifs de recherche, mais également pour développer dans ma pratique un lieu de problématisation et d’enquête à propos des formats de publication et de leurs enjeux, dont ce texte est la trace. Quels sont les effets d’une telle oscillation entre instrumentation et expérimentation ? Que permet-elle de comprendre et d’éprouver ? Comment qualifier les lieux de savoir produits par de telles pratiques hybrides ? Comment en mobiliser les produits, entre outils, instruments, et arguments ?
La deuxième tension a résidé dans l’oscillation constante des effets de ma contribution auprès des collectifs avec lesquels j’ai interagi, entre stabilisation et déstabilisation. En accord avec le caractère situé de l’ensemble de mes activités, j’ai été conduit à constamment relier des situations de production spécifiques – où les formats étaient entendus comme le résultat d’une activité tournée vers une publication précise – et la stabilisation d’éléments réutilisables propres à permettre un travail d’infrastructuration des pratiques de publication en SHS – dans lequel les formats produits se voyaient temporairement institués en formats-cadres pour de nouvelles situations de recherche. Comment ces variations articulent-elles les différents formats – éditoriaux, de données, d’écriture, d’enquête – de la publication de recherche ? Que produisent les alignements et les désalignements entre ces derniers ? Si l’étude de l’EME a déjà apporté des éléments de réponse à ces questions du point de vue de la constitution sociale et politique de collectifs de recherche à travers de tels vacillements, les expériences réalisées par la suite ont permis d’explorer plus avant leurs implications techniques en expérimentant une variété de technologies et de modèles en interaction avec les pratiques de la publication, et de suivre depuis le début des recherches les relations entre formats de données, formats d’écriture et formats d’enquête.
Enfin, la troisième tension provoquée par mes expérimentations, d’ordre méthodologique, a résidé dans la distinction entre la valeur intellectuelle de la trajectoire de fabrication suivie, et la valeur des produits – publications expérimentales et autres expositions, logiciels, modules techniques – qu’elle a occasionnée. Quels sont les effets des formats dévoilées par les dérivations qu’implique une pratique de design en recherche ? Quel est le statut méthodologique, social et politique des produits qui résultent d’une telle trajectoire de dérivation ?
En suivant cette dernière ligne de tension comme fil conducteur pour le développement de ce chapitre, je vais dans un premier temps revenir sur les situations de fabrication dans lesquelles j’ai été impliqué dans le cadre de cette recherche et qualifier les différentes opérations de dérivation qui les ont articulées. Il s’agira de retracer pour chacune d’entre elles les pratiques qui ont conduites d’une situation – et des formats travaillés à cette occasion – à une autre, depuis l’analyse embarquée et située du projet Enquête sur les Modes d’Existence jusqu’au développement de logiciels d’écriture, en passant par une diversité de collaborations spécifiques. Ce faisant, il sera possible d’explorer ce qui se produit dans le passage depuis des moments de déstabilisation invitant à la fabrication de formats spécifiques, vers des moments de stabilisation destinés à infrastructurer les moments suivants de la recherche. Je reviendrai alors, à travers le récit de ces expériences de la thèse, sur une définition de la pratique de l’expérimentation en recherche en la faisant valoir comme l’un des traits caractéristiques de la fabrication-comme-enquête.
Dans un deuxième temps, après avoir détaillé les modalités et les apports de la trajectoire de fabrication-comme-enquête de la présente recherche, je décrirai et j’interrogerai ses produits et leur statut méthodologique et épistémologique. À partir d’une description du projet le plus abouti parmi mes diverses expériences, intitulé Peritext, qui a conduit notamment à la réalisation de plusieurs logiciels d’écriture, de design et d’édition, je décrirai les différentes articulations que ce type de production est à même d’interroger à travers les pratiques qu’il donne à expérimenter. Conjuguant un format de données, un format d’écriture, et une diversité de formats éditoriaux, une telle production autorise des pratiques hybrides tout autant que le questionnement des manières de faire établies dans le champ de l’édition scientifique et technique. À la croisée entre instrumentation critique et expérimentation utilisable, le rôle de telles productions en tant que documents-publications dans le champ de la publication universitaire devra alors être qualifié, comme un genre particulier et inédit de lieux de savoir à même de participer à la conversation universitaire à propos de la matérialité des pratiques de recherche en SHS.
Expériences de dérivation : des situations de design entre stabilisation et déstabilisation
La genèse de mes pratiques de design de formats de publication expérimentaux a, dans le cadre de cette recherche, trouvé son origine dans l’expérience de terrain du projet Enquête sur les Modes d’Existence. Il s’agissait initialement d’équiper les différentes pratiques d’enquête que j’avais conduites. Une fois le terrain fini, cette pratique s’est progressivement transformée en un projet de démocratisation et de traduction de certains des aspects de l’EME, dans un souci d’équipement des collectifs de recherche en SHS : il s’agissait alors de dériver d’un projet unique à plusieurs titres, certains éléments de son format d’écriture, de son format éditorial ou de ses formats de données, de manière à les rendre utiles à un public élargi de chercheurs. Cependant, un tel projet a été rapidement déjoué par le long chemin qu’il impliquait. Les différentes situations d’expérimentation, conçues dans un premier temps comme autant de cas d’usage pour le développement « d’outils » génériques destinés à la communauté des « humanités numériques », ont construit une trajectoire non-linéaire, au cours de laquelle les développements successifs ont conduit à faire l’expérience des capacités des formats à être traduits et recontextualisés. Ces mêmes situations d’expérimentation ont aussi notamment permis d’explorer les complexes aller-retour qui s’établissent entre les formats-produits issus de la spécificité de situations de recherche et de production éditoriale, et les formats-cadres induits par la réutilisation des artefacts élaborés pour de nouvelles situations de recherche. Il s’agit donc de décrire ces opérations et ces traductions afin d’être ensuite en mesure d’en qualifier les effets et la valeur méthodologique pour la présente recherche.
Expérimentations autour de la publication de documents de recherche audiovisuels annotés : le cas de Dicto
Mes premières expériences de proposition de formats de publication ont porté sur le rôle des documents audiovisuels dans les pratiques d’écriture et de communication des communautés de recherche des SHS. Dans ce cadre, les documents audiovisuels prennent d’abord la forme de matériaux de recherche, aux formes et aux statuts très divers suivant les disciplines concernées, qu’il s’agisse par exemple d’objets d’étude pour des recherches en cinématographie, de documentation de terrain en anthropologie, ou encore de l’enregistrement d’entretiens de recherche sociologiques. En outre, ils prennent parfois également le statut de documents-publications, dans la mesure où les techniques d’enregistrement et de mise en ligne disponibles conduisent aujourd’hui à partager des communications orales – formelles telles que conférences et colloques, mais aussi parfois informelles telles que séances de séminaire – sous la forme de documents en ligne pérennes et publiquement accessibles3 . L’ensemble de ces transformations a conduit dans les années récentes à une multitude d’expérimentations visant à exploiter les potentialités des technologies numériques en général et du web en particulier pour fabriquer de nouveaux formats de documents-publication autorisant des pratiques d’écriture et de consultation diversifiées4 . De telles expérimentations vont dans le sens d’une publication-comme-enquête dans la mesure où elles permettent une meilleure exploitation des matériaux de recherche et une communication plus importante des différentes étapes de la recherche. J’ai donc été conduit à m’y intéresser dans le cadre de mon parcours.
En dialogue avec une série de situations ayant conduit, de proche en proche, depuis une pratique de terrain vers une pratique de proposition, j’ai progressivement stabilisé un modèle de données visant à articuler des pratiques d’analyse vidéographique, d’annotation et d’étiquetage, et enfin des pratiques d’écriture et de composition. Ce modèle a été exploité et valorisé à travers un logiciel accessible en ligne, intitulé Dicto. Il s’agit d’abord de retracer les différentes opérations ayant conduit à cette stabilisation.
Expérimenter différentes combinaisons entre pratiques des matériaux audiovisuels et situations de publication
Dans le cadre de mon terrain sur l’EME, selon les pratiques d’enquête relatées précédemment dans cette thèse, j’ai été amené à construire une interface de retranscription d’entretiens des différents acteurs du projet EME 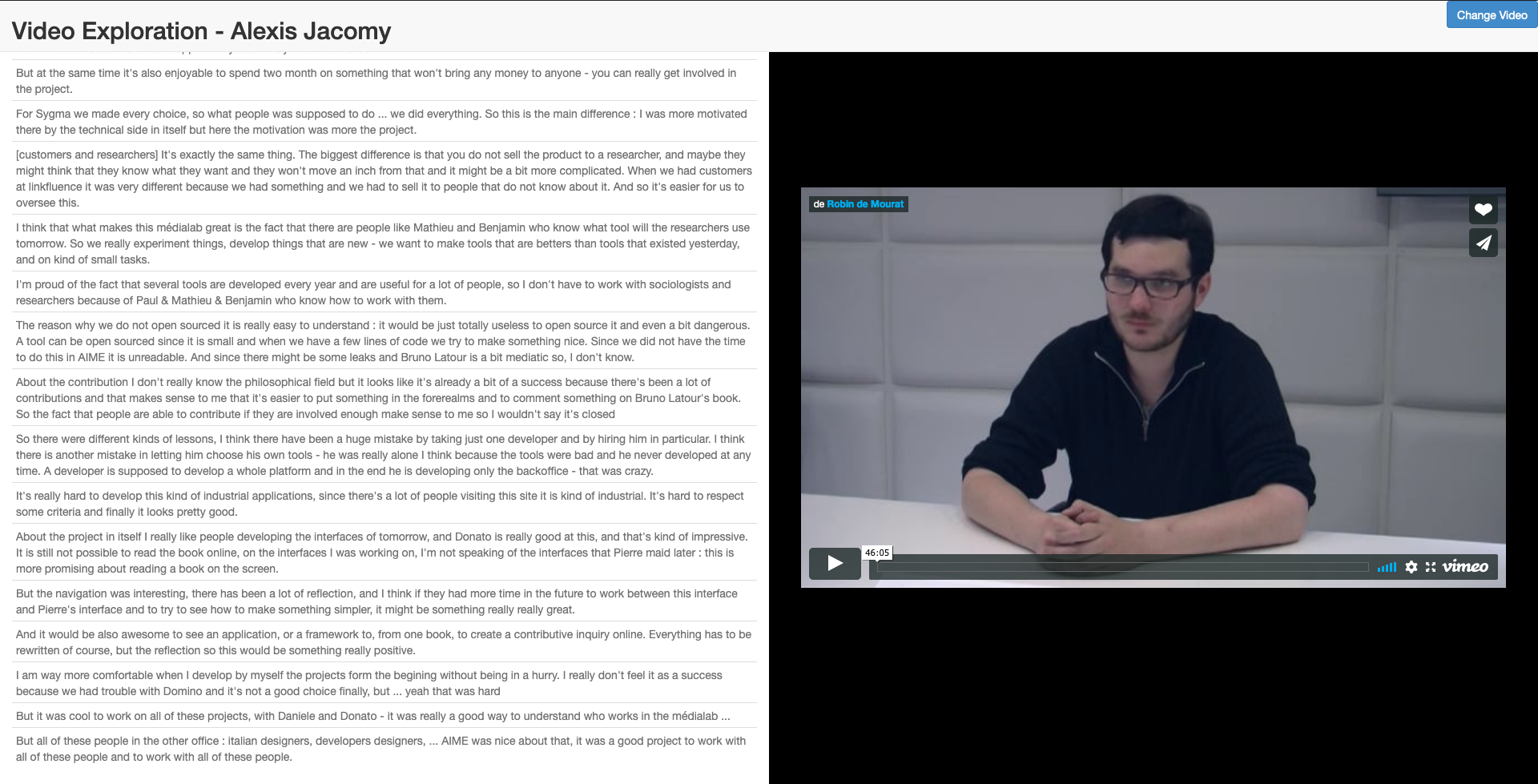 . Il me fallait transcrire puis communiquer les liens établis entre plusieurs sessions d’entretien semi-directif, et les communiquer de manière à interagir avec la communauté de participants au projet. Ces premières expériences ont été partagées de manière semi-publique à travers le site Enquête sur EME
. Il me fallait transcrire puis communiquer les liens établis entre plusieurs sessions d’entretien semi-directif, et les communiquer de manière à interagir avec la communauté de participants au projet. Ces premières expériences ont été partagées de manière semi-publique à travers le site Enquête sur EME .png)
.png) . À la suite de cette expérience, est né le projet de conjuguer le format graphique de mise en scène des entretiens adopté dans Enquête sur EME avec le logiciel – alors rudimentaire – de transcription bricolé pour l’occasion. Je me suis donc attelé à stabiliser une première version d’une interface permettant d’effectuer la transcription d’une élocution à partir de son enregistrement – fonctionnalité proposée par une importante quantité d’autres outils – mais permettant également sa publication sous la forme d’un site web autorisant une lecture multimodale et interactive. Ce projet a rapidement rencontré des contextes d’expérimentation constitués par l’environnement de cette recherche.
. À la suite de cette expérience, est né le projet de conjuguer le format graphique de mise en scène des entretiens adopté dans Enquête sur EME avec le logiciel – alors rudimentaire – de transcription bricolé pour l’occasion. Je me suis donc attelé à stabiliser une première version d’une interface permettant d’effectuer la transcription d’une élocution à partir de son enregistrement – fonctionnalité proposée par une importante quantité d’autres outils – mais permettant également sa publication sous la forme d’un site web autorisant une lecture multimodale et interactive. Ce projet a rapidement rencontré des contextes d’expérimentation constitués par l’environnement de cette recherche.
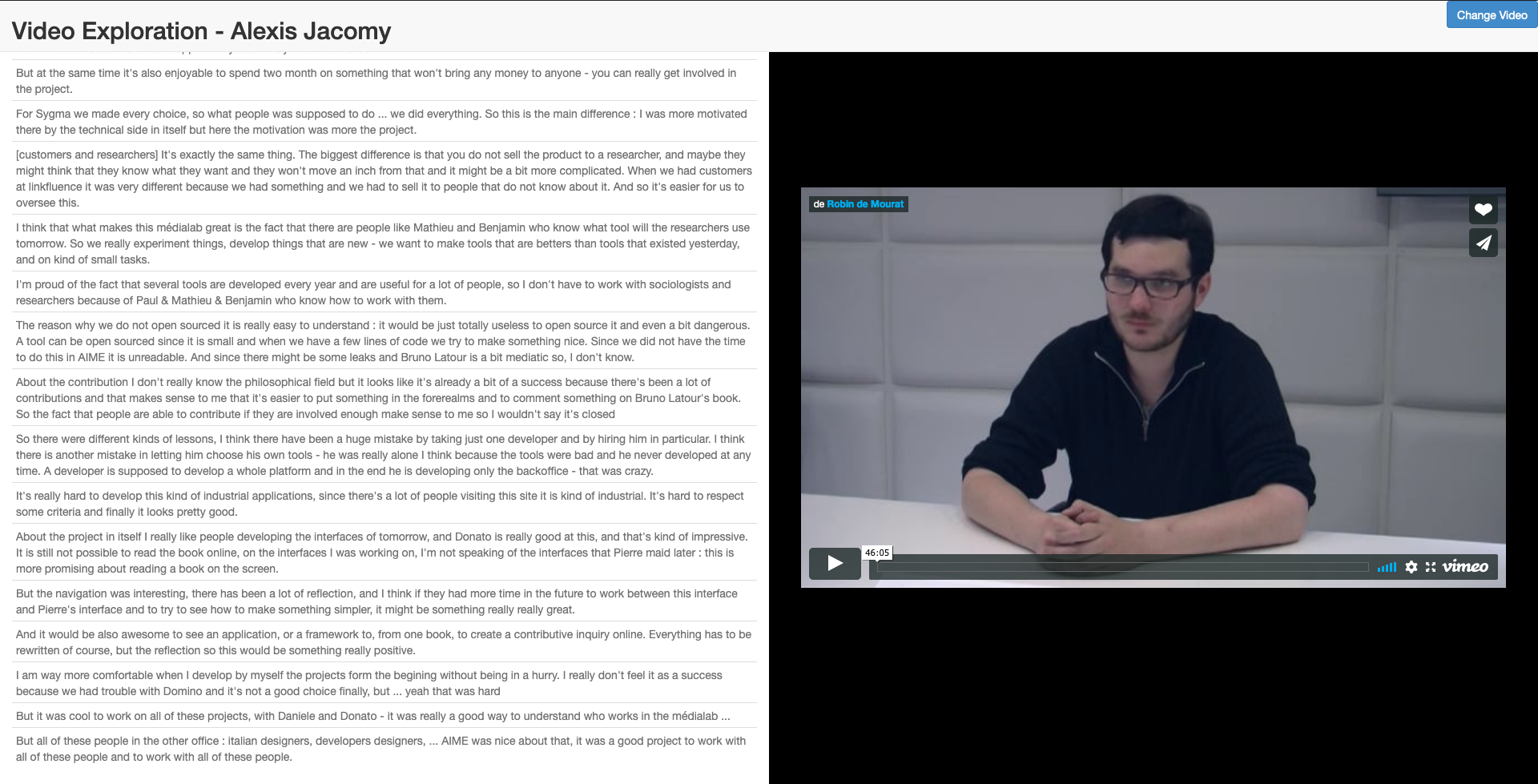 . Il me fallait transcrire puis communiquer les liens établis entre plusieurs sessions d’entretien semi-directif, et les communiquer de manière à interagir avec la communauté de participants au projet. Ces premières expériences ont été partagées de manière semi-publique à travers le site Enquête sur EME
. Il me fallait transcrire puis communiquer les liens établis entre plusieurs sessions d’entretien semi-directif, et les communiquer de manière à interagir avec la communauté de participants au projet. Ces premières expériences ont été partagées de manière semi-publique à travers le site Enquête sur EME .png)
.png) . À la suite de cette expérience, est né le projet de conjuguer le format graphique de mise en scène des entretiens adopté dans Enquête sur EME avec le logiciel – alors rudimentaire – de transcription bricolé pour l’occasion. Je me suis donc attelé à stabiliser une première version d’une interface permettant d’effectuer la transcription d’une élocution à partir de son enregistrement – fonctionnalité proposée par une importante quantité d’autres outils – mais permettant également sa publication sous la forme d’un site web autorisant une lecture multimodale et interactive. Ce projet a rapidement rencontré des contextes d’expérimentation constitués par l’environnement de cette recherche.
. À la suite de cette expérience, est né le projet de conjuguer le format graphique de mise en scène des entretiens adopté dans Enquête sur EME avec le logiciel – alors rudimentaire – de transcription bricolé pour l’occasion. Je me suis donc attelé à stabiliser une première version d’une interface permettant d’effectuer la transcription d’une élocution à partir de son enregistrement – fonctionnalité proposée par une importante quantité d’autres outils – mais permettant également sa publication sous la forme d’un site web autorisant une lecture multimodale et interactive. Ce projet a rapidement rencontré des contextes d’expérimentation constitués par l’environnement de cette recherche.Ainsi, à la suite de mon terrain, dans le cadre des activités du groupe de recherche Méthodes et outils numériques de la recherche en arts, design et esthétique (MONADE) de l’Université Rennes 2, j’ai été conduit à participer à l’animation du carnet de recherche éponyme, et à co-organiser avec Alexandre Dupont une séance de séminaire portant sur « Les pratiques de cartographie comme instruments heuristiques pour les humanités numériques »5 . J’ai dans ce contexte développé une première version relativement stable du logiciel que j’ai alors intitulé Dicto et dont j’ai été le premier utilisateur. Cette dernière permettait de transcrire manuellement une vidéo issue du web6 sous la forme d’une interface graphique déroulant un espace d’annotation correspondant au déroulement temporel du média 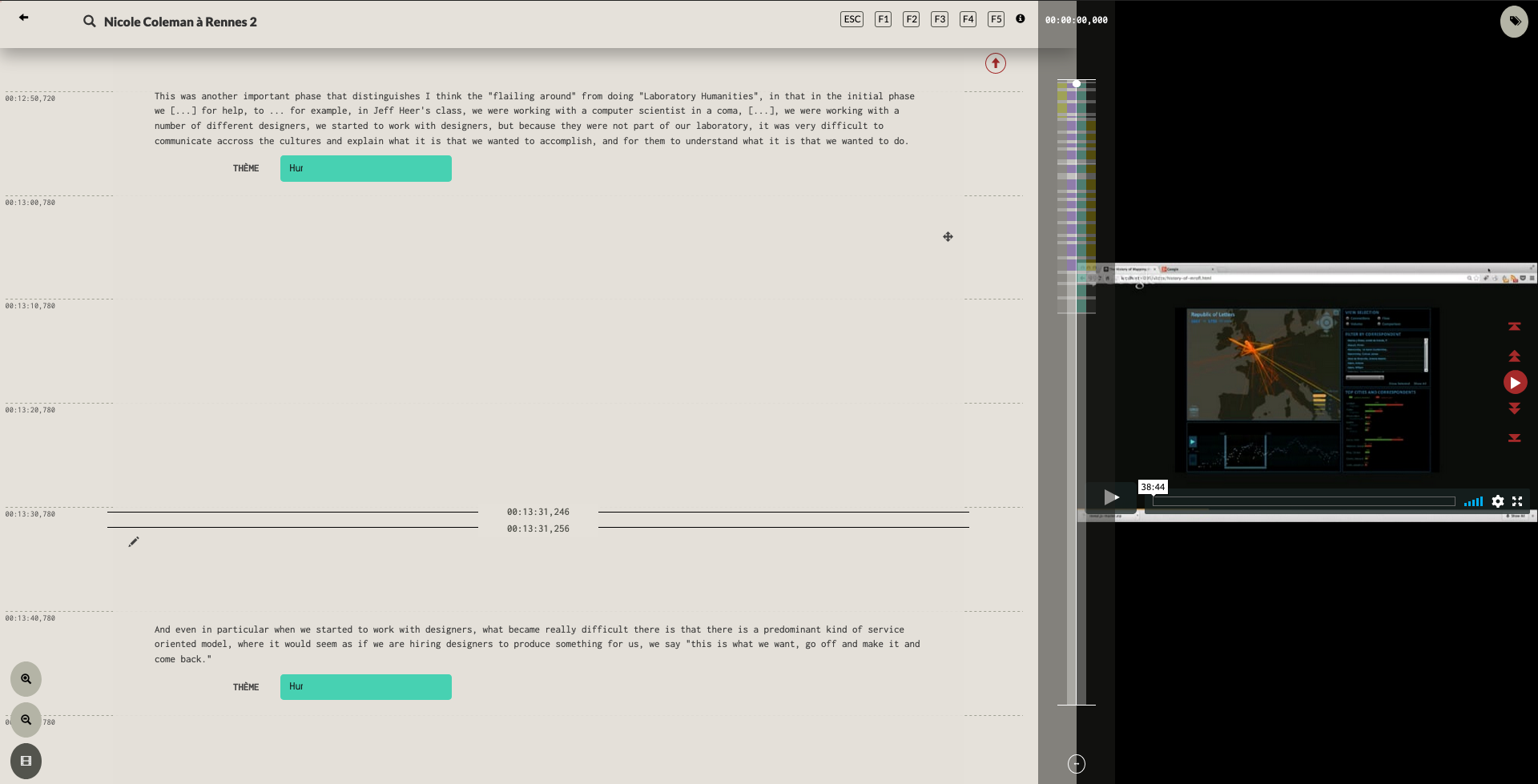 ; puis d’attacher une série d’étiquette aux différentes parties de transcriptions définies au moment de l’écriture
; puis d’attacher une série d’étiquette aux différentes parties de transcriptions définies au moment de l’écriture 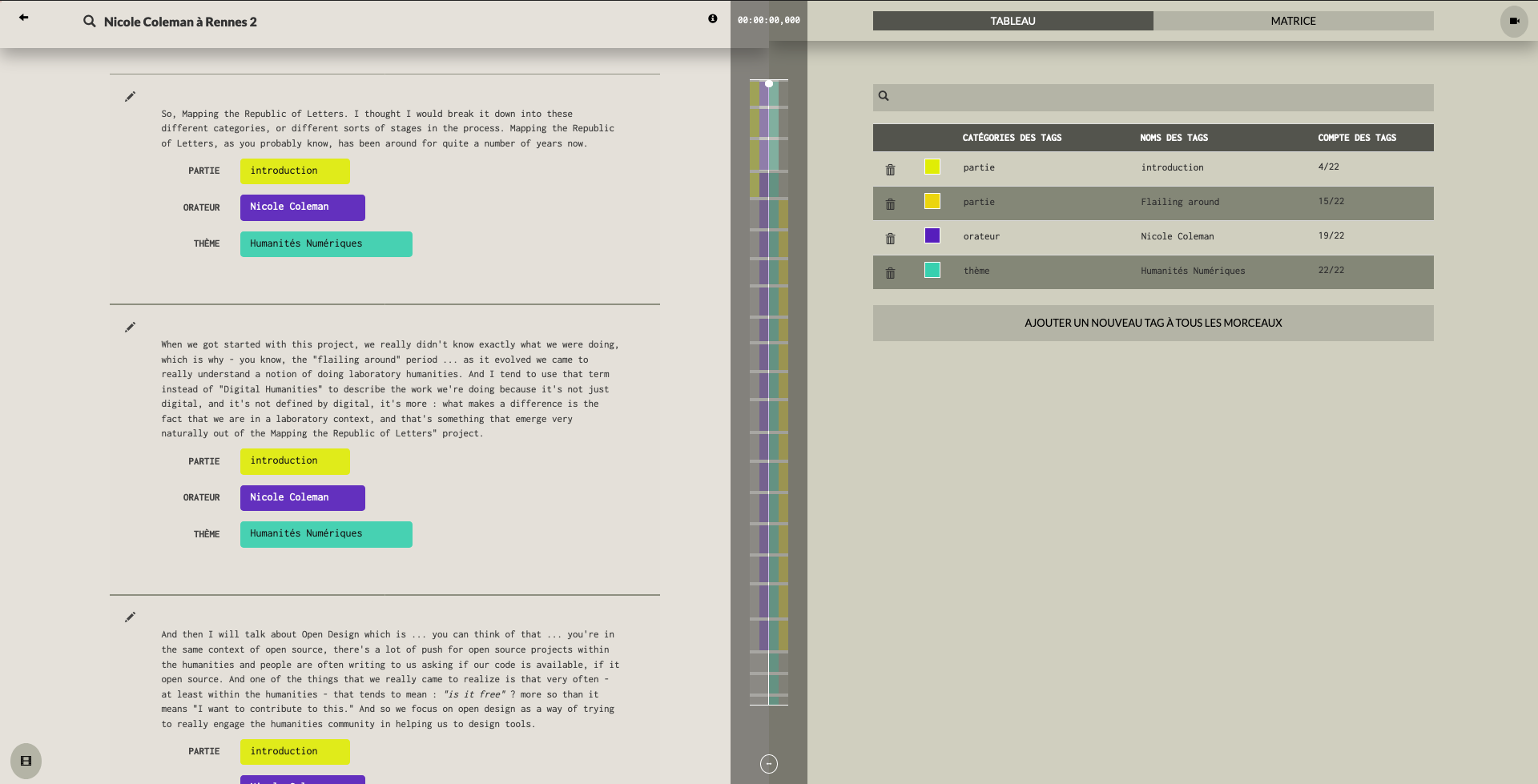 ; enfin de visualiser le résultat de ce travail sous forme d’un site web permettant de consulter conjointement vidéo, transcription et étiquettes apposées aux différents extraits.
; enfin de visualiser le résultat de ce travail sous forme d’un site web permettant de consulter conjointement vidéo, transcription et étiquettes apposées aux différents extraits.
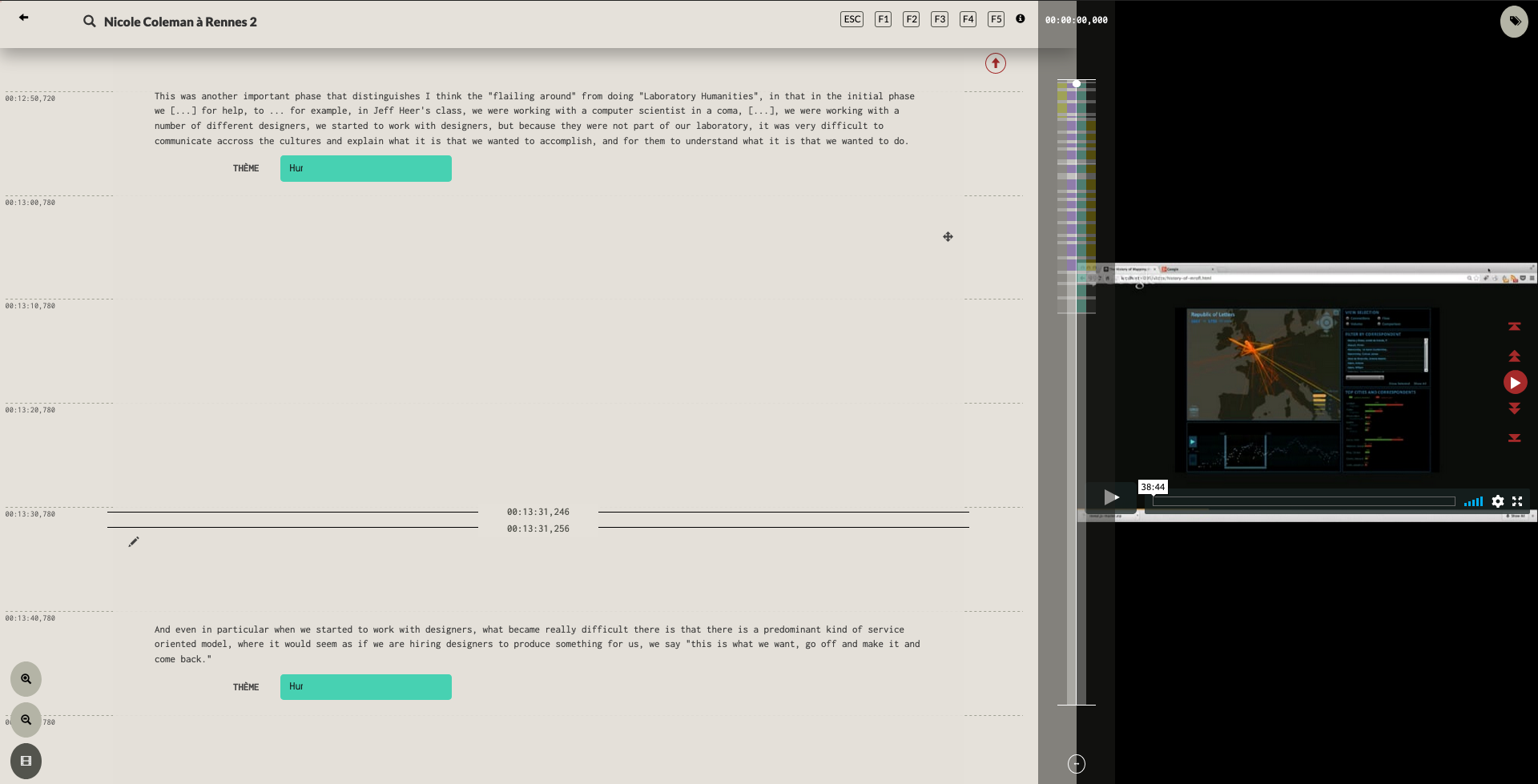 ; puis d’attacher une série d’étiquette aux différentes parties de transcriptions définies au moment de l’écriture
; puis d’attacher une série d’étiquette aux différentes parties de transcriptions définies au moment de l’écriture 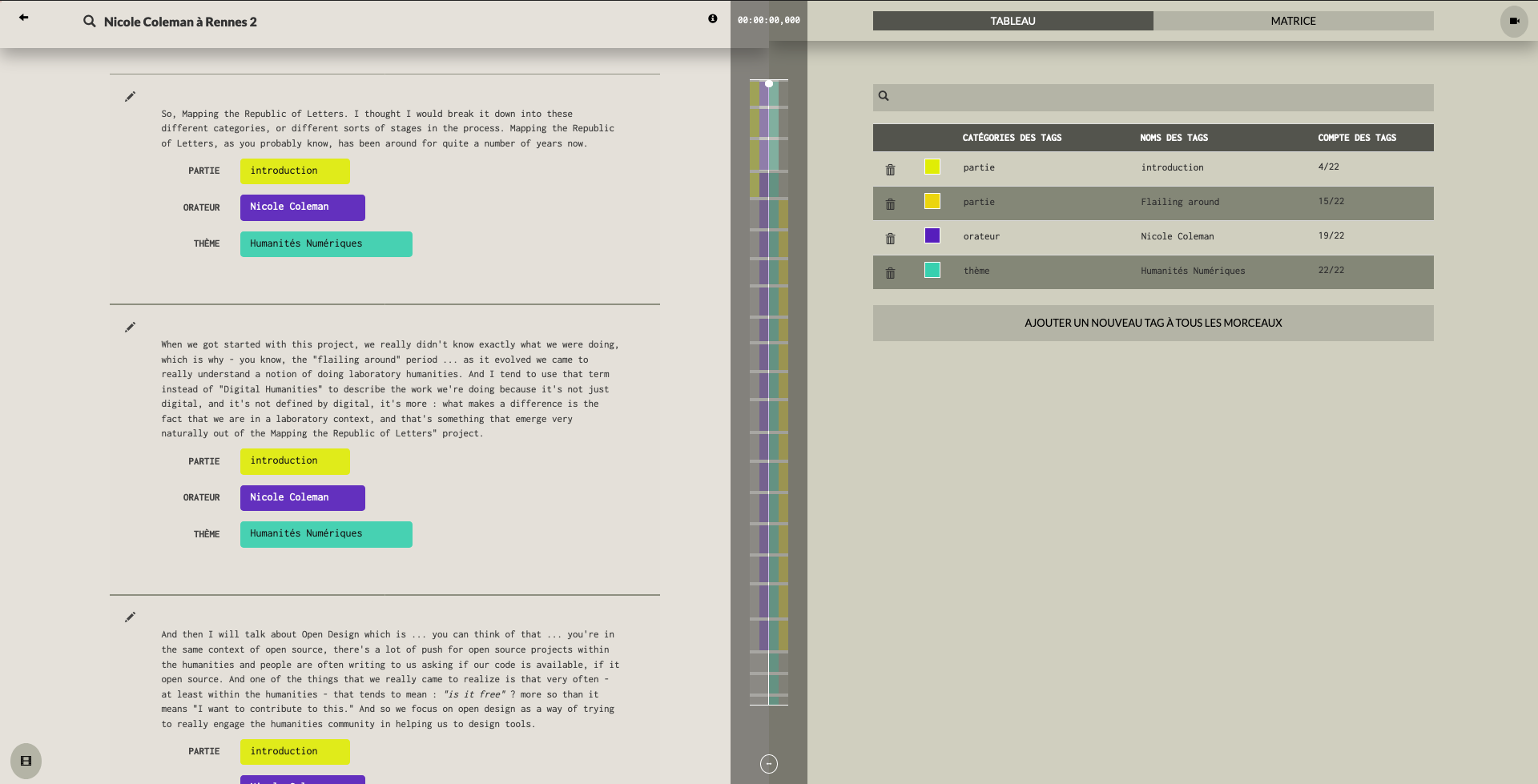 ; enfin de visualiser le résultat de ce travail sous forme d’un site web permettant de consulter conjointement vidéo, transcription et étiquettes apposées aux différents extraits.
; enfin de visualiser le résultat de ce travail sous forme d’un site web permettant de consulter conjointement vidéo, transcription et étiquettes apposées aux différents extraits.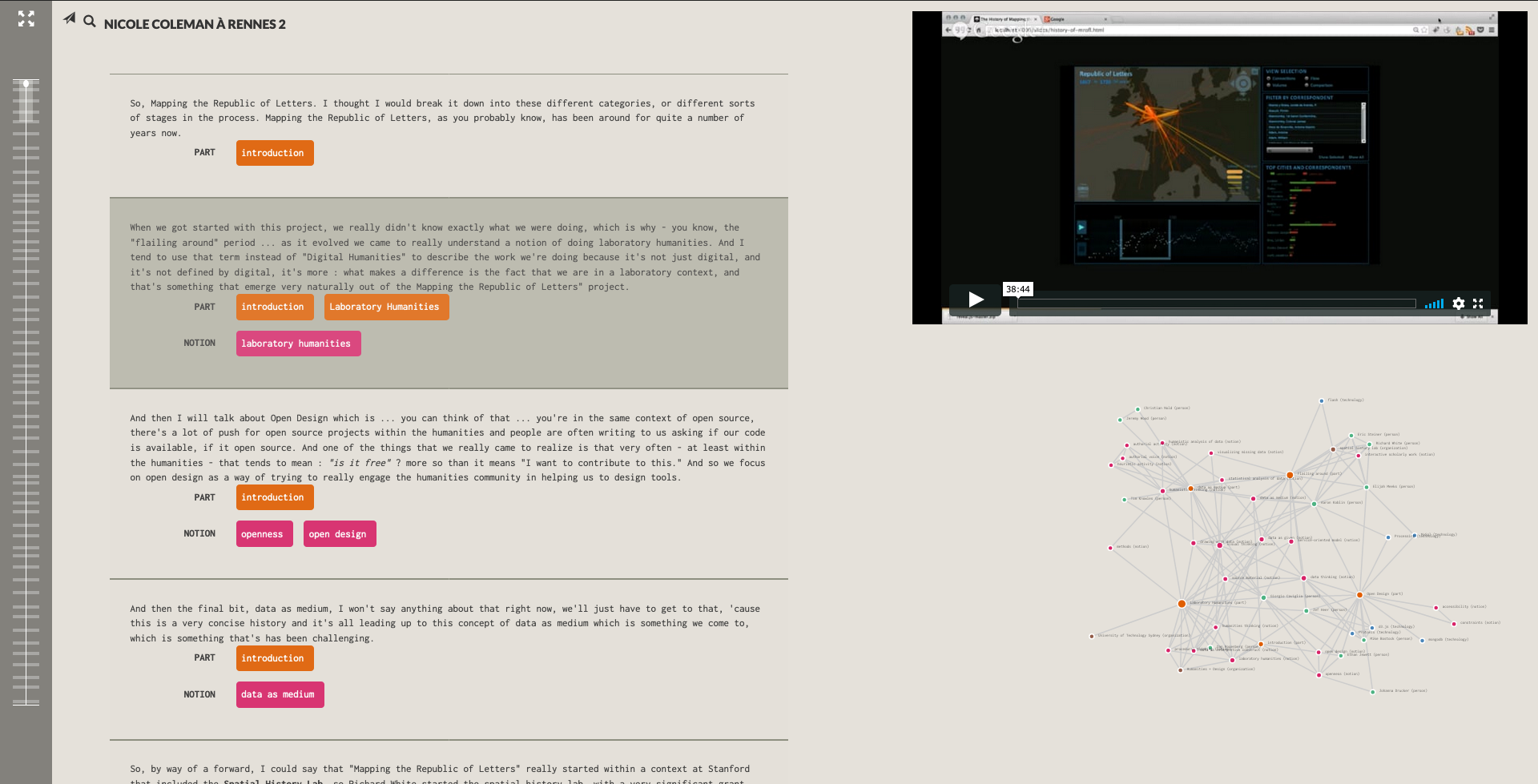
Cette version fut également l’occasion d’expérimenter différents modes de mise en forme de la relation entre médias audiovisuels et retranscription textuelle. Ainsi par exemple, à travers une interface de lecture affichant conjointement une vidéo, un transcript écrit interactif et un réseau constitué à partir des étiquettes attachées à chaque extrait du transcript, il s’agissait de permettre, au choix : un mode de lecture linéaire via le visionnage du média, une lecture en diagonale via le transcript ou encore des pratiques de visionnage sélectif en affichant uniquement les extraits associés à une étiquette particulière. D’autres modes de composition graphique furent en parallèle expérimentés7 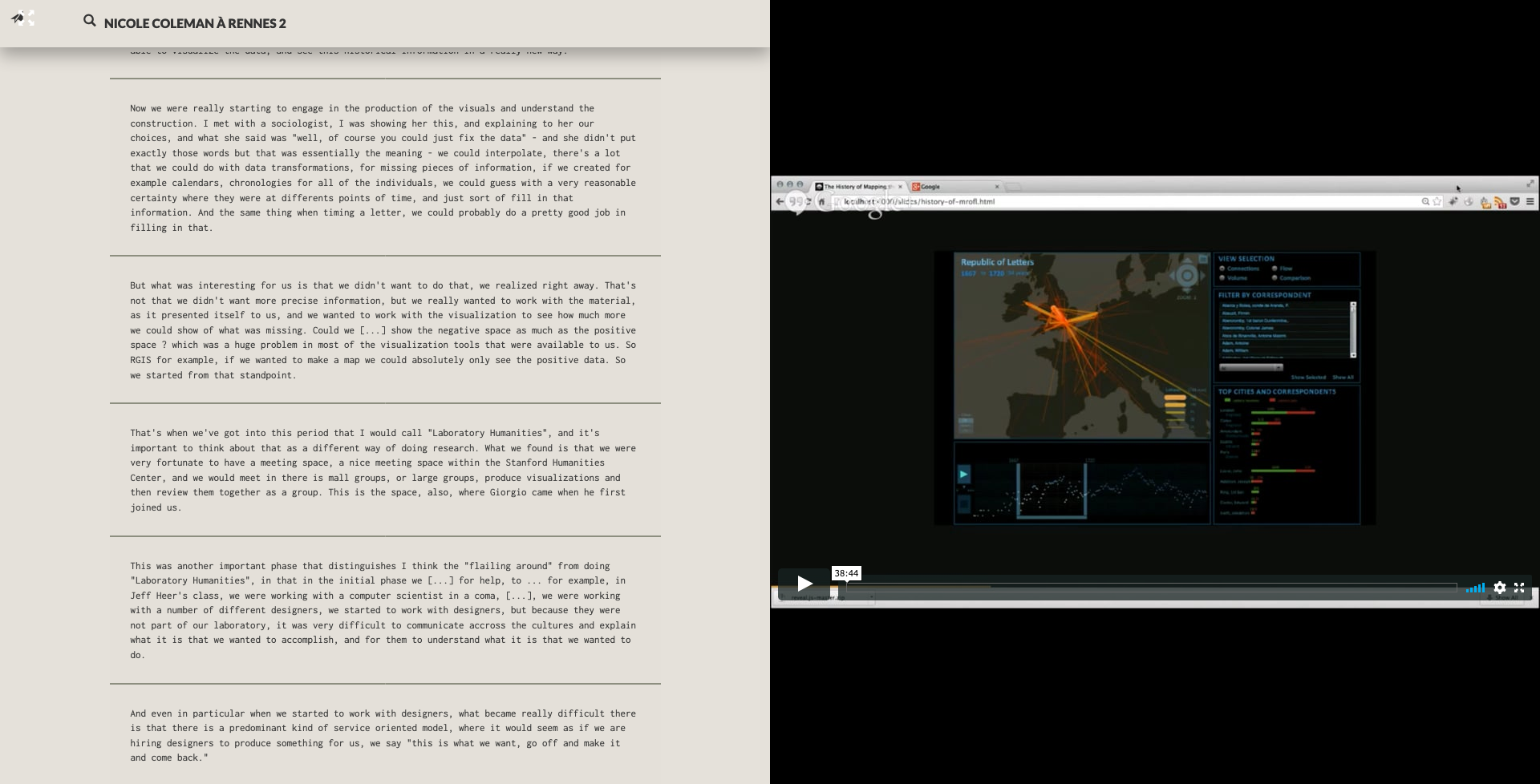
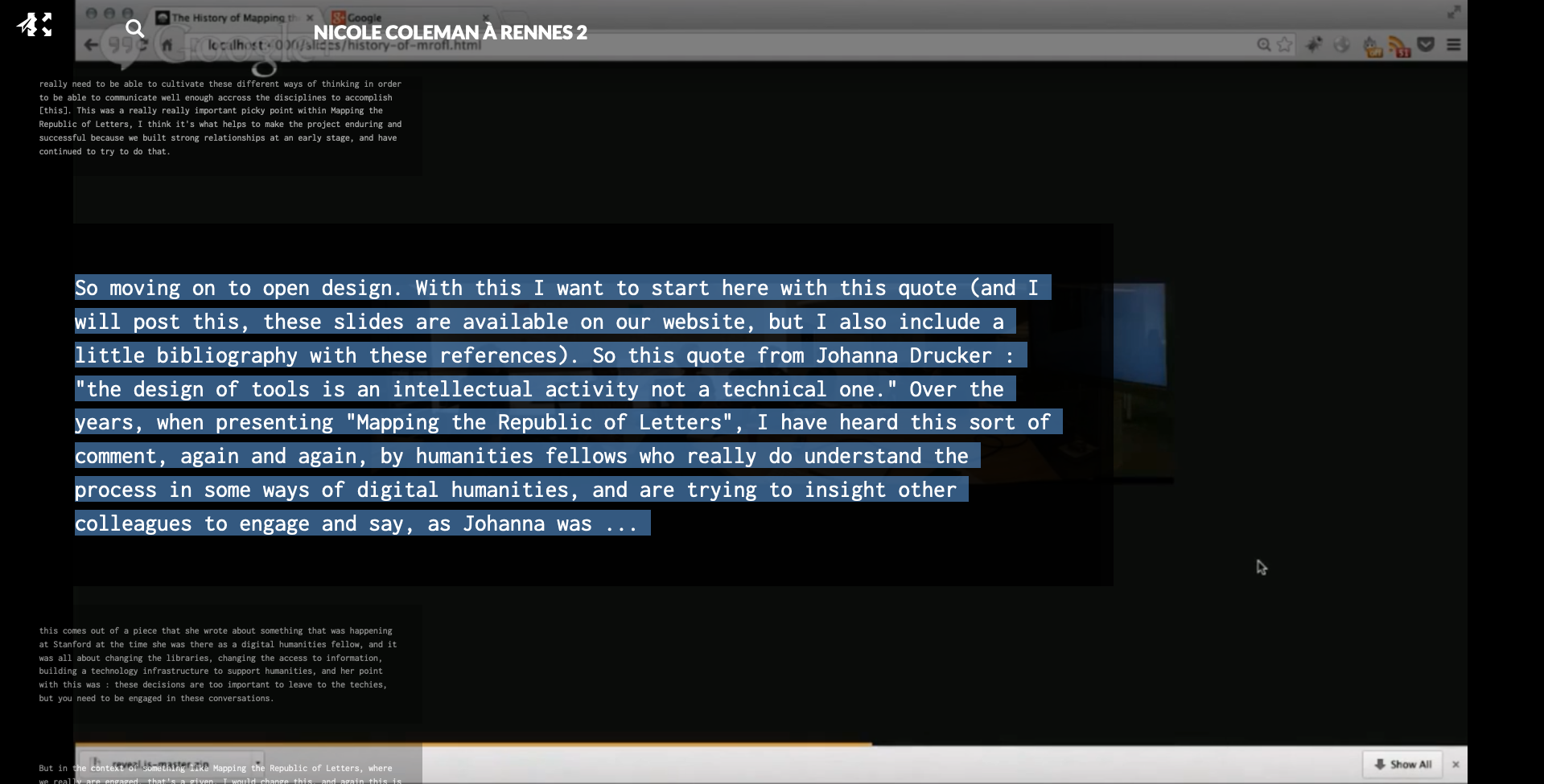 et discutés avec les membres de la communauté de recherche du groupe MONADE, notamment via le carnet de recherche en ligne «hypothèses » de ce dernier.
et discutés avec les membres de la communauté de recherche du groupe MONADE, notamment via le carnet de recherche en ligne «hypothèses » de ce dernier.
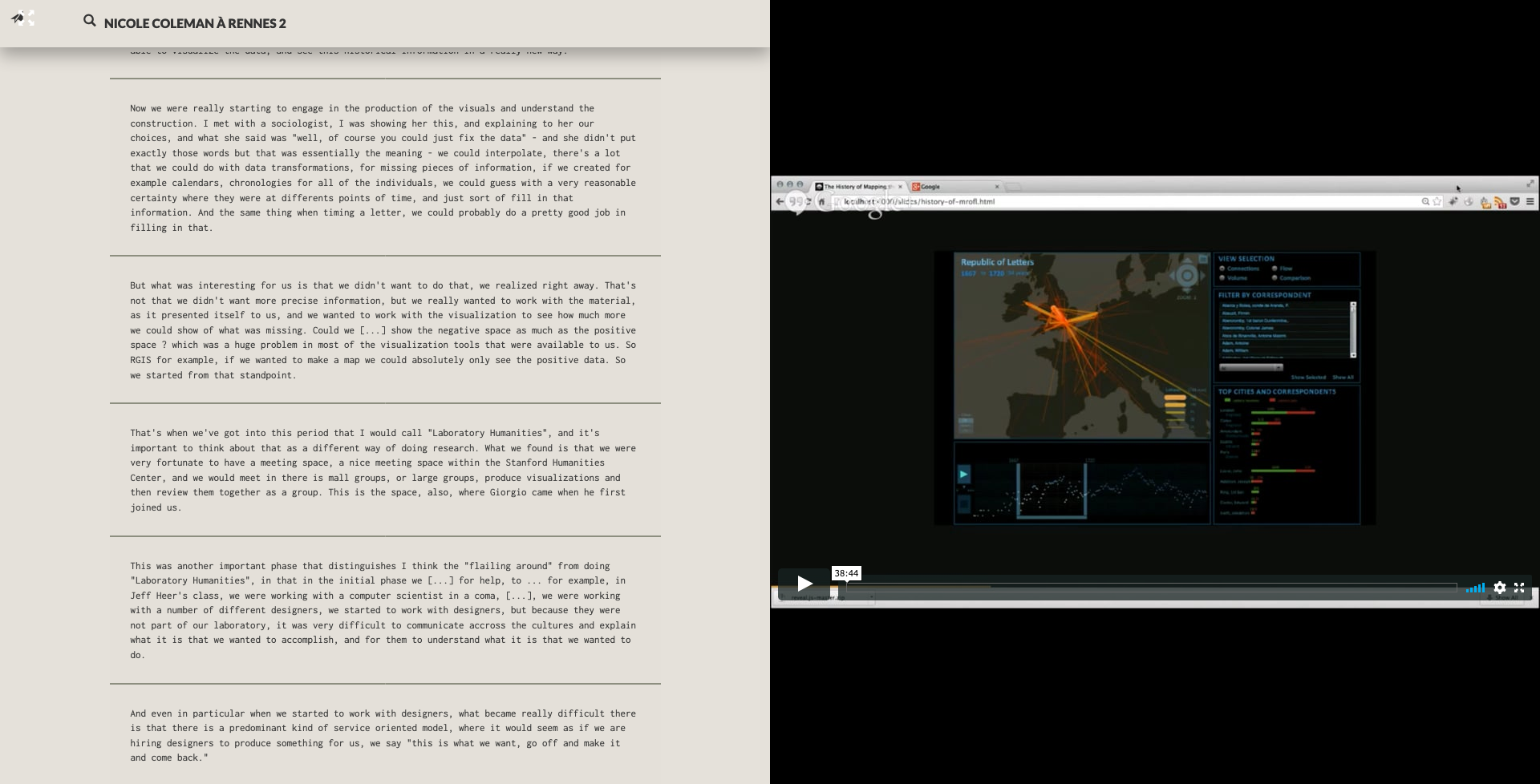
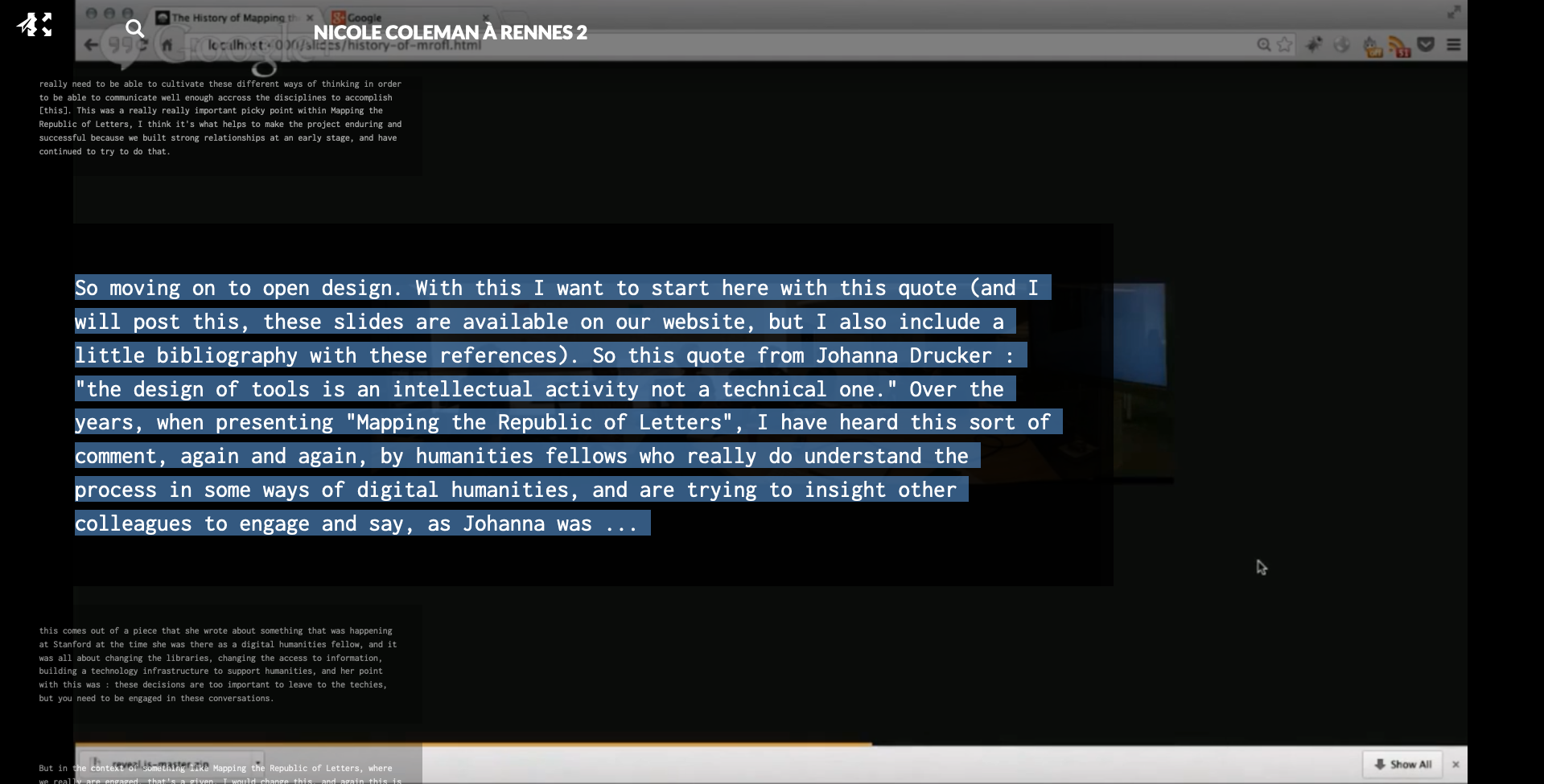 et discutés avec les membres de la communauté de recherche du groupe MONADE, notamment via le carnet de recherche en ligne «hypothèses » de ce dernier.
et discutés avec les membres de la communauté de recherche du groupe MONADE, notamment via le carnet de recherche en ligne «hypothèses » de ce dernier.À la suite des premières itérations de l’expérience Dicto, j’ai eu l’opportunité d’expérimenter son principe de fonctionnement dans le contexte de la mise en scène d’une démarche d’investigation artistique conduite par un collectif d’artistes et d’architectes. Ce « pas de côté » hors du champ strictement universitaire a permis de remettre en question certaines des fonctionnalités déjà expérimentées et de stabiliser le format de données impliqué par Dicto une première fois. Ainsi, le projet Anthropocene Observatory, mené par l’artiste Armin Linke, le duo d’architectes Territorial Agency (John Palmesino et Ann-Sofi Rönnskog) et le curateur Anselm Franke, a consisté à collecter en trois ans de vastes archives dʼimages, de vidéos et dʼenregistrements audio retraçant lʼémergence et lʼimpact du concept dʼAnthropocène sur les institutions politiques et scientifiques. Pour exploiter la richesse du matériel ainsi collecté, une plateforme dʼédition numérique et de publication a été conçue, dans la perspective d’une valorisation sous la double forme d’un site web et d’une exposition. Dans ce cadre, en collaboration avec Donato Ricci et le collectif de designers Calibro, nous avons alors collaboré à la réalisation d’un dispositif interactif exposé dans le cadre de l’exposition « GLOBALE : Exo Evolution »8 en Octobre 2015 au sein du Centre dʼart et de technologie des médias de Karlsruhe (ZKM).
Dans ce contexte, mes collaborateurs ont conçu une installation interactive destinée au public permettant aux visiteurs dʼexplorer les entretiens recueillis par l’Anthropocene Observatory au prisme des divers thèmes abordés dans ces derniers9 . Les visiteurs pouvaient interagir avec une visualisation projetée sur une table représentant les différents mots-clés associés aux matériaux sous la forme d’un nuage de mots, et, à lʼaide dʼune tablette, explorer les liens entre ces différents thèmes en créant puis en visionnant leurs propres listes de lecture personnalisées. Dans ce contexte, mon rôle a consisté à aménager Dicto pour qu’il soit mobilisé non pas comme un outil de production des dispositifs interactifs directement présentés aux visiteurs, mais plutôt comme un outil de préparation « en coulisse » destiné à être utilisé par l’équipe organisatrice de l’exposition. Il a dû également être modifié pour permettre aux autres designers du projet de disposer d’une source de données adaptées aux applications développées et de facilement modifier les matériaux en fonction de leur mise en scène, et vice versa. Dicto est ainsi devenu le « pivot » entre une diversité de collectifs collaborant à l’écriture de la double « publication » constituée par l’exposition et le site web.
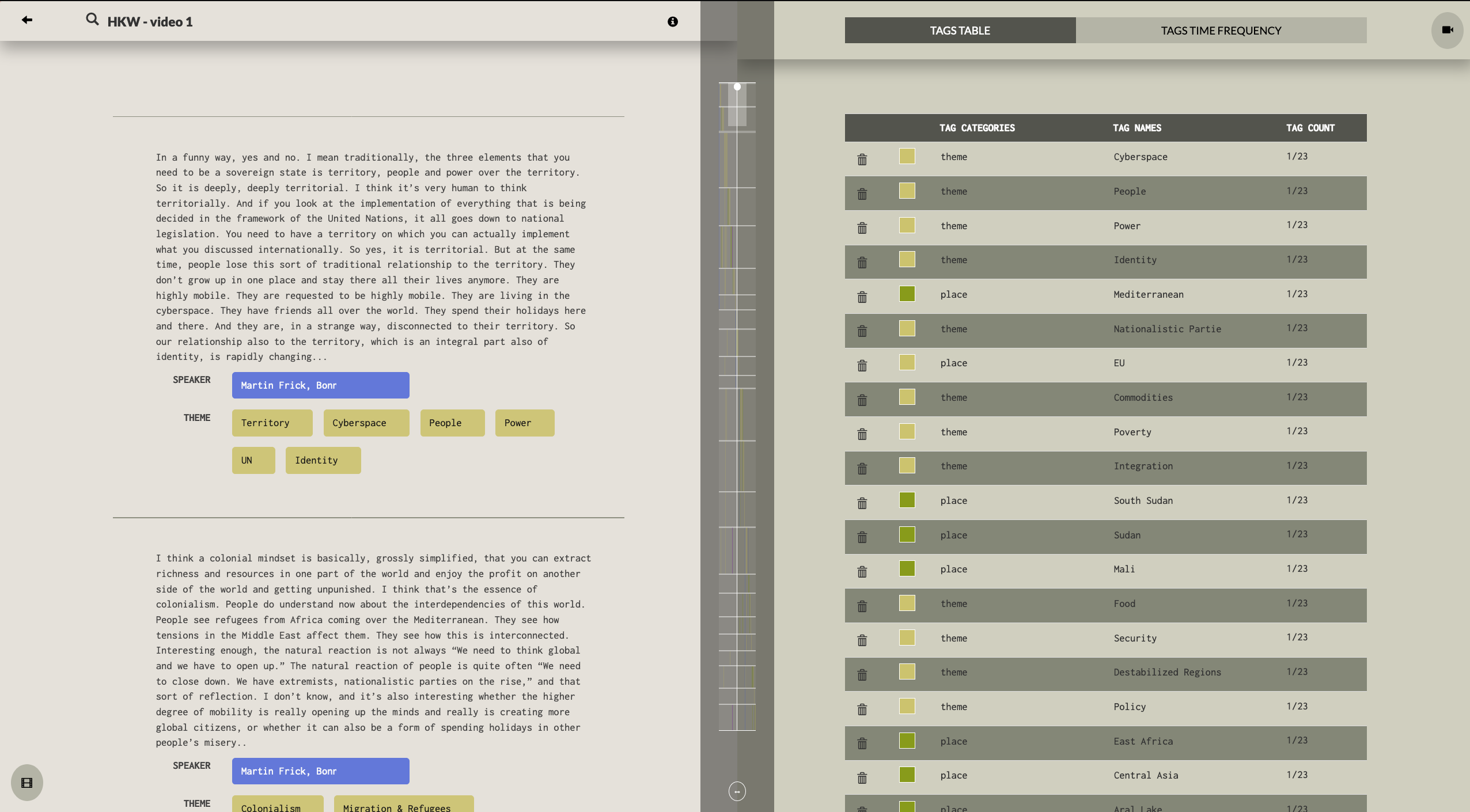
Dans ce contexte, les fonctionnalités d’étiquetage et de montage de l’outil ont été modifiées pour les besoins des personnes en charge de la retranscription et de l’étiquetage des vidéos, notamment en terme de visualisation et de gestion des étiquettes à l’échelle de plusieurs vidéos en même temps. L’expérience de collaboration avec les commissaires de l’exposition et les autres designers impliqués dans la fabrication de l’installation ont également conduit à stabiliser le modèle de données encodé dans le logiciel, dans la mesure où l’instance Dicto utilisée par les éditeurs a également fait office de serveur de données pour les développeurs de l’installation. Ce qui avait commencé comme une expérimentation a donc dû être formalisé et documenté techniquement afin de permettre la composition des formats de Dicto avec d’autres.
Dans le même temps, j’ai engagé une collaboration au long cours avec Antoine Delinotte et Laetitia Giorgino dans le cadre de la retranscription et de la publication des conférences et séances de séminaire du philosophe Pierre-Damien Huyghe. Après avoir traduit une série de transcriptions déjà réalisées avec d’autres outils par ces collaborateurs à l’occasion d’un travail de longue haleine, nous avons mis en place une instance spécifique qui a servi à la retranscription de nouveaux enregistrements et à l’étiquetage des différents extraits documentés. Là encore, le logiciel fut utilisé comme un outil d’écriture davantage que pour la production de documents-publications finis10 . Outre la dimension technique de repérage et de correction de bugs qu’a induite une telle collaboration, cette itération a également été l’occasion d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à cette instance par rapport aux versions préalablement expérimentées.
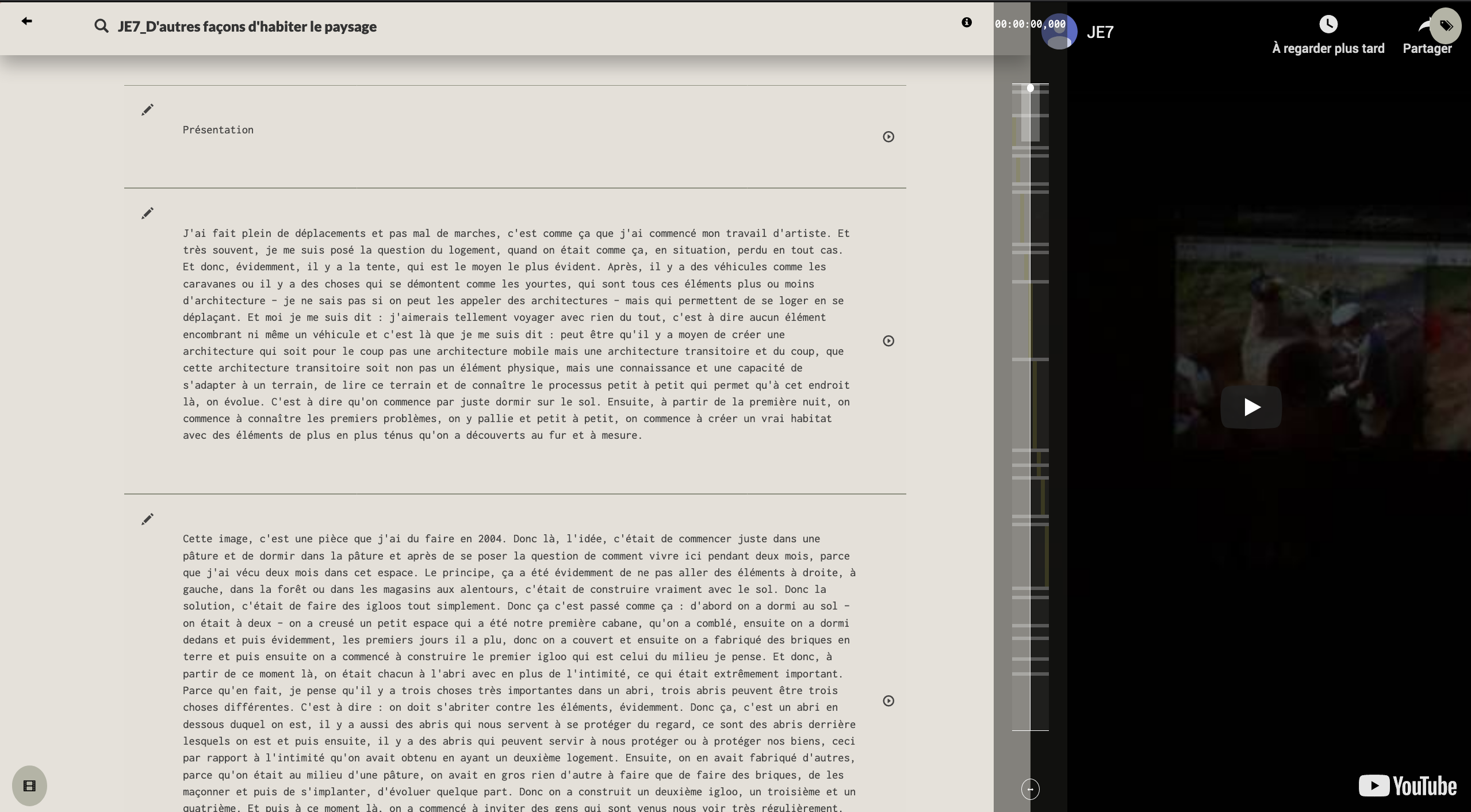
Ainsi, par exemple, l’ajout d’une vue panoptique fut développée pour autoriser la visualisation de l’ensemble des étiquettes apposées aux différents documents, et permettre la création de « compositions » assemblant différents extraits attachés à une étiquette particulière. Ces fonctionnalités de visualisation et de montage ont découlé à la fois des besoins spécifiques de cette situation, et des expérimentations réalisées à l’occasion de l’exposition au ZKM, traduisant la circulation et l’enrichissement mutuel des différentes versions permises par les multiples déclinaisons de Dicto au fil du temps.
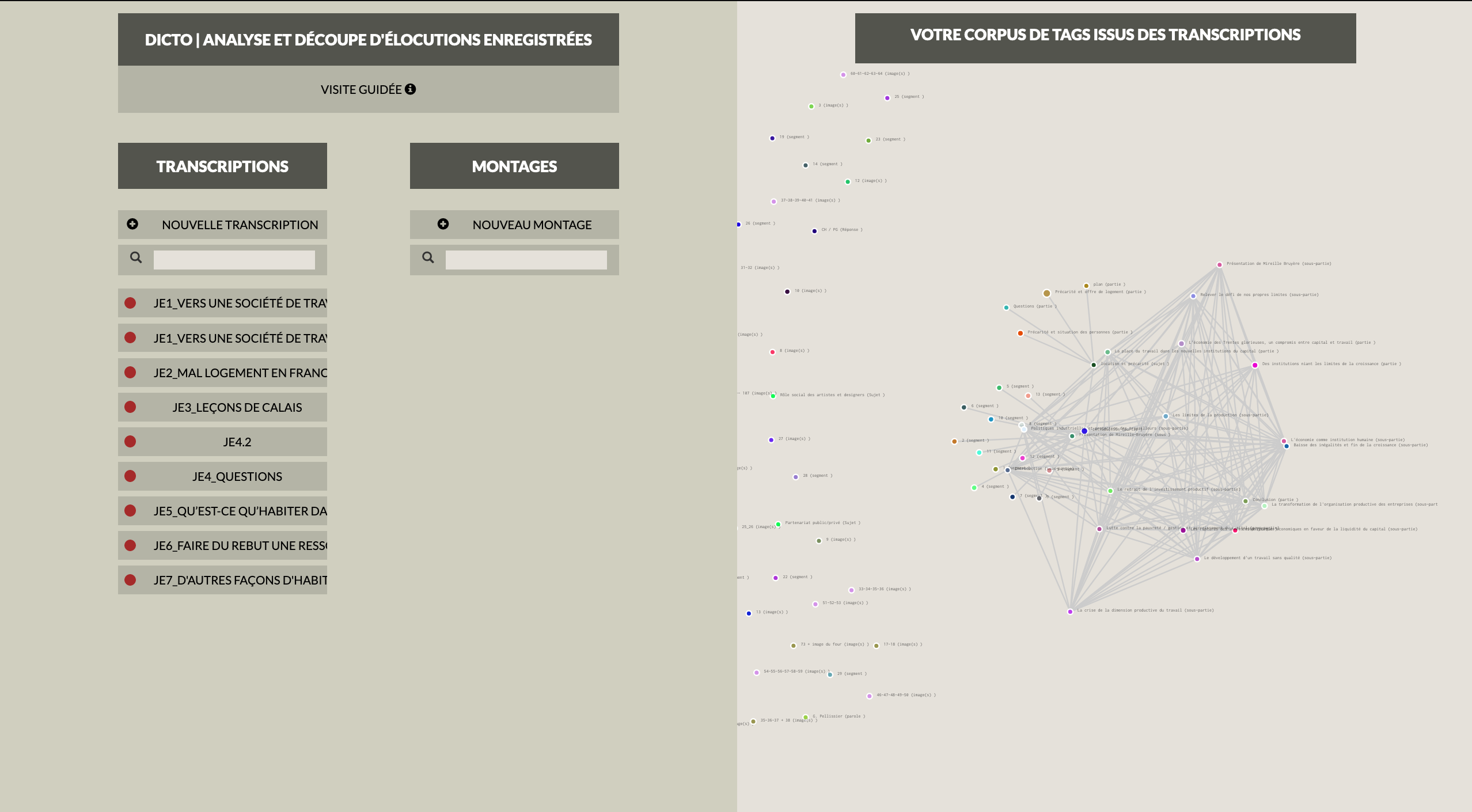
En ce sens, l’aller-retour entre les différentes versions de Dicto s’est accompagné de la multiplication des versions pour ces différents projets, et l’expérimentation de fonctionnalités distinctes selon les instances11 . Certains modules ont été développés et stabilisés de manière conjointe, alors que d’autres ont été conçus spécifiquement et utilisés dans une seule des versions.
Un an plus tard, une nouvelle situation s’est présentée quand il s’est agi pour un tandem d’étudiants danois12 conduisant un mémoire à propos de l’EME de conduire une série d’entretiens, les transcrire et les analyser. Leur approche des entretiens s’est inscrite dans un méthodologie d’étiquetage issue de la « théorie ancrée » qui consistait à labelliser librement les entretiens avant d’opérer une classification progressive et émergente (Laberge, 2012). L’aboutissement de leur travail étant la publication d’un mémoire de recherche imprimé, leur situation nécessitait par ailleurs d’exporter sous une forme écrite les transcripts réalisés et codés à partir de l’outil, pour les besoins de leurs annexes. Pour répondre à ce besoin, j’ai expérimenté une nouvelle bifurcation de l’outil intégrant de nouvelles fonctionnalités d’export, et de nouvelles vues qui autorisaient de naviguer dans les étiquettes et de les gérer de manière systématique. Une partie de ses modifications fut alors intégrée dans le code source de l’outil principal.
Parallèlement à ces différentes activités de collaboration13 , j’ai également utilisé l’outil pour des besoins de documentation personnelle dans le cadre de la thèse, notamment dans le contexte des études de cas présentées dans le chapitre 3 de ce texte. La publication de vidéos annotées sous la forme de visualisation des étiquettes autorisant à naviguer entre différentes thématiques ou disciplines – comme cela avait été expérimenté lors de l’exposition – une telle fonctionnalité fut développée pour utiliser Dicto afin de publier des bases de données d’extraits thématiques dans le cadre d’études de cas portant sur des dispositifs numériques tels que ceux présentés dans la revue Vectors.
À partir des différentes versions de Dicto et des multiples ajustements et modifications effectués en fonction des collaborations et des cas pratiques que j’ai rencontrés, j’ai finalement entrepris de stabiliser une version pérenne et destinée à un usage plus élargi. À l’occasion de ce travail de stabilisation technique et pratique, qui s’est avéré très long, certaines des expérimentations conduites précédemment n’ont pas été retenues, alors que d’autres ont été développées pour l’occasion. Techniquement, j’ai entrepris d’une part de stabiliser le format de données de Dicto à travers un formalisme standard14 , et d’autre part d’en développer une nouvelle version adaptée à une existence durable et économique en ressource : il s’est ainsi agi de développer un logiciel ne nécessitant pas l’usage d’un serveur15 , présentant des coûts d’entretien et de maintenance quasi nuls.
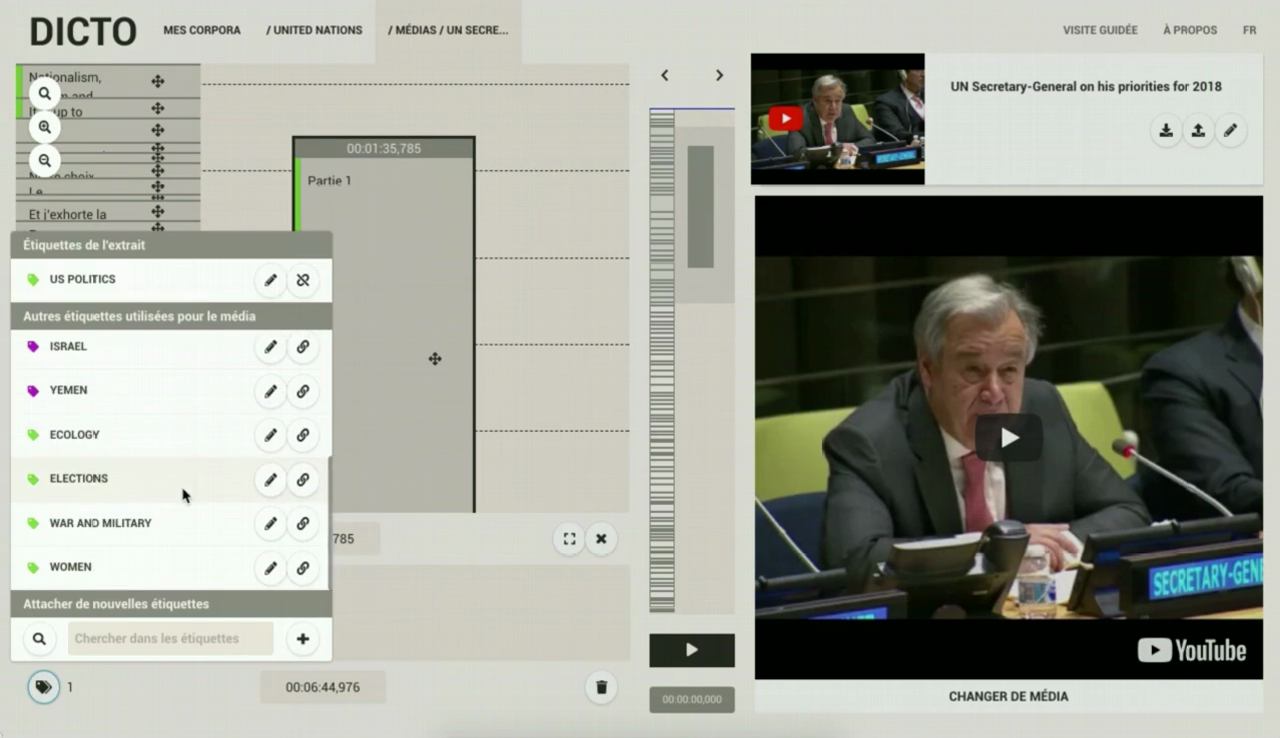
Accessible gratuitement sur le web sous la forme d’une application en ligne et d’une application de bureau16 et publié sous une licence libre autorisant d’en dériver le code source à nouveau, cette version stabilisée a ensuite été utilisée par une variété de chercheurs. Ainsi, à ma connaissance, Dicto s’est vu à ce jour mobilisé dans le cadre de recherches sur la prosodie17 , d’études cinématographiques, d’étude des débats parlementaires, et de documentation de conférences. Les pratiques et les appropriations de Dicto dans ces contextes m’échappent, et appartiennent désormais à leurs praticiens. Il s’agit maintenant de qualifier ce qui s’est précisément stabilisé dans le développement d’un tel logiciel en ligne.
Stabiliser un format d’écriture à travers un modèle de données
La conception de Dicto a conduit à la stabilisation d’un modèle de données permettant de décrire les types de documents mobilisés par le logiciel. Concevoir un tel modèle revenait alors à formaliser une grammaire d’objets et de relations, en dialogue constant avec les pratiques d’écriture et de lecture rencontrées dans les différentes situations précédemment décrites. Une telle entreprise a conduit à stabiliser l’articulation des différents formats impliqués par le logiciel pour en faire un format de publication.
Ainsi, dans ce modèle de données, les documents manipulés dans le cadre de Dicto sont intitulés corpora. Un corpus existe alors comme un « dossier » de travail attaché à une question ou une démarche particulière (par exemple, suivant les usages de l’outil : les médias attachées à un objet d’étude particulier, les enregistrements d’une série d’entretiens ou d’élocution, les documents attachés à un projet de publication spécifique, etc.).
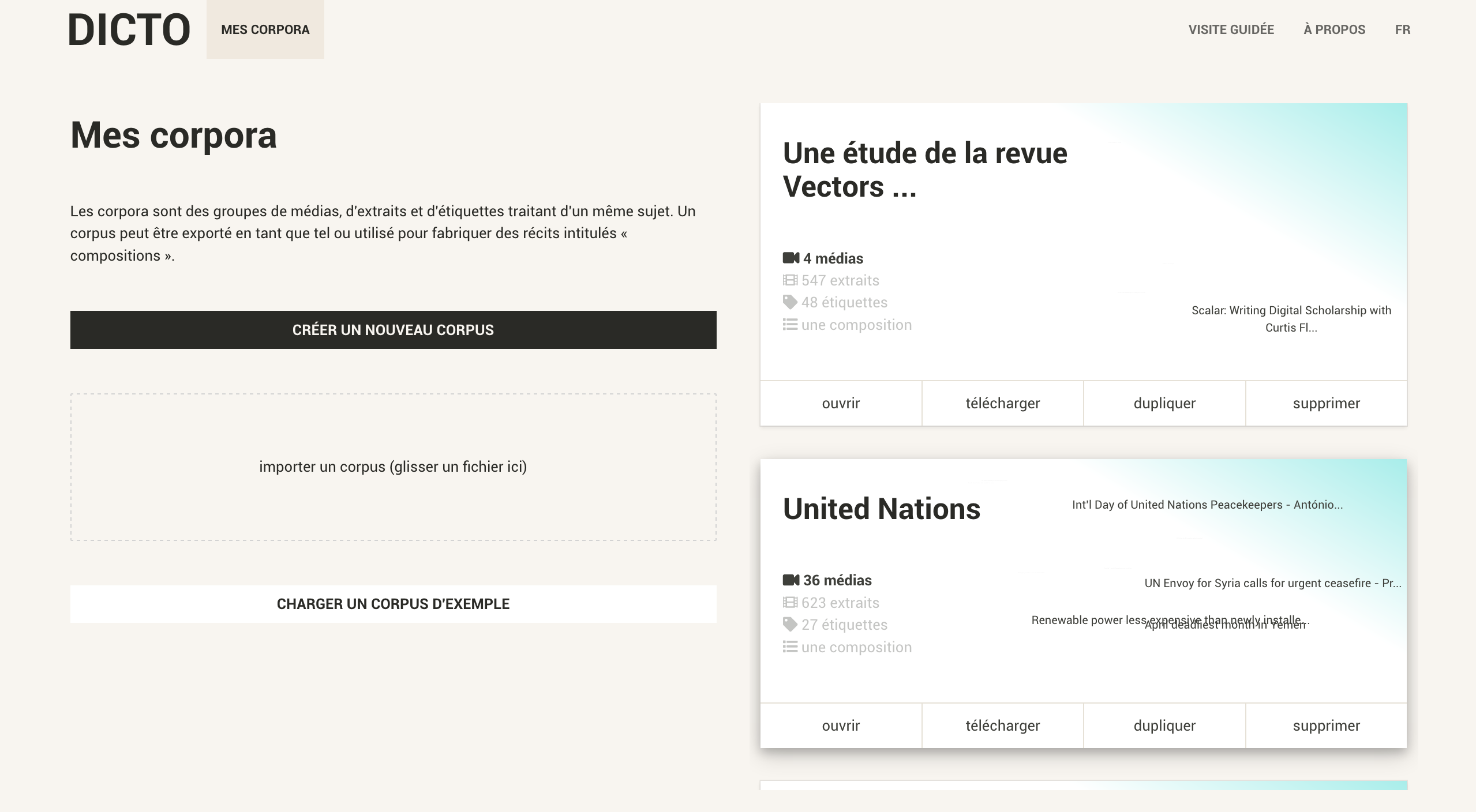
Un corpus est constitué de différents types d’éléments. Les médias représentent les vidéos et pistes audio manipulées dans le cadre du corpus (par exemple : série d’entretiens enregistrés, collection de courts-métrages, rushes issus d’un terrain), qu’elles soient en ligne ou téléchargées localement dans l’outil. Les extraits représentent des annotations apposées aux médias, et permettant d’attacher à des portions temporelles spécifiques de ces derniers un ensemble de contenus textuels. Par ailleurs, ces mêmes extraits peuvent être eux-mêmes annotés au moyen d’étiquettes, qui sont des marqueurs réutilisables à travers plusieurs médias et qui peuvent, suivant le type de pratique conduite avec l’outil, représenter des thématiques, des critères de classement ou de montage. Enfin, un corpus contient des compositions, qui sont des montages linéaires permettant d’assembler divers extraits de manière à produire des séquences linéaires publiables sous la forme de pages web.
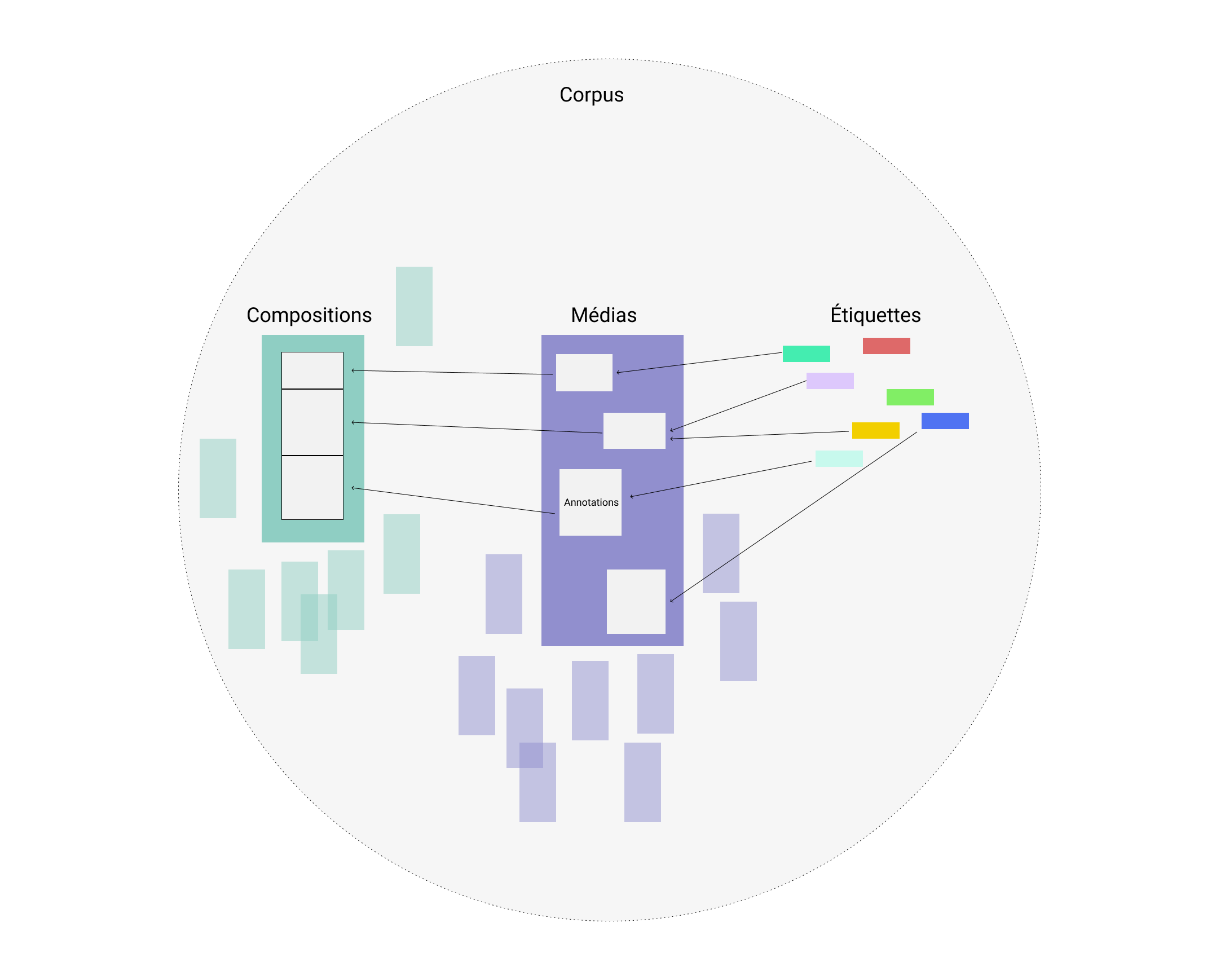
Dans la version stabilisée de Dicto, les extraits attachés à un média correspondent à des portions temporelles données, mais ils ne sont pas mutuellement exclusifs : la plage temporelle couverte par un extrait peut chevaucher ou englober celle d’un autre. Ce qui pourrait apparaître comme un détail, permet en fait de ne pas contraindre les pratiques à une logique séquentielle et/ou hiérarchique, et permet par la même occasion une diversité d’approches dans le découpage des extrait, comme par exemple des pratiques conjointes de transcription phrase à phrase, de chapitrage, de commentaire, de transition, etc. De la même manière, pour chaque extrait, il est possible de spécifier un nombre indéterminé de « facettes » permettant de les annoter selon plusieurs dimensions dont la définition est laissée à la discrétion des praticiens (par exemple, une facette pour la transcription et une autre pour son commentaire, des facettes organisées par axes d’analyse, par traductions, etc.). À partir de l’expérimentation visuelle initiale portant sur l’interface d’écriture et de publication des premières versions, Dicto a ainsi été l’objet d’une opération de généralisation apte à répondre à des pratiques diversifiées.
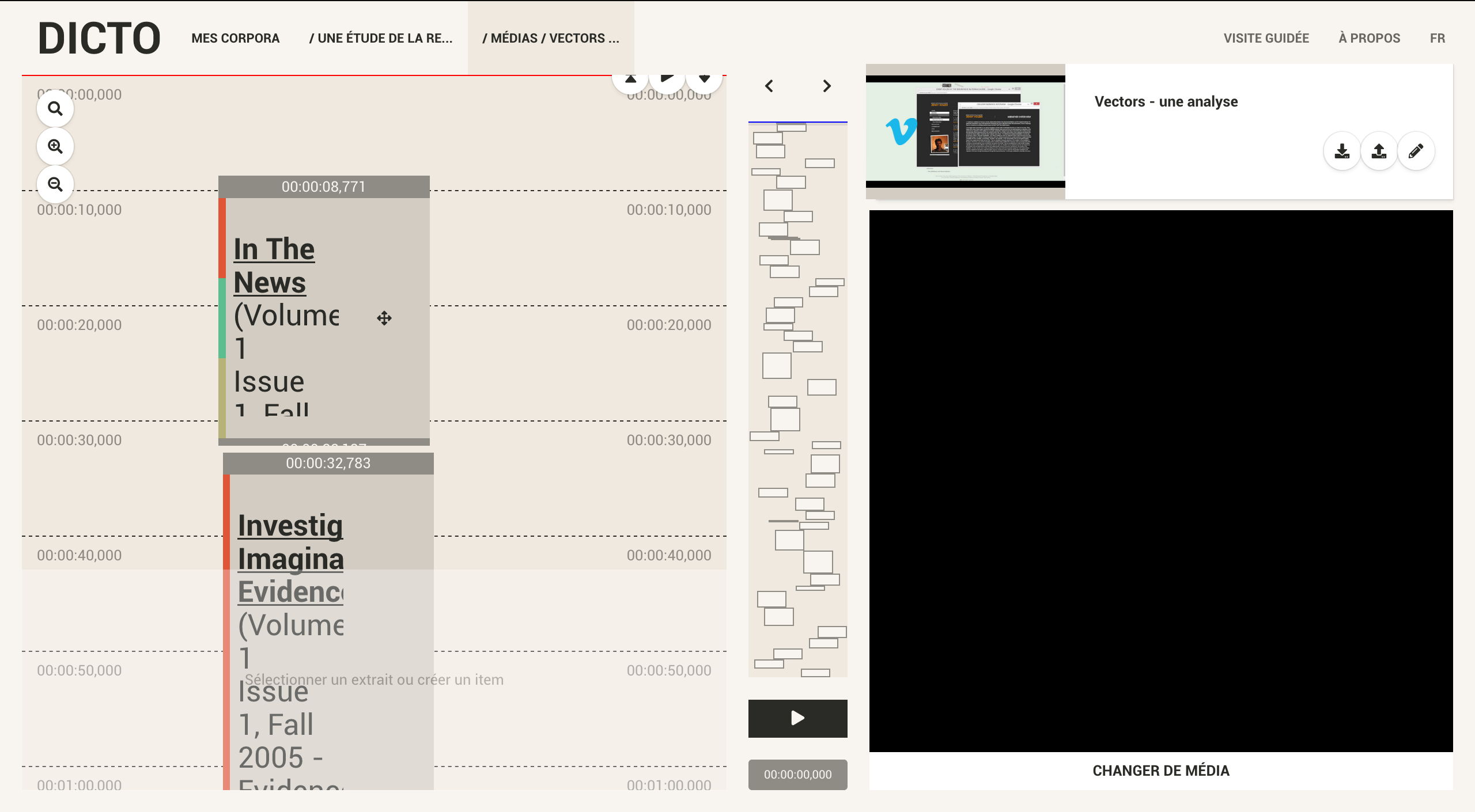
Par ailleurs, le logiciel est pensé comme un outil permettant de mettre en œuvre diverses pratiques de publication – dont une partie a été expérimentée en situation, et une autre relève de la proposition spéculative. Ainsi par exemple, les étiquettes d’un corpus peuvent être associées à des lieux et à des dates pour les besoins de l’analyse (et ainsi de télécharger le travail ainsi fait sous la forme de tableaux de données pouvant être retravaillés dans d’autres logiciels), mais également en vue de publier une pièce permettant de naviguer dans les extraits selon ces entrées spatiales ou temporelles.
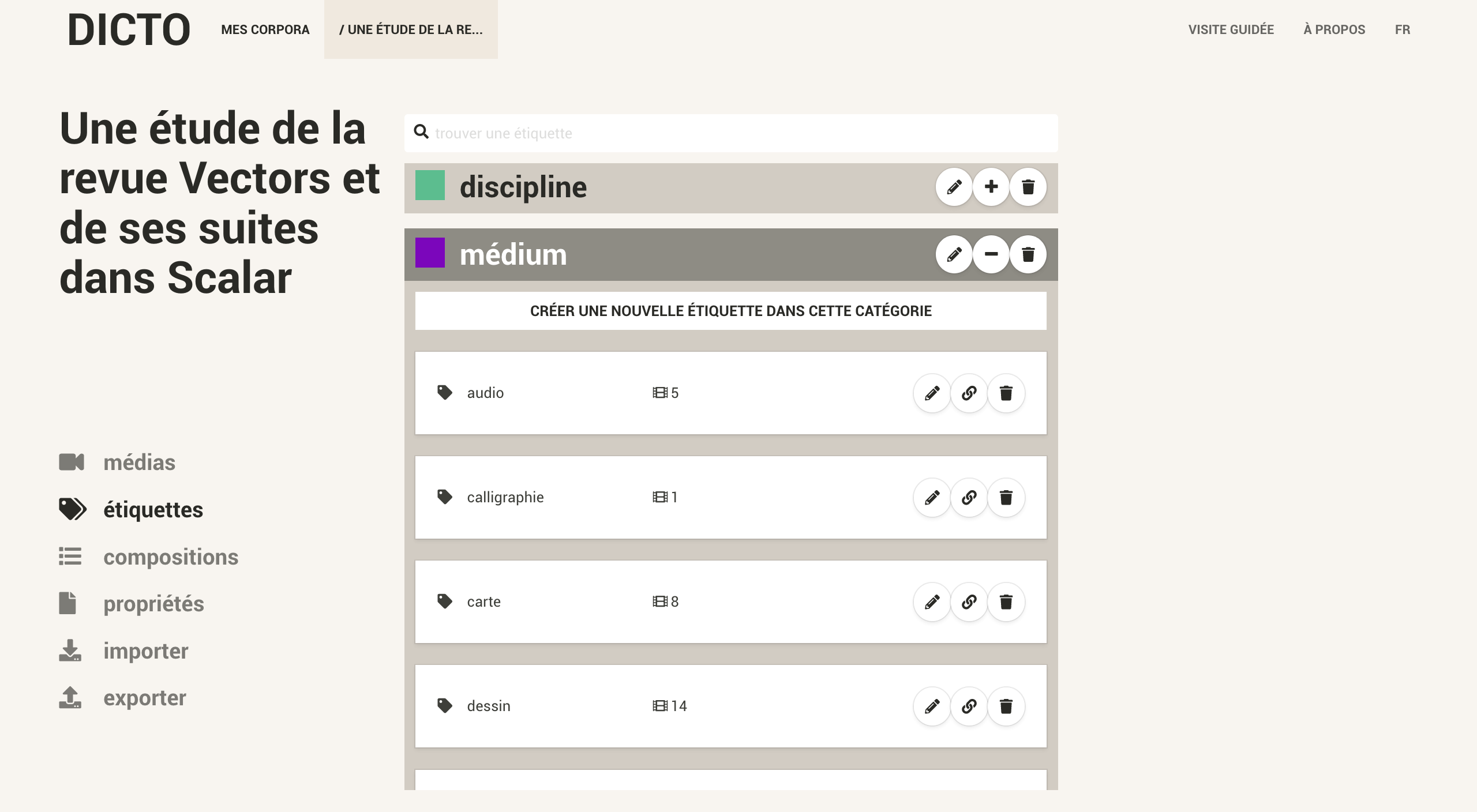
Sous la forme d’une publication web, il est alors possible de tirer parti des données géographiques ou temporelles associées à une étiquette pour offrir des représentations du corpus sous la forme d’une cartographie ou d’une frise chronologique. Ces représentations servent alors de « sommaire » pour l’appréhension des différents extraits enregistrés dans le document et permet aux lecteurs de visionner des montages réalisés à la volée correspondant à certains lieux ou certaines périodes historique. Ainsi, il s’est agi d’expérimenter différents de modes de mise en forme de la composition, orientés vers des stratégies de lecture multiples, tantôt à dominante séquentielle et tantôt orientées vers une navigation interactive.
.png)
De la même manière, le logiciel stabilisé permet de développer les pratiques de montage dynamique expérimentées dans les situations ultérieures. Ainsi, à travers ce qui a été dénommé des « compositions » dans l’interface, Dicto permet de construire des montages de plusieurs extraits d’un corpus auxquels peuvent être ajoutés, pour la publication, un ensemble de contenus complémentaires sous la forme de contenus riches18 , d’images ou d’hyperliens. Ce faisant, l’outil offre une plateforme pour la conduite d’expérimentations futures dans la publication de tels montages dynamiques et enrichis.
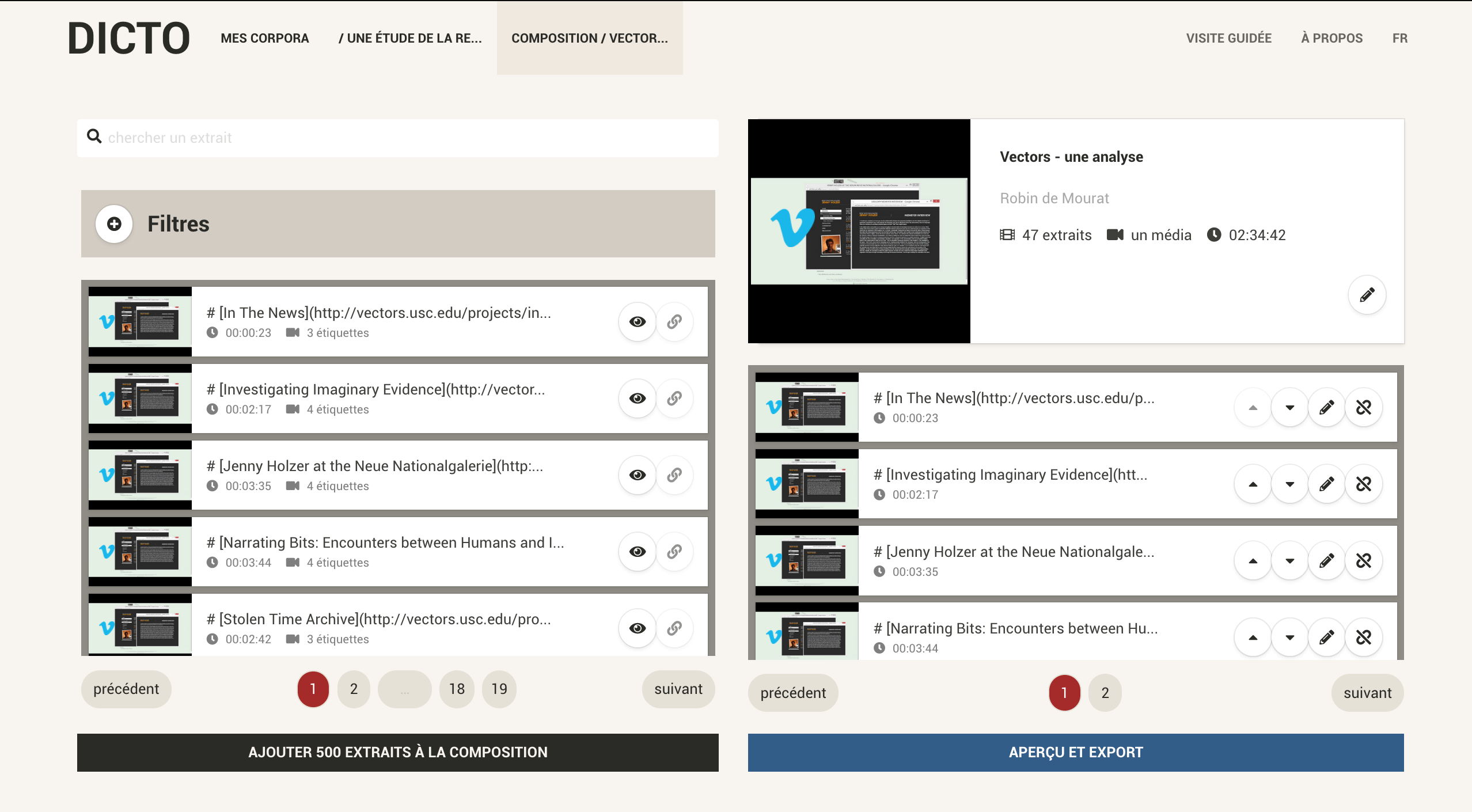

Enfin, le logiciel Dicto est stabilisé dans la mesure où il offre différentes fonctionnalités permettant d’intégrer son usage dans des chaînes de pratiques qui mobilisent d’autres outils et d’autres formats de données. En ce sens il offre une diversité de fonctionnalités d’export et d’import – au niveau des extraits associés à un média particulier, et au niveau du corpus entier – vers des formats standards et ouverts, qu’il s’agisse de permettre d’effectuer une mise en forme spécifique à partir d’un fichier html brut, de retraiter quantitativement les étiquettes ou les retranscriptions sous la forme d’un fichier de données tabulaire (format csv), ou encore d’interagir avec d’autres logiciels de transcription sous la forme de fichiers de sous-titres (format.srt).
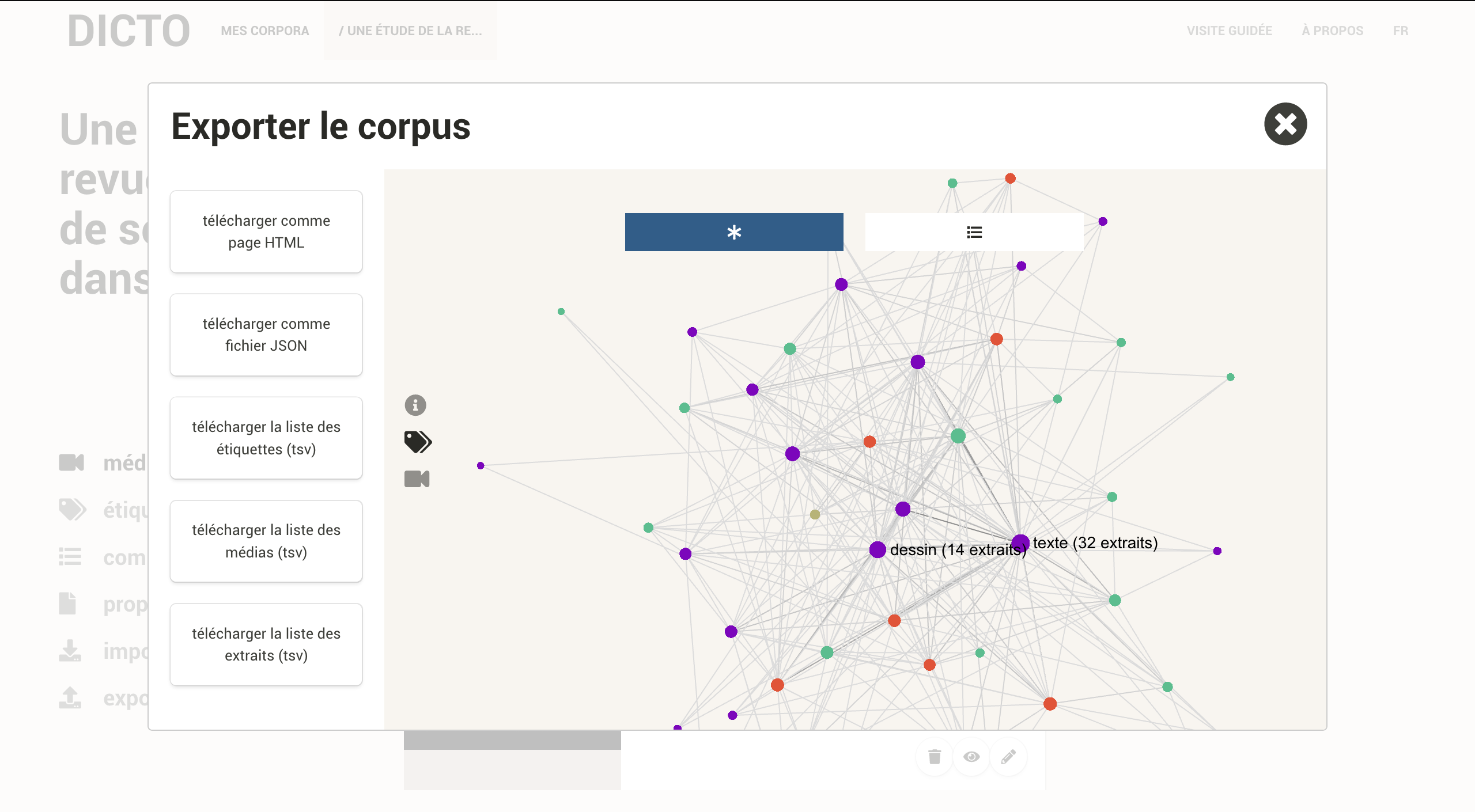
La stabilisation de Dicto a donc opéré autant comme l’affirmation de certaines qualités esthétiques, pratiques et techniques, que par la diversification de ses usages possibles. En ce sens, la version stabilisée de Dicto est destinée à au moins trois contextes d’utilisation complémentaires et distincts : d’une part, la pratique privée de l’analyse de transcriptions ou du commentaire de documents audiovisuels ; ensuite, la génération de pièces jointes numériques visant à faire office d’annexes ou de compléments donnant à lire les sources ou les données d’une publication établie selon un format conventionnel ; enfin, la publication de documents numériques autonomes, via le partage de sites web interactifs et la production et la circulation de « montages » dans les espaces scientifiques du web, tels que les blogs de recherche.
Le modèle de données de Dicto produit donc un format de travail et d’écriture à la fois très spécifique et très ouvert à diverses formes d’articulation. Cependant, ce format de travail, de part son caractère hybride et multiple, a fait autant œuvre de stabilisation de certaines méthodologies de travail que de désorientation des manières de faire, à commencer par les miennes. La trajectoire particulière qui a conditionné les caractéristiques de Dicto le place en effet à l’interface entre plusieurs genres de pratiques d’habitude pris en charge par des outils séparés. Ainsi, les logiciels d’analyse de données qualitative ou CAQDAS19 sont généralement dédiés à la transcription et à l’étiquetage des matériaux de recherche20 , alors que des logiciels de montage spécialisés distincts sont utilisés pour l’assemblage d’extraits21 . En ce sens, par son assemblage de pratiques idiosyncratique qui permet de passer de l’une à l’autre de ces activités à l’intérieur d’un même espace visuel et pratique, Dicto interroge la limite qui s’établit entre l’écriture qui vise à enquêter et l’écriture qui vise à publier.
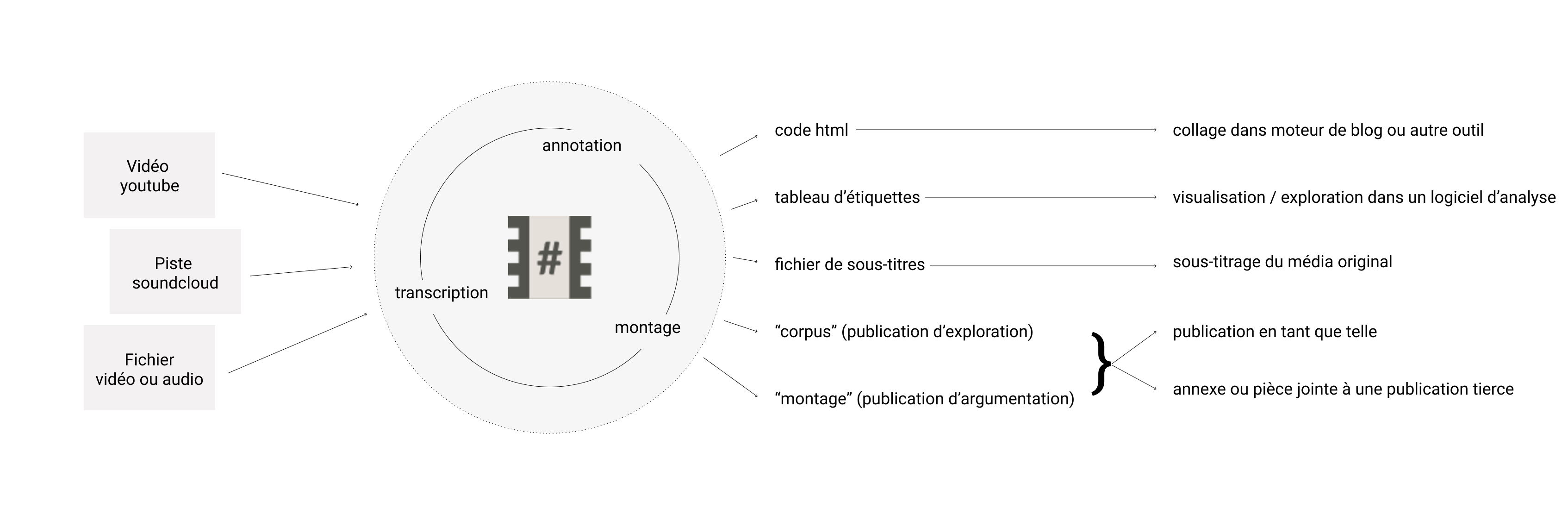
Dans la logique d’infrastructuration par le design qui sous-tend cette thèse, le code de Dicto est par ailleurs publié en ligne en licence libre (de Mourat, 2019) sous la forme d’une série de répertoires qui séparent l’outil logiciel, la description machinique de son schéma de données, et les différents gabarits de document-publication – pour les corpora, et pour les compositions – qu’il autorise. Cette mise à disposition technique permet à son tour des expérimentations ultérieures qui pourront reprendre cette expérimentation à partir de son logiciel stabilisé, de son modèle de données ou des formats éditoriaux qu’il propose.
D’un point de vue méthodologique, Dicto a donc évolué depuis des besoins de recherche qui étaient spécifiques à une phase de fabrication dans l’enquête au sein du projet EME jusqu’à la stabilisation d’un logiciel en ligne. À travers la situation de design ayant participé du développement de Dicto, les relations entre pratiques d’écriture, d’investigation et de mise en forme ont pu être explorées selon diverses formes de collaboration et d’articulation des pratiques. Ces articulations sont maintenant – temporairement – stabilisées dans un outil en ligne. J’ai néanmoins montré dans cette partie que ce mouvement ne se limite pas à la constitution d’une série « d’essais » et « d’ajouts » puis à leur systématisation sous la forme d’un « produit » final qui répondrait à une classe de problèmes identifiés sur le terrain. Certaines des expérimentations effectuées n’ont pas trouvé de stabilisation parce qu’elles ne prenaient leur sens que dans l’articulation spécifique de compétences, de matériaux et d’outils techniques dans lesquelles elles étaient situées. De plus, certaines des caractéristiques du « Dicto stabilisé » ont été développées dans une pure logique d’expérimentation qui entend le logiciel comme une plateforme pour des expérimentations ultérieures.
Parallèlement à la trajectoire de Dicto, j’ai engagé une autre série d’expérimentations de plus grande envergure à partir de mon expérience de terrain sur l’EME. Cette dernière portait non seulement sur la mobilisation de documents audio-visuels dans la publication, mais également sur une variété d’autres matériaux – données quantitatives, images, références d’ouvrages, pièces numériques. Il s’agissait par ailleurs d’interroger le rôle des stratégies de publication dans le contexte d’éditiorialisation et de diversité des supports qui caractérisent les espaces contemporains de la publication. J’ai ainsi conduit une deuxième série de dérivations, qui a abouti à la réalisation de plusieurs logiciels d’écriture, d’édition et de design. Il s’agit maintenant d’en reconstituer les développements.
Pratiques de développement pour une publication-comme-enquête
Transposer et recontextualiser un format expérimental : le cas de « Open AIME, a speculative workshop »
À la suite du terrain d’observation participante que j’ai conduit dans l’Enquête sur les Modes d’Existence, j’ai tenté de rendre davantage accessible le type de techniques de recherche observées dans les multiples jeux de traductions opérés par le projet : des stratégies de publication multiples et polymorphiques ancrées dans une relation très intime aux matériaux de recherche. En ce sens, dans les mois suivant la fin officielle du projet AIME, s’est tenu les 11 et 12 Juin 2015 un workshop intitulé « Open AIME : a speculative workshop » (Leclercq et al., 2015) que j’ai co-organisé avec Daniele Guido, Donato Ricci & Christophe Leclercq. L’objet de ce workshop était d’éprouver les possibilités de traduction de certains des éléments du projet en direction de nouvelles démarches de recherche en cours ou à venir.
Les objectifs d’une telle initiative étaient multiples. D’un point de vue stratégique et technique, il s’agissait de « capitaliser » sur les investissements techniques, financiers et humains impliqués par l’EME en les mobilisant dans de nouvelles collaborations et recherches pour d’autres acteurs – notamment dans une logique de retour sur investissement fortement sollicitée par le financeur européen. D’un point de vue politique et éthique, il s’agissait également pour l’équipe de revenir sur la question de « l’ouverture » au centre des discussions à propos du projet. Après avoir expérimenté les divers degrés d’ouverture impliqués par le partage du code source de la plateforme, et de l’accueil d’un public de participants élargi et multidisciplinaire, nous voulions tenter d’ouvrir le format de l’EME en tant que telle en prélevant des portions de son infrastructure singulière pour les recontextualiser dans d’autres situations de recherche. Enfin, du point de vue de cette recherche, il s’agissait d’expérimenter la mesure dans laquelle les formats d’écriture, de lecture et d’enquête produits par le projet spécifique de l’EME pouvaient être à leur tour dérivés pour d’autres enquêtes et d’autres projets éditoriaux, et quels problèmes pouvaient être posés lors de telles opérations.
Le workshop « Open AIME » a consisté à réunir des individus aux compétences et aux provenances scientifiques variées, que l’on pourrait distinguer selon deux groupes. D’une part, nous avions invité une série d’acteurs ayant été impliqués dans la construction – ou l’analyse – de l’infrastructure technique et méthodologie de l’EME : ingénieurs, designers, contributeurs impliqués, et étudiants ayant produit des analyses de la plateforme numérique. D’autre part, nous avions réuni trois équipes de chercheurs rencontrés selon diverses modalités et intéressés à la réutilisation de l’infrastructure l’EME pour leur propre compte. Après avoir conçu en amont des esquisses de projets allant en ce sens, nous avons réalisé qu’une telle opération pouvait impliquer des dimensions diverses qui pouvaient tantôt – et parfois simultanément – mobiliser des aspects philosophiques, méthodologiques, esthétiques ou techniques. Les trois situations de recherche au centre d’Open AIME ont alors constitué trois situations de dérivations différentes du point de vue des méthodes et des opérations qu’elles impliquaient.
Ainsi, Cristina Aus Der Au, théologienne et philosophe à l’Université de Zurich, s’est présentée au workshop parisien avec un projet en gestation visant à retracer l’histoire de l’église réformée suisse. Elle s’est rapprochée de l’équipe du projet avant tout pour explorer les possibilités de développement d’une écriture collective d’un ouvrage théologique. Les raisons qui la motivaient à formuler un tel projet étaient doubles : d’une part, pour des motifs méthodologiques, les sources et les informateurs associés à son enquête étaient éparpillés et difficiles à collecter et elle désirait mettre en place une technique de collecte faisant usage du web ; d’autre part, pour des raisons méthodologiques et théologiques, parce que la dimension distribuée et démocratique de l’histoire de l’église réformée suisse lui semblait nécessiter un format d’écriture collective cohérent avec les qualités de l’objet d’étude en question :
Le défi, maintenant, consiste à écrire une ecclésiologie qui reflète de manière sympathique mais aussi critique sa propre provenance, tout en étant capable dʼincorporer, mieux encore : de manifester les caractéristiques mentionnées ci-dessus. Cette ecclésiologie ne doit donc pas être directive mais doit être participative et démocratique sans être arbitraire ; elle doit montrer quelque chose de ce processus de dialogue et de controverse en cours et jamais achevé[…].22
Il est par ailleurs intéressant de noter que, dans ce cas au moins, la reprise du format EME n’était pas indifférente au projet philosophique et aux thématiques de l’EME en tant que telle. Ainsi, le projet de Cristina Aus Der Au ne formulait pas que des analogies méthodologiques et structurelles avec l’EME, mais également plus rattachées au contenu et au projet initial de Latour, notamment sur le rapport à la parole :
Elle nʼest pas seulement un outil et une structure qui aime se présenter comme le modèle parfait. Cʼest aussi dans son contenu que jʼai trouvé une analogie […]. Je commencerais donc aussi par des « croisements » – ces valeurs et concepts clés, qui peuvent être abordés par différents chemins, en essayant dʼatteindre une pluralité qui soit aussi englobante que possible et qui permette en même temps un dialogue mutuel et, espérons-le, une compréhension. Lʼensemble du processus lui-même permettrait ensuite de cartographier le corps de lʼéglise dans son existence dynamique et son ouverture.23
Dans ce cas, l’opération de dérivation envisagée peut être qualifiée de transposition, dans la mesure où elle consiste à reprendre plusieurs des dimensions – méthodologiques, techniques, esthétiques – du format initial pour l’appliquer à un autre. On notera quand même une différence importante dans la dimension méthodologique d’un tel projet : Cristina Aus Der Au désirait éviter la dimension « pyramidale » du format initial de l’EME, identifiant un auteur « principal » et des contributeurs variés pour lui préférer un mode d’écriture collective distribué dès l’ouverture du projet. Une telle nécessité fut au centre du travail de design effectué durant l’atelier.
La deuxième équipe conviée à Open AIME provenait du Centre Virtuel de Connaissance sur l’Europe (CVCE), centre de recherche rattaché à l’Université de Luxembourg, qui concentre notamment une base historique très importante de documents de divers types (imprimés, vidéos, …) permettant de retracer l’histoire communautaire de l’Union Européenne. Pour ce cas, c’est un dispositif existant qui fut utilisé comme point de départ : le site du CVCE proposait en effet déjà à différents chercheurs, sur la base de l’archive constituée par l’institution, d’écrire et de publier de courts textes permettant de mettre en sens et en perspective cette dernière. Sous la forme de pages web intitulées « ePublication », le site mêlait ainsi ensemble un texte à vocation scientifique ou didactique, et une sélection de « ressources » tirées de la base générale du centre.
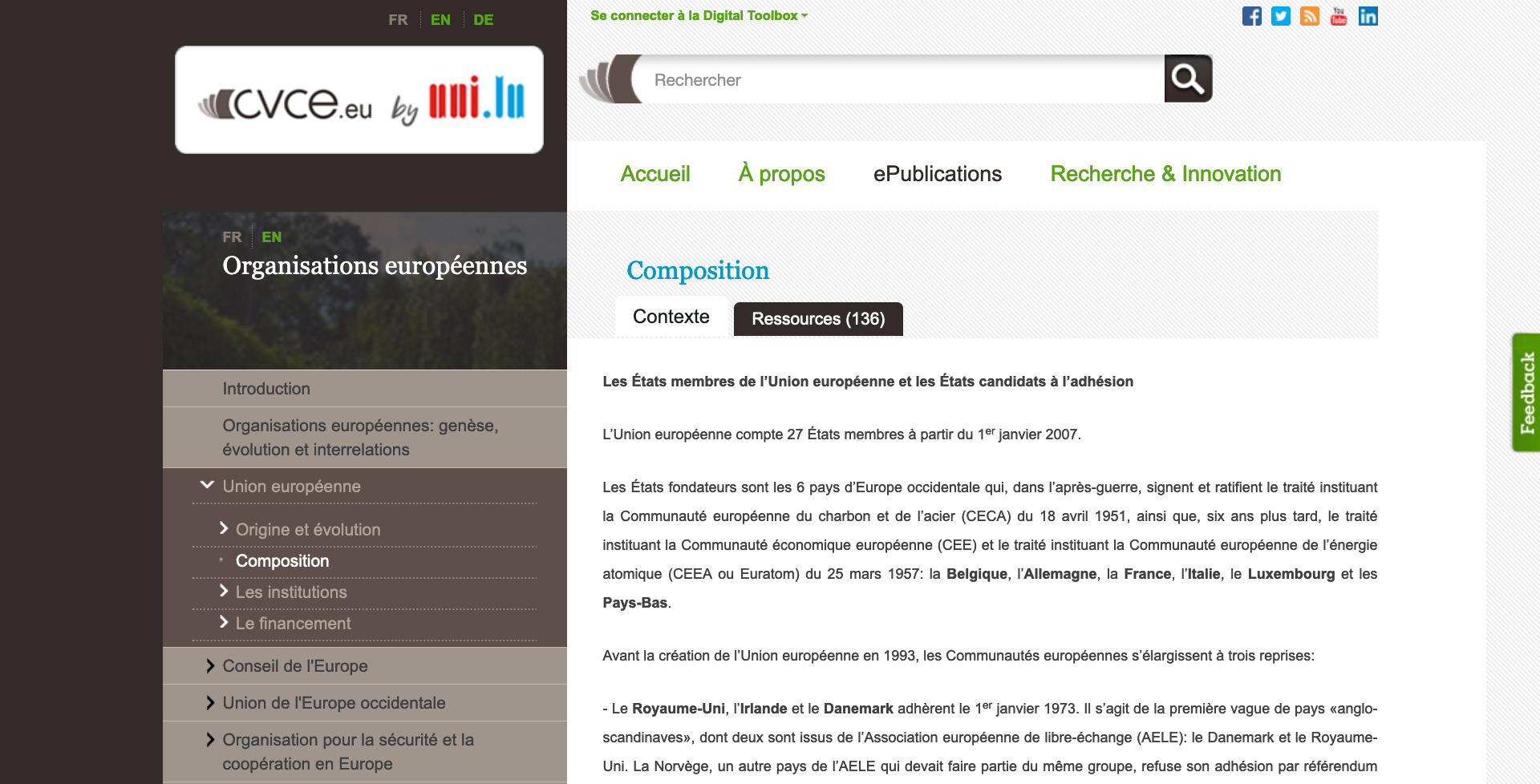
La rencontre avec le format de l’EME fut alors envisagée comme le moyen – technique et interfacique – de rapidement re-concevoir l’interface de lecture et d’écriture des « ePublications » dans le sens d’une intrication plus intime entre les documents de la base et les textes écrits par les historiens. L’opération peut alors être envisagée comme celle d’une extraction ou d’une transplantation de l’une des dimensions du format de lecture et d’écriture de l’EME – notamment, le système de colonnes de son édition web dite « livre » – puis de recontextualisation dans un espace de publication à la géographie sociale, au contenu et aux objectifs différents.
Bruno Latour, enfin, a participé au workshop dans le cadre d’une recherche de terrain ethnographique conduite auprès de scientifiques spécialisés en géochimie et en sciences du sol tournés autour des Zones Critiques24 , pour lesquels il se questionnait vis-à-vis de techniques d’enregistrement de données de terrain. Il envisageait un prolongement de l’EME comme outil hybride faisant à la fois office de carnet de terrain et d’outil d’écriture à ciel ouvert, permettant notamment d’impliquer ses « observés » dans la production et la critique de la documentation constituée pour écrire l’ouvrage. Dans ce cas, le plus proche du projet original – du fait de la présence de Bruno Latour, de l’architecture du collectif et de la présence d’un système de contribution, etc. – on pourrait dire que l’opération envisagée a relevé initialement de la reproduction du format construit par l’EME : il s’agissait de reprendre quasiment le même dispositif puis d’envisager sa compatibilité avec un autre contenu.
Sur la base de ces trois projets, le workshop a consisté à présenter le format EME et les différentes analyses dont il avait été l’objet – notamment en terme d’appropriation collective et de réception – puis à assembler des équipes permettant de matérialiser et de spéculer sur de potentiels transferts, réutilisations ou reprises dans chacun des cas. Ces discussions, nourries par de nombreuses pratiques matérielles de design – schématisation, maquettage rapide, mise en situation au moyen d’outils de dessin – ont permis d’explorer les transferts possibles et les problèmes à venir si certaines de ces dérivations venaient à être effectivement engagées.

De ces échanges et des sessions de travail, ont découlé un projet de système d’éditorialisation d’archives pour la base sur l’Union Européenne, un outil d’écriture « entourée » pour l’écclesiologie helvétique, et une plateforme d’écriture et de documentation construite sur le principe d’un mouvement de question/réponse et de conversation documentée pour le projet de Bruno Latour25 . Ces propositions ont été le résultat de diverses négociations dans lesquelles nous avons tenté d’envisager les efforts minimums qui permettraient d’effectuer de telles opérations de dérivation. Dans certains cas, le pari fut réussi, alors que pour d’autres, ce sont les principes méthodologiques et les dimensions techniques fondamentales de l’EME qui ont du être remises en cause.
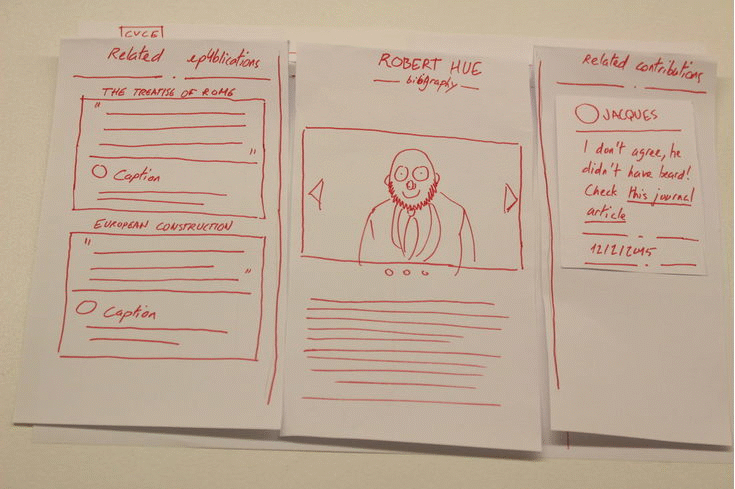
Ces expériences ont révélé une double complexité : d’une part, la difficulté à désintriquer les différentes dimensions du format de EME – notamment la complémentarité des différentes éditions (site web, imprimé, …)26 et la correspondance entre ses dimensions philosophiques et méthodologiques ; d’autre part, la difficulté de séparer l’EME de son contexte de recherche et de production originel (notamment, les ressources humaines et techniques du médialab, partie cardinale de l’infrastructure du projet initial)27 . Au cœur des discussions et des expérimentations conduites dans ce cadre, la fragilité d’un tel format a également été éprouvée dans la mesure où il s’est trouvé à plusieurs reprises menacé par le risque de perdre de sa pertinence une fois vidé de sa substance initiale – la question posée étant alors de repartir du projet EME ou de faire table rase pour reconcevoir des dispositifs en fonction de chaque situation travaillée.
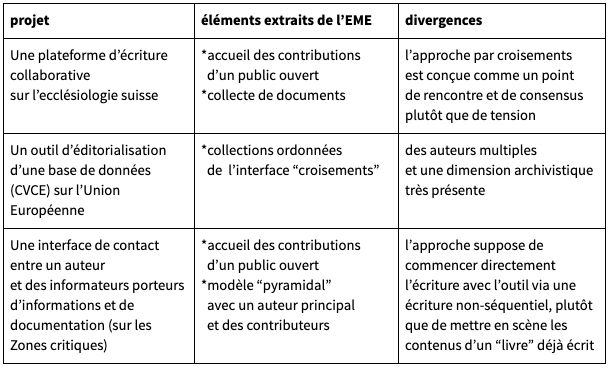
Au-delà des perspectives découvertes à propos des trois cas d’étude présentés durant la rencontre, l’expérience a renseigné sur les opérations intellectuelles qu’impliquent un tel mouvement de dérivation à partir d’un format expérimental devenu cadre pour de nouvelles pratiques : transposer certains éléments de son infrastructure, recontextualiser certaines de ses caractéristiques, ou encore reproduire certaines de ses fonctionnalités. De telles opérations ne sont pas allées sans générer certaines frictions produites par les reconfigurations produites entre les différents formats de l’EME, qui se sont ainsi manifestés dans toute leur hétérogénéité.
Reconstituer une démarche d’enquête hétéroclite à travers la production d’un format d’écriture et de lecture expérimental
En parallèle de l’expérience d’Open AIME, j’ai mené une suite d’expérimentations mêlant design graphique et développement informatique, et visant initialement à mettre en forme et partager les résultats de mes diverses pratiques de reconstitution à propos de l’EME. Au vu des diverses modalités d’enquête employées, le problème de leur communication et de leur articulation avec un texte en prose synthétisant mon analyse du projet s’est rapidement posé. Cette situation est alors devenue le point de départ pour la fabrication de moyens de publication permettant de combiner des pratiques d’écriture mobilisant finement les matériaux d’une recherche, la production de documents respectant les normes techniques et documentaires en vigueur dans le monde universitaire, et un environnement propice à des activités de design graphique et interactif avancées.
Dans le cadre d’un appel à contribution de la revue de design internationale Visual Language, pour un numéro spécial consacré à la relation entre design et humanités numériques intitulé Critical Making : Design and the Digital Humanities, j’ai d’abord effectué avec les membres de l’équipe du projet EME une forme de retour analytique sur le type de conclusions et d’interprétation qu’avaient permis de produire mon passage dans l’équipe. Pour ce faire, nous avons écrit un article imprimé – constitué de textes et de figures visuelles tirées du projet et de nos diverses analyses – publié dans le cadre de la revue (Ricci et al., 2014) mais également une version numérique interactive que nous avons qualifiée de web compagnon28 . Cette version numérique offrait une profondeur de lecture supplémentaire aux chercheurs intéressés en leur permettant de parcourir les matériaux de recherche mobilisés pour produire nos arguments : pour un extrait d’entretien, il s’agissait de donner accès à la vidéo en ligne de son enregistrement, accompagnée de sa transcription, afin de permettre d’en consulter la matière langagière mais également les inflexions, hésitations et autres formes de langage non-verbal de l’interviewé ; pour une visualisation d’informations, il s’agissait de permettre au lectorat des activités de navigation temporelle, de filtrage ou d’approfondissement ; pour une citation de document, le web nous permettait de donner à lire les extraits mobilisés dans le contexte de leur source complète ; etc. Il s’agissait ainsi, à travers cet article proposant un retour critique sur les différentes formes de réception et d’appropriation de l’EME, d’opérer un geste réflexif et récursif reconduisant le même geste de publication que celui des éditions numériques dont l’article était l’objet.
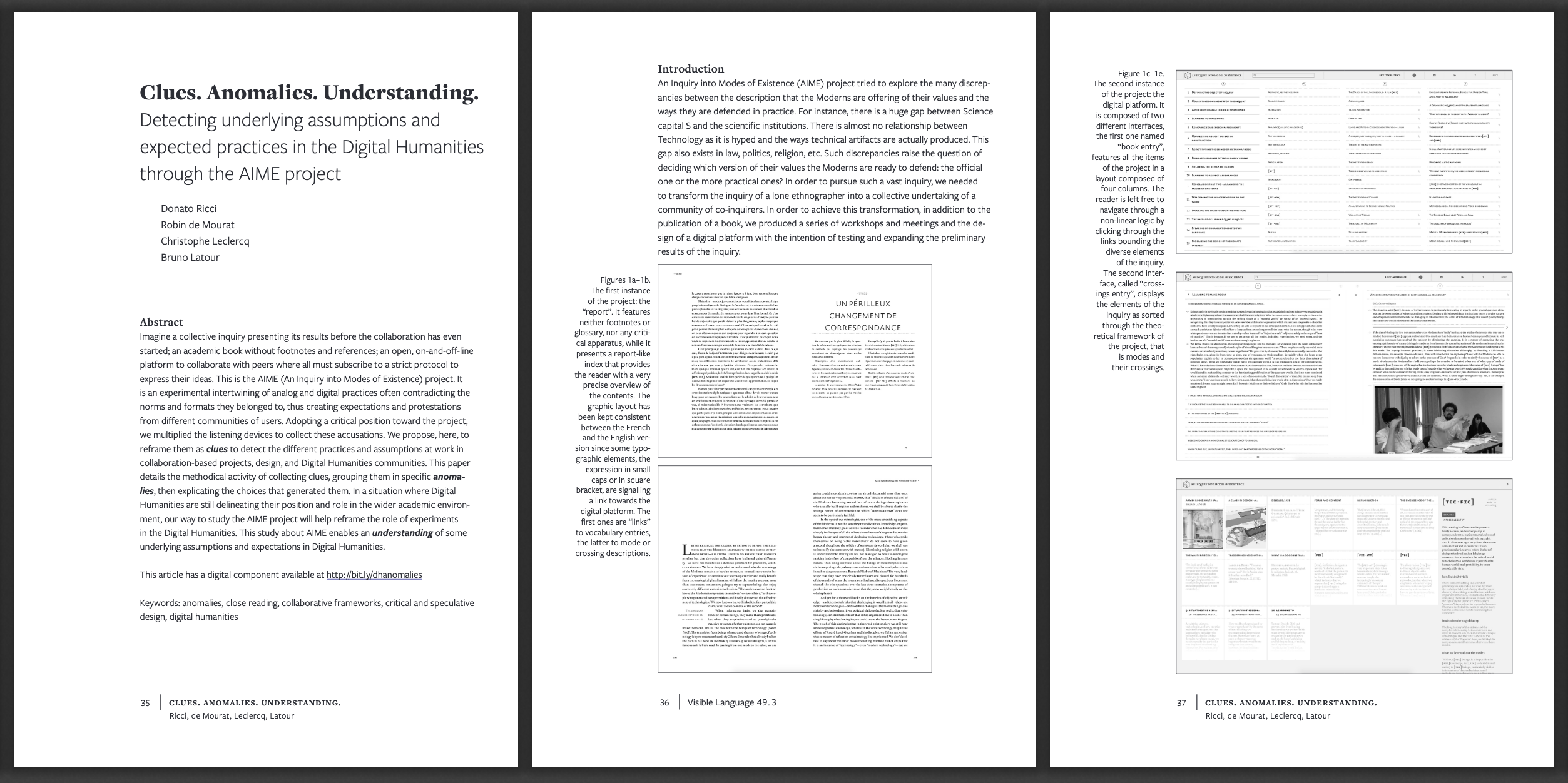
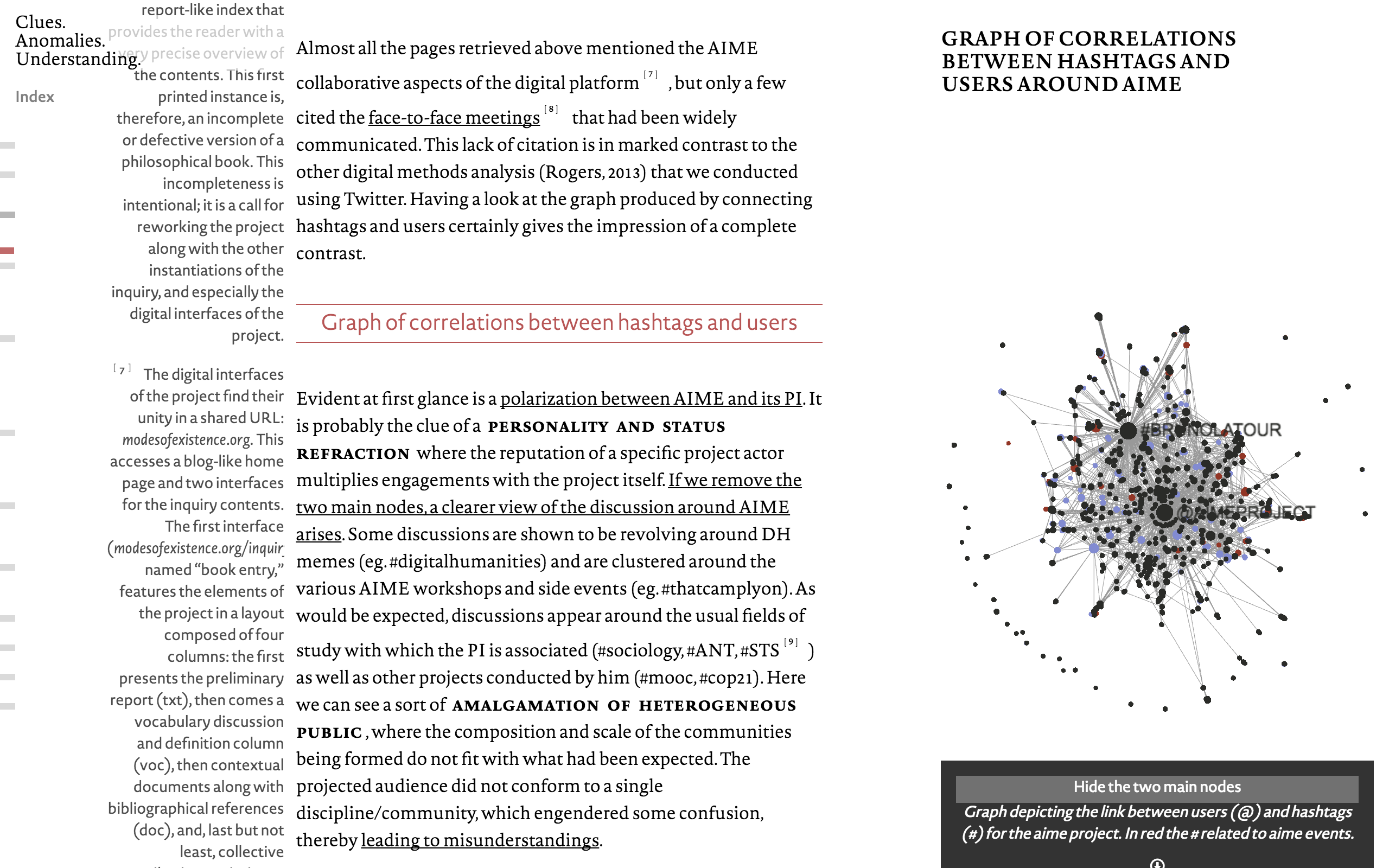
Du point de vue de son dispositif de lecture, la version web compagnon de Clues Anomalies Understanding se présente comme une pièce en trois colonnes qui fait usage d’un motif d’interaction web intitulé scrollytelling29 , à savoir un mode de lecture séquentiel dans lequel l’opération de défilement vertical des contenus par le lecteur déclenche un ensemble d’évènements à l’écran, tels que l’affichage d’une vidéo, l’apparition ou la mise à jour d’une visualisation, en correspondance avec la partie du texte en train d’être lue. Dans cette mise en page en trois colonnes, la colonne de gauche tient lieu de sommaire et fil d’Arianne pour la navigation dans l’espace de la page, la colonne principale présente un texte séquentiel identique à celui de la version papier de l’article, et la colonne de droite affiche un contenu contextuel qui dépend de la position du lecteur dans la page et/ou des actions de ce dernier (certains éléments du texte sont cliquables). Elle peut afficher divers type d’éléments : des images, des visualisations (frise chronologique, réseau de noeuds et de liens), des images, et des sites ou documents paginés entiers. La page web existe également sous une forme imprimable, qui reprend les différents éléments de contextualisation de l’article et les remet en page selon une logique séquentielle adaptée à un document paginé30 .
Du point de vue de son dispositif d’écriture, et dans la logique d’observation participante de mon terrain, Clues Anomalies Understanding a été écrit à huit mains par Donato Ricci, Christophe Leclercq, Bruno Latour et moi-même. Pour ce faire, en parallèle du design du site à proprement parler, j’ai fabriqué un module technique intitulé Modulo qui permettait d’amender et de modifier le texte, les références bibliographiques utilisées et les visualisations, à travers l’édition d’un fichier unique pouvant être écrit avec un éditeur de texte générique. Ce fichier unique a pu être mis à jour progressivement et collectivement pour conjuguer dans un même mouvement l’écriture en prose, la spécification des différentes visualisations, et la configuration des extraits vidéos et autres citations présentées dans le site. Par ailleurs, la légèreté du système alors utilisé – qui ne nécessitait pas de base de données, de serveur ou de logiciel d’édition spécifique, et consistait en une simple page web opérant la mise en forme depuis le navigateur des visiteurs grâce à la technologie javascript – a permis de mettre en place une méthode de travail itérative et organique dans laquelle l’évolution du site et de son design n’était pas dépendante d’une lourde infrastructure technique ou de compétences ingénieriques importantes.
Ainsi, le projet de web companion répondait à la fois par son histoire et par son fonctionnement au projet EME, dont il tentait de reprendre un ensemble de propriétés et de les traduire pour une autre démarche et un autre contexte, redoublant ainsi sur un autre mode le geste de dérivation effectué lors de l’atelier Open AIME. Sur cette base, dans la double perspective d’équiper la publication de la présente thèse et de diffuser de telles méthodes auprès d’autres chercheurs, j’ai formulé le projet de formaliser cette expérimentation via un modèle de données explicite, puis de la décliner en un ensemble de modules techniques interopérables, puis, plus tard, de la faciliter grâce à des logiciels spécifiques d’écriture et d’édition. Cette stabilisation allait trouver le nom de Modulo, puis plus tard de Peritext.
L’échec de stabilisation de pratiques expérimentales via l’adaptation de formats de données existants
La première bibliothèque de code dérivée de l’article « Clues Anomalies Understanding » fut intitulée Modulo et publiée en 2015 sur la plateforme de partage de code github (de Mourat, 2 novembre 2015/2015). Elle consistait à interpréter un fichier de texte brut composé avec les formats établis markdown (pour l’écriture des parties en proses de l’article) et JSON (pour la spécification des visualisations de l’article) pour produire le site web existant.
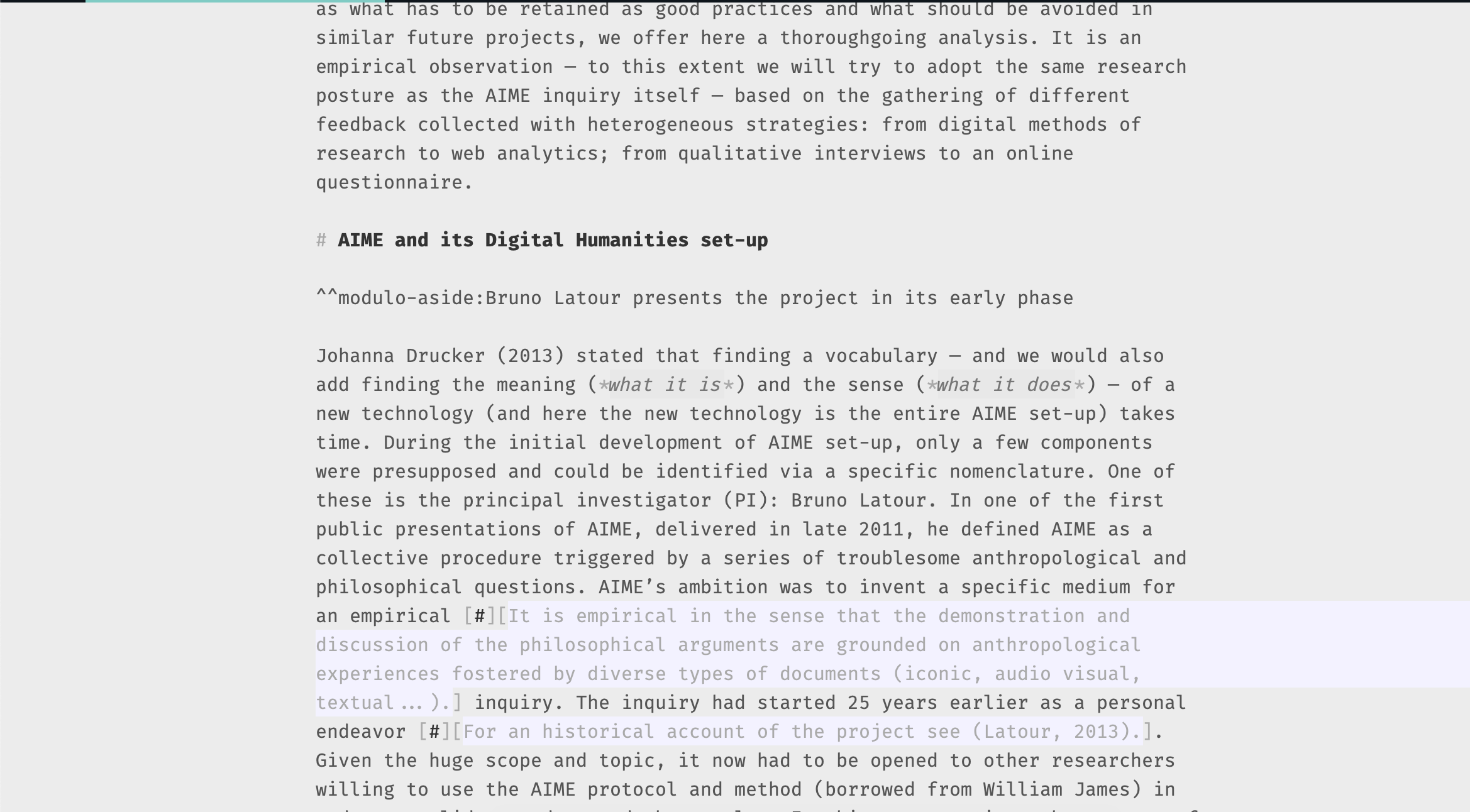
L’écriture de l’article fut également l’occasion d’expérimenter d’autres systèmes d’écriture plus conventionnels pour l’écriture scientifique, utilisant notamment XML et LaTeX. Peu adaptés à la dimension web visée par le projet initial, ces expérimentations permirent néanmoins de faire évoluer l’expérimentation dans le sens d’un nouveau format d’écriture reprenant partiellement ces formats dominants, en utilisant le format de définition des références bibliographiques associé au format LaTeX (intitulé BibTeX), et le mêlant avec le format markdown utilisé pour l’écriture de la prose. L’idiome hybride utilisé pour l’écriture de l’article fut ainsi progressivement stabilisé dans l’optique de créer une méthode d’écriture propre à être réutilisée et appliquée à la génération de sites web, mais également de documents pour liseuses numériques au format.epub, et de fichiers.pdf propres à l’impression, répondant ainsi à la dimension polymorphique et multi-support au centre des méthodologies du projet EME. À partir de ce projet, mes activités ont ensuite consisté à effectuer le design d’un format de données éditorial permettant de manipuler dans le texte la représentation de figures complexes tels que des visualisations de données, des extraits audiovisuels et autres éléments avancés convoqués par les documents.
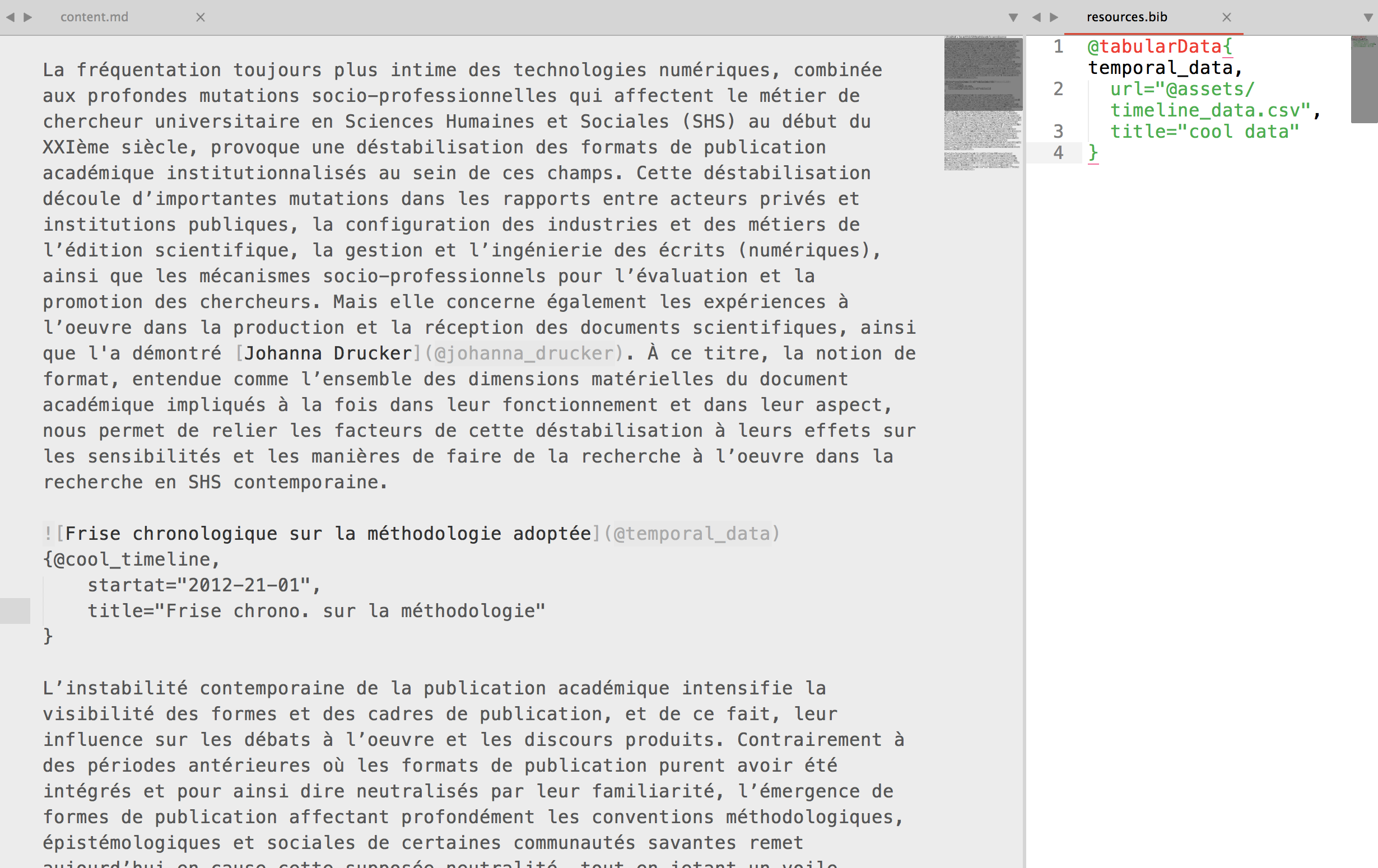
À partir du modèle d’écriture alors imaginé, le premier Peritext fut développé comme une série de modules techniques articulés par une structuration des données commune, et aptes à être mobilisés de manière coordonnée ou autonome en fonction de différents projets de conception éditoriale. Dans le scénario de travail de cette version, un ensemble de fichiers markdown, bibtex et de dossiers se voyait édités par les auteurs, éditeurs et designers31 , puis interprété au moyen de modules dits connecteurs. Enfin, au moyen de contextualiseurs puis de renderers, ces contenus étaient mis en forme et transformés en fichiers propres à la publication – qu’il s’agisse de fichiers.pdf pour l’impression, de fichiers.epub pour liseuses numériques, ou de fichiers.html permettant la publication de sites web statiques.
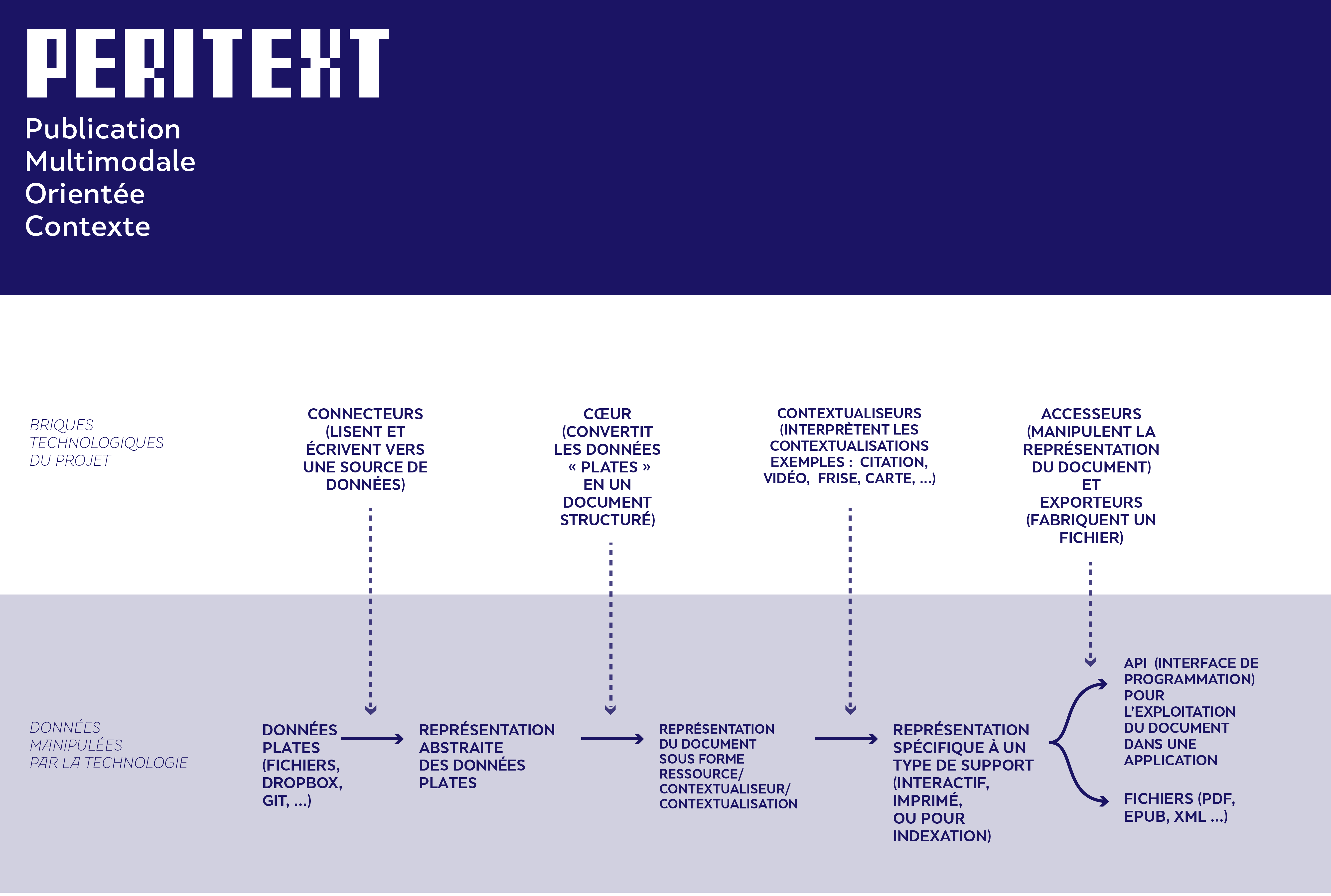
Conjointement à ce projet de conception autorisant de nouvelles pratiques d’écriture au plus proche des matériaux, le système Modulo, qui fut rapidement renommé en Peritext, fut également développé dans l’optique de ne pas négliger la rigueur documentaire et technique requise par les normes d’édition scientifique. Ainsi, les premières versions du projet s’attachèrent notamment à automatiser la génération de documents web abondamment documentés au moyen de la norme de définition de métadonnées DublinCore (« Dublin Core Metadata Initiative », 1995) ; mais également à permettre la compatibilité de ces mêmes documents avec des logiciels de gestion de bibliographie tels que Zotero via l’encodage des références bibliographiques mobilisées dans les pages32 , et enfin l’utilisation de formats de microdonnées à l’intérieur des contenus facilitant une indexation précise des contenus produits par les moteurs de recherche généralistes et spécialisés33 .
Parallèlement aux développements techniques de Peritext, les mécanismes de lecture et de navigation mis en place dans l’article numériques furent stabilisés. Leur adaptation à des échelles de contenus plus importantes – celles d’une monographie ou d’une thèse de doctorat – conduit à stabiliser les dispositifs expérimentés précédemment, mais également à en expérimenter de nouveaux comme la génération d’index numériques permettant de naviguer dans les différentes mentions d’un terme ou d’une personne. La rédaction de la présente thèse fut le premier lieu d’expérimentation de tels essais.

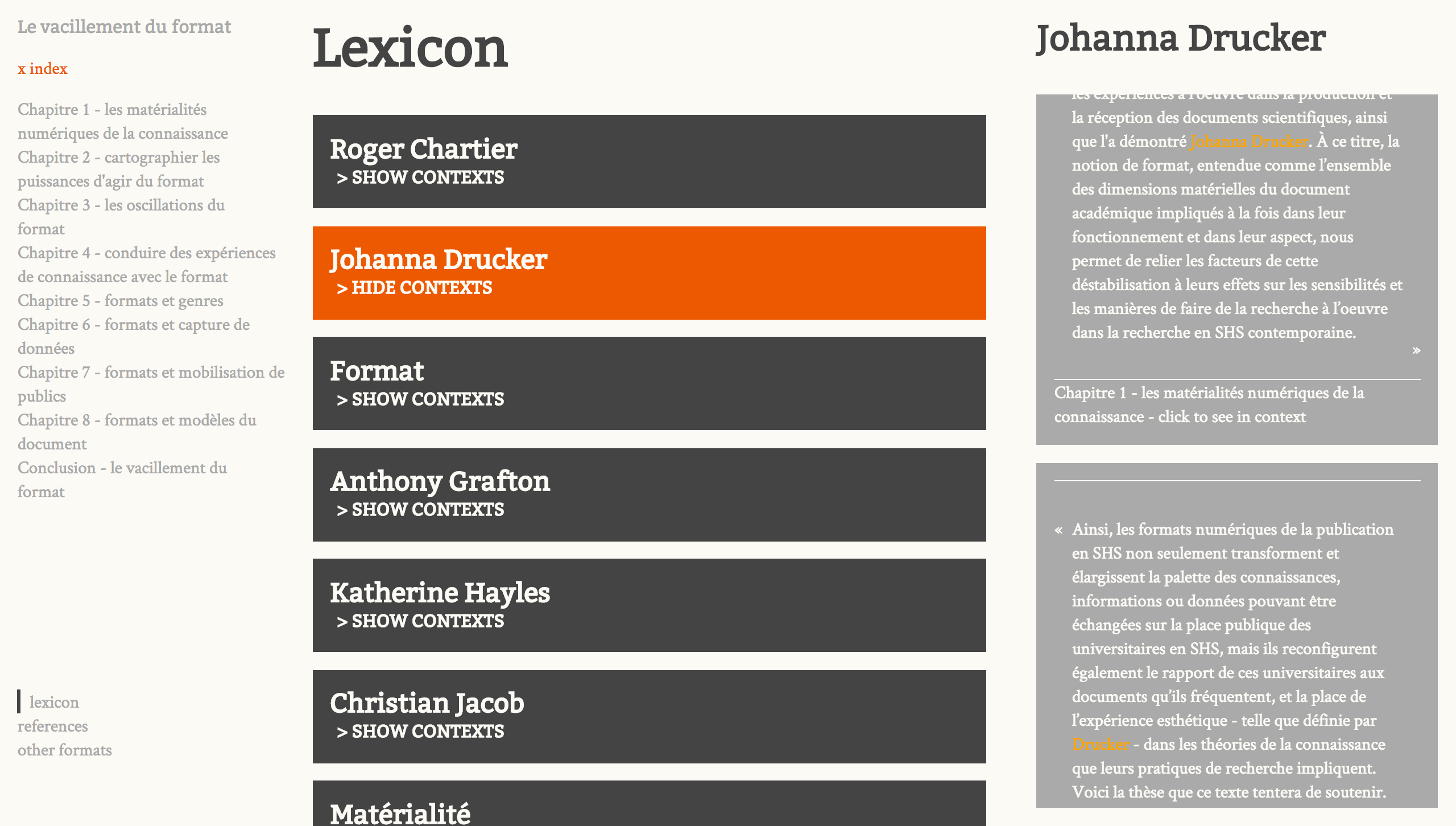
Le développement du module technique mis en place pour l’article « Clues Anomalies Understanding » a été l’occasion de rejouer une partie de la méthode expérimentée dans l’EME, mais aussi d’en expérimenter certains des points aveugles, d’abord en termes d’articulation entre dimensions techniques et sociales. Ainsi, le système mis en place a permis de questionner le caractère centralisé et techniquement lourd d’une infrastructure telle que celle mise en place pour l’Enquête, en proposant à la place une technologie plus légère à mettre en place et à faire évoluer. Ensuite, alors que les éditions numériques de l’EME se présentaient comme une forme de « boîte noire » pour le web, nécessitant la création d’un compte pour être consultées et ne respectant pas les normes techniques en vigueur concernant la documentation et l’indexation des publications scientifiques en ligne, j’ai cherché dans un premier temps à développer des moyens de répondre aux contraintes techniques de manière automatisée afin de pouvoir plus librement aborder les aspects au centre la publication-comme-enquête. Des bases étaient alors posées pour la conduite de nouvelles expérimentations, et l’instauration d’un espace plus stable pour de futures pratiques de collaboration entre designers et chercheurs.
L’ensemble des éléments constitutifs de cette première version furent documentés sur une page wiki accessible à l’édition (de Mourat, 2016), puis présentée et utilisée pour quelques expérimentations avec des chercheurs du médialab Sciences Po et des designers. Le projet fut exposé à la biennale de design graphique de Chaumont en 2017 (Philizot & Martin, 2017).
Reconstruire une infrastructure pour les pratiques d’écriture, d’édition et de design dans les SHS
La troisième étape conduite à partir des expériences de dérivation du dispositif éditorial de l’EME a été concentrée sur le développement d’interfaces d’écriture spécifiques et la mise au point minutieuse d’un modèle de données stable. En effet, je me suis assez rapidement heurté aux limites du bricolage que constituait le système d’écriture du premier Peritext fondé sur les formats existants markdown et bibtex. Plusieurs expérimentations et présentations auprès de chercheurs et de designers ont révélé que l’écriture avec ce dernier s’avérait lourde et complexe, et de plus que les bénéfices apportés par le système n’étaient pas suffisamment supérieurs au coût d’apprentissage des langages concernés pour que le système soit vraiment adopté. En outre, il était difficile de représenter les structurations complexes que demandait la description d’objets élaborés tels que des visualisations de données, ou encore de manipuler le format bibtex de manière satisfaisante au moment de l’écriture, au-delà du renseignement de références bibliographiques auquel ce format était initialement dédié.
C’est alors que la création d’un système plus spécifique s’est présentée comme une possibilité risquée mais justifiée dans le contexte d’expérimentation qui était le mien. D’abord, un modèle de données sous la forme d’une série d’objets a été développé – il sera décrit dans la suite de ce chapitre – et les formats de données associés à l’édition initialement utilisés – bibtex et markdown – furent abandonnés au profit du format JSON, plus adapté à la formulation de relations complexes, et faisant office de format d’échange standard dans les environnements web dans lesquels les modules du projet étaient de plus en plus mobilisés. En parallèle, je me suis engagé dans le développement d’une interface d’écriture spécifique permettant d’éditer visuellement des documents de recherche complexes, et notamment de basculer entre plusieurs modes de prévisualisation de différentes « intentions d’écriture » selon les types de supports – web, imprimé, liseuse.
À partir de 2016, les différentes itérations et expérimentations de Peritext furent donc progressivement stabilisées en un ensemble cohérent et partageable comportant un schéma/format de données, un ensemble de bibliothèques de code interopérables, et une application d’édition se présentant sous la forme d’un service et ligne et d’un logiciel de bureau intitulé Ovide 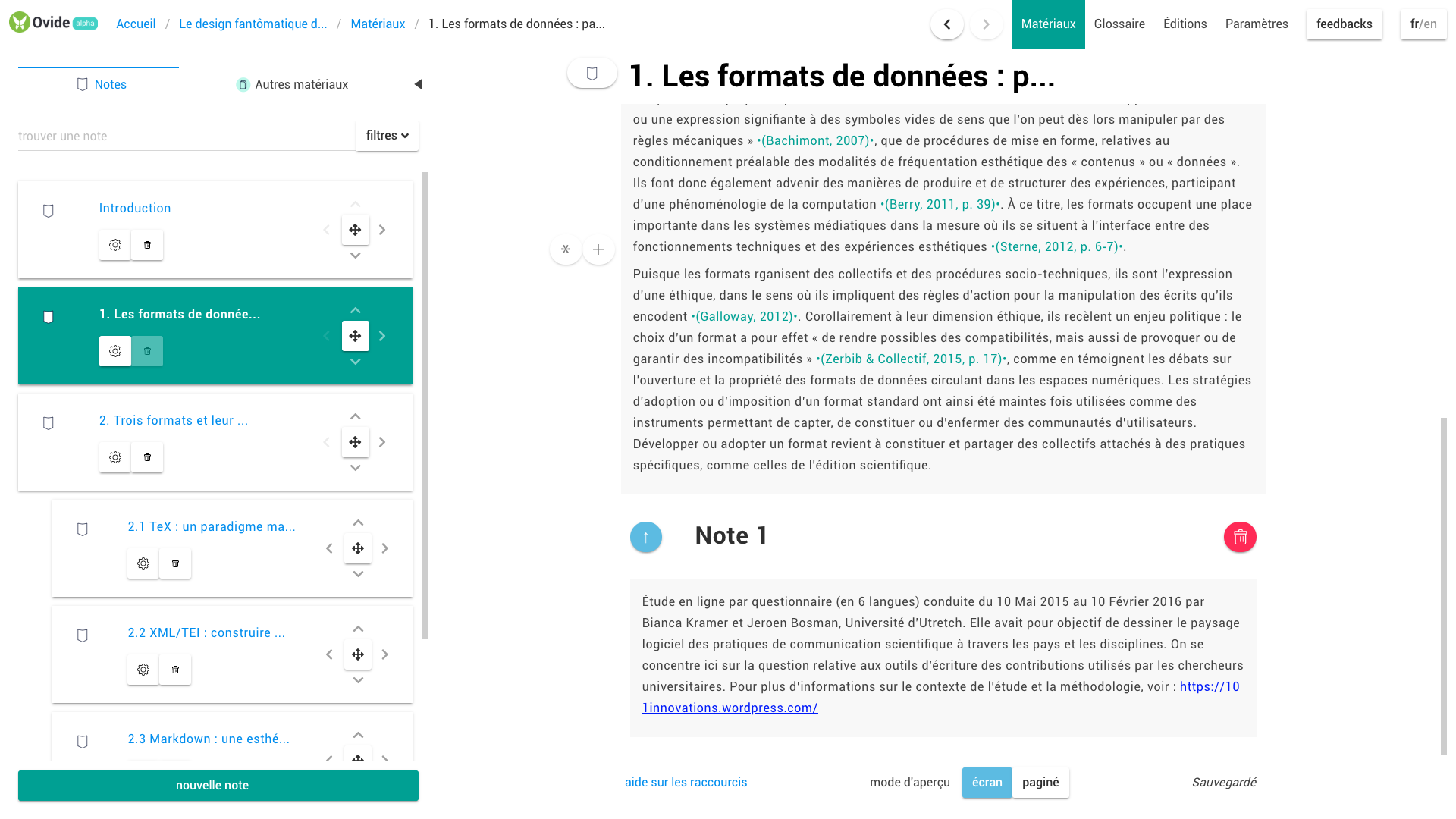 . Ovide est disponible – comme le logiciel Dicto décrit précédemment – comme une application autonome fonctionnant en ligne ou sous la forme d’une application de bureau. Ce logiciel a fait office d’outil d’écriture et de composition de la présente thèse, lieu d’une nouvelle situation d’articulation entre format d’écriture, format éditorial et format de données – en même temps que son développement a agi comme la démonstration des possibilités du modèle de données Peritext.
. Ovide est disponible – comme le logiciel Dicto décrit précédemment – comme une application autonome fonctionnant en ligne ou sous la forme d’une application de bureau. Ce logiciel a fait office d’outil d’écriture et de composition de la présente thèse, lieu d’une nouvelle situation d’articulation entre format d’écriture, format éditorial et format de données – en même temps que son développement a agi comme la démonstration des possibilités du modèle de données Peritext.
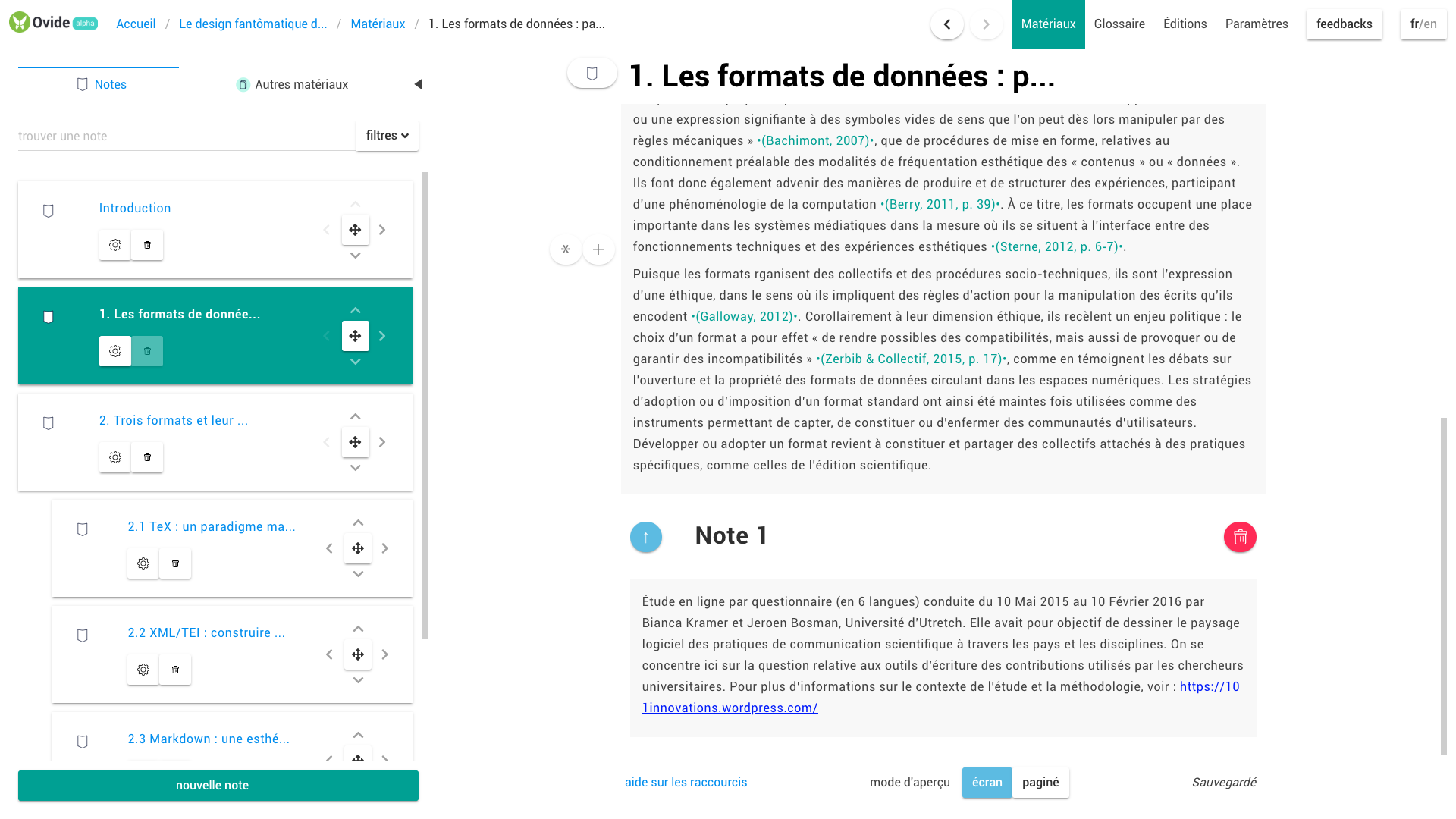 . Ovide est disponible – comme le logiciel Dicto décrit précédemment – comme une application autonome fonctionnant en ligne ou sous la forme d’une application de bureau. Ce logiciel a fait office d’outil d’écriture et de composition de la présente thèse, lieu d’une nouvelle situation d’articulation entre format d’écriture, format éditorial et format de données – en même temps que son développement a agi comme la démonstration des possibilités du modèle de données Peritext.
. Ovide est disponible – comme le logiciel Dicto décrit précédemment – comme une application autonome fonctionnant en ligne ou sous la forme d’une application de bureau. Ce logiciel a fait office d’outil d’écriture et de composition de la présente thèse, lieu d’une nouvelle situation d’articulation entre format d’écriture, format éditorial et format de données – en même temps que son développement a agi comme la démonstration des possibilités du modèle de données Peritext.Les pratiques de recherche engagées durant le temps de ma recherche doctorale ont alors dialogué avec des pratiques professionnelles dans lesquelles j’ai été impliqué en tant que designer d’interfaces et développeur. D’abord, j’ai été conduit à effectuer une simplification du modèle de données Peritext dans le cadre du programme de recherche Formation par la cartographie des controverses à l’analyse des sciences et techniques (FORCCAST) au sein l’équipe du médialab de Sciences Po. Dans ce contexte, j’ai été le designer et le développeur principal d’un logiciel collaboratif intitulé Fonio34 visant à permettre l’édition collective de dissertations numériques pour des étudiants en Sciences Humaines et Sociales. Ce dernier propose un modèle de données (et une interface d’écriture) légèrement moins complexe que celui de Peritext, car dédié exclusivement à la réalisation de sites web combinant une forte structuration documentaire, et des possibilités avancées de design et d’intégration de matériaux divers. Avec Fonio, de nombreux étudiants35 ont eu l’occasion de s’approprier ce format d’écriture et de publication pour en faire le cadre de nouvelles expérimentations à leur degré de compétence, mobilisant parfois le logiciel pour produire des sites web semi-finis qu’ils ont ensuite repris au moyen d’autres outils.
J’ai par ailleurs été conduit à effectuer une opération d’adaptation de Peritext à l’occasion d’une collaboration dans le champ de la publication en arts et design avec le groupe de recherche Hybrid Publishing36 de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (« Experimental Publicizations », 2018). Il s’agissait d’adapter certains des modules techniques et des principes stabilisés de Peritext au projet d’une plateforme collaborative d’édition de revues en art & design. À cette occasion, la conception et la fabrication du prototype Métis37 a permis d’explorer la capacité de certains des principes de conception de Peritext à permettre des pratiques de design avancées, notamment pour la conception de livres numériques au format.epub. Ce prototype a également introduit la possibilité de créer des éditions ou des « articles » de revues centrés sur des matériaux non-textuels, qu’il s’agisse par exemple de vidéos38 ou d’œuvres d’art numérique. Cette expérience a permis d’enrichir le modèle stabilisé de Peritext à l’issue de la collaboration, et de reprendre certains des modules techniques développés pour l’occasion afin de les verser dans le « corps » des bibliothèques de code en licence libre qui constituent la part technique du projet.
Partant d’un projet initial que l’on pourrait qualifier d’instrumental, la fabrication de Peritext s’est ainsi muée en une aventure longue et sinueuse39 aux développements techniques, esthétiques et intellectuels non-anticipés. À partir de la première version conçue pour étudier le projet EME, c’est tout un ensemble de modules, d’expériences et d’essais qui furent développés à travers le temps et les collaborations qui ont jalonné ce parcours doctoral. Ce cheminement a été suivi pour réaliser un projet initial de l’ordre de l’infrastructuration des pratiques de publication dans le sens d’un dialogue plus riche entre pratiques de design et pratiques de publication universitaire. Cela dit, il s’est également progressivement transformé en une pratique réflexive participant de mon enquête. Le lieu de la conception est donc devenu l’occasion d’une étude des technologies d’écriture, des formats de données éditoriales, et des implications de la publication pour les manières d’écrire et de conduire la recherche. En dérivant d’une situation de conception à une autre, j’ai été amené à rejouer ou à reconstituer en partie les problématiques de conception qui se sont posées lors de la stabilisation des manières de faire de la publication aujourd’hui dominantes et relativement stabilisées sur les plans techniques, épistémologiques et institutionnels. Il s’agit maintenant de qualifier les effets méthodologiques et épistémologiques d’une telle trajectoire de fabrication-comme-enquête.
Qualifier les effets d’une trajectoire de fabrication-comme-enquête
Les situations de conception et de fabrication éprouvées lors de cette thèse40 , ont conduit à une multitude d’expérimentations qui questionnent toutes les tensions entre stabilisation et déstabilisation provoquées par une pratique de design située au sein des collectifs de recherche en SHS. À travers la description du parcours suivi, j’ai identifié une série d’opérations qui ne se limitaient pas à une série d’essais et d’erreurs en vue de trouver des solutions optimales. Au contraire, ces traductions ont permis de provoquer une multitude de reconfigurations entre les différents formats – de données, d’écriture, d’édition – qui se sont vus produits à l’occasion de l’une de ces situations, puis re-mobilisés en tant que cadres pour une autre. Elles ont par ailleurs permis de dresser un inventaire partiel des opérations de dérivation qui permettent de qualifier ces diverses transformations.
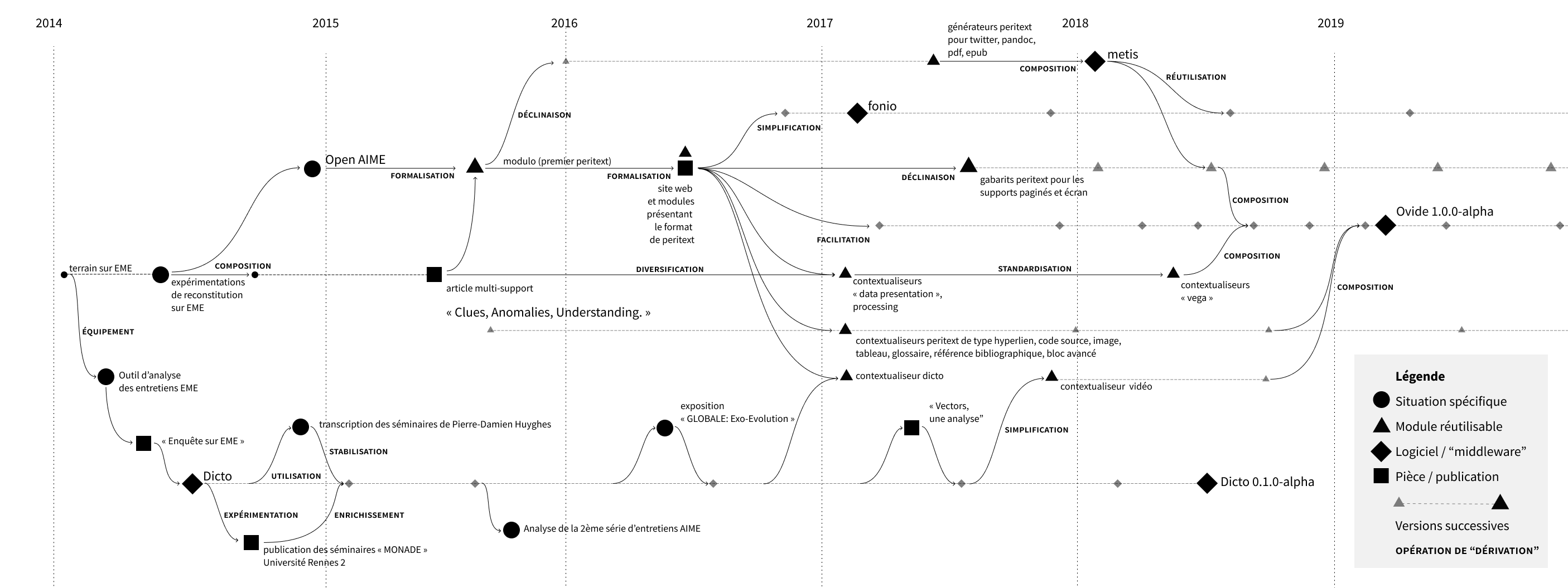
La trajectoire qui a construit cette recherche se présente ainsi comme un double cheminement visant à la fois à contribuer à un meilleur équipement des pratiques – une visée diagnostique – et à expérimenter des formes d’articulation entre design et enquête – une visée méthodologique. D’un point de vue diagnostique, elles ont permis de stabiliser et d’améliorer un modèle de données adapté à des pratiques mêlant de manière intime pratiques d’enquête, d’écriture et de design, et que j’ai qualifiées de publication-comme-enquête. D’un point de vue méthodologique, elles ont aussi constitué une méthode d’expérimentation des rôles possibles du design vis-à-vis des situations de publication en SHS. Il s’agit alors d’en qualifier les effets.
Une attitude évolutive dessinant un paysage pluriel pour les contributions d’une enquête en design aux SHS
Les différentes dérivations constitutives de la trajectoire de recherche sont le fruit de l’hétérogénéité de mon attitude dans les différents temps qui ont construit cette recherche. Ainsi, suivant les situations, la mobilisation du design a été effectuée selon des finalités que je qualifierais d’instrumentales – c’est-à-dire destinées à remplir une fonction prédéterminée – et d’autres que je qualifierais d’expérimentales – c’est-à-dire pour l’exploration des qualités incidentes sur les plans techniques, esthétiques ou éditoriaux, des productions réalisées dans les situations de fabrication. L’effet que produit un tel vacillement est une forme de cartographie partielle des différentes attitudes que peut occasionner l’embarquement de segments de design dans une pratique d’enquête.
Afin de qualifier la trajectoire expérimentale dessinée par cette recherche, je propose donc d’écrire sous la forme d’un diagramme le territoire que j’ai exploré. Pour ce faire, je propose de le dessiner comme un espace spéculatif à deux axes : l’un pour l’action des formats que j’ai élaborés, l’autre de l’attitude qui les a produites 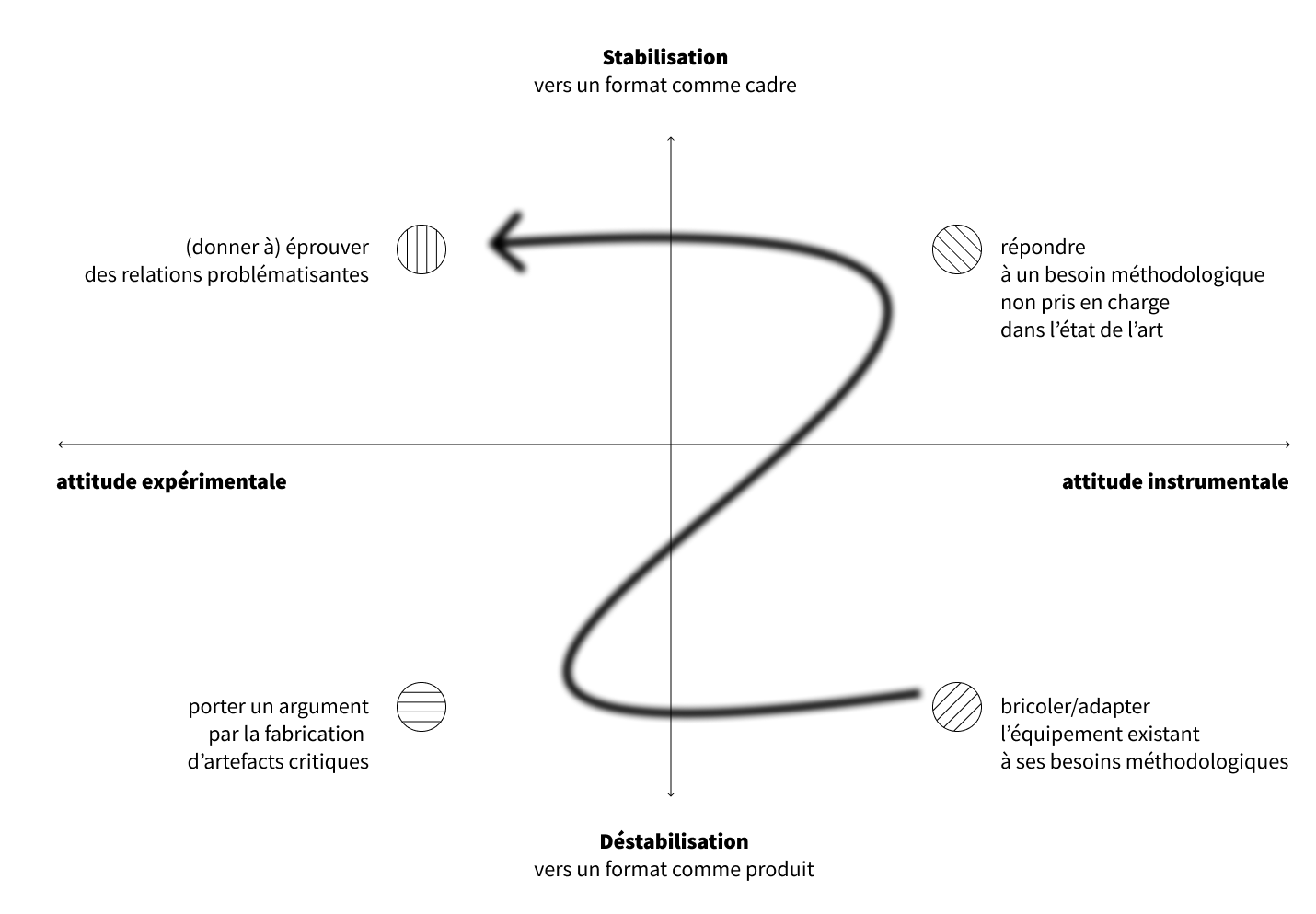 . Dans ce territoire, je peux alors tracer les différents déplacements qu’a produit l’enchaînement de dérivations qui a caractérisé par pratique du design. Ainsi, dans un premier temps, via une attitude d’équipement conduisant au bricolage de moyens existants, les situations de collaboration rencontrées dans le cadre de ma recherche m’ont conduit à participer à la fabrication de documents-publications expérimentaux dont les formats furent conçus spécifiquement pour une situation de recherche. Dans un deuxième temps, je me suis engagé dans une démarche de stabilisation conduisant à la production de logiciels utilisables et fonctionnels, selon une tendance instrumentale visant à équiper et susciter le développement de pratiques de publication-comme-enquête. Dans un dernier temps, ces logiciels sont devenus le cadre pour de nouvelles pratiques expérimentales en cours ou à venir, ainsi que pour la fabrication itérative de cette thèse. Une telle trajectoire dessine ainsi un espace de possibilités pour les rôles que peuvent prendre les pratiques de design au sein des collectifs de recherche en SHS, sur le registre d’une contribution réciproque entre les dimensions expérimentales et instrumentales d’une tellle activité.
. Dans ce territoire, je peux alors tracer les différents déplacements qu’a produit l’enchaînement de dérivations qui a caractérisé par pratique du design. Ainsi, dans un premier temps, via une attitude d’équipement conduisant au bricolage de moyens existants, les situations de collaboration rencontrées dans le cadre de ma recherche m’ont conduit à participer à la fabrication de documents-publications expérimentaux dont les formats furent conçus spécifiquement pour une situation de recherche. Dans un deuxième temps, je me suis engagé dans une démarche de stabilisation conduisant à la production de logiciels utilisables et fonctionnels, selon une tendance instrumentale visant à équiper et susciter le développement de pratiques de publication-comme-enquête. Dans un dernier temps, ces logiciels sont devenus le cadre pour de nouvelles pratiques expérimentales en cours ou à venir, ainsi que pour la fabrication itérative de cette thèse. Une telle trajectoire dessine ainsi un espace de possibilités pour les rôles que peuvent prendre les pratiques de design au sein des collectifs de recherche en SHS, sur le registre d’une contribution réciproque entre les dimensions expérimentales et instrumentales d’une tellle activité.
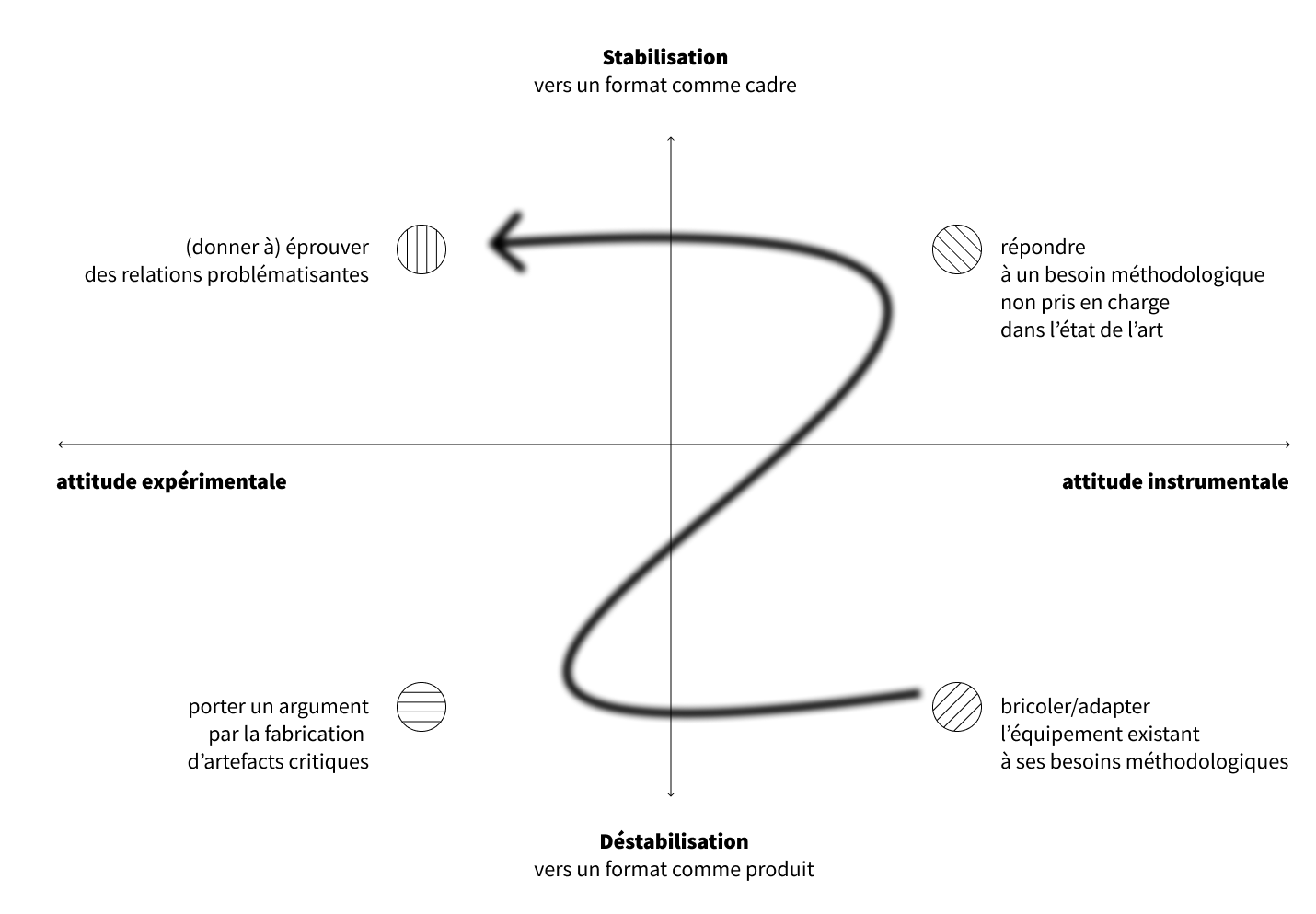 . Dans ce territoire, je peux alors tracer les différents déplacements qu’a produit l’enchaînement de dérivations qui a caractérisé par pratique du design. Ainsi, dans un premier temps, via une attitude d’équipement conduisant au bricolage de moyens existants, les situations de collaboration rencontrées dans le cadre de ma recherche m’ont conduit à participer à la fabrication de documents-publications expérimentaux dont les formats furent conçus spécifiquement pour une situation de recherche. Dans un deuxième temps, je me suis engagé dans une démarche de stabilisation conduisant à la production de logiciels utilisables et fonctionnels, selon une tendance instrumentale visant à équiper et susciter le développement de pratiques de publication-comme-enquête. Dans un dernier temps, ces logiciels sont devenus le cadre pour de nouvelles pratiques expérimentales en cours ou à venir, ainsi que pour la fabrication itérative de cette thèse. Une telle trajectoire dessine ainsi un espace de possibilités pour les rôles que peuvent prendre les pratiques de design au sein des collectifs de recherche en SHS, sur le registre d’une contribution réciproque entre les dimensions expérimentales et instrumentales d’une tellle activité.
. Dans ce territoire, je peux alors tracer les différents déplacements qu’a produit l’enchaînement de dérivations qui a caractérisé par pratique du design. Ainsi, dans un premier temps, via une attitude d’équipement conduisant au bricolage de moyens existants, les situations de collaboration rencontrées dans le cadre de ma recherche m’ont conduit à participer à la fabrication de documents-publications expérimentaux dont les formats furent conçus spécifiquement pour une situation de recherche. Dans un deuxième temps, je me suis engagé dans une démarche de stabilisation conduisant à la production de logiciels utilisables et fonctionnels, selon une tendance instrumentale visant à équiper et susciter le développement de pratiques de publication-comme-enquête. Dans un dernier temps, ces logiciels sont devenus le cadre pour de nouvelles pratiques expérimentales en cours ou à venir, ainsi que pour la fabrication itérative de cette thèse. Une telle trajectoire dessine ainsi un espace de possibilités pour les rôles que peuvent prendre les pratiques de design au sein des collectifs de recherche en SHS, sur le registre d’une contribution réciproque entre les dimensions expérimentales et instrumentales d’une tellle activité.Un geste performatif, multimodal et investigatif
La trajectoire méthodologique suivie dans le cadre de cette recherche a par ailleurs un effet sur la manière dont cette enquête sur le vacillement des formats se voit écrite. Dans la mesure où la présente thèse mobilise elle-même les expérimentations qu’elle relate, ce parcours a construit dans une même correspondance son objet d’étude, son propos et sa propre infrastructure de publication, et fait dialoguer diverses pratiques d’écriture – qu’elles soient prose, dessin, ou programmation informatique. C’est donc un geste performatif de reconstitution des enjeux du vacillement des formats qui, en faisant vaciller les formats de la présente publication, constitue une démarche de publication performative41 visant à incarner son propos dans son mode de matérialisation.
Cependant, c’est aussi un geste multimodal dans la mesure où il s’inscrit dans le désir de faire dialoguer des pratiques de fabrication avec des pratiques d’enquête en reprenant et en retravaillant des matériaux avec leurs propres techniques d’écriture. En cela, ma démarche s’inscrit bien dans le registre d’une fabrication critique visant à faire dialoguer des pratiques matérielles et des pratiques discursives (Ratto, 2011) plutôt qu’à illustrer ou à démontrer des concepts ou des « théories » préexistantes. Via le dialogue avec des matériaux de recherche inconnus qu’implique un geste multimodal, ce dernier participe aussi d’une remise en lumière des modèles performés dans le cadre des pratiques normales de publication. En ce sens, la mise en œuvre cette trajectoire a permis de faire constamment jouer la distinction entre « service » et « recherche » dans les institutions universitaires : elle a successivement relevé de ces deux dimensions en alternant entre des attitudes instrumentales et des attitudes expérimentales. Ensuite, elle a aussi travaillé la frontière qui existe entre pratiques d’enquête, pratiques d’écriture et pratiques de publication, via les agencements hybrides que les dérivations entre les situations de fabrication ont notamment produit.
Enfin, une trajectoire de dérivation par le design est une pratique investigative dans la mesure où elle est l’occasion d’une série de pratiques de documentation et de développement ancrées dans les enjeux de conception de chacune des situations de fabrication rencontrées. Ces dernières constituent alors des lieux d’investigation bibliographique et empiriques depuis lesquels peuvent être produits des études de cas, des démarches d’équipement conceptuel et le lieu de production de matériaux « discursifs » pour la recherche. En ce sens, en guise d’exemple, les travaux de conception et de fabrication de Dicto m’ont amené à comparer différentes versions de la notion des « données de recherche » et son rôle hétéroclite dans les pratiques de publication, suivant qu’on l’entende dans le champ des pratiques de recherche en SHS, de l’informatique ou des métiers de l’édition. Dicto m’a également conduit à approfondir mes lectures sur les relations épistémologiques et méthodologiques qui s’établissent entre terrain et écriture, abordées dans le chapitre 3. Le travail de Peritext, quant à lui, m’a notamment conduit à me rendre davantage attentif à la performativité transactionnelle (Johanna Drucker & Svensson, 2016) des technologies d’écriture en recherche et à la mettre en regard avec les multiples modulations impliquées par la collaboration interdisciplinaire. Quant à la distinction entre « contenu » et « présentation » abordée dans le chapitre 2, cette dernière est au centre des expérimentations sur les représentations intermédiaires qui seront détaillées par la suite dans ce chapitre. Ces situations de design ont donc été à la fois un « véhicule pour l’enquête » (Matthews & Wensveen, 2015), un terrain d’investigation et une contribution en tant que telles à la présente recherche. Il s’agit maintenant de définir ce qu’une pratique de fabrication-comme-enquête en design peut apporter dans ce contexte.
La fabrication-comme-enquête comme pratique située, réflexive et expérimentale
Il s’agit maintenant de qualifier les différents effets méthodologiques et épistémologiques du geste méthodologique conduit à travers cette recherche. Le premier de ces effets est la dimension nécessairement située des connaissances élaborées selon cette manière de faire la recherche en design. L’enquête en design menée dans le cadre de cette thèse a en effet été conduite depuis une petite quantité de laboratoires, de collaborations et d’environnements qui ont fait naître les pratiques depuis des situations spécifiques. Elle s’inscrit en ce sens en partie en résonance avec des pratiques contemporaines de la recherche en design participatif consistant à ancrer la recherche dans la pratique de la « résidence » (Gourlet, 2018) ou de « l’immersion » (K. W. Hall et al., 2019). Une telle approche conduit à la formulation de « méthodes situées » (Nielsen et al., 2014) qui ont des implications pour le type de connaissances produites mais aussi pour les relations qu’elles impliquent vis-à-vis des productions disciplinaires existantes. En ce sens, dans le champ de l’anthropologie du design, Lucy Suchman a proposé une reconceptualisation des pratiques de conception comme des activités situées dans un ensemble de réseaux et de pratiques et liées aux méthodes et savoirs qui peuvent les aider sous la forme de ressources – plutôt que de « recettes » ou, dans le vocabulaire de cette recherche, de matériaux plutôt que de modèles gouvernant à priori les pratiques (Suchman, 2006). Cette dimension « opportuniste » de l’enquête en design conduit ainsi à un rapport souple avec les équipements discursifs des autres disciplines qui peuvent être adaptés, combinés ou « retournés » (Gentès, 2015) en fonction de la pertinence de la situation.
Ensuite, cette trajectoire est réflexive, dans le sens où elle engage, par la dérivation entre les situations qu’elle implique, à faire retour sur les manières de faire et formuler les enseignements appris. À ce titre, les travaux du chercheur Donald Schön (Schon, 1984), semblent pertinents pour décrire les effets d’une trajectoire de dérivation en recherche. Les concepts de réflexion en action et de conversation avec le « matériau de la situation » – comme moyens de comprendre dans la pratique des designers – sont en ce sens les instruments d’un mode d’interprétation spécifique qu’il me semble avoir expérimenté dans mes trajectoires de fabrication. Dans le cadre d’une pratique située, par ailleurs, cette dimension réflexive est « contagieuse » dans la mesure où elle peut infuser les pratiques des collectifs dans lesquels elle est intégrée.
Enfin, cette trajectoire est expérimentale, dans la mesure où, même si elle a pu présenter des finalités précises à un moment ou un autre de son développement, elle est mue par un mouvement de correspondance avec chacune des situations qu’elle rencontre dont l’aboutissement n’a pas été défini par avance et ne peut être complètement défini. Il faut cependant d’abord interroger ce que l’on peut entendre par « expérimentation » dans le champ contemporain des SHS, et prendre quelques précautions vis-à-vis des implications de ce terme. Johanna Drucker a ainsi qualifié de « poussières de pixel » (« pixel dust ») une approche de l’expérimentation dans les SHS qui prendrait pour horizon un solutionnisme technologique susceptible d’économiser les temps et les efforts nécessaires à la conduite de la recherche (Johanna Drucker, 2014b). Dans la même perspective, depuis le champ voisin des cultural studies, Janneke Adema a appelé à distinguer deux acceptions de la notion d’expérimentation (Janneke Adema, 2012b) : la première viserait, via un processus dont la finalité serait l’innovation, à rentabiliser les investissements effectués dans lʼUniversité. La seconde version de l’expérimentation, cela dit, est comprise comme une expérience à même de questionner le cadre intellectuel depuis lequel elle est formulée. Elle engage alors l’expérimentation comme un moyen de générer des espaces d’altérité à l’intérieur de l’institution, participant d’un accès ouvert radical qui questionne les limites et les conditions de formation sociale des collectifs de recherche. Au moins dans sa dimension performative et démonstrative de manières alternatives de faire de la publication, cette recherche s’inscrit dans un positionnement similaire.
Par ailleurs, du point de vue de la valeur méthodologique de l’expérimentation, Tim Ingold conçoit aussi lʼactivité d’expérimentation comme une méthode dʼélaboration de connaissance de lʼintérieur plutôt que comme l’exploitation de « données » permettant de séparer le « vivre » et le « connaître ». Il approche à ce titre des pratiques comme celle de lʼobservation participante en tant que manière dʼapprendre de son terrain plutôt que dʼapprendre à propos de lui. Dans la lignée de l’art de l’enquête prôné par Ingold, les expérimentations que j’ai conduites ont d’abord été le moyen de prendre connaissance d’un objet et d’en explorer les enjeux, mais également d’entrer en correspondance avec ce dernier. Lʼexpérimentation est alors saisie comme l’occasion d’un cheminement intellectuel plutôt que comme l’évaluation dʼhypothèses ou la résolution de problèmes :
Dans lʼart de lʼenquête, le développement de la pensée accompagne et répond continuellement aux flux des matériaux avec lesquels nous travaillons. Ces matériaux pensent en nous comme nous pensons à travers eux. Ici, chaque mise en œuvre constitue une expérimentation, non pas au sens où lʼentendent les sciences de la nature (comme mise à lʼépreuve dʼhypothèses prédéfinies), et pas davantage au sens technologique dʼune confrontation entre des idées ‹ dans la tête › et des faits ‹ sur le terrain ›, mais plutôt au sens dʼun éclaireur qui fraye un chemin et poursuit sa route pour voir où elle le conduit. (Ingold, 2013/2017, p. 32)
L’expérimentation se présente alors comme une attitude et une méthode d’enquête en soi, et le rapport des pratiques de design numérique et de développement informatique à l’œuvre peut alors être décrit comme une expérience d’engagement et d’investissement plutôt que de collecte. En ce sens, quand Tim Ingold fait valoir les similarités entre son approche de l’anthropologie comme « art de l’enquête » et les pratiques de design42 , il pointe la dimension nécessairement située des pratiques concernées et propose de les recadrer comme « engagement observationnel » et une pratique de « correspondance » avec les parties prenantes de la recherche plutôt que comme une pratique de résolution rationnelle de problèmes définis :
Le design, lui aussi, évite le clivage entre les données et la théorie. Il ne procède pas par la collecte de données puis ensuite leur théorisation ; il propose plutôt ses expériences et ses improvisations comme des interventions imaginatives nourries par des engagements observationnels dans le monde. Comme les interventions de l’observation participante anthropologique, elles sont proposées comme des moyens de se joindre aux gens pour avancer dans leur vie, plutôt que comme des moyens de collecter du « matériel » sur eux ou à leur sujet. Et elles constituent en même temps un processus dʼapprentissage, une éducation de lʼattention – une façon de regarder des choses familières rendues inhabituelles par lʼintroduction de nos propres inventions. En dʼautres termes, le design est une pratique de ce que jʼappelle la correspondance, formellement analogue à lʼobservation participante.43 (Ingold, 2015, p. 6)
En ce sens, la pratique de dérivation mise en œuvre dans cette recherche me semble avoir relevé d’une expérimentation sur le double plan du questionnement social et politique qu’elle génère dans les collectifs où elle est située, et de l’attitude « d’engagement observationnel » ouvert qui l’a motivée. Ainsi, les qualités située, réflexive et expérimentale induites par la trajectoire de cette recherche ont permis de documenter les articulations à l’œuvre dans la fabrication puis le travail des formats de publication de la recherche en SHS par des pratiques de design. Il faut maintenant décrire les effets d’un design des formats du point de vue des productions, ou des traces, laissées par une telle démarche, et qualifier à leur tour leur statut pour la présente recherche en design.
Équiper les pratiques de publication-comme-enquête : entre formats-cadres et formats-produits
Il s’agit maintenant de revenir sur les produits de mes expérimentations de design et de qualifier les tensions révélées par leur fabrication dans le cadre de la présente enquête. Pour ce faire, je vais dans un premier temps décrire de manière détaillée les principes et les modalités de fonctionnement de la version stabilisée du projet Peritext présenté précédemment. Dans un second temps, je décrirai les articulations qu’une telle production questionne et perturbe dans le champ des pratiques de publication en SHS. Je reviendrai ensuite, sur un plan épistémologique et méthodologique, sur le statut de tels produits dans le cadre d’une recherche en design, en puisant dans la littérature de la recherche en design et des humanités numériques, pour proposer une requalification du statut des « outils » de recherche produits en contexte universitaire.
Les intentions d’un format d’écriture et d’édition expérimental
Peritext est le nom d’un ensemble hétéroclite d’expérimentations matérielles et discursives, composées de principes et de modèles documentaires, de bibliothèques de code44 , de gabarits graphiques et interactifs pour une diversité de supports et de logiciels utilisables par une diversité d’acteurs45 . L’ensemble de ces éléments, regroupés sur la plateforme de partage de code et de collaboration github, est accessible sous la forme de 38 « dépôts de code source » disponibles en open source et réutilisables grâce à leur publication sous licence libre AGPL (GNU Affero General Public License 3.0, 2007). Ces derniers contiennent parfois du code source réutilisable, la documentation des différents sites ayant visé à partager les expérimentations, ou des exemples de réalisations. Ils constituent pour ainsi dire l’archive de cette trajectoire de recherche par la fabrication, donnant à voir les différents mouvements de composition, simplification, ou déclinaison précédemment décrits. Il s’agit maintenant d’en décrire la version stabilisée au moment du dépôt de cette thèse, d’abord à partir des objectifs instrumentaux principaux de l’expérimentation.
Écrire au plus près des matériaux de recherche
Le modèle de données proposé par Peritext46 vise à permettre diverses stratégies dʼécriture ancrée dans une relation très proche aux matériaux (données, sources, documents, …) récoltés durant une recherche. Il vise donc à équiper des méthodologies de recherche dans lesquelles la relation entre, d’une part, la collecte et l’élaboration privée des arguments, et d’autre part, l’écriture et la publication du travail de recherche au contact des publics concernés, ne se voient pas séparées et divisées par l’utilisation d’outils spécialisées, mais envisagés dans un mouvement continu et itératif.
Pour écrire « au plus près des matériaux », Peritext se fonde sur le principe selon lequel n’importe lequel des éléments élaborés au cours d’une recherche devrait pouvoir être le point de départ d’un travail d’écriture, ou l’un des composants d’un travail d’architecture éditoriale.
De fait, du point de vue du format d’écriture proposé, dans les documents produits selon le modèle, des auteurs peuvent écrire des contenus tout autant à partir d’une image, que d’une vidéo, d’un fichier de données, d’une citation bibliographique, d’un lieu, d’une date, etc. On pourra ainsi écrire en partant dʼune référence bibliographique pour en consigner les notes de lecture, sʼattacher à une image particulière pour y développer son analyse, produire lʼexploration détaillée dʼun fichier de données à la manière dʼun notebook, etc.
Le projet ambitionne aussi de questionner la distinction entre l’écriture en prose effectuée par les chercheurs et toutes les formes d’écriture qui peuvent porter sur des matières « non-textuelles » – qu’il s’agisse d’images, de vidéos, de fichiers de données, ou d’éléments interactifs. Il vise ainsi à inviter les auteurs à entrelacer intimement texte et matériaux de recherche dans leur pratique d’écriture, via la composition de représentations numériques attachées à l’écrit strictement textuel et de représentations permettant de préciser rhétoriquement l’usage de tel ou tel matériau dans l’argumentation. Pour ce faire, il leur permet de spécifier de nombreux paramètres pour lʼintégration des matériaux de recherche dans les textes (ex. heure de début et de fin pour une vidéo, paramètres de visualisation pour un tableau de données, etc.). Il permet ainsi aux chercheurs, dans l’espace d’écriture proposé par le modèle, de comparer des fichiers de données via leur visualisation, de convoquer des extraits dʼentretiens spécifiques, de mettre en scène lʼanalyse de vidéos et autres images, etc.
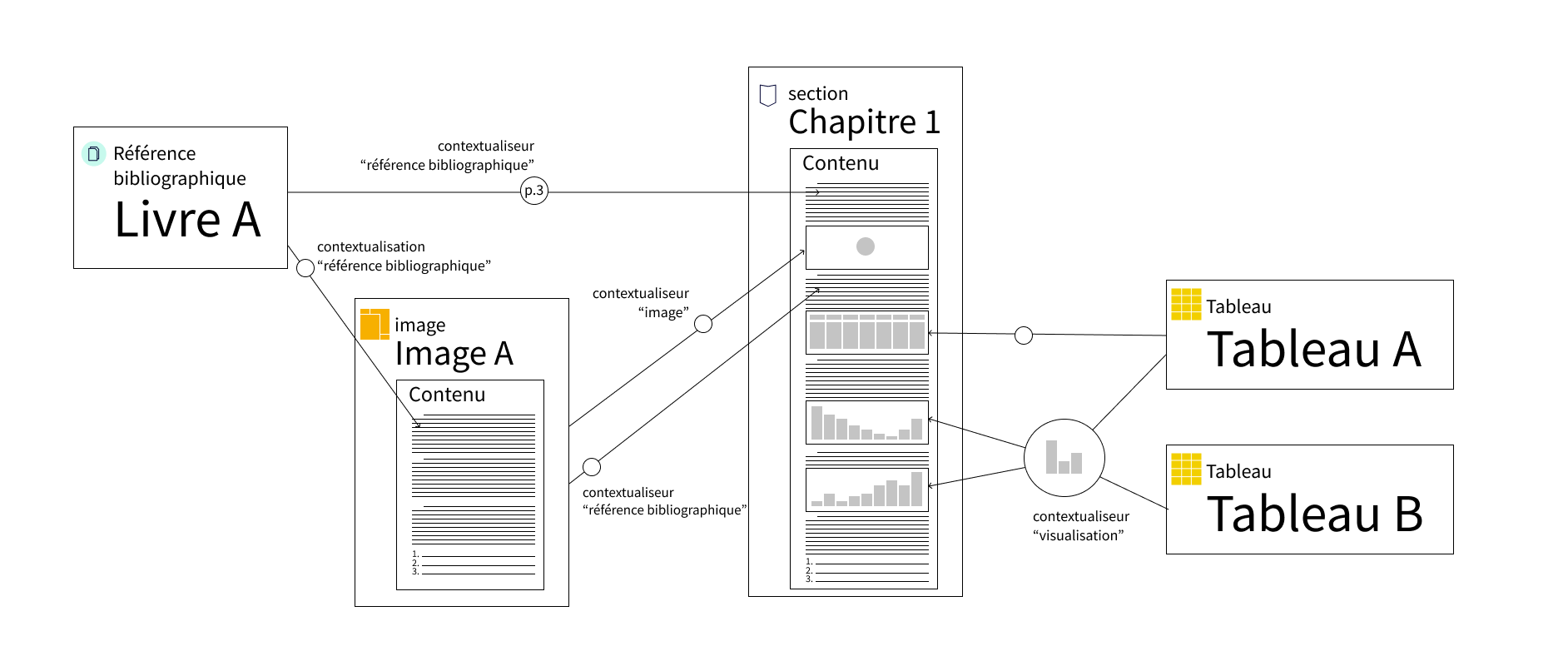
Enfin, la troisième ambition du projet est de permettre aux auteurs de prendre en compte la dimension multi-support de la publication de leur travail dans le temps même de l’écriture. Pour ce faire, la contextualisation de chaque matériau dans les contenus est aussi l’occasion d’un ensemble de décisions prises par les écrivains sur les modalités d’affichage et de mise en scène de chaque élément en fonction des supports. À la différence de systèmes industriels de type Create once publish everywhere (COPE) qui automatisent la déclinaison d’une source donnée pour une diversité de supports, ou de démarches artisanales qui produisent séparément chacune des versions d’une publication donnée, Peritext entend permettre une méthodologie souple dans laquelle un auteur peut à la fois écrire du contenu pour une diversité de support et, s’il le souhaite, mettre en place des stratégies sémiotiques élaborées pour sa déclinaison.
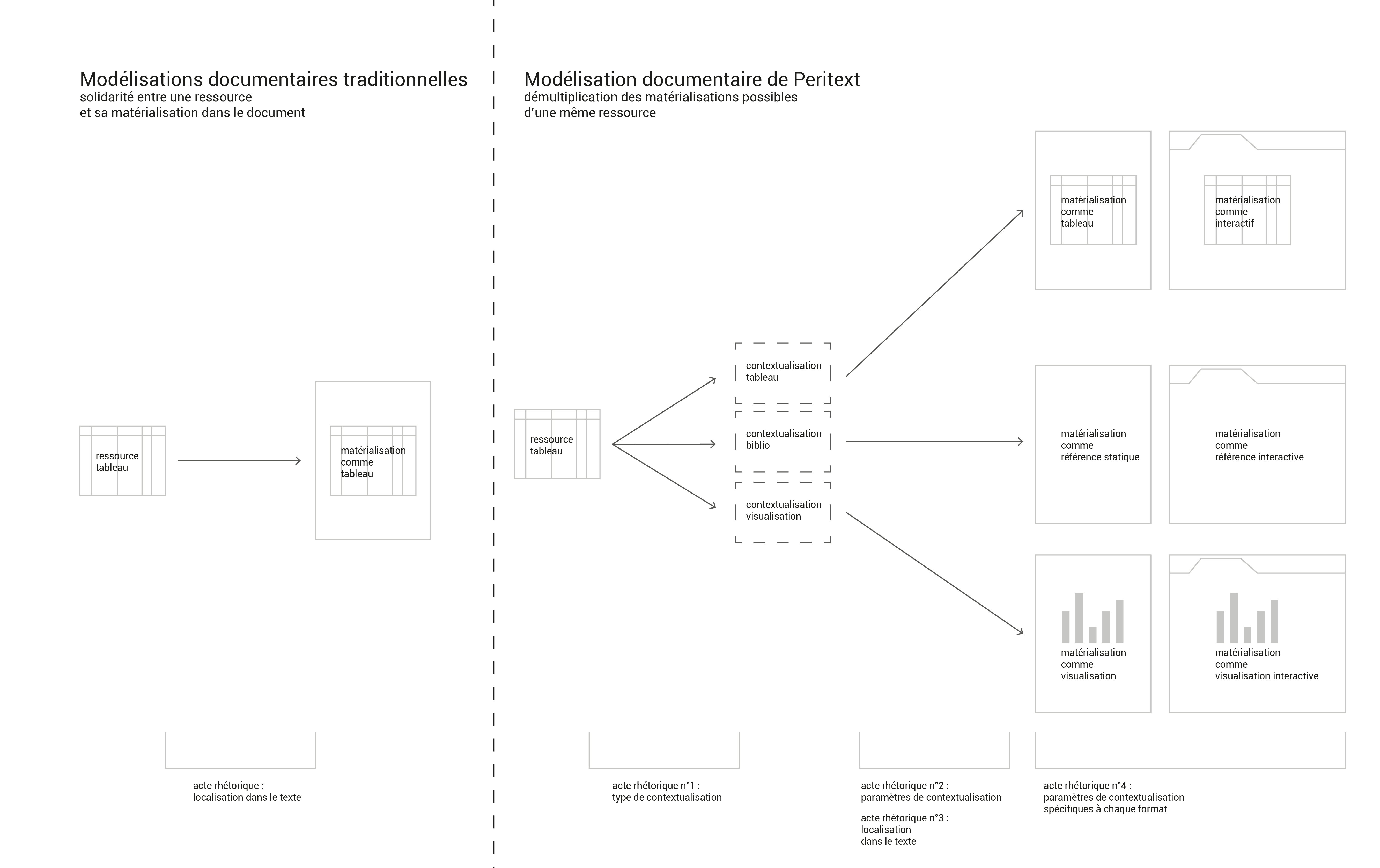
À partir de ces différentes ambitions du point de vue du format d’écriture proposé, Peritext vise également à permettre des pratiques éditoriales – qu’elles soient prises en charge par les chercheurs eux-mêmes ou par des acteurs tiers – différentes.
Éditer pour/par la multitude
Du point de vue du format éditorial, Peritext permet de structurer la présentation de contenus de recherche de manière traditionnelle (en chapitres et sous-chapitres) mais également dʼutiliser les différents « matériaux » dʼune recherche comme structure pour la composition des éditions. Il permet de mettre en œuvre ces différentes versions sous la forme d’une multitude d’éditions qui peuvent être destinées à l’impression ou à l’affichage à l’écran. Ces éditions peuvent être générées par les modules de Peritext afférents sous la forme de ressources prêtes à la publication, ou alors sous la forme de « semi-finis numériques » aptes à être entièrement modifiables et reprisables via d’autres outils plus spécialisés d’édition et de design graphique.
Ainsi, chaque édition dʼune production Peritext peut ainsi être conçue en fonction des objectifs, des publics ou du stade dʼavancement de la recherche (carnet de recherche, rapport dʼavancement, publication conclusive, etc.). Chaque édition est dotée d’une composition particulière qui définit quels matériaux de recherche ou d’écriture la composent, mais peut également être entièrement redesignée et faire l’objet d’un travail de design graphique et interactif spécifique.
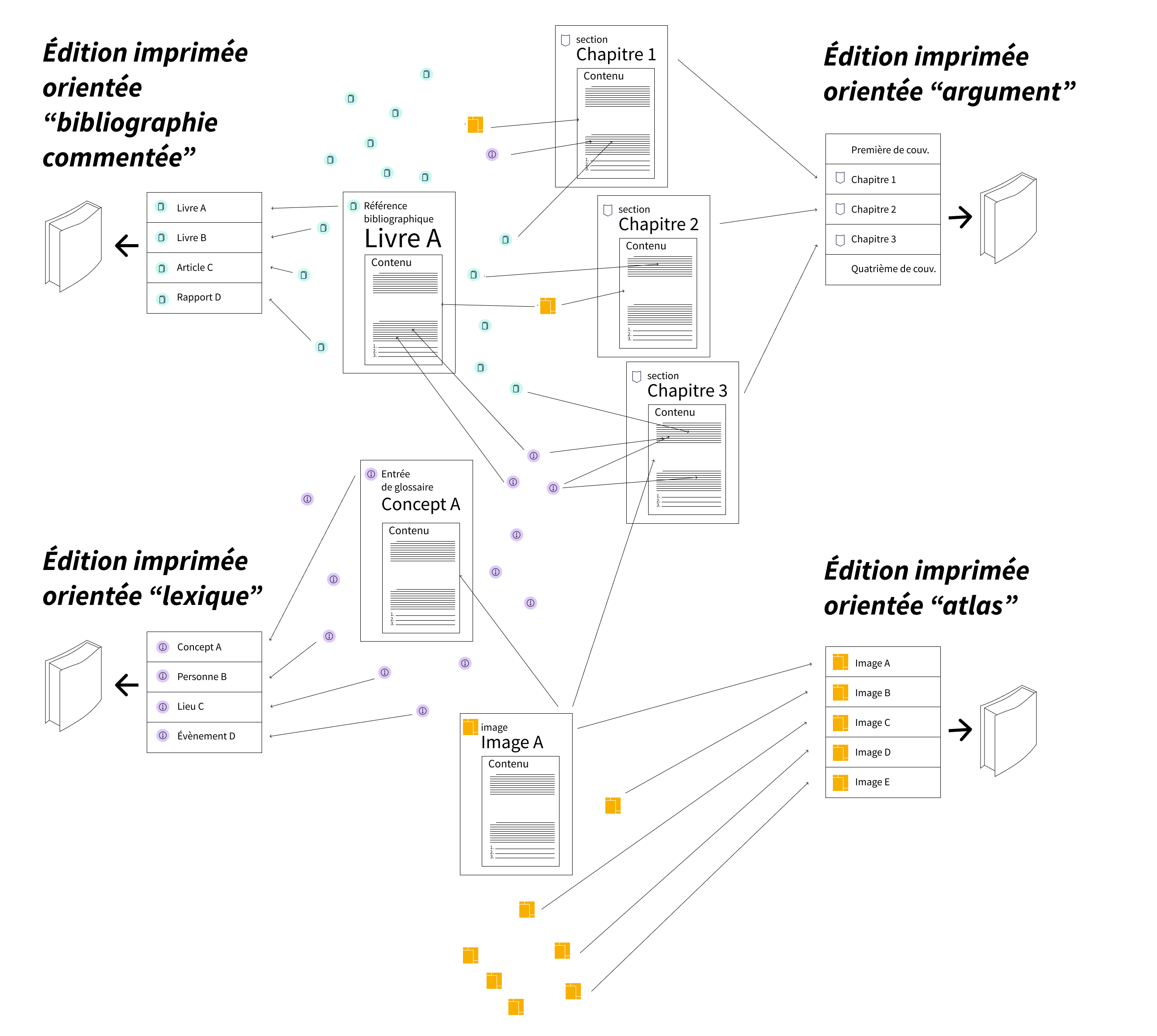
À partir dʼun corpus dʼécrits donné, Peritext permet ainsi de publier des travaux de recherche intermédiaires (working papers, éléments de carnets de recherche, publications adossées à des évènements de type séminaire, …), la publication de compagnons ou de pièces jointes à des publications scientifiques classiques, ou encore publication dans des contextes de publication savante connexes au champ proprement universitaire, tels que ceux du journalisme, de la publication savante amateure ou de lʼenseignement supérieur (mémoires, thèses,...). Peritext est adressé à des projets éditoriaux se situant à la marge des systèmes traditionnels de la publication scientifique, et est particulièrement adapté pour la production de formes rattachées à la littérature « grise », telles que « rapports d’enquête », « livres blancs », « working papers », mémoires et autres thèses, pour lesquelles des moyens éditoriaux ne sont pas prévus à l’avance. Il s’agit néanmoins de permettre à ces formes semi-conventionnelles de communiquer de manière satisfaisante avec le système de la communication scientifique d’un point de vue technique (être indexable) et méthodologique (être citable).
Des formats à un modèle de données
Peritext repose sur un modèle de données destiné à décrire et à manipuler des projets scientifiques et éditoriaux et leurs différentes publications, sous la forme dʼune abstraction informatique intitulée production. Le caractère générique du terme a été choisi pour autoriser de multiples formes d’appropriation, allant de la création de « dossiers » centrés sur un corpus ou un sujet de recherche, à des « projets » plus structurés et motivés par des stratégies éditoriales définies, telle que la production de livres ou de rapports.
Techniquement, ce modèle s’incarne dans un schéma de données, implémenté au moyen du formalisme JSON-schema (« JSON Schema », 2009), qui est lisible à la fois par des humains et par des machines, et permet de vérifier si des productions existantes sont valides vis-à-vis de la norme technique instituée par Peritext, ou bien d’en créer automatiquement de nouvelles, ou encore, pour les développeurs, de disposer d’un point de référence clair et exhaustif pour concevoir et programmer de nouveaux modules destinés à construire des logiciels qui suivent le format Peritext.
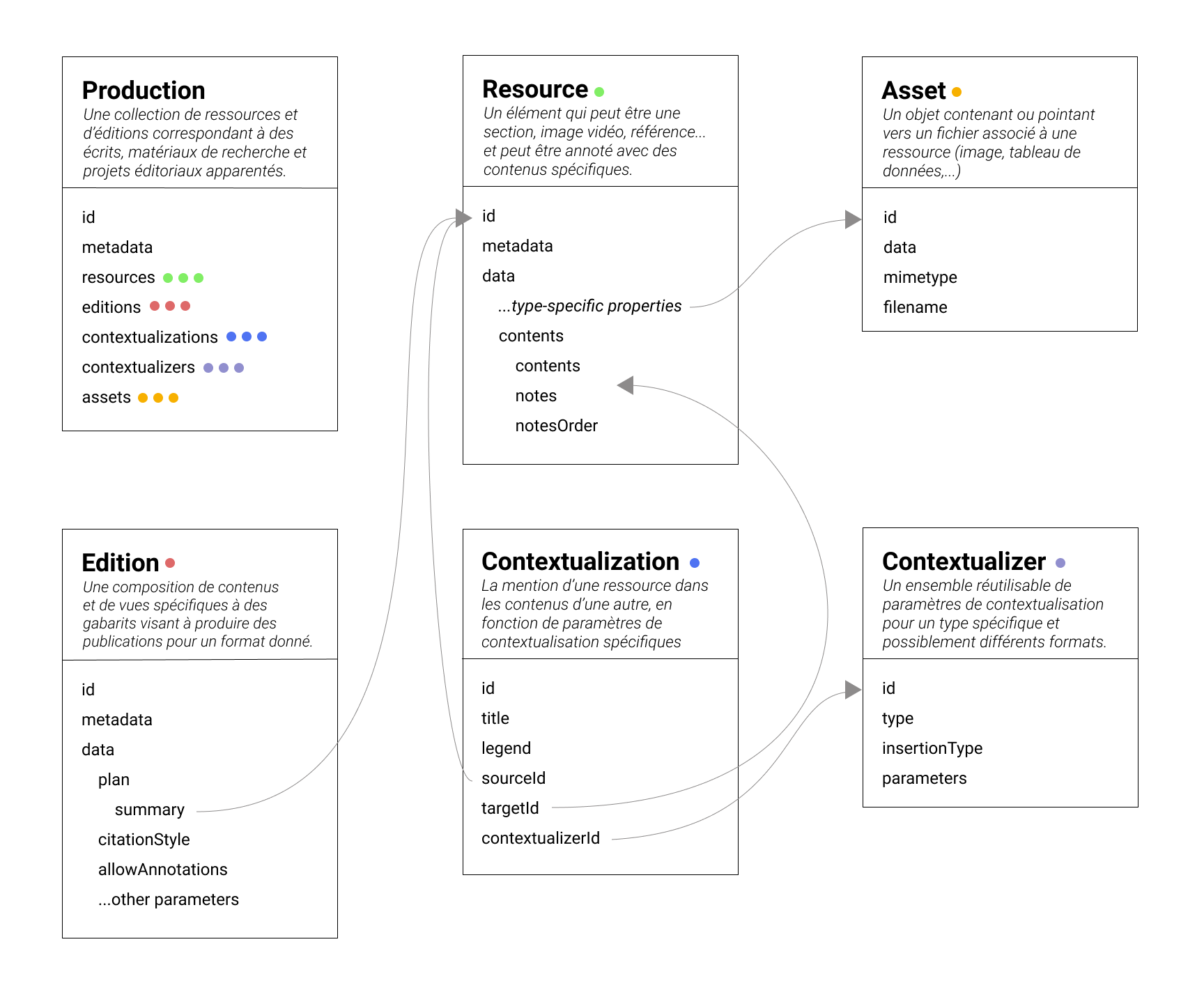
Outre sa dimension technique, le modèle de Peritext décrit une typologie d’objets informatiques et leurs relations, stabilisant les formats d’écriture et d’édition dans un formalisme technique. Ainsi, une production Peritext est un ensemble de collections dʼobjets informationnels dont les plus importants sont de trois types : les ressources, les contextualisations, et les éditions.
Ressources
Dans Peritext, une ressource désigne tout élément convoqué dans le cadre dʼune investigation ou dʼun projet dʼécriture : il peut s’agir d’une référence bibliographique, d’une entrée de glossaire, d’une vidéo, d’une image, etc. Cette liste est par définition extensible et adaptable à chaque contexte dʼécriture et de recherche, dans la mesure où la nature et le type des ressources n’est pas défini en propre par le modèle mais appelé à être précisé au moment de la construction d’une production ou d’un logiciel d’écriture spécifique.
Chaque ressource est associée avec des métadonnées (titre, auteurs, dates, …), décrites de manière homogène pour permettre répondre aux normes spécifiques à lʼédition scientifique en termes dʼindexation et de citabilité. Elle contient également des données spécifiques à son « type » (par exemple : une URL pour une vidéo, des coordonnées géographiques pour une entrée de glossaire de type « lieu », une chaîne de code source pour une ressource de type « code »).
Elle contient enfin des annotations sous la forme de contenus textuels, qui peuvent être de la longueur de quelques mots ou de plusieurs centaines de paragraphes, et contenir du texte simple comme des éléments avancés issus d’autres ressources (images, visualisations, vidéos, éléments interactifs). Via ce système d’annotation, chaque ressource peut être mobilisée dans les annotations de n’importe quelle autre.
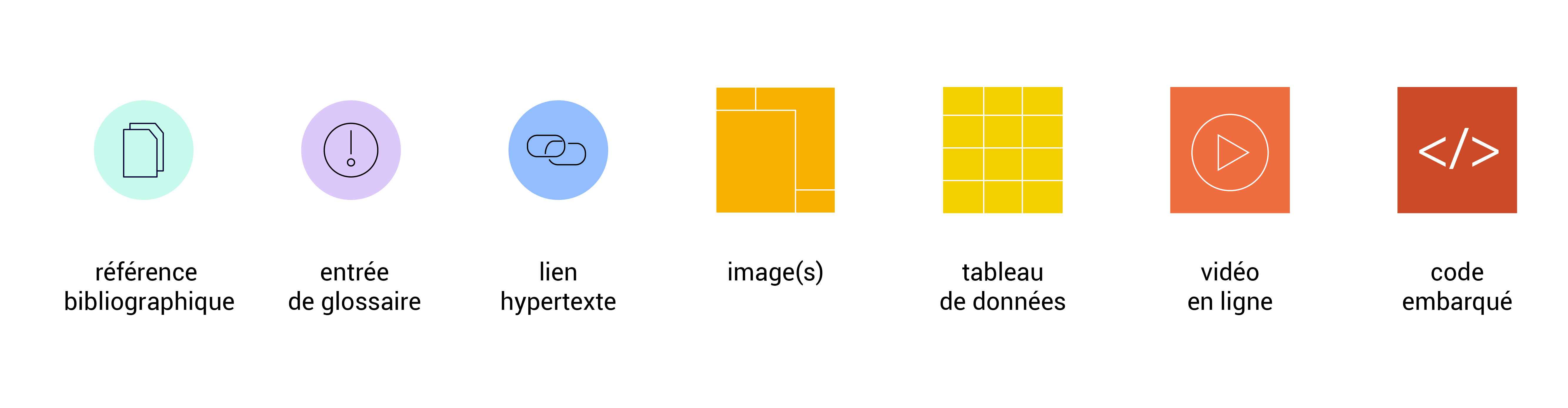
Dans ce cadre, le statut des éléments à dominante textuelle – ce qui deviendra plus tard des chapitres, des sections, des parties, etc. – sont définies par la négative : il s’agit de ressources qui ne sont associées à aucune donnée spécifique. Ces dernières sont appelées « sections », le choix du terme étant, comme pour l’appellation de « production », destiné à permettre la plus grande diversité d’appropriations possibles pour ce terme.
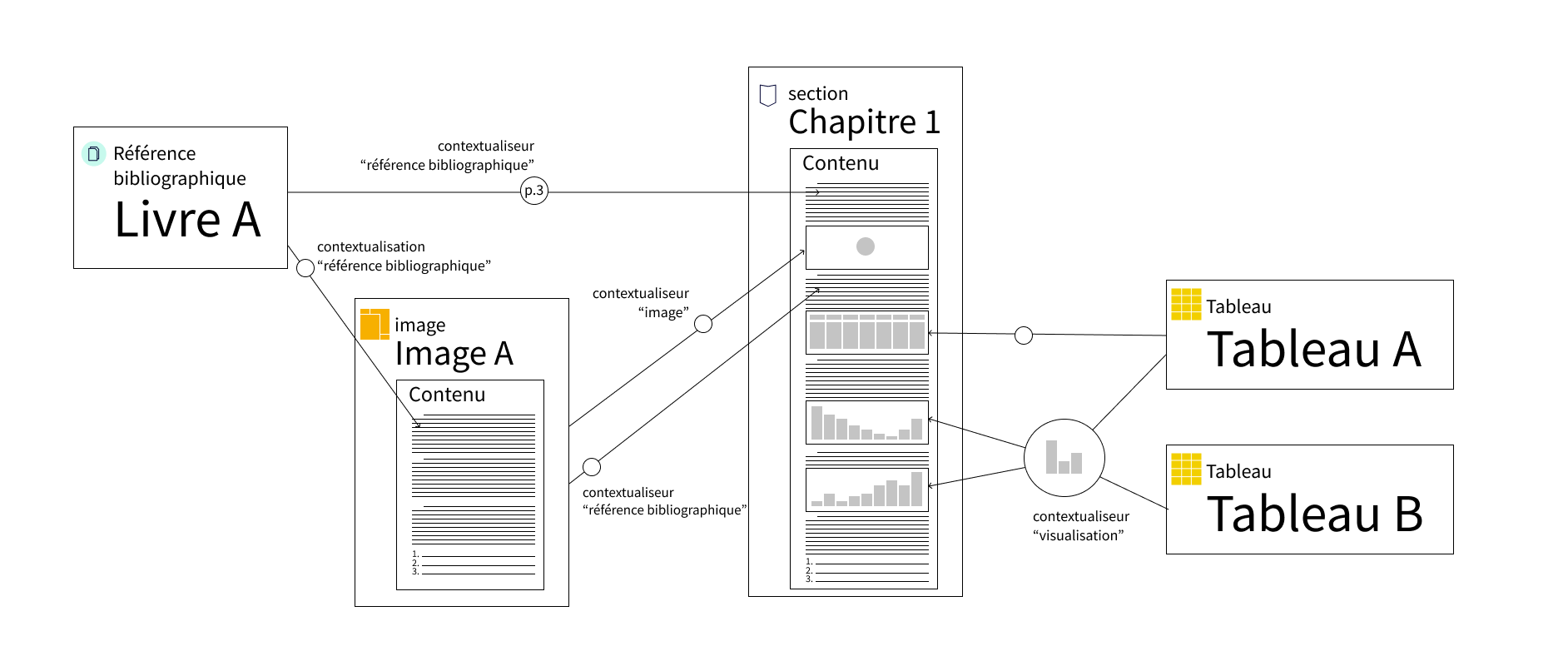
Le modèle de Peritext est ainsi un modèle « à plat » qui ne présuppose pas de hiérarchie dʼimportance entre éléments « à dominante textuelle » et « non-textuelle » et qui autorise une multitude de relations entre les différentes ressources ainsi définies. Ces dernières sont alors médiées par des paramètres de « contextualisation ».
Contextualisations et contextualiseurs
À l’intérieur des annotations – ou contenus – attachés à une ressource, Peritext permet de convoquer les données issues d’une autre ressource – par exemple, pour insérer une référence bibliographique, manifester une image, afficher un document audiovisuel. Dans ce contexte, les ressources convoquées dans une production Peritext et les différentes formes que ces dernières peuvent prendre dans le cadre de lʼargumentation opérée par un texte sont séparées, dans la lignée des méthodologies éditoriales dominantes qui séparent « contenu » et « présentation »47 . Cela dit, Peritext introduit un troisième terme dans cette relation en intégrant dans son modèle des objets médiateurs permettant de spécifier des modalités de mises en forme très précises en fonction des intentions rhétoriques des auteurs, sans pour autant qu’elles soient attachées à une forme ou un support de présentation prédéfini.
Ainsi, quand les données dʼune ressource se voient mentionnés dans les contenus d’une autre, cette relation est médiée par deux types dʼobjets :
- un contextualiseur, qui définit un ensemble de paramètres spécifiant comment la ressource source devrait être affichée dans les contenus de la ressource cible (en spécifiant par exemple un numéro de page) et potentiellement différenciant les différents formats de sortie (web ou imprimé).
- une contextualisation, qui décrit le point de jonction entre lʼidentifiant de la ressource cible, celui de la ressource source, et celui du contextualiseur utilisé pour établir la relation via un ensemble de modalités et de paramètres.
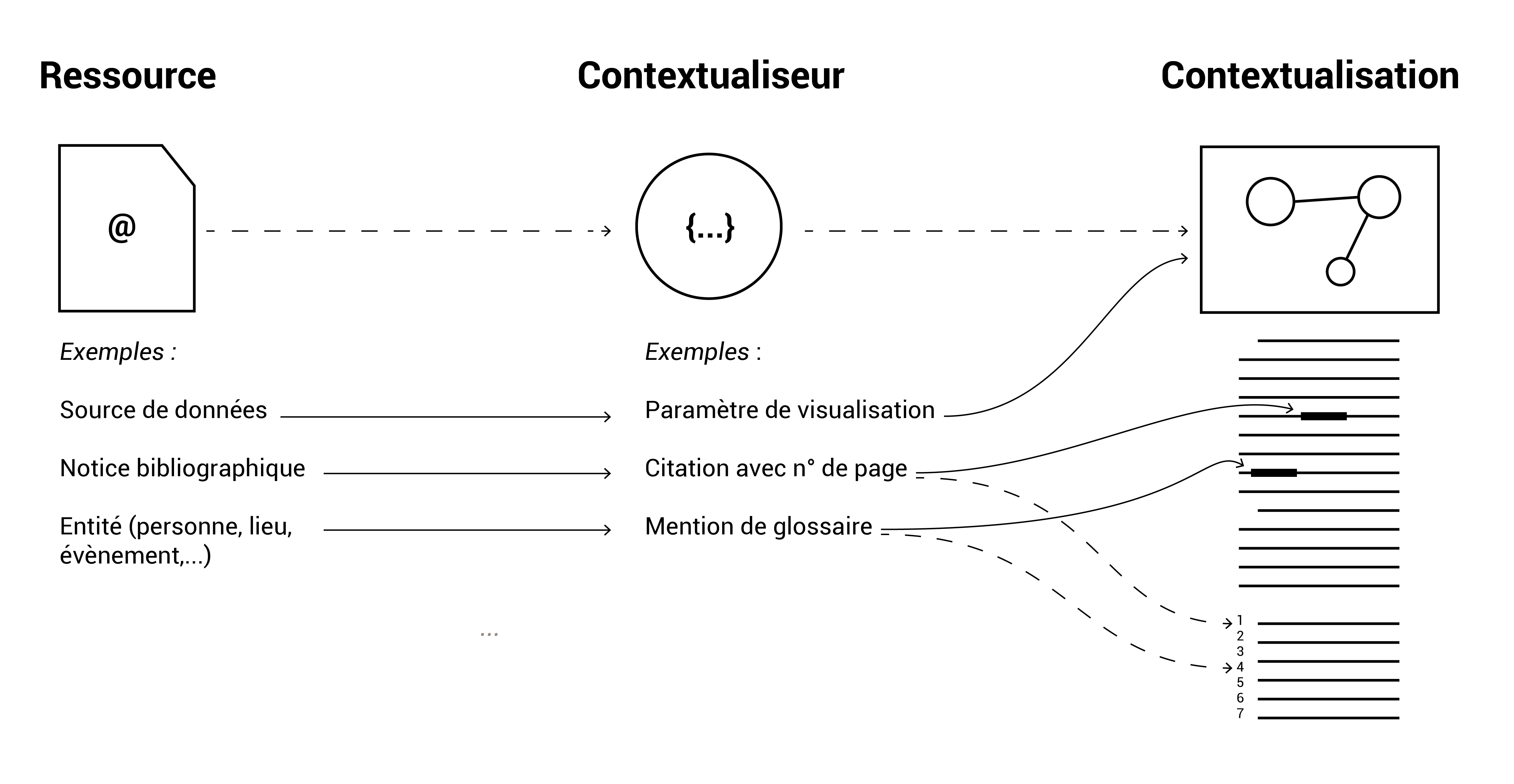
Entre la « ressource » et le « contenu » dans lequel elle est mobilisée, Peritext mobilise donc un troisième type d’objet voué à décrire la relation ainsi effectuée d’un point de vue plastique, sémiotique et technique. La contextualisation et le contextualiseur décrivent une manière de mettre en scène la ressource à un endroit précis des contenus, et en fonction des différents supports, mais ne figent pas encore de manière exacte les modalités de mises en forme dans lesquelles cette relation devra être finalement matérialisée.
Un tel principe permet une certaine finesse dans la manière dont les ressources sont convoquées au sein des contenus et autorise davantage de possibilités rhétoriques quant à la manière dʼécrire avec ces dernières, tout en maintenant une intégrité documentaire et en évitant les redondances d’information. Il permet également de réutiliser des paramètres de mise en forme complexe à plusieurs endroits dans les contenus des différentes ressources (par exemple pour comparer plusieurs jeux de données avec de multiples visualisations de données réalisées selon les mêmes paramètres).
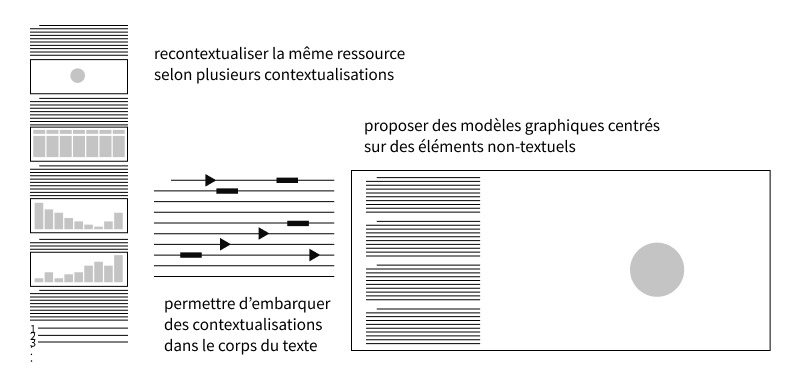
Ce faisant, le modèle Peritext permet dʼassocier une grande rigueur documentaire vis-à-vis de la mobilisation de « figures », « références » et autres éléments convoqués par les auteurs dans les textes, et de multiples possibilités sémiotiques et de design dans les choix de « contextualisation » effectués par les auteurs dans des contextes de publication multi-supports.
Éditions
Peritext permet par ailleurs la définition d’une série illimitée d’éditions visant à définir des modes de matérialisation spécifiques – à un support, un contexte et une temporalité de publication – à partir du corpus de ressources constitué par une publication. En cela, il autorise la fabrication d’une chaîne éditoriale complète (Crozat, 2012) dans la mesure où il représente à la fois un ensemble d’écrit et les différents paramètres permettant d’en tirer des objets prêts à la publication. Peritext entend cependant s’éloigner des systèmes entièrement automatisés de type « single source publishing ». En effet, le modèle de Peritext est conçu pour permettre la production dʼune diversité dʼédition tout en autorisant la reprise et le travail de chacune d’entre elles avec un degré important de spécificité et de précision.
Pour ce faire, une production Peritext contient un ensemble dʼobjets numériques intitulés éditions, qui agissent comme le patron ou le mode d’emploi pour la génération de documents-publications spécifiques à un support. Une édition est donc spécifique à un support donné (web ou imprimé). Par ailleurs, elle décrit une composition de contenus tirés de la production, et permet donc d’assembler une multitude de ressources – qu’il s’agisse de « sections » ou d’éléments à dominante non-textuelle – pour les besoins d’une publication particulière. Ainsi, par exemple, il est possible de composer une édition avec les ressources renseignées à une certaine période de temps (journal), celles attachées à un certain thème de la recherche (anthologie), ou encore de les assembler selon un ordre séquentiel destiné à faire la démonstration d’un argument (essai, thèse). Le « sommaire » de l’édition peut par ailleurs contenir des vues spécifiques qui utilisent la structure du modèle de Peritext pour fabriquer des dispositifs de lecture et d’apparat savant. Ces derniers peuvent être conventionnels (génération de glossaires, de bibliographies, de tables des matières) mais également proposer de nouveaux dispositifs, tels qu’une entrée par carte géographique, par graphe des relations entre les ressources, par frise chronologique, etc. Enfin, du point de vue de son design graphique et interactif, chaque édition peut faire l’objet de l’écriture de règles de mise en forme spécifiques48 qui permettent de définir un aspect graphique et des interactions propres.
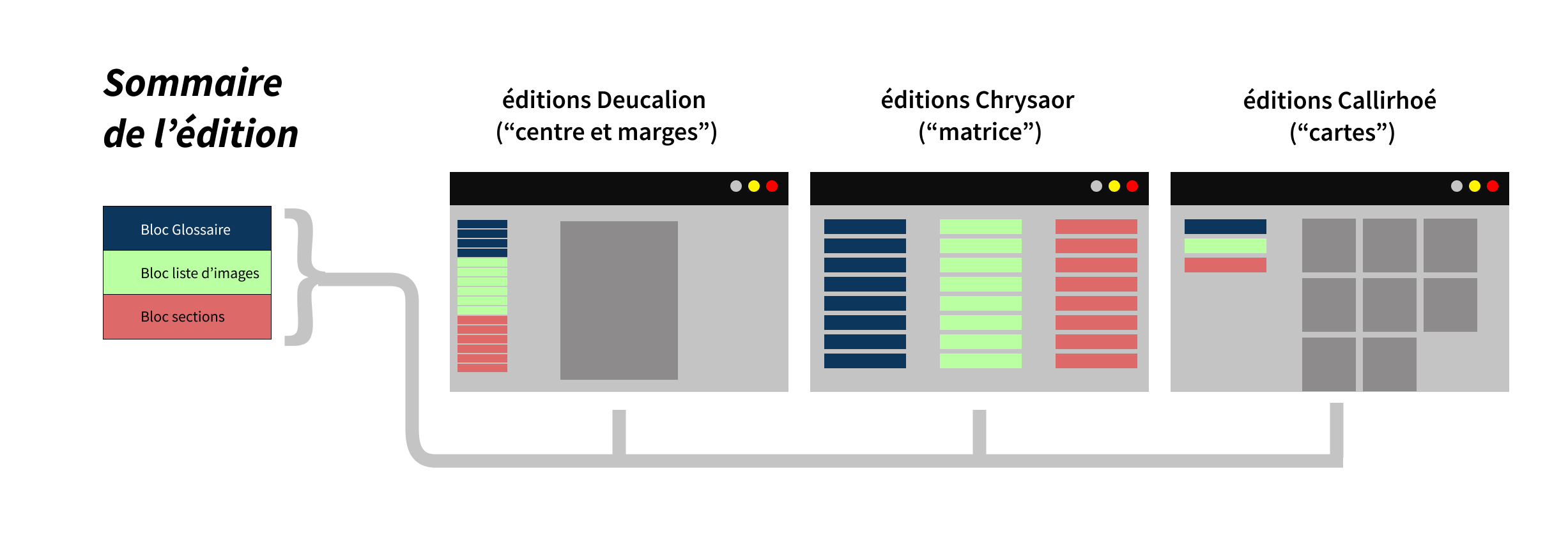
À travers le modèle de l’édition, Peritext entend permettre à la fois une facilitation de la production de projets éditoriaux se déployant sur une diversité de supports et de temporalités, et une grande liberté dans les modes de matérialisation des contenus dʼune production selon les supports et les contextes de publication.
D’un modèle de données à un programme d’écriture, d’édition et de design : le cas du logiciel Ovide
La version stabilisée du modèle de données Peritext s’articule avec une multitude de modules techniques qui en exploitent les possibilités, dont des logiciels à interface graphique qui permettent d’en faire l’épreuve à un public élargi de chercheurs, de designers et d’éditeurs. Dans ce contexte, le programme Ovide se présente comme le logiciel destiné à rendre sensibles, compréhensibles et propres à l’expérimentation les diverses dimensions du format stabilisé. À cause de l’évolution de ce projet parallèlement à l’écriture de la présente thèse – et donc de la maturation des concepts et des intentions qu’il est censé soutenir – le vocabulaire du logiciel Ovide est légèrement différent de celui du modèle Peritext à proprement parler, qui lui est antérieur. Le développement d’Ovide a par ailleurs été l’occasion d’expérimenter une interface visuelle dont l’organisation graphique et interactive a vocation à traduire les potentialités et la logique du projet Peritext et des intentions qui le sous-tendent.
Un éditeur pour les « productions » du modèle Peritext
Tout d’abord, Ovide permet de créer, modifier et enrichir une série de productions organisées selon le modèle de Peritext. Ces productions correspondent chacune à un ensemble de matériaux et de textes traitant dʼun sujet commun.
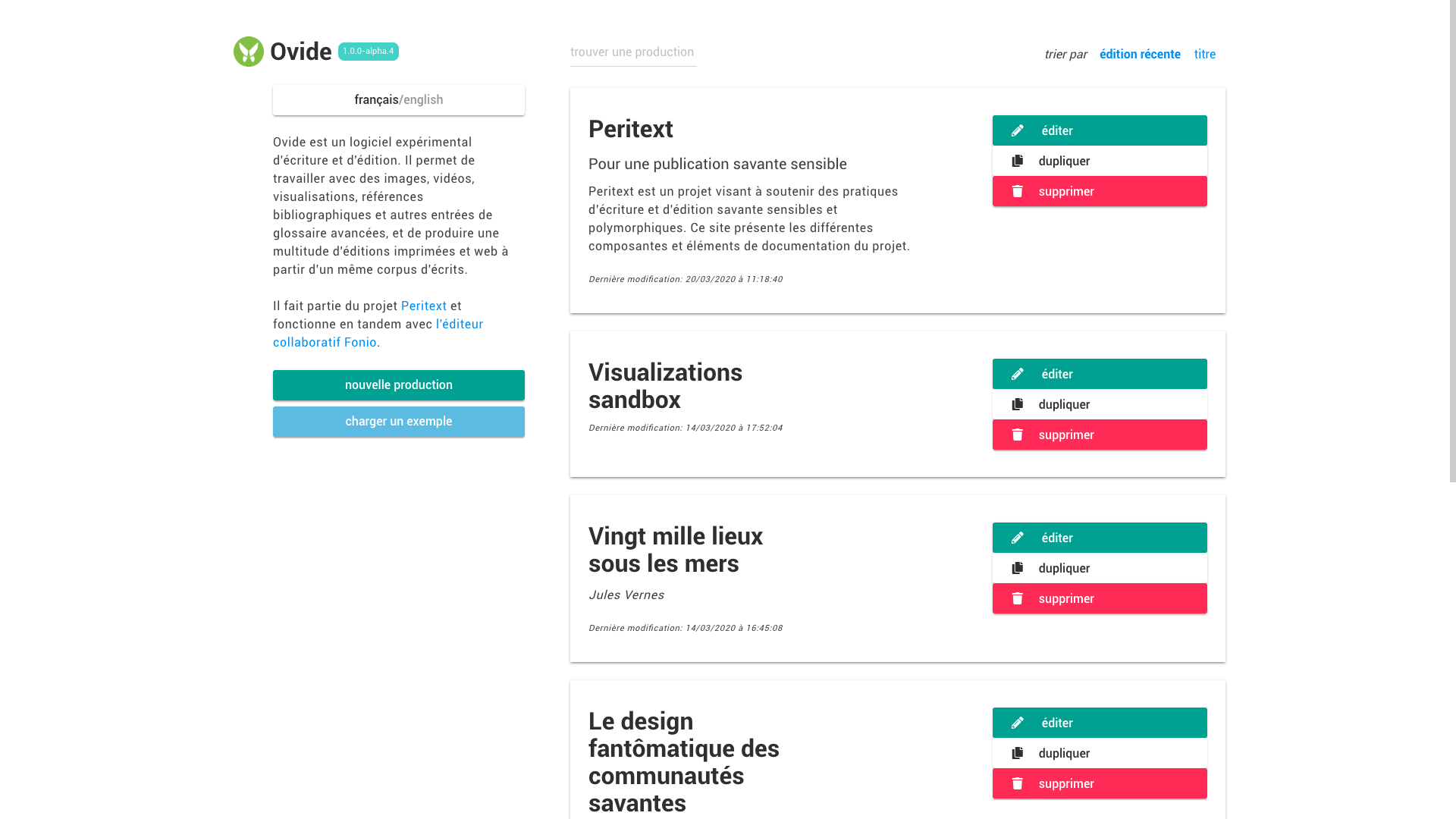
Ovide se présente comme une interface mono-utilisateur qui peut soit être utilisée directement en ligne, soit téléchargée sous la forme d’une application locale. Si elle n’est pas collaborative, elle est néanmoins pensée pour permettre un travail partagé dans la mesure où les productions peuvent être dupliquées, importées et exportées pour dʼautres utilisateurs ou dʼautres outils49 .
Le « matériau » comme unité de contenu hybride
Ovide propose de manipuler et dʼéditer une série d’éléments issus de l’enquête sous la forme de « matériaux », qui correspondent aux ressources spécifiées par le modèle de données Peritext50 . Sous cette dénomination, on retrouve à la fois des « notes » représentant des éléments à dominante textuelle qui pourront devenir des chapitres, sections, parties, etc. ; on retrouve également divers éléments paratextuels ou non-textuels issus des pratiques de recherche : entrées de glossaire, images, vidéos et autres médias audiovisuels éventuellement assortis de leur transcription, références bibliographiques, extraits de code, hyperliens vers des pages web, tableaux et fichiers de données.
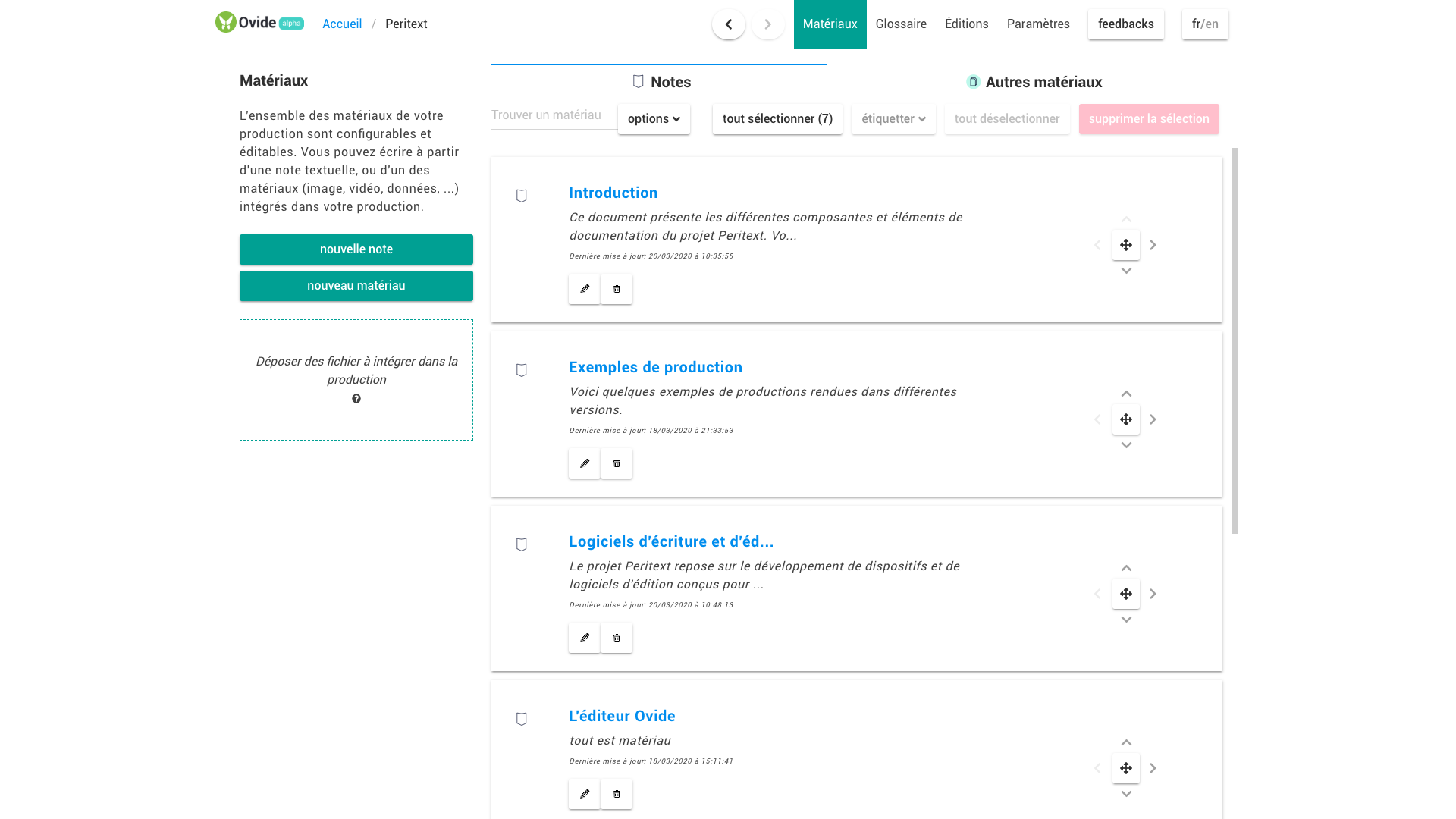
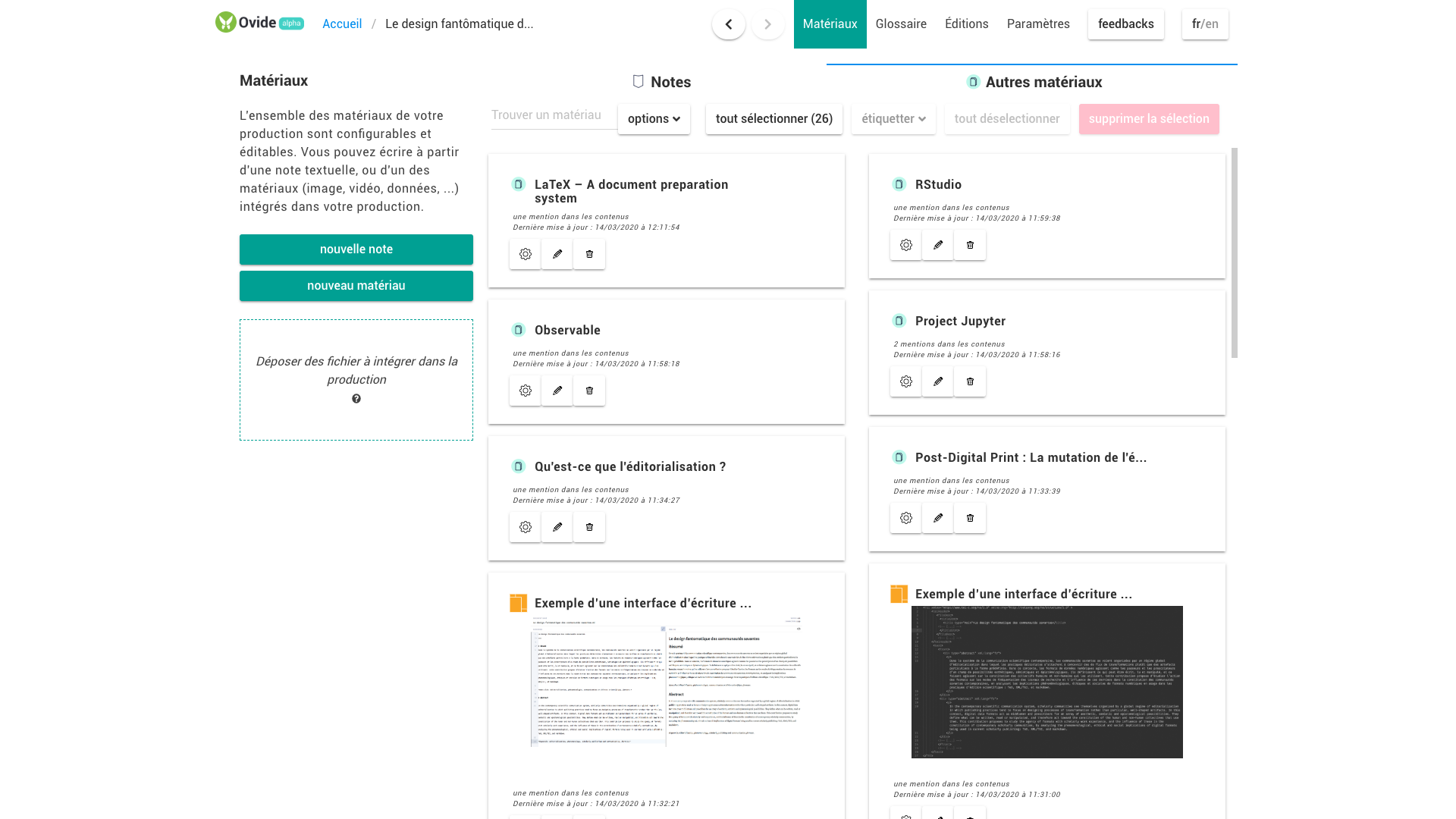
Chacun des matériaux peut alors être édité pour faire l’objet dʼun travail dʼécriture et dʼannotation. Il est ainsi possible d’écrire des contenus à l’intérieur d’une note, mais également à l’intérieur d’une image, d’une entrée de glossaire, d’une vidéo, d’un jeu de données. Pour permettre aux auteurs d’organiser leur travail et aux éditeurs/designers de constituer des éditions à partir des différents matériaux, chaque élément peut par ailleurs se voir attacher des « étiquettes ».
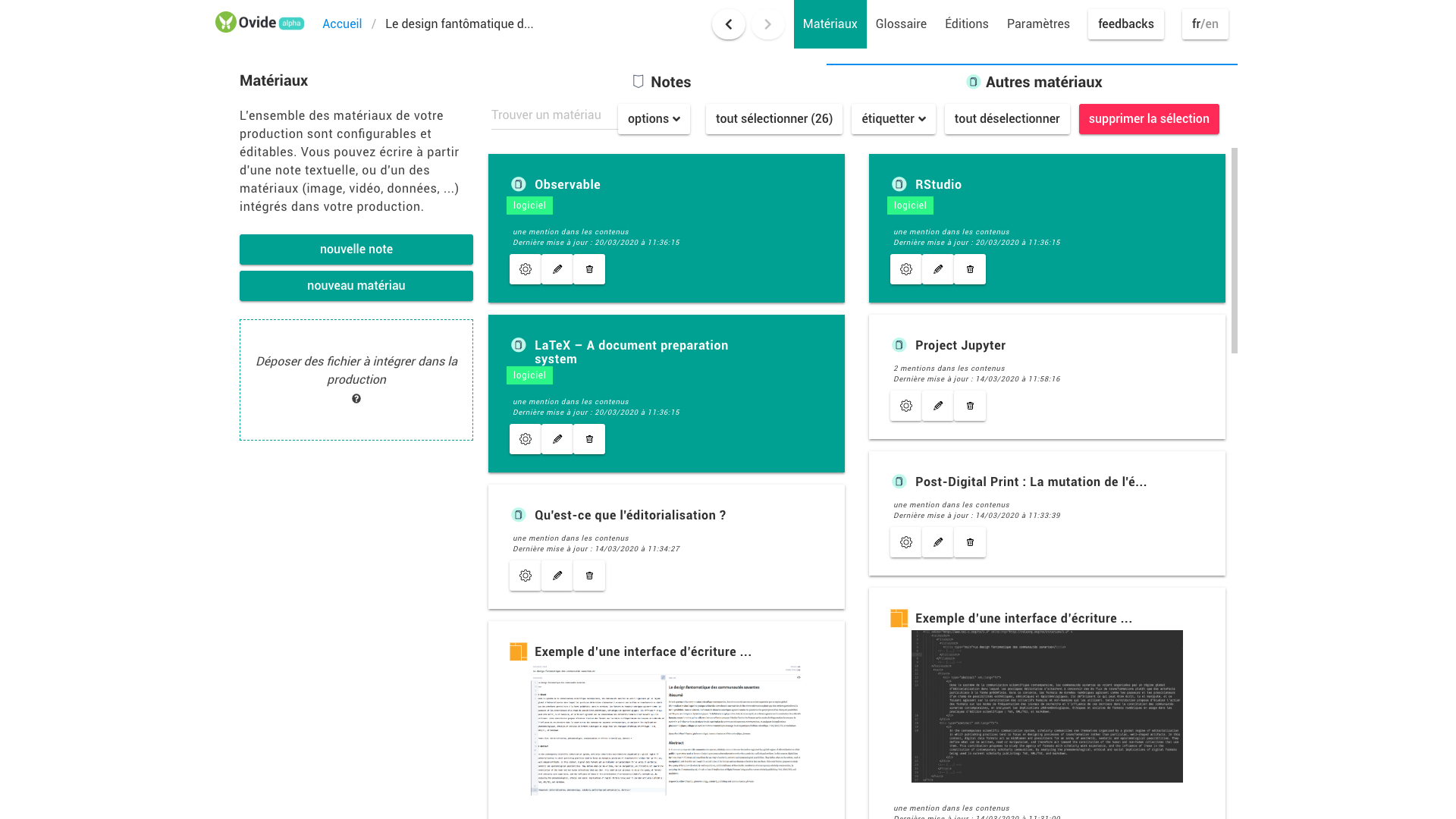
Les « étiquettes » peuvent alors être mobilisées pour filtrer les matériaux affichés dans la liste des éléments, mais aussi, comme on le verra plus tard, pour constituer des éditions avec des matériaux attachés à une ou plusieurs étiquettes particulières. Du point de vue des auteurs, elles peuvent donc être utilisées pour marquer le statut d’un élément (ex : « brouillon », « à relire », « fini »), pour identifier les thématiques qui lui sont attachées, pour suivre une typologie de classification critique, etc. Sur cette base, la première pratique proposée par Ovide est une pratique de curation et de documentation consistant à éditer les métadonnées des différents matériaux d’une recherche et les étiqueter en fonction de ses objectifs de recherche. Vient ensuite – ou en même temps – le temps de l’écriture à proprement parler.
Un éditeur textuel orienté vers le « tissage » de relations entre des matériaux
Afin de permettre aux auteurs d’écrire les textes rattachés à l’un ou l’autre des matériaux de leur enquête, Ovide propose une interface d’écriture textuelle. Cette dernière est construite à partir d’une technologie existante permettant de fabriquer des éditeurs de textes en ligne51 , et adaptée pour proposer une interface d’écriture de type What you see is what you Mean52 . Cette interface autorise un mode d’interaction visuel sous la forme de boutons et d’un codage graphique du texte en fonction des statuts des différents éléments (ex. titre, citation, etc.) ; elle prend également en charge le format markdown sous la forme d’un ensemble de raccourcis d’écriture53 destinés aux écrivains qui connaissent et préfèrent cette manière de faire. Elle est par ailleurs conçue spécifiquement pour l’écriture savante en SHS, dans la mesure où elle permet notamment lʼécriture de notes de bas de page et l’insertion de matériaux à l’intérieur des contenus.
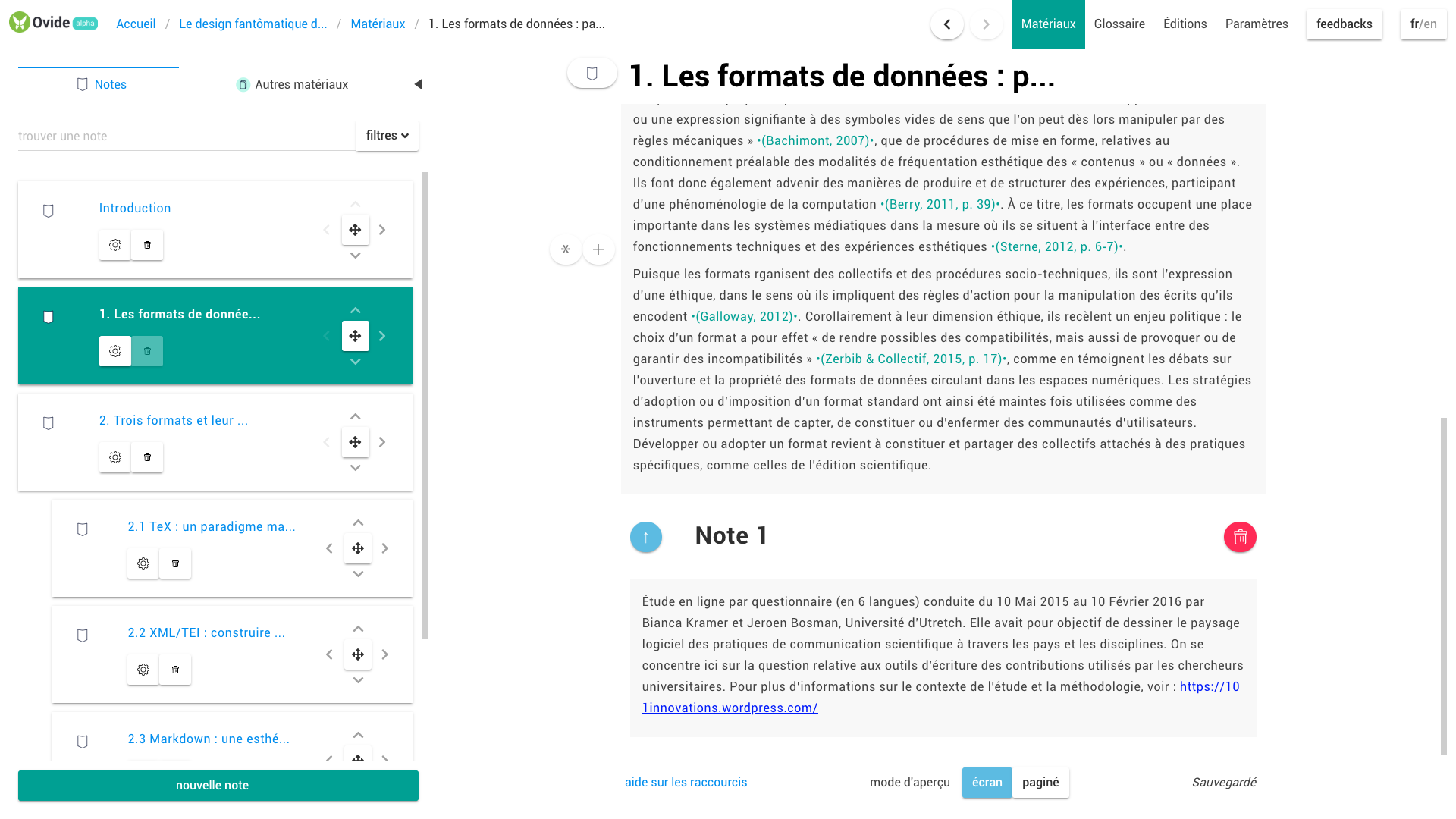
En ce sens, dans l’espace de l’interface d’édition des contenus d’un matériau, il est possible de « mentionner » (ce qui, dans le vocabulaire sous-jacent de Peritext, est appelé une contextualisation) un autre matériau à l’intérieur d’un paragraphe. Pour ce faire, les écrivains sont amenés à faire glisser les éléments visuels représentant un matériau dans le corps du texte54 puis voient ce dernier intégré à l’endroit de leur dépôt. La ressource en question est alors « contextualisée » et apparaît sous la forme d’un élément-bloc ou intégrée à l’intérieur du paragraphe où elle a été déposée.
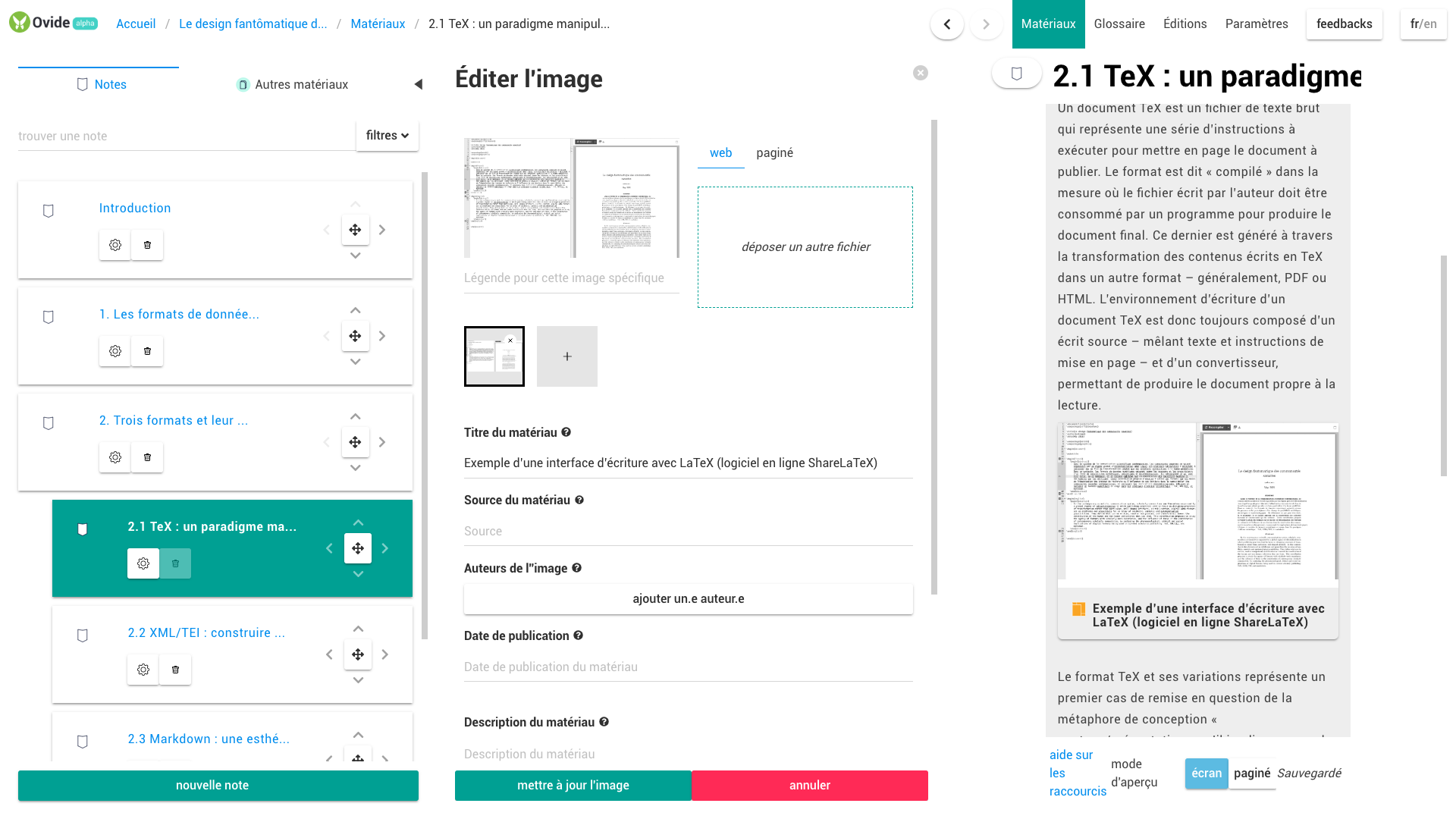
Une fois une « mention » (ou contextualisation) initiée, il est possible de l’éditer pour effectuer une série de réglages et de spécifications visant à décider comment « mettre en scène » le matériau à cet endroit précis des contenus, et en fonction des différents supports disponibles.
Sur cette base, Ovide autorise des pratiques d’écriture multiples en fonction des disciplines et des matériaux convoqués par les chercheurs. Il permet par exemple de développer conjointement au texte des pratiques dʼexploration et de visualisations dʼinformation à partir de matériaux de type « tableau », au moyen de la grammaire de description vega (Satyanarayan, Wongsuphasawat, & Heer, 2014) qui donne accès à un large éventail de techniques et de modes de représentation des données.
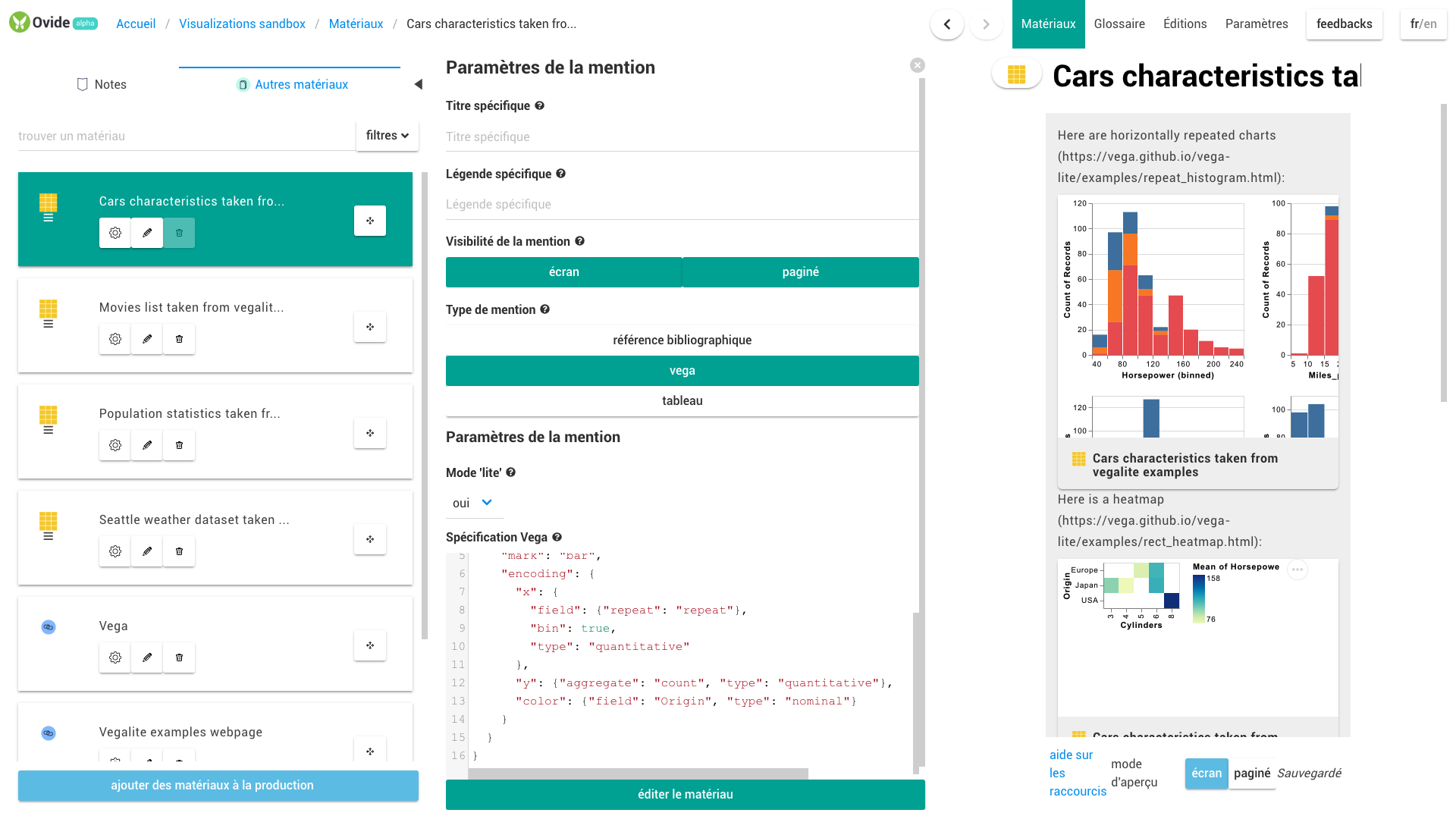
De la même manière, pour d’autres types de recherches, Ovide permet de convoquer les matériaux vidéo et audio de manière très fine à lʼintérieur des textes, pour ponctuer le texte dʼextraits choisis qui peuvent être présentés sous la forme de blocs ou sous la forme de micro-éléments disposés directement à l’intérieur du texte. Il agit ainsi comme une forme de continuation et de composition du logiciel Dicto présenté précédemment, dont il reprend certaines des fonctionnalités dont en les intégrant dans un cadre plus large.
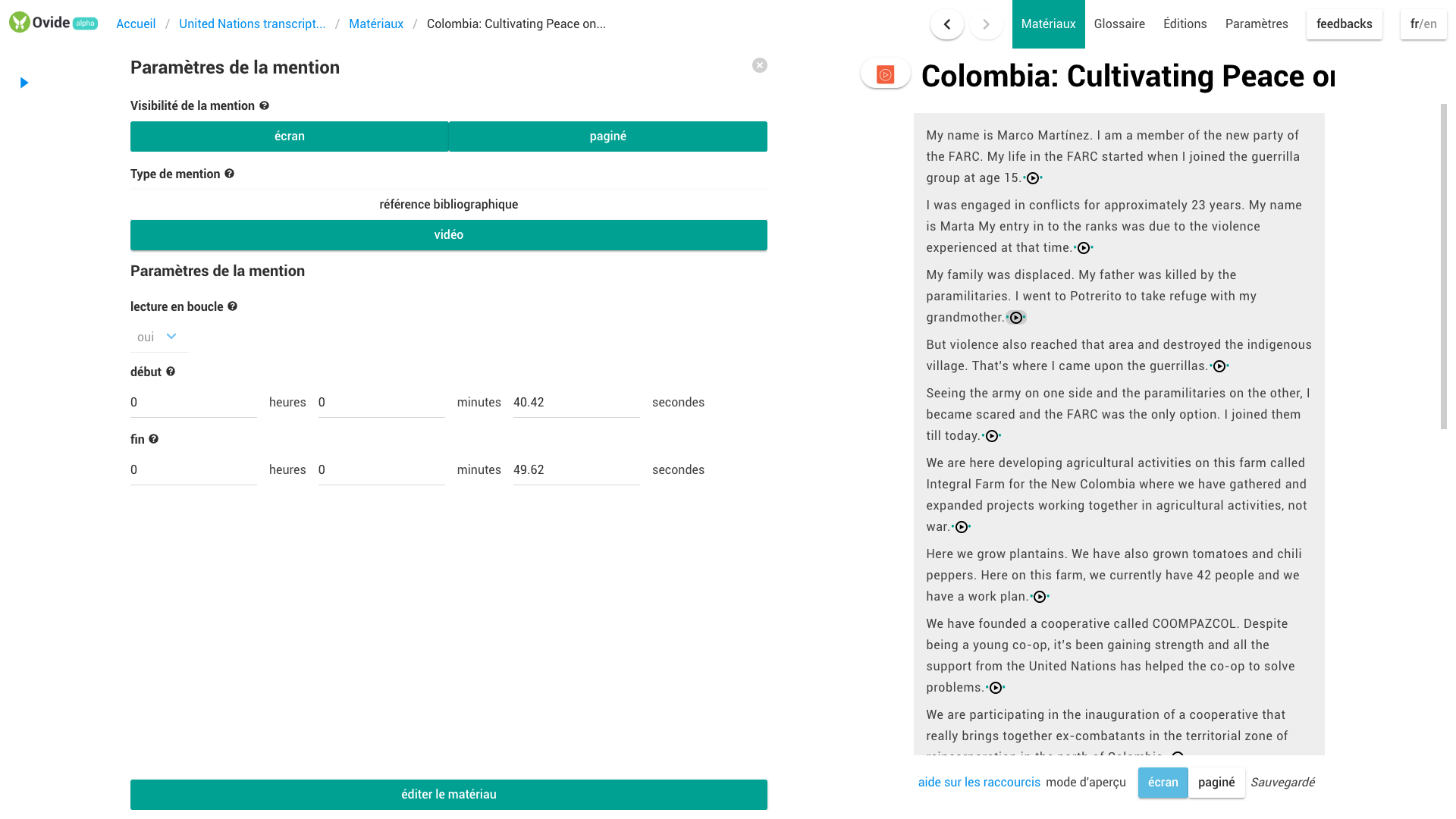
Pour chaque type de matériau, les paramètres de « mention » disponibles permettent de développer des pratiques d’écriture au plus près des matériaux et de faire jouer l’entrelac entre prose et documents de recherche de manière riche et diversifiée. Si Ovide en explore certaines d’entre elles, le logiciel se présente surtout comme une invitation et un facilitateur pour la déclinaison de telles pratiques en fonction des contextes et des matériaux de recherche.
Une interface pour l’élaboration d’un glossaire avancé
Ovide permet par ailleurs la gestion et lʼenrichissement dʼune série de matériaux de type « entrée de glossaire », qui peuvent être de plusieurs types : notions, personnes, lieux, et dates. Chaque type d’élément de glossaire conditionne certaines métadonnées spécifiques – un élément de glossaire de type « lieu » pourra par exemple être agrémenté d’une adresse et/ou de coordonnées géographiques, et un « évènement » pourra être documenté avec une date. Les entrées de glossaire pouvant être étiquetées au même titre que les matériaux, il est possible de créer des typologies complexes d’entités qui pourront ensuite être mobilisées comme des marqueur à l’intérieur des contenus de tous les autres matériaux de la production.
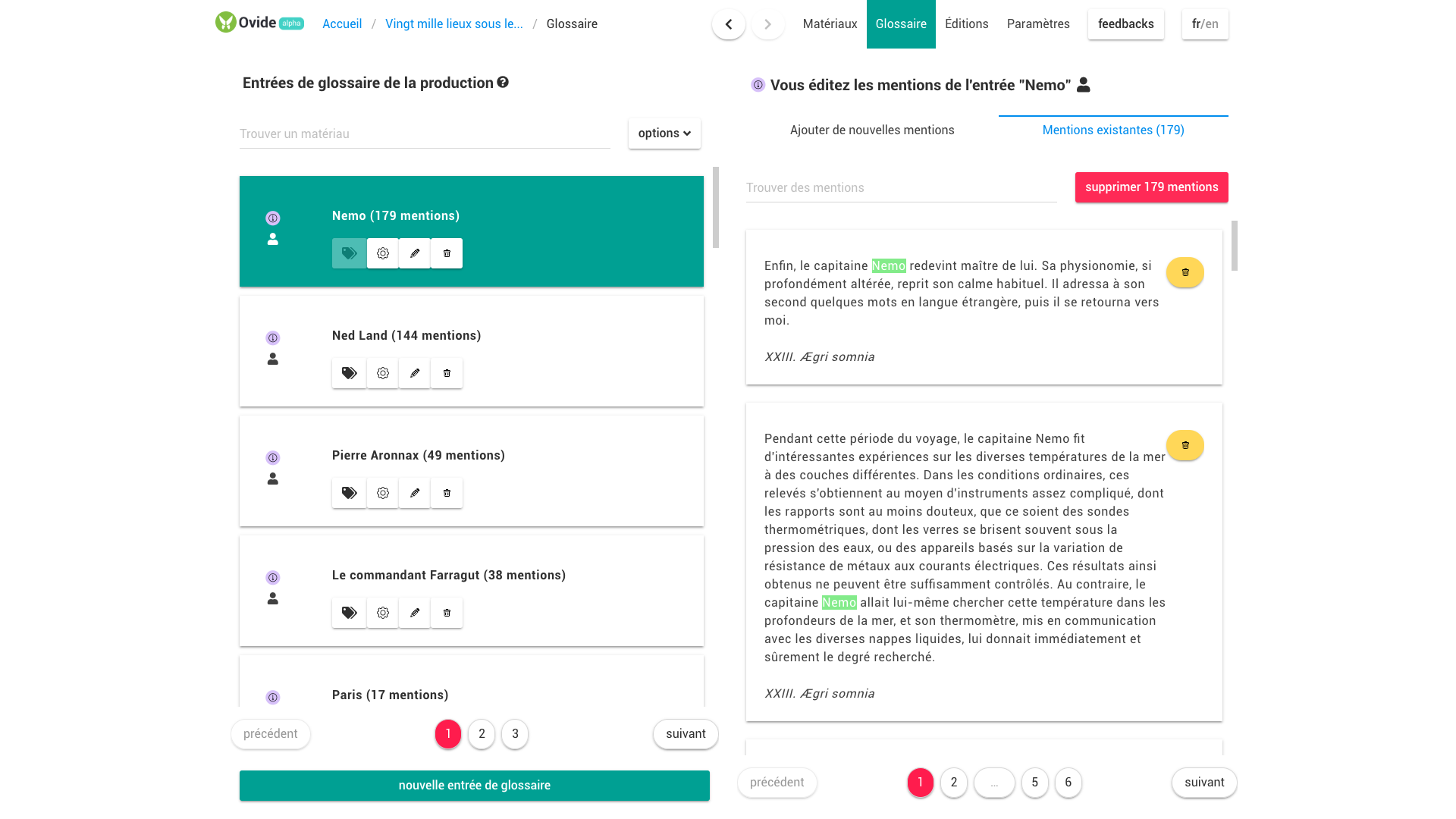
La vue « glossaire » d’Ovide permet de gérer ces éléments, mais surtout dʼannoter les contenus des différentes ressources de la production. Au moyen d’une interface de recherche et de traitement par lot, elle permet ainsi d’enrichir les contenus en créant une myriade de relations entre les ressources, par le truchement des entrées de glossaire. Ces entrées pourront ensuite être mobilisées dans les dispositifs de lecture – au premier rang desquels, celui de l’index de lieux, personnes ou dates – mais également être utilisées pour composer le sommaire d’éditions spécifiques.
Un espace de composition et de prévisualisation pour les éditions « web » et « paginées »
À partir du travail dʼécriture effectué avec les matériaux dʼune production, Ovide permet de créer, dupliquer et supprimer un ensemble dʼéditions qui sont des « mises en scène » des matériaux pour des objectifs et des formats éditoriaux définis.
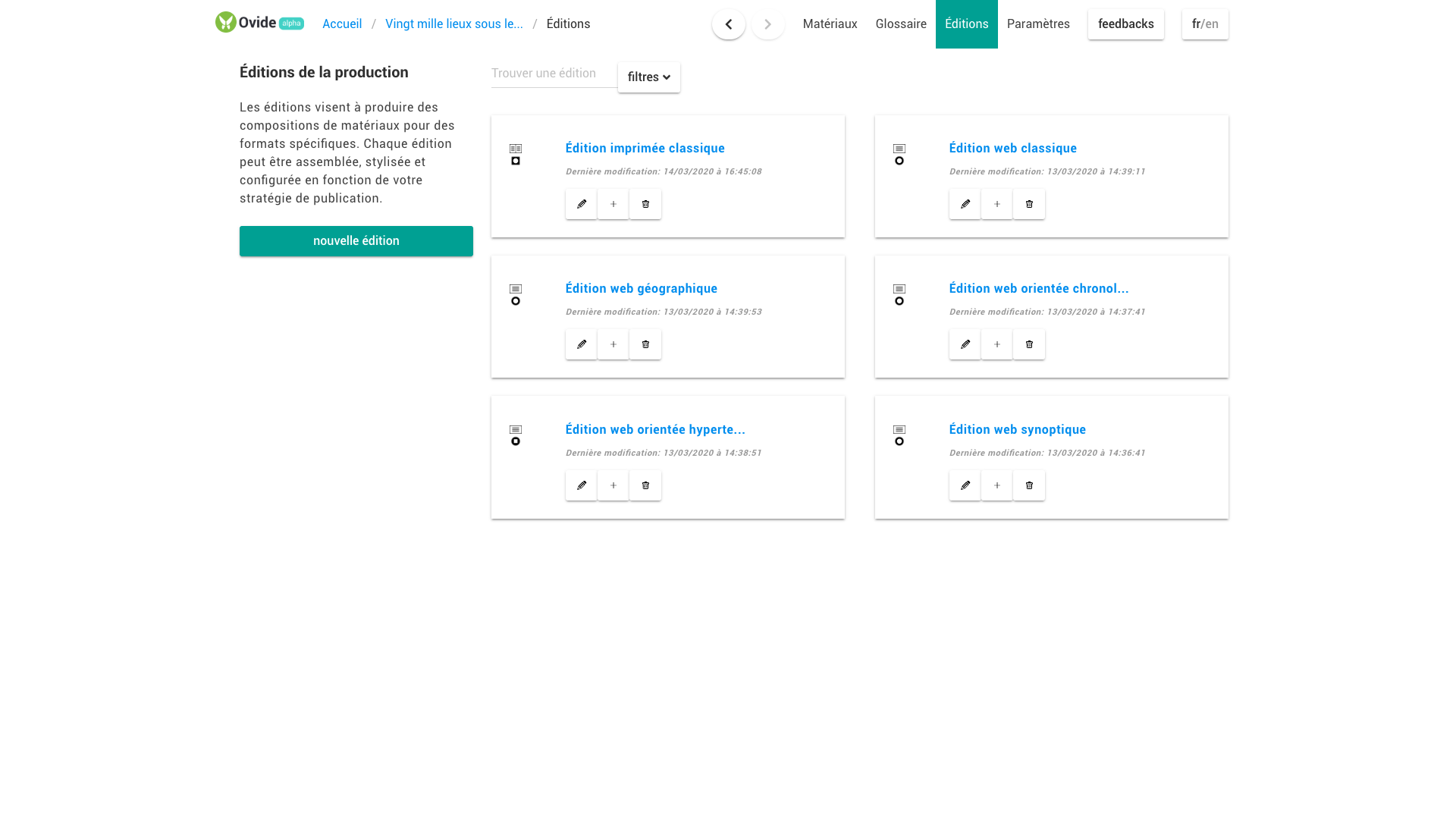
Il est possible, pour chaque édition, de définir un « sommaire » particulier. Les éléments qui composent le sommaire, spécifiques à chaque gabarit d’édition, peuvent être des composantes conventionnelles (par exemple, une première de couverture, une table des matières, ou un glossaire) ou des éléments expérimentaux (par exemple, une sélection de ressources, une carte géographique, ou une visualisation en réseau des mentions). À travers une interaction de glisser-déposer, le logiciel permet ainsi d’assembler une telle série d’élément afin de composer la séquence des éléments associés à une édition particulière, qu’elle soit destinée au web ou à l’impression.
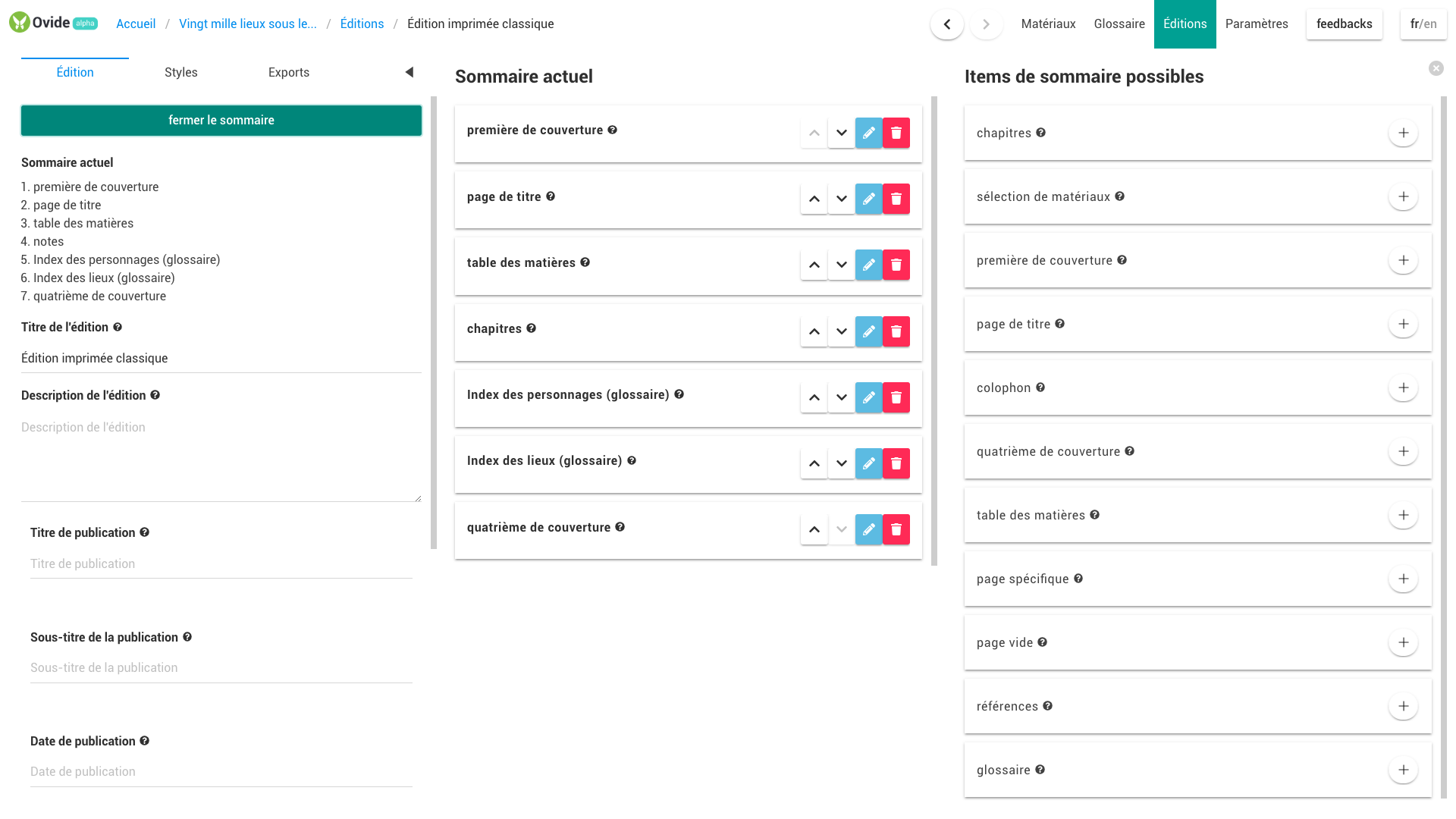
Les contenus sont assemblées et prévisualisés dans une même interface, permettant un aller retour rapide entre la composition de l’édition et la prévisualisation de son aspect. Dans ce cadre, Ovide permet la fabrication de sites web mais autorise également la conception dʼéditions imprimées de grande qualité, en utilisant des technologies permettant de prévisualiser l’aspect d’un document paginé à l’intérieur d’un navigateur web55 .
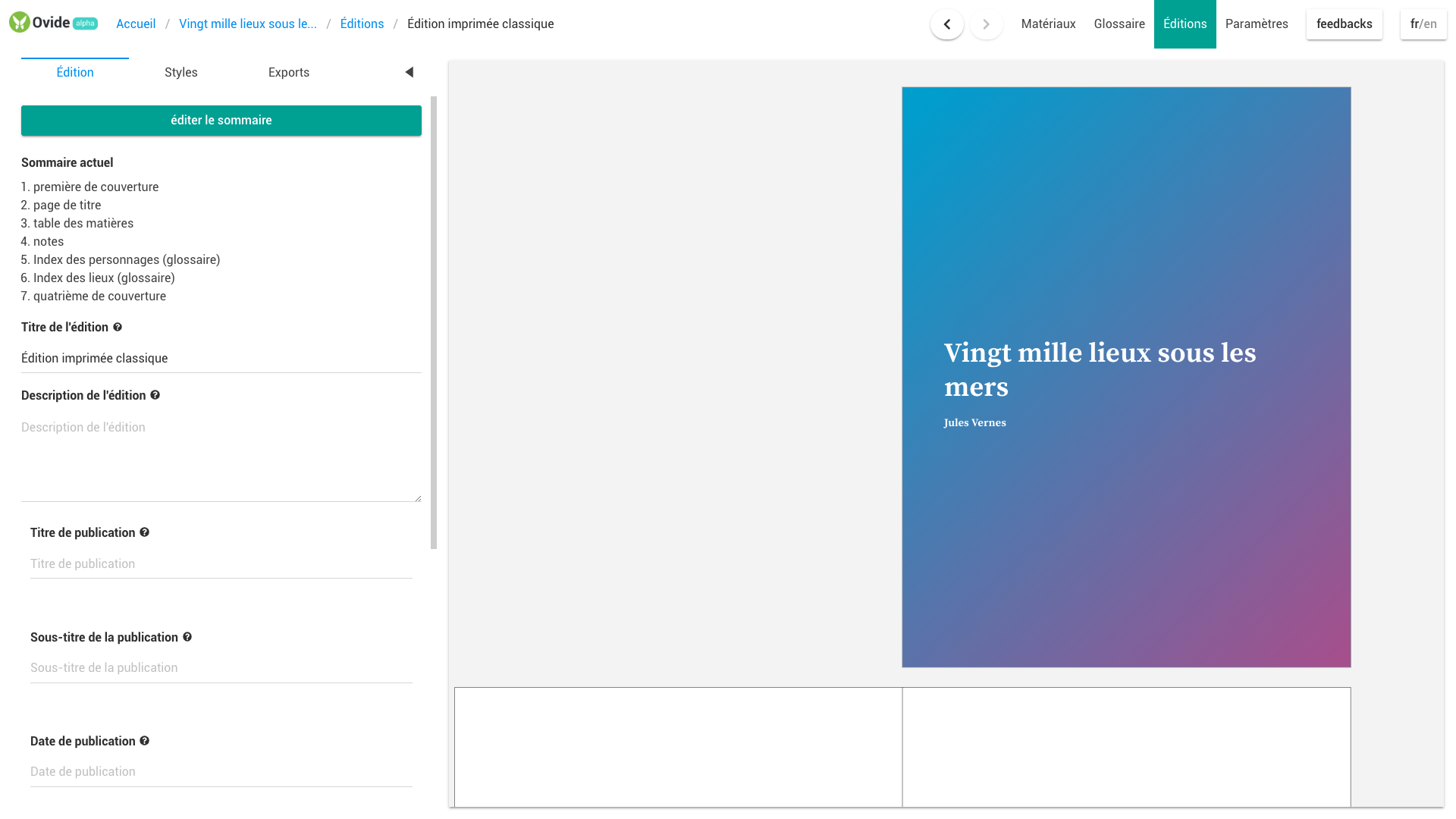
Lʼoutil offre par ailleurs une interface dʼédition des styles spécifiques à chaque édition. Il permet de modifier les styles par défaut de lʼédition ou de les reprendre entièrement pour produire un design graphique complètement spécifique à lʼédition.
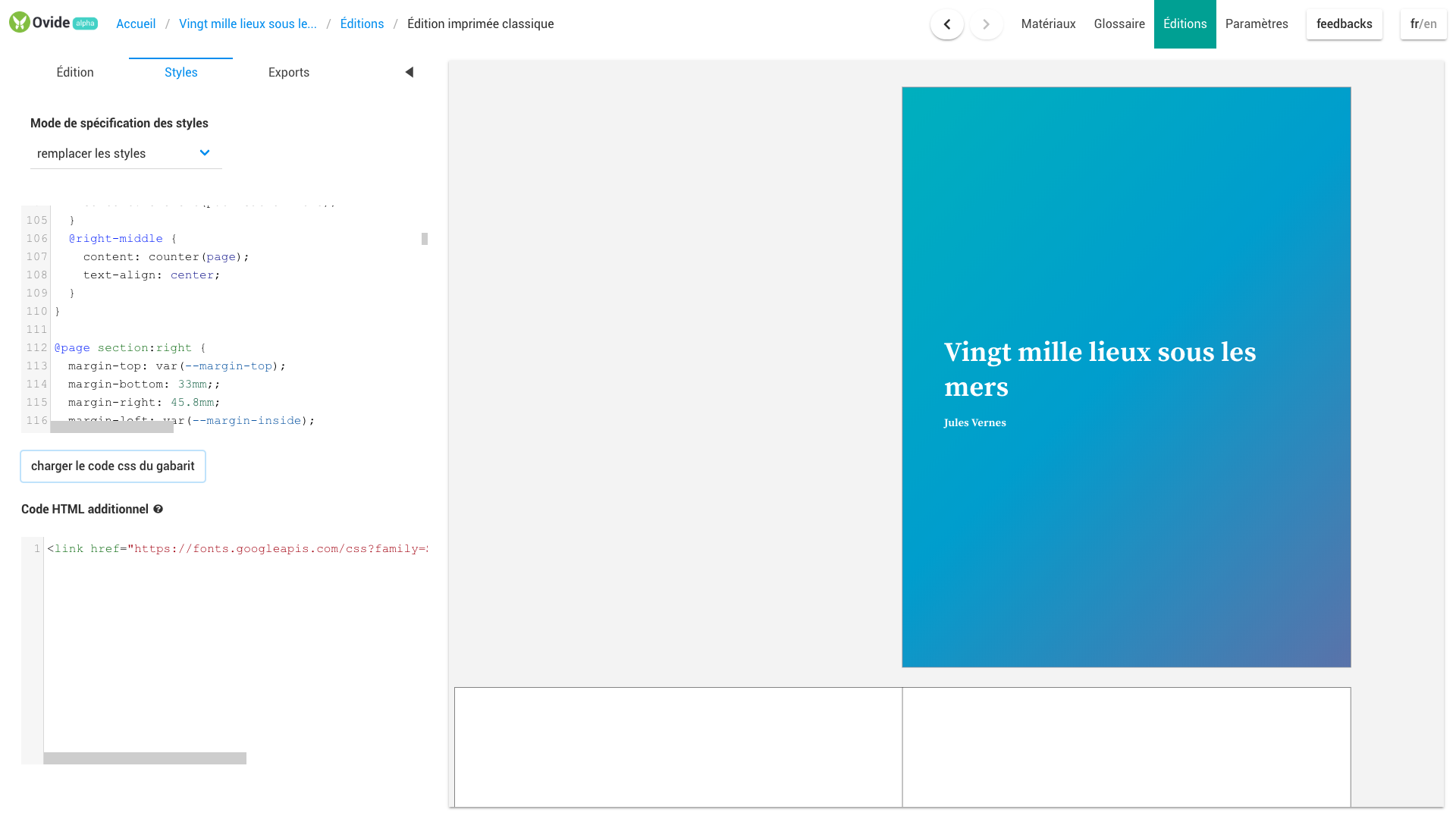
En concentrant la composition, le paramétrage et la stylisation dans une même interface, Ovide permet ainsi de réaliser des cycles itératifs entre plusieurs activités qui seraient sinon expérimentées dans des environnements logiciels différents. La dynamique des éditions et la possibilité de les dupliquer facilement, encourage également à une attitude expérimentale et à la multiplication des versions produites à partir d’un même corpus de matériaux et d’écrits.
Des gabarits exploitant les potentialités du modèle de données
Via l’interface d’édition, Ovide est interfacé avec d’autres modules de Peritext constitués par les gabarits, qui sont des patrons ou des modèles graphiques et interactifs destinés à la génération des éditions. Chaque gabarit – par ailleurs entièrement modifiable, comme indiqué précédemment – a été créé et conçu selon une approche de la lecture spécifique et une manière de tirer parti du modèle Peritext au niveau des dispositifs de consultation.
Ainsi, le gabarit Pyrrha, dédié à la génération d’éditions paginées destinées à l’impression ou la création de fichiers au format.pdf, est orienté vers la création d’éditions longues et propose différents éléments d’apparat critique conventionnel tout en tirant parti de la structure documentaire pour en effectuer des variations : il s’agit par exemple de proposer une bibliographie permettant d’afficher toutes les mentions d’un élément donné, ou un lexique étendu à partir d’éléments de glossaire. Le corps des contenus, quant à lui, présente une marge importante dédiée à l’annotation et utilise les différents bords de la page pour distribuer de manière lisible figures, notes et titres courants.
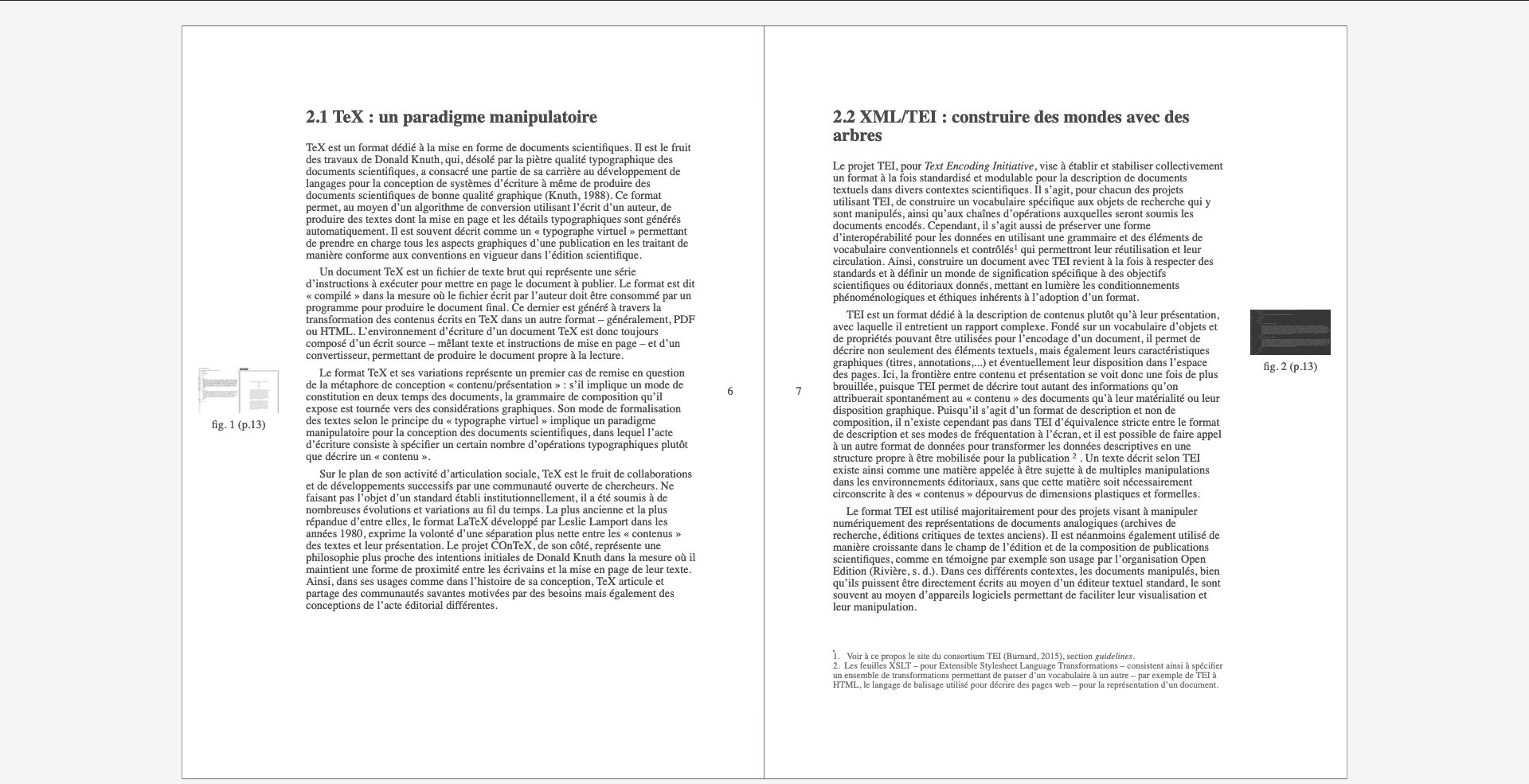
Le gabarit Deucalion, fait pour la génération d’éditions web, tire parti des multiples relations entre les ressources pour proposer un appareil de lecture permettant une alternance entre des pratiques de lecture séquentielle et de lecture associative via les mentions des matériaux dans les contenus. Il est en effet constitué d’une mise en page à deux colonnes qui permet d’afficher conjointement les contenus d’une ressource et les différentes contextualisations attachées à une ressource en particulier. Ainsi, en cliquant sur une citation, d’une image ou d’une vidéo affichée dans les contenus, on affichera sur la colonne contextuelle tous les extraits dans lesquels cette ressource se voit également citée, permettant de naviguer à l’intérieur du document au prisme de ces multiples contextualisations plutôt que selon la séquence linéaire proposée par l’édition. On pourra donc découvrir un texte en parcourant tous les usages qu’il fait d’un ouvrage particulier, ou suivre les différentes mentions et visualisations d’un jeu de données mobilisé par l’enquête, ou encore repérer les usages d’un concept ou d’une personne qui aurait auparavant été définie et annotée via l’interface de création de glossaire, etc.
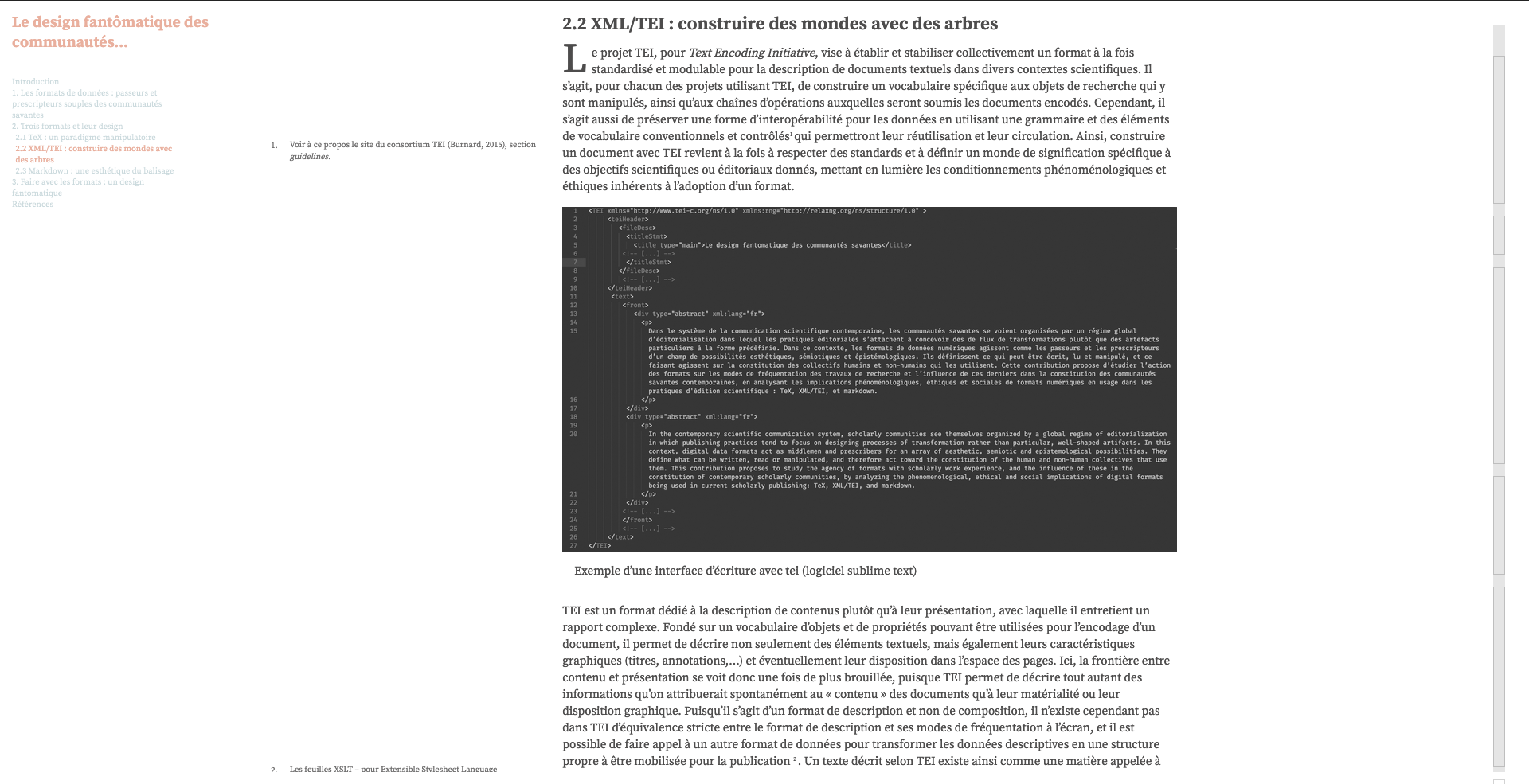
Deucalion propose par ailleurs des éléments de composition permettant de fabriquer des « vues d’ensemble » des contenus sous la forme d’une carte géographique, d’une frise chronologique, ou d’un graphe de mentions. Pour chacune de ces représentations, le clic sur l’un des éléments représentés (lieu, date, élément) permet d’accéder à l’ensemble des extraits auxquels il est attaché, puis de naviguer jusqu’à l’un d’eux afin de reprendre une activité de lecture séquentielle.
Le gabarit Chrysaor, enfin, se présente comme une dérivation de l’instance web « livre » du projet EME dont il reprend le principe d’organisation graphique et interactive. Pour ce gabarit, la définition des éléments de l’édition correspond à la définition d’une série de colonnes qui seront ensuite affichées sous la forme d’une page unique et interactive. Dans la composition des colonnes, il est ainsi possible de sélectionner les chapitres d’un texte, ou un type de matériau particulier (ex. colonne de références bibliographiques, ou d’images, ou d’entrées de glossaire de type « personne », etc.), ou encore d’utiliser le système des étiquettes afin d’effectuer un filtrage dans les éléments affichés. Chaque colonne se présente comme une liste d’éléments qui correspondent aux critères de sélection de leur élément de composition correspondant. Ces derniers peuvent être « dépliés » au clic pour la lecture
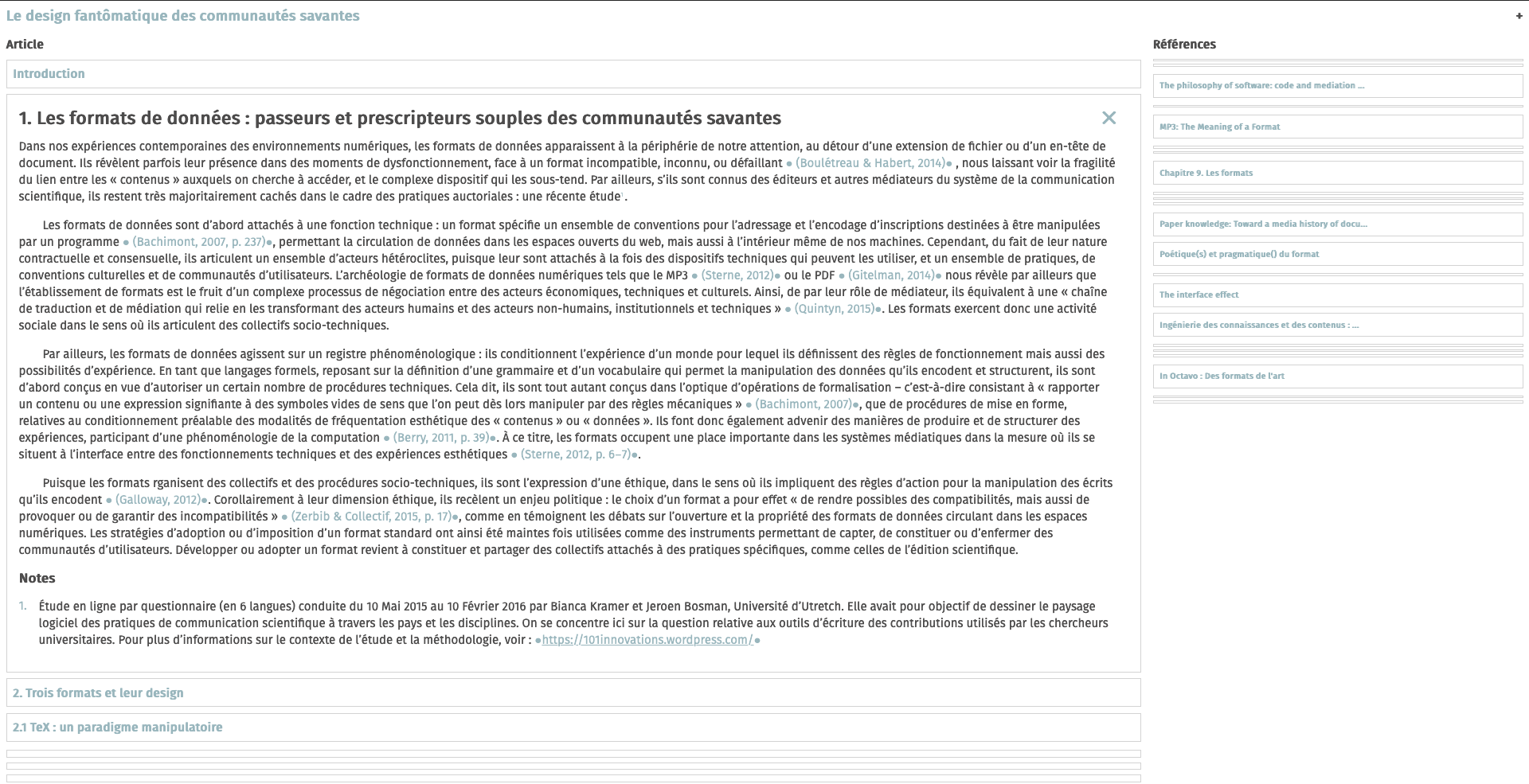
Lorsqu’un élément est déplié dans Chrysaor, l’interface des colonnes se voit redimensionnée de manière à laisser un espace suffisant à l’élément lu, et à réduire la taille de tous les autres éléments. Parmi ceux-ci, les éléments qui sont contextualisés dans celui qui est lu sont de taille plus importante que les autres afin de signaler qu’ils lui sont « liés ». Une telle transformation encourage le lecteur à cliquer sur ces éléments liés et à ainsi adopter une séquence de lecture par « dérives » successives d’un élément à ses voisins. En ce sens, Chrysaor opère une généralisation du dispositif de lecture inventé pour l’EME puisqu’il en reprend le principe tout en le rendant adaptable et déclinable à une multitude de situations et de matériaux.
Conversions et compatibilités
Ovide autorise la création d’une chaîne éditoriale complète allant de l’écriture des contenus à la production de documents près à la publication. Cela dit, le logiciel ne se présente pas comme une solution tout-en-un et est le fruit d’un certain nombre d’efforts destinés à atténuer les effets de verrou et de fermeture qu’implique la mise en place d’un modèle de donnée et de formats nouveaux et spécifiques.
Ainsi, Ovide permet de générer, à l’échelle d’une production ou d’une édition spécifique, une série d’exports dans des formats de fichiers de travail (HTML, markdown, XML-TEI) permettant de convertir le travail effectué dans le logiciel dans d’autres idiomes et pour d’autres outils. De tels exports induisent une certaine quantité de perte d’information – la structuration complexe du modèle de Peritext étant la raison initiale pour laquelle cesdits formats ne furent pas adoptés – mais permet une forme de reprise dans d’autres contextes d’écriture et d’édition.
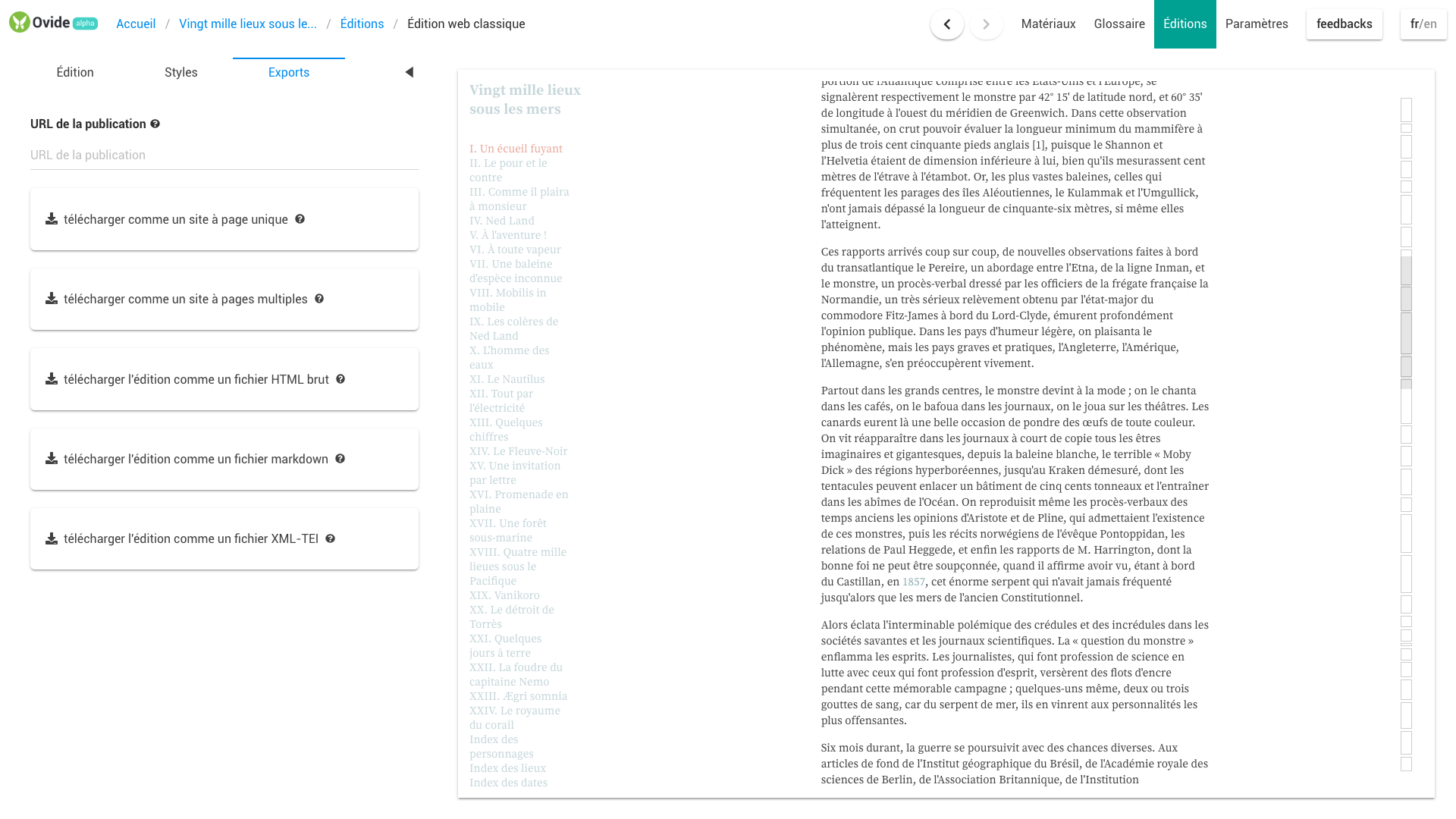
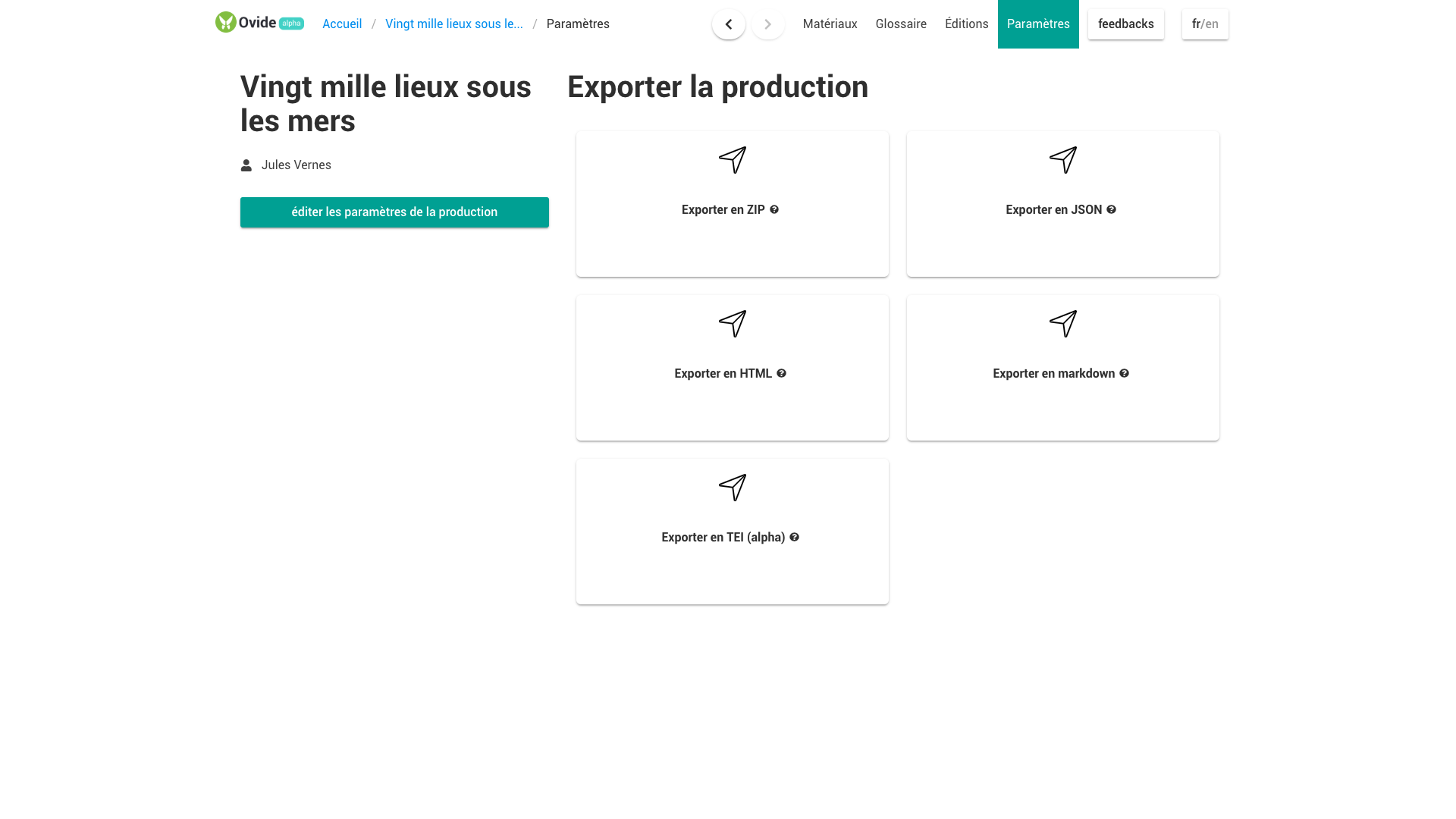
Par ailleurs, les exports prêts à la publication proposés par Ovide sont pensés comme des « semi-finis » propres à un travail ultérieur au moyen dʼautres outils de développement, de design et dʼédition. Ainsi par exemple, l’interface d’exports d’une édition paginée permet de télécharger une publication donnée sous la forme d’un simple site pouvant ensuite être retravaillé par un designer graphique au moyen d’un éditeur de code HTML et de ses propres outils de mise en forme.
Enfin, Ovide est par ailleurs compatible avec l’éditeur collaboratif Fonio (de Mourat, Du, Plique, Pichon, & Richard, 23 novembre 2016/2017), vers et depuis lequel des productions peuvent être échangées. Une telle compatibilité permet de mettre en œuvre des dynamiques de travail collaboratif, articulant par exemple l’écriture et la révision de certains contenus avec Fonio et leur édition et leur design avec Ovide.
Un cadre reconfigurable
Outre son aspect et ses fonctionnalités en tant que telles, Ovide a été développé comme une infrastructure modulaire et adaptable, conçue elle-même pour être dérivée afin de produire d’autres logiciels plus spécialisés pour des recherches ou des contextes éditoriaux particuliers. Ainsi, lʼensemble des matériaux manipulables et des gabarits utilisés par lʼéditeur peuvent être facilement modifiés au moyen dʼun fichier de configuration unique qui permet d’enlever ou d’ajouter de nouveaux types de matériaux, supports56 , modules de « contextualisation » ou gabarits d’éditions. On pourrait par exemple imaginer de rajouter un type de matériau relatif aux contenus dʼun réseau social particulier ou d’un type de document spécifique57 , d’utiliser une autre technologie pour la visualisation de données que celle actuellement mobilisée par le logiciel, ou encore d’introduire un gabarit dʼédition proposant des modes de consultation inédits, etc. Ovide se présente en ce sens comme la stabilisation partielle d’une infrastructure pour des expérimentations et des aménagements à venir.
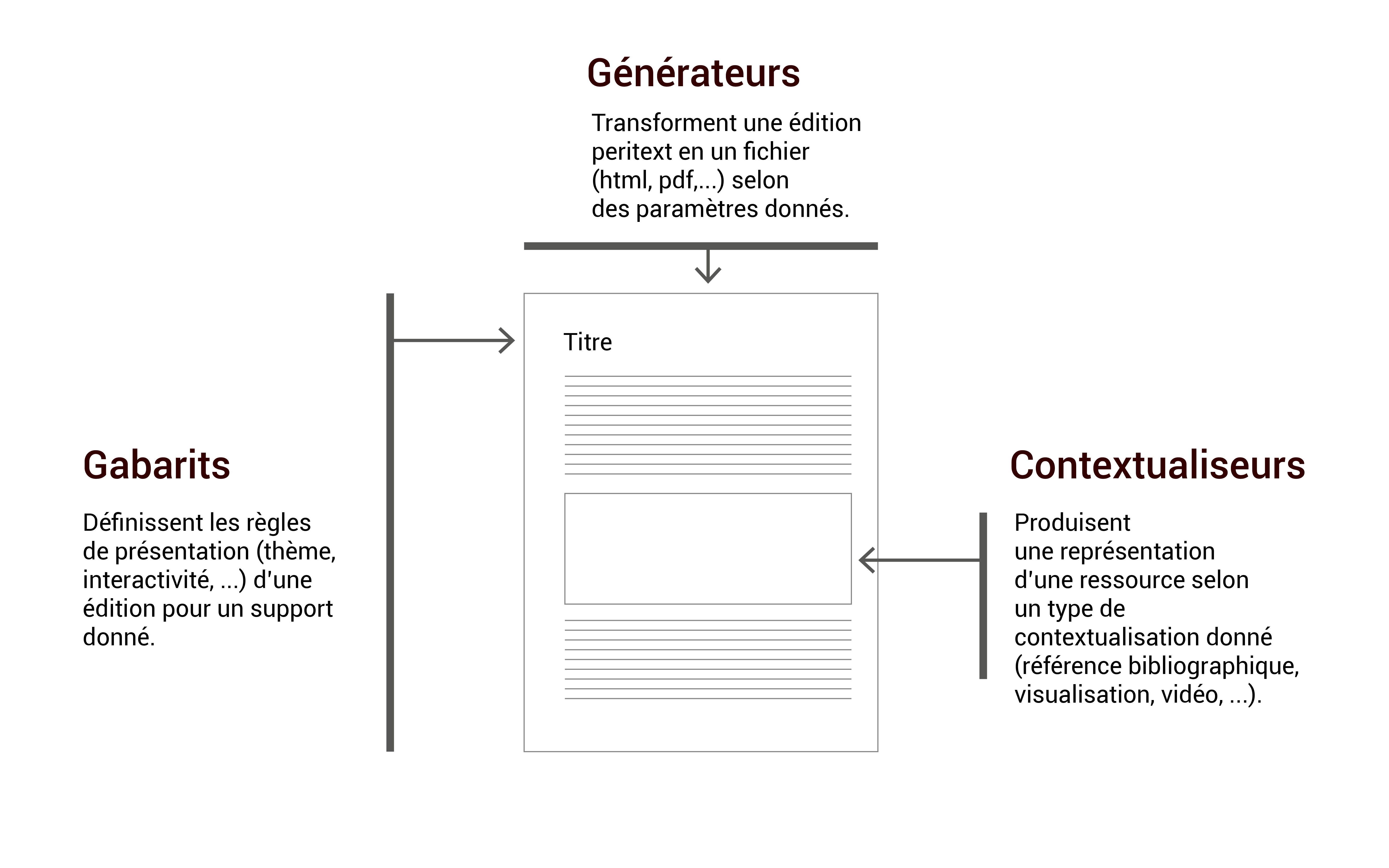
Ainsi, alors que les fonctionnalités qu’il présente sont liées à l’enquête, l’écriture et le design des documents-publications constituant la présente thèse, Ovide a été conçu pour éviter toute dynamique de standardisation ou de fixation dans les manières de faire de la publication, et son architecture modulaire autorise à le reprendre et le réadapter dans une diversité de contextes. Il se propose comme la démonstration de certaines potentialités du modèle de données Peritext stabilisé au fil des situations rencontrées durant l’enquête, autant que comme un équipement directement utilisable par des chercheurs. Il propose en cela une contribution diagnostique en direction des collectifs de recherche ainsi que ceux attachés à la communication scientifique. Cependant, en tant que composant d’une démarche de fabrication-comme-enquête, il propose également une contribution épistémologique à l’étude du vacillement des formats et aux diverses articulations qui construisent le cadre des pratiques de publication. Il s’agit maintenant d’en détailler les modalités.
Un format-cadre entendu comme perturbation : mécanismes de reconnaissance déjouée dans les pratiques de Peritext
Le paradoxe inhérent à une pratique de recherche en design conçue comme infrastructuration réside dans le fait qu’il relève à la fois d’une trajectoire expérimentale propre à générer des formats-produits issus de la spécificité des situations, d’une part, et qu’il produit des équipements qui opèrent comme des formats-cadres aptes à générer des horizons de pratique, d’autre part. Ce faisant, comme on l’a vu dans le chapitre précédent, les produits d’une telle pratique tendent à provoquer des mécanismes de reconnaissance déjouée qui révèlent les habitudes et les tensions à l’œuvre dans un collectif donné. À ce titre, Peritext peut être décrit comme le lieu de mise en lumière d’une telle série de tensions dans les formats des publications en SHS étudiés dans le reste de ce texte. Il ne s’agit pas ici de soutenir qu’un projet comme Peritext a été conçu depuis ses débuts pour provoquer de telles perturbations porteuses de sens. Mais il s’agit de faire l’hypothèse qu’il l’a fait, et que même si ce fut parfois « malgré lui » (ou plutôt malgré moi !), cette propriété perturbatrice qui résulte du vacillement entre instrumentation et expérimentation qui a caractérisé son contexte d’élaboration informe les effets que l’on peut attendre d’une pratique de recherche articulant enquête et fabrication.
Peritext a en effet été développé dans la triple perspective d’une contribution diagnostique, d’un cheminement réflexif, et d’une série d’expérimentations visant à questionner et déplacer certaines des conventions établies dans les outils et logiciels dominants associés à la publication en SHS. Une telle activité a produit une série de tensions qui permettent en retour de questionner les modèles associés à la publication. En se concentrant ici sur la version stabilisée du modèle, des bibliothèques de code et du logiciel Ovide, je propose donc de reprendre les problématiques et les effets visités dans la cadre de cette recherche pour identifier la manière dont le projet Peritext a permis d’en faire l’expérience et le lieu d’un cheminement réflexif.
Un format de données vacillant : principes de conception polymorphique et modèles du texte
La première tension travaillée par Peritext, au niveau de son format de données, relève de la relation entre « contenu » et « présentation » explorée en détail dans le chapitre 2. À ce propos, Peritext adhère partiellement au modèle de conception de la séparation entre les « contenus » et la « présentation » tout en y ménageant un espace de jeu. Il y adhère, puisqu’il sépare l’écriture de ressources et de leurs relations, et leur mise en forme à l’intérieur d’éditions particulières. Par ailleurs, en ce qui concerne la mobilisation d’une ressource imbriquée dans une autre (citation, image, etc.), il maintient la référence au matériau cible et propose en ce sens une structuration indépendante des choix de présentation conduits en aval lors de la production et du design des éditions.
Cependant, dans Peritext, ce qui constitue les « contenus » peut relever tout autant d’un contenu discursif que d’intentions graphiques – par exemple les conditions de présentation d’une série d’image – audiovisuelles – par exemple un extrait particulier – ou diagrammatiques – par exemple des instructions de visualisation de données – qui sont alors pris en charge dans la chaîne de transformations de l’outil comme des indications intermédiaires à mi-chemin entre le « contenu » et la « présentation ». Ces indications sont ensuite interprétées différemment en fonction des supports visés et des éditions qui sont construites en aval à partir des « contenus » et sont le lieu de pratiques d’écriture propres. Ainsi, au-delà de la distinction entre « contenus » et « présentations », le format Peritext est structuré par une autre distinction : celle entre une « ressource » et ses « contextualisations » à l’intérieur des contenus d’autres ressources. Là où des systèmes existants effectueront une distinction bipartite entre « formes canoniques » et « formes de publication » (Bachimont & Crozat, 2004), Peritext se fonde sur un modèle tripartite : il n’est pas structuré exclusivement par la distinction « contenus/présentation » mais, via la notion de « contextualisation », par un troisième registre de représentation relevant de l’intention. Ce principe d’indication intermédiaire n’est pas fondamentalement différent de technologies d’écriture numériques telles que celles du langage de mise en forme CSS, massivement utilisé pour les publications web58 . Mais il matérialise un geste en direction d’une poétique de la métamorphose documentaire, qui consiste à multiplier les étapes de traduction dans le processus éditorial pour augmenter les occasions de production de sens, mais aussi en questionnant la division des rôles dans l’écriture des documents-publications en permettant aux auteurs de davantage jouer avec les conditions de matérialisation de leurs écrits. Ainsi, en multipliant les jeux de traduction et en troublant le modèle de la séparation entre « contenu » et « présentation », le projet déploie des possibilités d’écriture nouvelles tout autant qu’il questionne les modèles de conception strictement dualistes.
Par ailleurs, à travers son modèle de données constituée d’objets liés entre eux plutôt que d’une structure hiérarchique (dite « en arbre » dans le jargon informatique) concevant les contenus d’un document comme un ensemble imbriqué d’éléments, Peritext propose une remise en question du modèle documentaire du « contenu structuré » institutionnalisé par le format SGML et ses descendants. Une telle structure se voit remplacée par une approche relationnelle impliquée par le graphe de ressources, de contextualisations et d’éditions interconnectées qui constituent une production Peritext59 .
Le projet opère aussi, malgré lui, une remise en question de la « norme en devenir » que constituent les formats dits légers et à la popularité croissante, tels que markdown ou asciidoc. En effet, il met en place une méthode d’écriture et un mode de représentation des contenus que de tels formalismes ne pourraient pas exprimer sans difficulté – ainsi qu’en témoigne la trajectoire de développement de Peritext qui prenait initialement markdown pour format pivot. En ce sens, il met en lumière le fait que les modes de représentation des contenus impliqués par les dispositifs dominants de publication polymorphique sont contraints par une logique du « plus petit dénominateur commun » en terme de structuration des « contenus »60 . De telles approches dominantes dans les nouvelles pratiques éditoriales ne sont pas dénuées de qualités – modularité, stabilité, facilité de maintenance, interopérabilité relative – mais elles viennent avec leurs limitations qu’il s’est agi ici à la fois d’éprouver, dans les premiers temps du projet, et de questionner à la lumière d’approches de l’écriture de recherche spécifiques, dans un second temps, via la stabilisation d’un modèle alternatif pour la publication expérimentale.
Un format vacillant pour l’écriture : une approche multimodale de l’enquête
Au niveau des techniques d’écriture qu’il suggère et permet, Peritext questionne d’abord les relations qui s’opèrent entre les matériaux d’une recherche et les pratiques d’écriture qui entendent les mobiliser dans le cadre du geste de publication. En autorisation la formulation d’intentions intermédiaires à l’interface entre les pratiques d’écriture d’un auteur et la variété de formats éditoriaux que sont amenées à prendre les différentes édition d’une production, Peritext perturbe ce que l’on peut entendre comme des pratiques d’écriture dans les SHS.
De ce fait, il ouvre pour les chercheurs-écrivains un ensemble de conditions de possibilité pour des pratiques d’écriture fondées des images, des vidéos, des textes, voire des données statistiques. Cela dit, il le fait sans escamoter la dimension collective de l’édition ou succomber au fantasme d’immédiateté véhiculé par les technologies de type What you see is what you get, puisqu’il propose d’indiquer des intentions d’écriture plutôt que des instructions de mise en forme précises, et de garder leur interprétation ouverte pour la suite de la chaîne de transformations conduisant à la fabrication des documents-publications. En fin de compte, en proposant aux écrivains de définir des intentions s’étalant sur plusieurs étapes jusqu’à la production des éditions, Peritext tire parti de la tendance technique des technologies numériques et de modèles fréquemment utilisés en informatique, à savoir la structuration des programmes en une multitude de fonctions produisant des résultats – « sorties » – à partir d’un ensemble de paramètres – ou « entrées ». Cependant, il reprend ce principe et le « retourne » à contre-emploi d’une division du travail et des tâches entre « contenu » et « présentation » pour élargir la palette des possibilités expressives à disposition des chercheurs-écrivains dans des contextes polymorphiques et distribués : le travail d’écriture se situe alors à la fois dans la définition d’un corpus, l’écriture de divers segments de prose textuelle, et l’indication d’un ensemble d’intentions de mise en forme pour la contextualisation de ces productions dans une variété d’environnements et de supports. Cette approche multimodale de l’écriture tente en fait de concilier une attention à la matérialité des documents-publications avec le régime distribué et polymorphique de l’éditorialisation, en favorisant de nouvelles formes d’écriture elles-mêmes distribuées et polymorphiques61 .
Par ailleurs, d’un point de vue méthodologique, Peritext questionne également la division stricte – au niveau des moyens logiciels et des méthodologies établies – entre le temps de l’enquête et celui de l’écriture pour la publication de recherche. En effet, un logiciel comme Ovide permet de penser le temps de la documentation conjointement à celui de la publication et à associer étroitement la pratique de la documentation et de l’organisation d’un corpus avec la pratique du développement écrit. Il s’agit d’encourager les auteurs à construire conjointement et dans l’ordre qui leur est le plus pertinent ce rapport double au texte.
Enfin, Peritext questionne la relation entre écriture et lecture, et l’influence de la deuxième sur la seconde dans un contexte polymorphique et toujours peu stabilisé sur le plan des formes d’écriture numérique. Sur ce plan, la dimension structurée de Peritext permet de produire une série d’éditions – notamment numériques – qui tirent parti des diverses formes d’hypertextualité qu’elle permet pour encourager des pratiques de lecture non-séquentielle et associative. Si la possibilité d’une lecture savante non-séquentielle est permise depuis la stabilisation des éléments d’apparat savant associés à l’histoire du livre – tels que table des matières, index, etc. – elle est ici constamment visible pour l’écrivain pendant le temps de l’écriture selon la diversité de modalités offortes par les différents gabarits proposés. Notamment, la proposition de dispositifs de lecture permettant d’aller et venir entre une « ressources » et les diverses « contextualisations » dont il a fait l’objet dans le corps du texte permet de penser la lecture d’un texte non pas au prisme du flux de prose qui le constitue, mais de la récurrence des matériaux insérés en son sein et de leur capacité à faire office de prisme pour des pratiques de lecture « en coupe » dans les contenus. Une telle configuration, anticipée et présente lors de la rédaction, conduit à interroger la place de ces formes d’hypertextualité au moment de l’écriture et ses différentes expressions dans les formats dominants de la publication.
Un format vacillant pour la collaboration : processus éditoriaux, écriture collective et division du travail
Le projet Peritext met enfin en lumière les différentes tensions à l’œuvre dans l’articulation entre les diverses pratiques et acteurs associés à la publication en SHS. En hybridant différentes pratiques à travers un outil commun, il permet d’abord d’identifier les différentes perspectives qui concourent à la stabilisation des formats de publication dominants. On pourrait en ce sens considérer Peritext comme un système destiné à préciser et définir les problématiques propres à une série d’acteurs.
Cela dit, en concentrant écriture, édition et design graphique dans une seule et même interface, Peritext autorise un mélange et une redistribution des rôles entre auteurs, éditeurs et designers et perturbe les divisions du travail stabilisées vis-à-vis des processus éditoriaux de production des SHS62 . Ainsi, une interface comme Ovide permet de donner accès en un même lieu à la configuration des contextualisations effectuées pour le propos, la composition et la spécification des éditions qui en organisent la teneur, ainsi que la spécification graphique et interactive de chacune desdits éditions. Il ne s’agit pas ici de soutenir une organisation du travail qui déposséderait les métiers de l’édition de leurs prérogative, ou prétendrait offrir une solution technique susceptible de se substituer aux épaisseurs de la médiation éditoriale. Il s’agit plutôt d’offrir un point de jonction entre des pratiques et des métiers qui sont d’habitude séparés, d’en expérimenter les articulations et les interdépendances.
Par ailleurs, du point de vue des pratiques d’équipement de la publication elles-mêmes, Peritext questionne également l’organisation des efforts techniques dans le sens d’une infrastructuration des pratiques de publication des chercheurs. En effet, le projet a été pensé, à la fois dans son format de données et dans l’architecture technique des modules qui permettent de fabriquer des projets avec ce dernier, comme un projet conçu pour des contextes d’implémentation légers et modulaires. Suivant les occurrences, le projet a été implémenté dans des contextes très variés : sous la forme d’une application autonome pour des contextes d’écriture solitaire, d’une application client-serveur dans le cadre de pratiques collaboratives de petite envergure, enfin d’une application client-serveur-base de données pour équiper des projets éditoriaux tels que la conception de revues scientifiques multimodales. Cette diversité d’implémentations est liée au contexte d’élaboration de cette recherche, orientée vers les démarches et pratiques et des chercheurs davantage que vers les acteurs du système de la communication scientifique et des « cyberinfrastructures » qui structurent actuellement le paysage éditorial. Peritext a été pensé pour pouvoir être implémenté à la marge de ces systèmes tout en étant capable de dialoguer avec ces dernières. En ce sens, la dimension modulaire de Peritext permet aussi (et surtout ?) de développer des modules spécifiques pour chaque projet sur la base d’une architecture informationnelle commune. Elle invite donc à questionner le design graphique entièrement automatisé de la plupart des revues électroniques de recherche en SHS63 en faisant la démonstration, sous la forme de choix purement techniques, que d’autres modes d’organisation et de collaboration entre éditeurs, designers et développeurs, sont possibles.
Les choix sédimentés dans l’archipel de modules, de logiciels et de documents qui constituent la version stabilisée de Peritext sont donc autant des propositions que des manières de questionner et de troubler certaines des relations qui avaient pu être stabilisées par les formats de publication majoritaires des SHS. Ces choix, durant le temps de la conception, furent des sites de réflexion sur les enjeux méthodologiques, épistémologiques et socio-économiques des formats de publication. Ils ont ici été explicités sous la forme de tensions qui se veulent émerger plus ou moins spontanément via la pratique de logiciels comme Ovide. Dans ce cas, si l’on considère Ovide comme un document-publication propre à être fréquenté comme l’un des formats de publication de cette recherche, comment qualifier un type d’artefact qui fonctionne à la fois comme un outil pour des collectifs de recherche et comme un lieu de réflexion et d’échange à propos de la recherche de laquelle il est dérivé ?
Qualifier des lieux de savoir au statut hybride
Les productions de cette thèse ont souvent été qualifiées « d’outils » à l’occasion des différentes présentations qui en ont été effectuées. Cette qualification peut leur convenir quand ils sont saisis comme les équipements participant d’une pratique d’instrumentation des collectifs de recherche. Cependant, cette dénomination ne suffit pas à décrire le caractère expérimental de leur contribution, ni à épuiser les gestes possibles d’une démarche de design située à l’intérieur des SHS. En effet, ainsi que l’a montré Stephan Wensveen, les prototypes produits par une démarche de recherche en design peuvent jouer une multitude de rôles : tester une hypothèse technique, esthétique ou ou ergonomique, recueillir des données auprès de participants, ou encore faire œuvre de démonstration ou d’argumentation (Matthews & Wensveen, 2015). Afin de définir les effets d’une trajectoire de fabrication-comme-enquête sur les collectifs avec lesquels elle dialogue, la production de design très particulière que constitue l’élaboration d’équipements de recherche doit en ce sens être précisée. Il s’agit donc, pour reprendre le concept élaboré par Christian Jacob, de qualifier en quoi ces équipements relèvent-ils de lieux de savoir capables de se lier avec d’autres lieux pour devenir l’occasion d’une élaboration collective (Jacob, 2014).
En ce sens, je me propose d’examiner différentes qualifications possibles pour ce qui peut être attendu de la pratique des expérimentations des présentes recherche, et dans quelle mesure une situation d’utilisation d’une production telle qu’Ovide pourrait être articulée avec la lecture de la présente thèse comme l’une des composantes de l’enquête. Une telle tâche touche à la question des méthodologies de recherche en arts et design, mais elle touche plus largement le statut des différentes productions matérielles et logicielles survenues récemment dans l’espace des SHS – logiciels d’analyse de données, interfaces de bases de données, etc. – et leur statut vis-à-vis des communautés de recherche, au premier rang desquelles celles des humanités numériques. Suivant un nouveau geste de dérivation, il s’agit donc de tester différentes associations de ces produits matériels avec des qualificatifs discursifs qui permettraient d’en définir des usages productifs sur le plan de l’interprétation et de l’enquête.
Instruments
La requalification la plus proche des « outils » produits par cette recherche me semble être le terme d’instrument. De la même manière que le design des produits de la thèse a fait office de véhicule pour la conduite de mon enquête et de sa problématisation, on peut faire l’hypothèse que des logiciels tels qu’Ovide et Dicto peuvent être considérés comme des instruments d’observation des formats de la publication et de leurs enjeux. À ce titre, la pratique de l’expérimentation et du développement matériel dans le cadre des recherches en sciences humaines et sociales, et plus particulièrement de développement informatique, a été à plusieurs reprises discutée dans le champ des humanités numériques. Dans un article intitulé « Developing things: toward an epistemology of making in the digital humanities » (Ramsay & Rockwell, 2012), Stephen Ramsay et Geoffrey Rockwell se demandent quel statut donner aux pratiques de développement apparues dans les collectifs de recherche. La question du « prototypage » les conduit notamment à proposer différentes hypothèses permettant de construire une « épistémologie matérielle » à même de donner une place aux artefacts informatiques dans l’espace de reconnaissance et de communication du travail universitaire en SHS. Dans ce contexte, la fonction d’instrument apparaît comme l’une des acceptions possibles pour établir une telle place.
Le problème sous-jacent à la reformulation d’outils en tant qu’instruments relève cependant de leur faiblesse énonciative : ils se veulent transparents ou faciles et ne portent pas dʼarguments. Au contraire, ils se soustraient à l’attention dès que lʼon essaie dʼapprocher la connaissance quʼils produisent :
Ces outils, loin dʼêtre utilisés sur le devant de la scène dans un contexte performatif, ne sont remarqués que lorsquʼils tombent en panne ou refusent de travailler en toute transparence. De tels outils nʼexpliquent pas ou nʼargumentent pas, mais facilitent. […] Un artefact numérique qui vous montre de manière transparente quelque chose dʼautre peut transmettre des connaissances, mais il nʼintervient pas comme une explication ou un argument ; il sʼéloigne de la vue au profit de ce qui est représenté.64 (Ramsay & Rockwell, 2012, p. 78)
La dimension instrumentale des productions de cette recherche les rend donc difficilement mobilisables comme les matériaux d’une enquête dans la mesure où elles invitent nécessairement à un cadre « représentationnaliste » de ce qu’elles donnent à fréquenter. Qualifier Ovide d’instrument ne permettrait donc pas de le faire participer de la lecture de cette thèse. Il faut donc le redéfinir dans un sens qui permettrait de le faire dialoguer avec les productions discursives de la recherche.
Arguments
On pourrait d’abord considérer des logiciels tels qu’Ovide et les formats tels que Peritext comme des arguments visant à pointer les limites et les contingences des formats dominants, telles que détaillées ci-avant dans ce texte, ou à proposer de nouveaux modèles pour la matérialité des pratiques de recherche relatives à la publication. Dans la littérature de la recherche en design, l’approche du design comme un acte relevant de l’argumentation est une proposition relativement ancienne qui remonte notamment aux travaux de Richard Buchanan (R. Buchanan, 1985). Ce dernier proposait ainsi de concevoir les objets technologies comme le déploiement d’une forme de rhétorique, un « argument de design » visant à persuader les citoyens dʼadopter des valeurs et des attitudes vis-à-vis de leur vie quotidienne et pratique. Selon lui, la technologie se présente avant tout comme une forme de persuasion, qui tente de faire entrer dans la vie une variété de points de vue à propos de la vie sociale. Buchanan reprend en ce sens les principes aristotéliciens de la rhétorique pour distinguer trois composantes de lʼargument de design : le raisonnement technologique (logos) – à savoir la manière non-neutre dont un problème pratique est résolu ; le caractère (ethos), à savoir les valeurs suggérées ou portées par le produit ; et lʼémotion (pathos), c’est-à-dire le mouvement dʼidentification et dʼattachement esthétique porté par les qualités sensibles de lʼobjet. En ce sens, pour Buchanan, les pratiques de design présupposent – et donc préforment – les circonstances dans lesquelles une technologie est utilisée et se voit investie de sens selon une « rhétorique de la démonstration » qui amplifie ou développe un ensemble de valeurs et de modes de vie.
De telles approches ont été, dans l’histoire plus ou moins récente de la recherche en design, adoptées à plusieurs reprises dans les champs du design radical, puis du design spéculatif et critique (Seago & Dunne, 1999), récemment regroupés par Bruce et Stephanie Tharp sous le nom de « design discursif » pour désigner les moyens par lesquels « des idées dʼimportance psychologique, sociologique et idéologique sont incarnées dans des artefacts ou délibérément engendrées par ceux-ci »65 (Tharp & Tharp, 2019). Les productions de cette thèse diffèrent cependant de telles pratiques « discursives » dans la mesure où elles ne provoquent pas ou ne portent pas un « argument » définitif, mais tentent plutôt de déplacer les manières de faire, de ralentir les automatismes induits par la stabilisation des formats de publication. Elles ne sont pas non plus inscrites dans des événements circonscrits dans l’espace et le temps – comme c’est le cas de beaucoup des versions du design « discursif » souvent marquées du sceau de l’exceptionnalité et de l’incongruité66 – mais sont des productions discrètes aptes à composer une diversité de situations à la finalité plus ou moins expérimentale. Ce sont au contraire des productions qui ont le potentiel d’accompagner les chercheurs dans la quotidienneté de leur travail. Il est donc nécessaire de trouver une manière alternative de décrire les effets de telles productions pour permettre d’articuler les pratiques matérielles (« d’utilisation ») qu’elles impliquent avec les pratiques discursives (de commentaire et de discussion) auxquelles elles entendent participer.
Annotations
On peut enfin considérer les productions de cette recherche et les reconstitutions qu’elles opèrent comme des annotations vis-à-vis des dispositifs dominants d’écriture, d’édition et de design pour la publication des recherches universitaires. La question de l’annotation est déjà au centre de plusieurs travaux de recherche en design, comme une des modalités d’articulation entre les pratiques de fabrication et celles d’écriture et de conversation universitaire – cependant elle désigne généralement le statut des textes qui accompagnent des productions de design dans une démarche de recherche. En ce sens, Bill Gaver a proposé la notion de « portfolio annoté » pour articuler pratiques de design et écriture (Gaver & Bowers, 2012), là où Donato Ricci a qualifié le travail d’écriture en design comme « l’annotation d’une anthologie de pensées et d’expérimentations »67 (Ricci, 2019a).
Je voudrais, pour proposer une qualification des produits de ma pratique matérielle de recherche, reprendre la notion d’annotation tout inversant la relation entre pratiques discursives et matérielles, et considérer les productions de cette recherche elles-mêmes comme des annotations pour les discours et les pratiques dominantes à l’œuvre à propos de la publication en SHS. Ce sont des annotations, d’abord parce qu’elles sont le fruit d’un travail d’écriture (de code) qui a été produit dans le contexte de fréquentation d’autres écrits (logiciels) en usage dans les pratiques de la publication de recherche. Ce sont également des annotations dans la mesure où, par les formats qu’ils déploient pour les pratiques d’enquête, d’écriture et d’édition, des logiciels tels qu’Ovide ou Dicto invitent à questionner, commenter et comparer les pratiques établies et stabilisées des collectifs de recherche. Il rendent les acteurs qui les utilisent sensibles à des articulations inattendues et invitent à remettre ces dernières en question, tout en offrant une stabilisation partielle pour investir de telles articulations et éventuellement les investir sur un registre expérimental.
On peut re-mobiliser à ce titre le concept de middleware intellectuel pour tenter de décrire ce que de tels logiciels peuvent faire aux collectifs de recherche et aux discussions qui les animent. Si « décider de considérer que tous les actes de structuration et de modélisation de lʼinformation sont des actes dʼénonciation permet de prendre en compte la performativité transactionnelle de leurs effets »68 (Johanna Drucker & Svensson, 2016, p. §54), alors la production de logiciels et de formats expérimentaux peut être considérée comme un acte d’énonciation distribué socialement et temporellement à travers les contextes d’élaboration et d’appropriation dont il fait l’objet. En faisant rejouer des pratiques familières au prisme d’inflexions processuelles et de variations procédurales, la contribution de productions telles qu’Ovide aux collectifs des SHS se situerait alors dans le statut hybride des middlewares intellectuels qu’elle propose, entre instrumentation de pratiques familières et déviation de procédures et de manières de faire établies.
Tout comme pour les middlewares intellectuels en général, l’attention portée à ces productions en tant qu’annotation matérielle sera probablement très fragile, puisqu’elle est constamment menacée de disparaître au profit des opérations et des usages qu’elle permet de faire. Si cette attention était maintenue, toutefois, elle permettrait de faire l’expérience d’inflexions interprétatives à même de faire ré-fléchir des manières de faire établies, de rendre sensibles certaines présuppositions opérationnalisées dans des outils quotidiens et de rejouer des modèles sédimentés par la contingence de l’histoire.
Ainsi, en proposant de qualifier des productions telles qu’Ovide comme des annotations, je tente de qualifier le statut à la fois instrumental et expérimental que ces lieux de savoir hybrides pourraient endosser vis-à-vis des discussions qui portent sur la matérialité des pratiques savantes. Il s’est en ce sens agi de définir les effets envisagés par les productions laissées dans le sillon de la présente recherche. Il serait incorrect d’affirmer que ces effets étaient prémédités de ma part dès le début de cette recherche et préalablement à l’écriture du présent texte. Par ailleurs, une telle démarche joue bien sûr elle-même le rôle d’un format, dans la mesure où elle tente de (re-)cadrer, par la pratique discursive de l’écriture de ce document, les pratiques matérielles d’expérimentation avec ce qui pourrait être perçu, sinon, seulement comme des outils, des instruments ou des arguments. Elle constitue donc une dérivation à part entière dans l’élaboration de cette enquête.
Conclusion
Dans ce chapitre, j’ai décrit et qualifié les vacillements que peut produire une pratique de design impliquée dans la fabrication de moyens conjoints d’écriture, d’enquête et de publication pour les collectifs de recherche en SHS. Les effets de cette pratique ne relèvent pas d’une optimisation des manières de faire ou d’une résolution des problèmes posés par les contextes institutionnels, éditoriaux et techniques de la publication en SHS contemporaine. Ils relèvent plutôt, quand ils sont intégrés et articulés avec une démarche d’enquête, de la mise en évidence d’un certain nombre de tensions à l’œuvre dans l’évolution des équipements proposés aux chercheurs pour la conduite de leurs activités d’enquête, d’écriture et d’édition. De la même manière, la production de logiciels finalisés et utilisables a permis de partager certaines de ces propositions dans la situation de la présente recherche, mais ne constitue pas l’aboutissement ou la finalité d’une telle démarche. Cette dernière relève plutôt d’un geste à la fois performatif, multimodal et investigatif qui a permis de documenter et d’éprouver les enjeux à l’œuvre dans la production et la mobilisation des formats d’écriture, d’édition et de lecture.
Dans ce cadre, ma démarche a consisté à articuler une série de situations de conception et de fabrication par les dérivations successives de formes éditoriales, de principes techniques et de procédures méthodologiques – produisant un jeu de stabilisation et de déstabilisation pour les formats des pratiques de lecture, d’écriture et d’édition avec lesquelles elles ont dialogué. En ce sens, à travers les opérations d’échantillonnage, de conversion et plus généralement de traduction que permet un travail fondé sur la dérivation de formats-cadres en formats-produits et vice-versa, cette pratique a permis de restituer au format son caractère « à la fois normatif […] et ce qu’il implique de pluralisme formel ou ontologique » dans sa double dimension de« matrice » et d’« opérateur souple » qui autoriserait, en dépit de sa normativité intrinsèque et du fait qu’il s’inscrive dans une grammaire d’usages primaires définis, des usages secondaires, des déplacements, des conversions, des traductions, des passages vers un autre que lui-même » (Quintyn, 2015, pp. 50‑51). La dérivation, en ce sens, est une opération en mesure de décrire à la fois les articulations de ma trajectoire de recherche et les modalités selon lesquelles les formats vacillent entre les deux pôles de la « matrice » et de « l’opérateur ».
Cette démarche a également produit un ensemble varié de produits – qu’il s’agisse de logiciels, de bibliothèques de code ou de documentation technique – constituant une forme complémentaire et multimodale de cette recherche. J’ai proposé de mobiliser ces derniers en évitant une opposition stricte entre un mode de justification relevant de l’« instrumentation » (ingénierique) et un autre de l’« expérimentation » (artistique). J’ai plutôt tenté de les re-qualifier, dans le cadre de cette recherche, comme des lieux de savoir au statut hybride, qui proposent de nouveaux équipements aux collectifs de recherche tout en instaurant l’espace d’un ralentissement, d’une dénaturalisation et d’un questionnement de leurs pratiques. En ce sens, je reprends à mon compte les notions de middleware intellectuel – issues de la littérature des humanités numériques – et d’annotation – issues notamment de la littérature de la recherche en design – pour désigner le statut de ces artefacts en tant que documents-publications et leurs effets espérés sur le « lectorat » qu’ils entendent rencontrer dans le cadre de cette thèse.
Par ailleurs, ce chapitre a permis de qualifier le type de cheminement méthodologique opéré par la trajectoire de dérivation caractéristique de cette enquête. Une telle trajectoire a permis de faire dialoguer des pratiques textuelles avec des pratiques matérielles, mais aussi de rencontrer une variété de disciplines et de méthodes de recherche étrangères au design. En ce sens, des chercheures en design comme Annie Gentès ont décrit la capacité des pratiques de design à reconfigurer les concepts et les méthodes avec lesquelles elles dialoguent sur le registre d’une inter-discipline propre à interroger l’organisation et la hiérarchisation des savoirs ainsi que de leurs méthodes (Gentès, 2015). Il me semble avoir éprouvé une telle reconfiguration à travers les multiples dérivations qui ont concouru à la fois de la formulation de mes projets de conception, et de leur reprise après-coup pour l’écriture de ce texte.
Cette démarche s’est enfin inscrite dans le projet d’une infrastructuration des collectifs de recherche en SHS par le design. Cette dernière vise à permettre à ces collectifs de formuler et de travailler les problèmes qui les préoccupent, par la fabrication de moyens – techniques, méthodologiques, sociaux – élaborés depuis les situations de recherche, les terrains et les communautés concernées. Dans la lignée des théories de la recherche en design définies par Alain Findeli (Findeli, 2015), j’ai ainsi adopté une attitude qui s’est voulue à la fois épistémologique – élaborer des connaissances sur le vacillement des formats – et diagnostique – contribuer à équiper le design des publications en SHS. Ce faisant, une telle pratique d’infrastructuration participe nécessairement d’une poétique de la métamorphose documentaire qui tire parti du régime de l’éditorialisation pour travailler les positions et les rôles à l’œuvre dans la circulation et la reformulation des documents-publications de recherche, qui sont à la fois les traces et les matériaux du dialogue permanent et choral qui conduit à la constitution des savoirs.