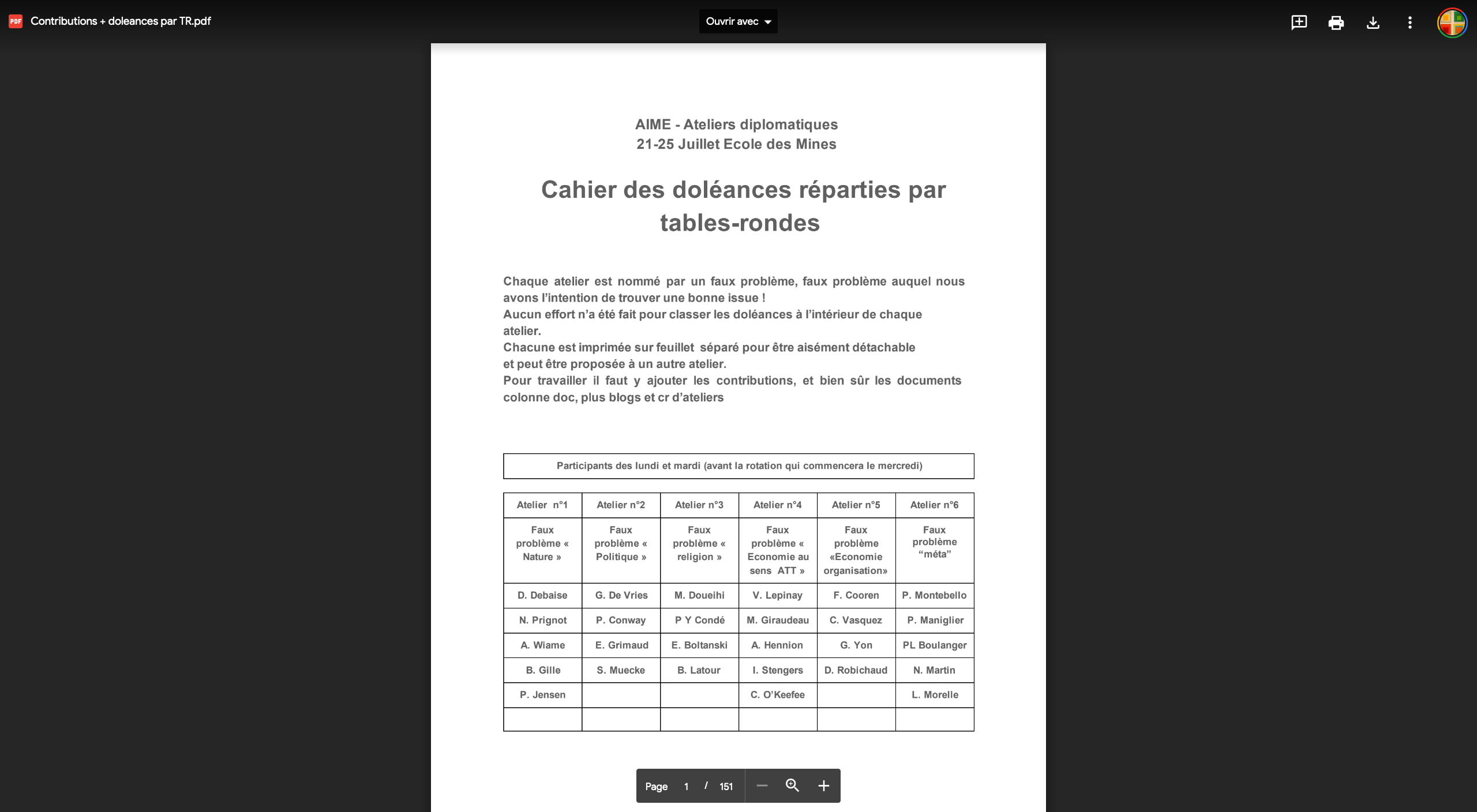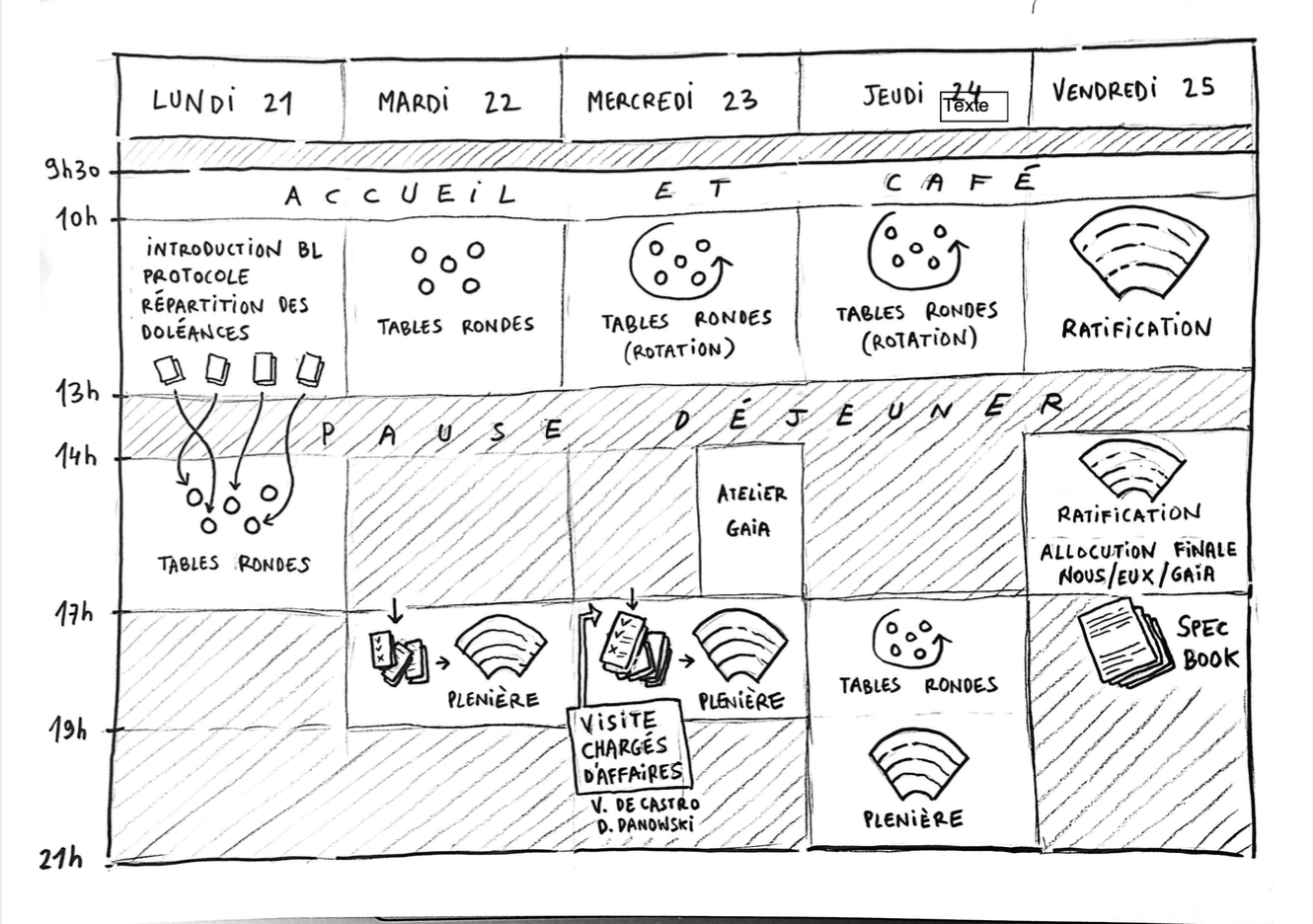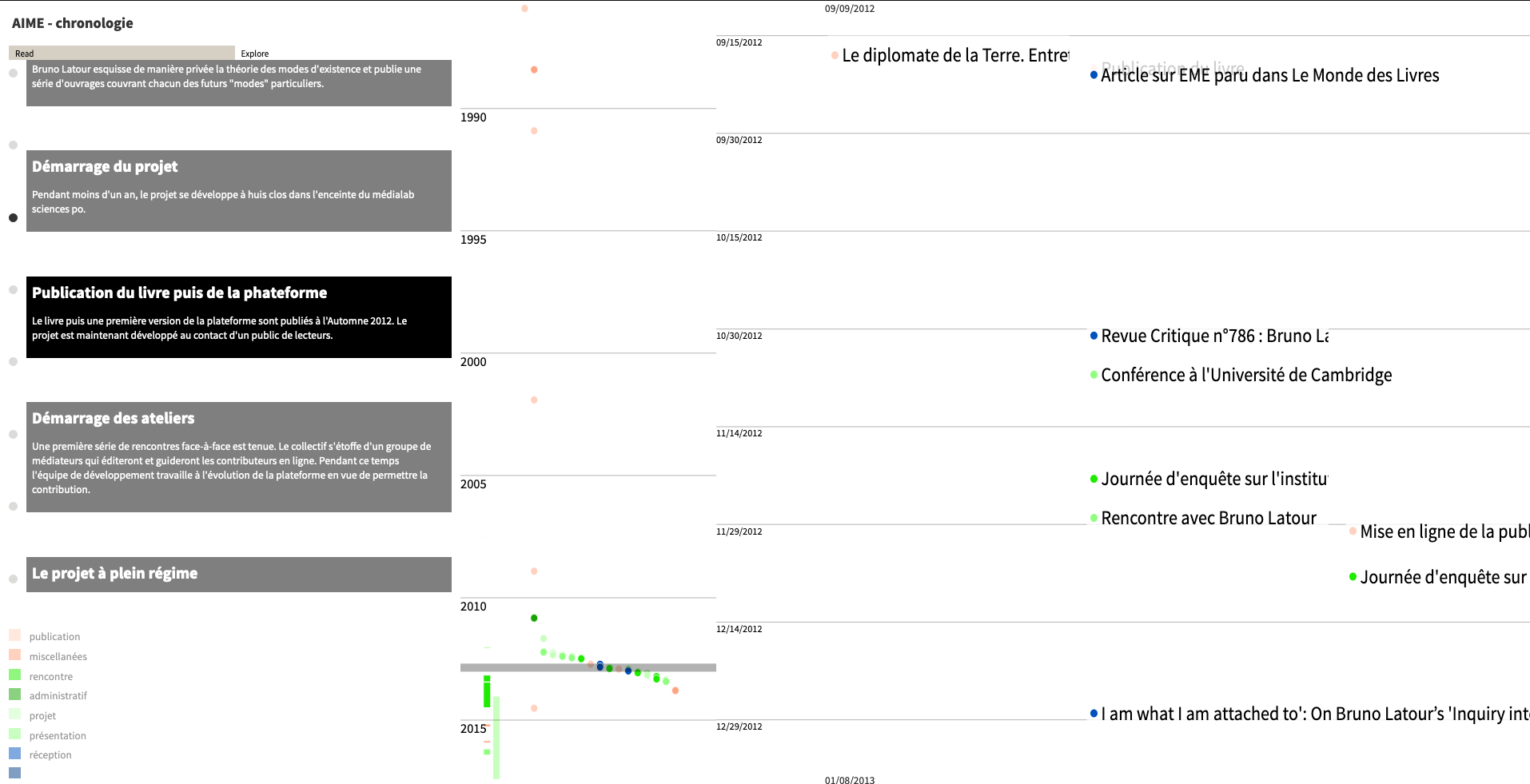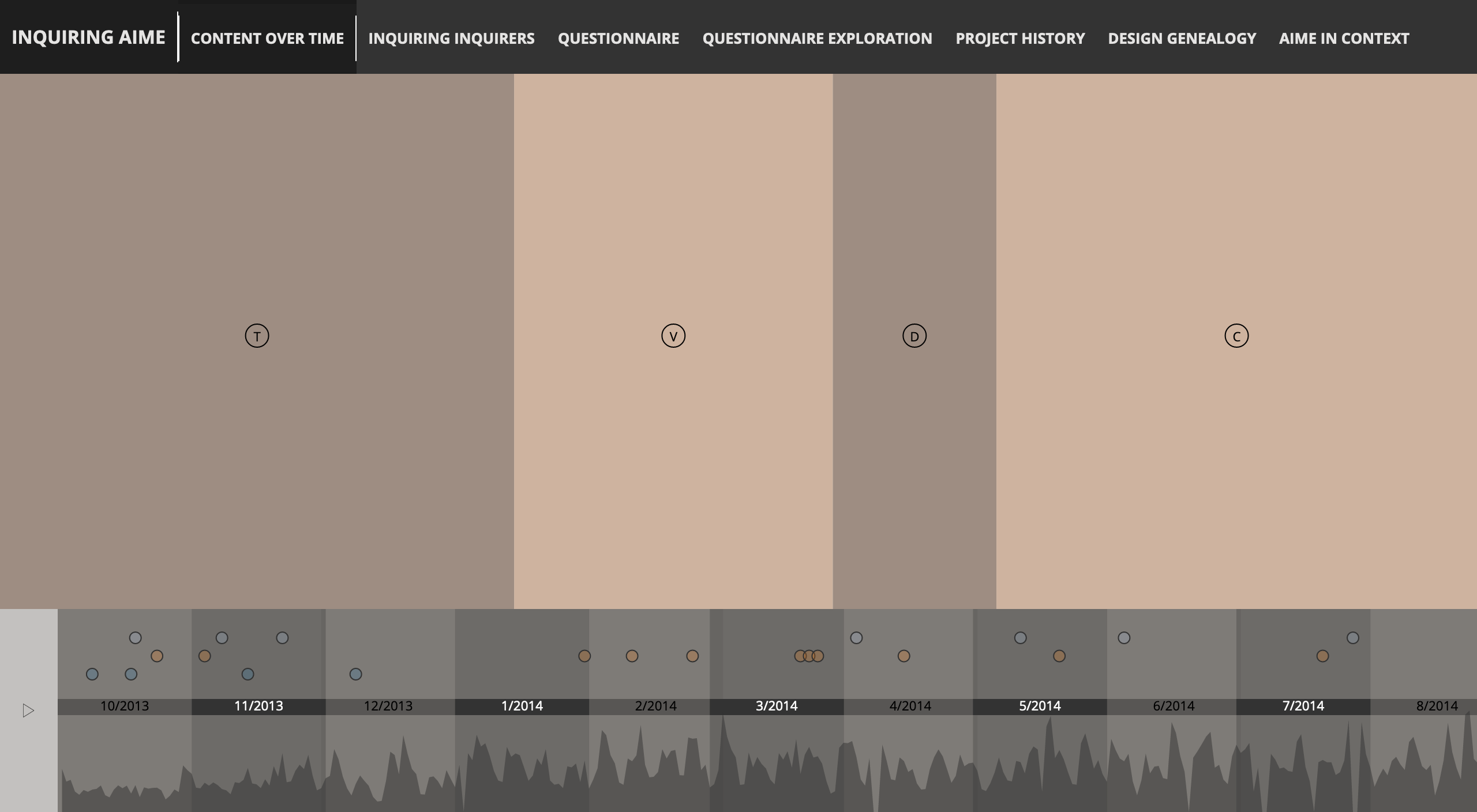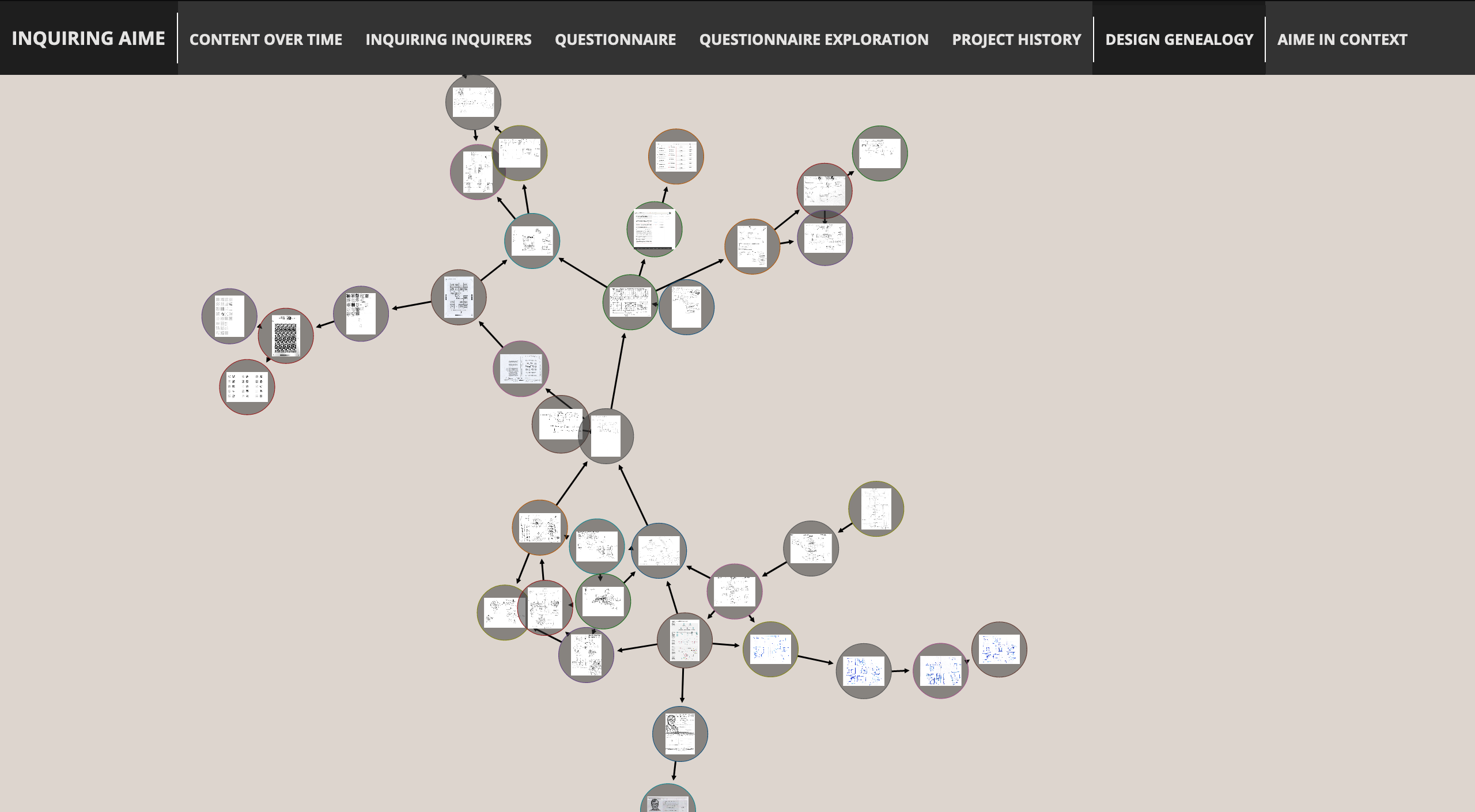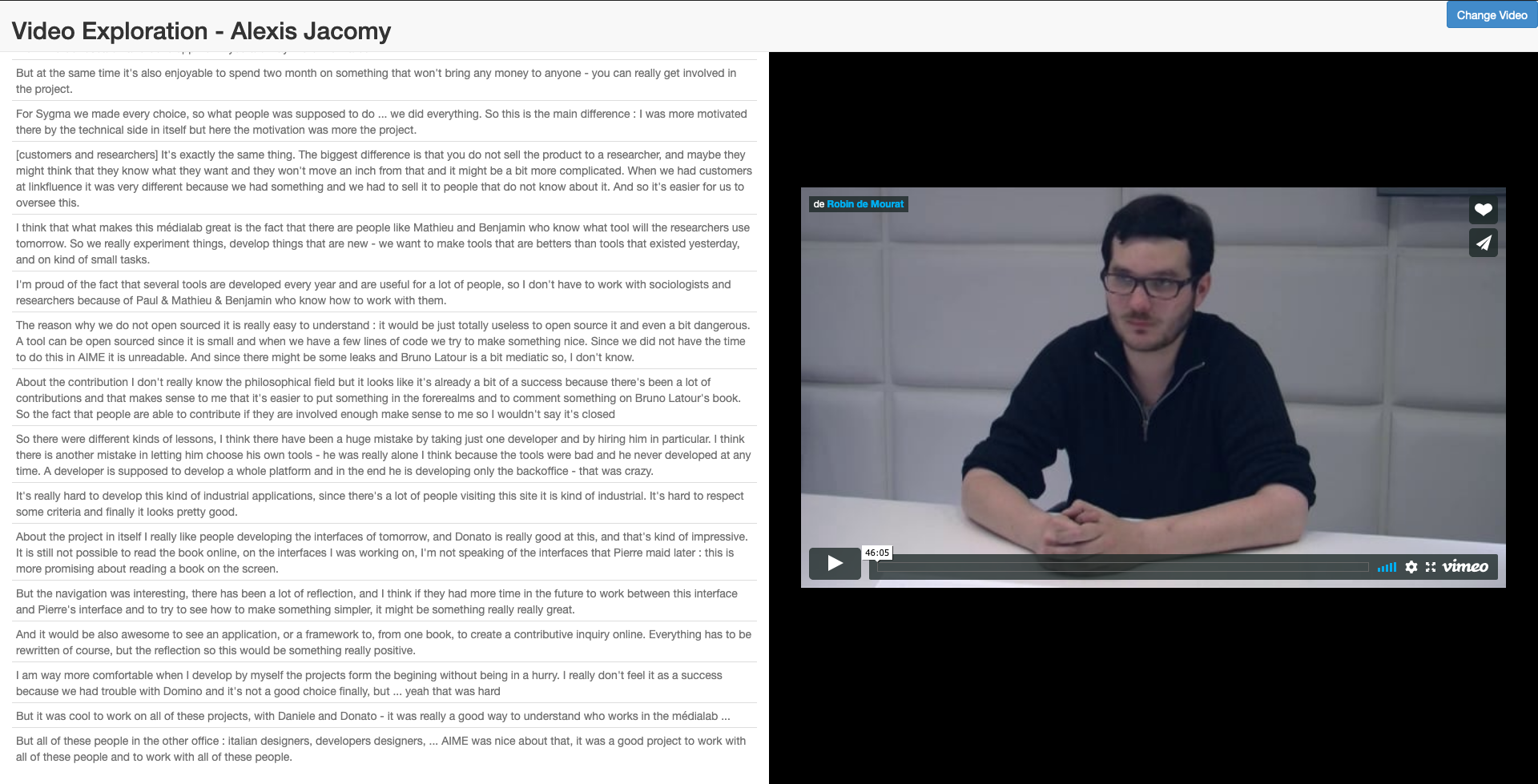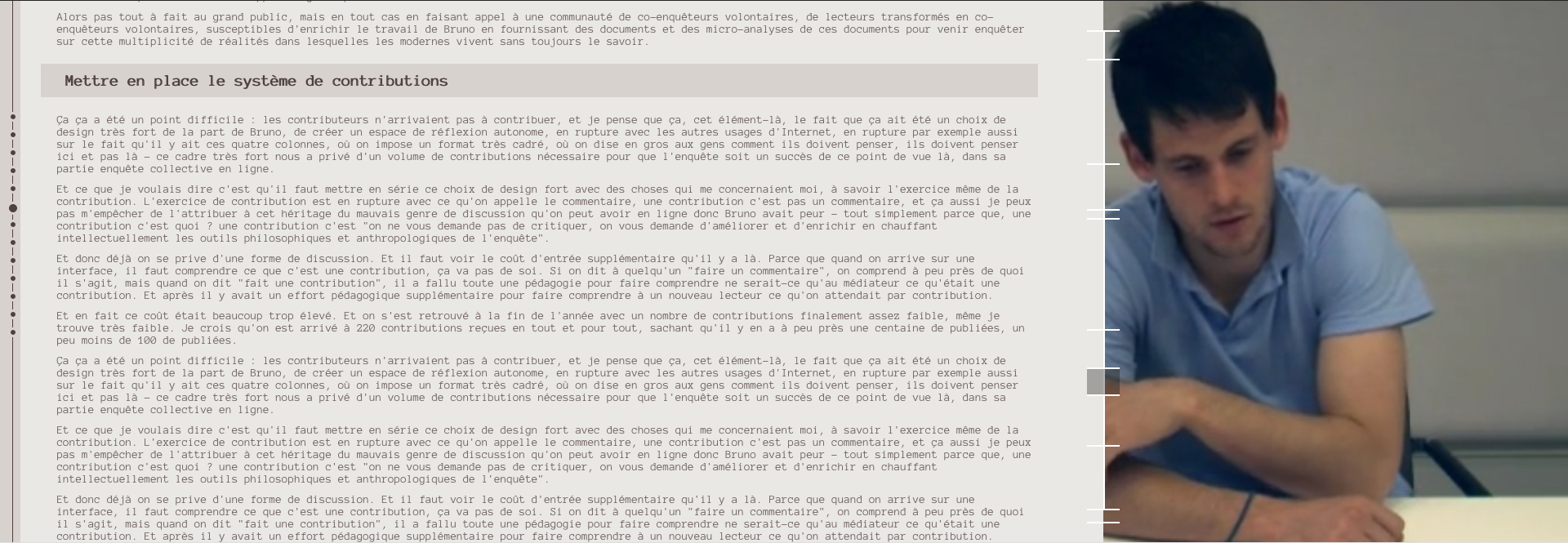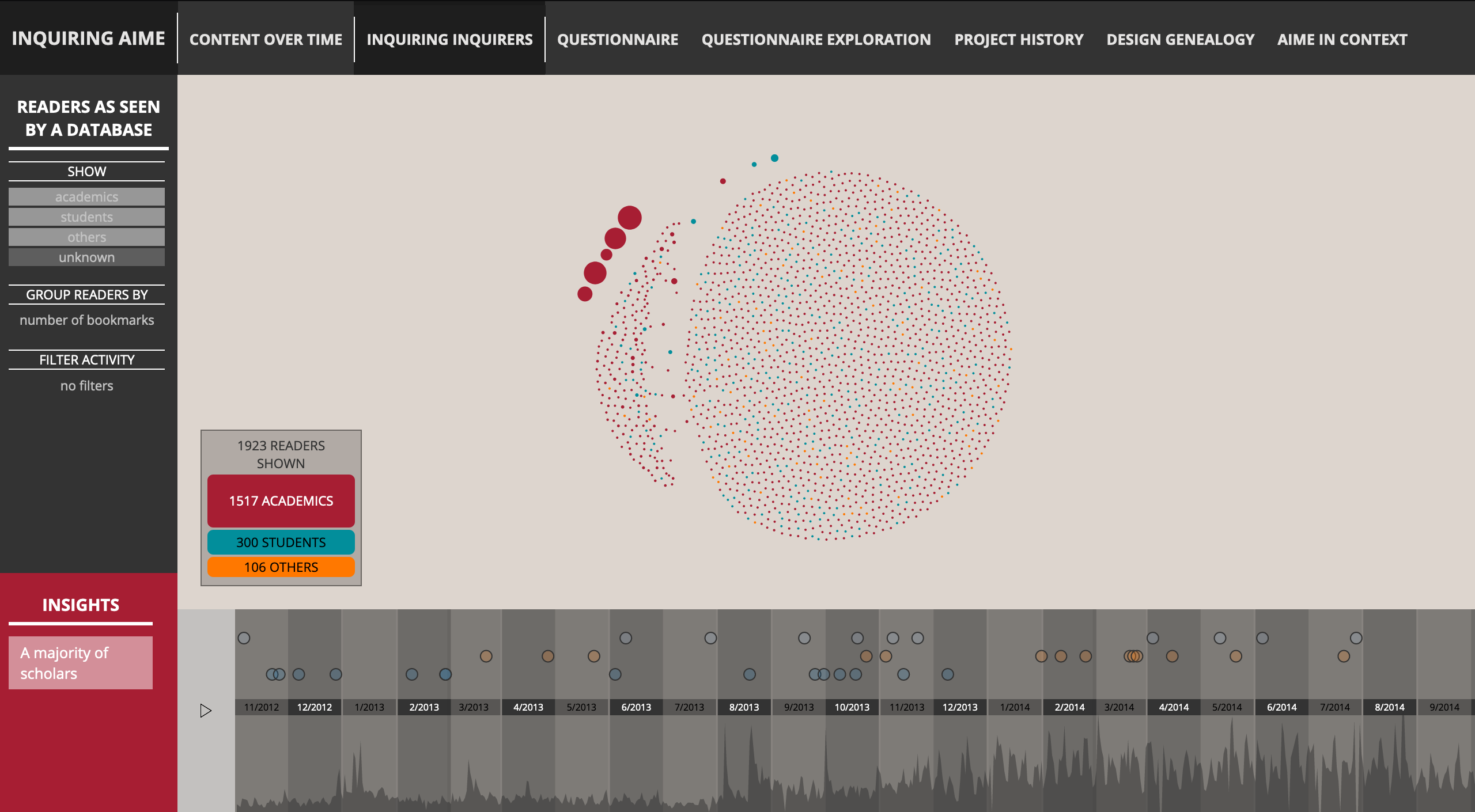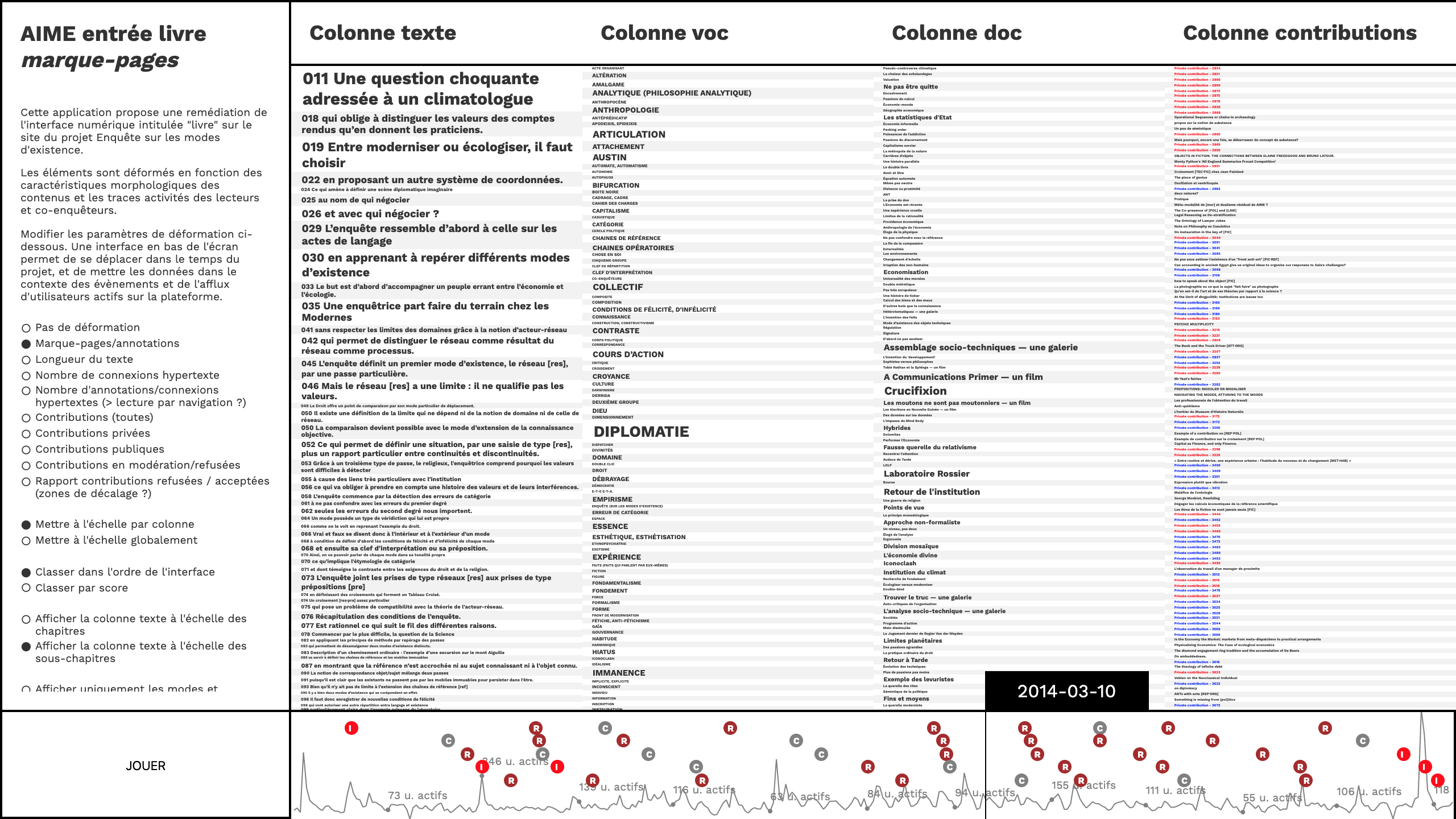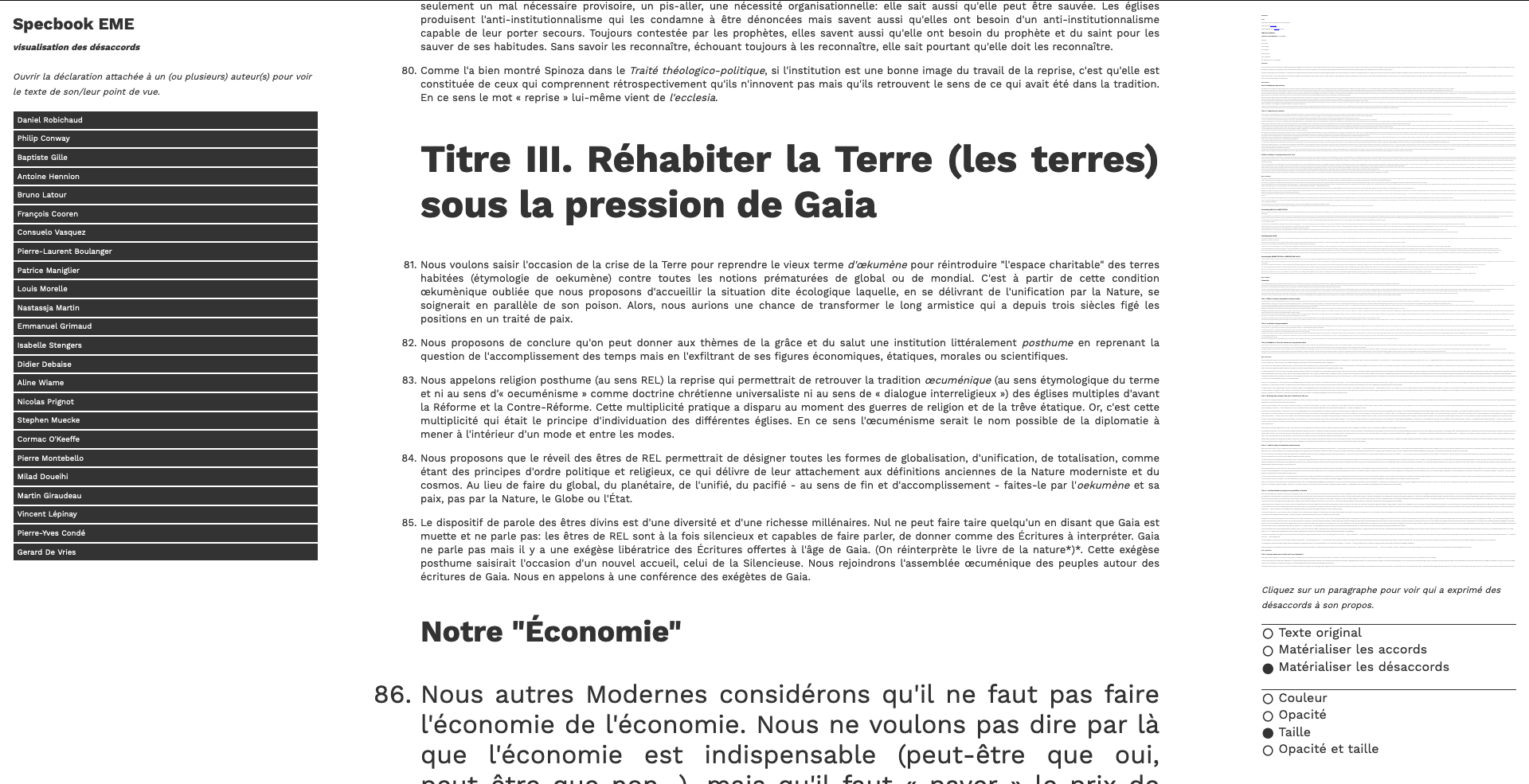Chapitre 4. Les formats de publication à l'épreuve d'une écriture en public : le cas de l'Enquête sur les Modes d'Existence
Nous venons ici pour vous offrir ce texte, avec à l’esprit l’importance de la négociation qui nous réunit tous. Ce texte a beaucoup de valeur pour nous. Nous comptons d’autant plus sur vous pour le remanier. Il est le résultat d’un travail collectif considérable, entrepris depuis plusieurs années. C’est un étrange exercice auquel nous allons nous livrer. Nous proposons de nommer cela diplomatie, néanmoins personne ne nous a mandatés, il n’y a pas de camps. C’est donc une sorte de diplomatie interne que nous proposons. En bons diplomates, commençons par nous présenter. En effet, nous présenter avec politesse, avec civilité, c’est aussi affirmer qu’il est certaines choses auxquelles nous sommes vraiment attachés sans bien savoir les définir. C’est là l’objet incertain de la conférence qui va nous réunir. (Boulanger et al., 2014)
Par une chaude semaine de juillet 2014, un collectif de vingt-quatre philosophes, anthropologues et autres chercheur.e.s en sciences sociales se retrouve dans les locaux du Centre de Sociologie de lʼInnovation (CSI) de lʼÉcole des Mines, 60 Boulevard Saint-Michel à Paris. Ils sont réunis pour écrire collectivement un texte de philosophie empirique. Alors que le principe même d’une écriture collective est rare dans le champ de la philosophie et des SHS en général, l’entreprise est doublement ambitieuse dans la mesure où chacun des vingt-quatre co-auteurs est appelé, au-delà de l’apposition de sa signature, à participer effectivement à l’écriture et à ratifier le texte final malgré les désaccords et divergences de points de vue importantes qui ne manqueront pas d’émerger à l’intérieur du collectif. Le document à produire est labellisé à l’avance : il sera appelé « Specbook » (pour « livre de spécifications »). Il proposera un mode d’emploi philosophique permettant aux « Modernes » de mieux se présenter à eux-mêmes, aux autres peuples, et finalement, à « Gaïa », dans le contexte de la crise environnementale du début du XXIème siècle. Tous devront le signer. Il sera écrit en une semaine. Outre ses finalités propres, il devra faire office de conclusion provisoire au projet Enquête Sur les Modes dʼExistence initié par le philosophe et anthropologue Bruno Latour, élaboré depuis les locaux du laboratoire médialab de Sciences Po, 27 rue Saint-Guillaume, et ayant impliqué un grand nombre de participants dans la conduite d’une démarche d’enquête collective articulée par une diversité de rencontres physiques, d’ouvrages imprimés, et de dispositifs contributifs de publication numérique.
Cette semaine de travail aboutira effectivement à la production chorale d’un curieux texte à mi-chemin entre manifeste philosophique et déclaration diplomatique (Boulanger et al., 2014). Mais elle sera également le théâtre d’un âpre processus de négociation. En effet, les enjeux sont importants et promettent de susciter des discussions animées, puisque l’objectif de cette semaine, quelque peu ambitieux, est de produire un texte offrant une forme de redéfinition de l’expérience des Modernes. La séance de travail est par ailleurs contrainte par la perspective dʼune séance de débats publics autour du texte, programmée pour le lundi 28 Juillet 2014, deux jours après la fin de la rédaction du document. Le texte devra à cette occasion être présenté par les auteurs à un public de chercheurs et d’étudiants. Il sera reçu par des « chargés d’affaire » qui endosseront la charge symbolique de recevoir le document ainsi produit et d’en proposer une lecture et une réinterprétation. Cette semaine de réécriture est donc marquée par l’urgence et la contrainte d’un résultat à produire dans les temps, mais également par une procédure de déroulement conçue à l’avance par l’équipe du projet.

Malgré l’unité de temps de ce théâtre de négociation miniature, les lieux dans lesquels se conduit cette entreprise sont multiples. Il y a dʼabord la salle commune du CSI, organisée en tablées concentrées autour de certains chapitres et points conceptuels particuliers qui doivent être abordés dans le texte (la religion, la nature, la politique, la diplomatie…). L’organisation spatiale nʼest pas sans rappeler les scénographies de « workshops » conduits dʼhabitude dans le cadre de projets dʼarts, de design ou dʼingénierie. En plus de la salle commune, deux salles connexes, fermées, sont proposées aux groupes de travail qui recherchent le calme et/ou le secret. Une autre salle, plus périphérique encore, sert dʼentrepôt pour le matériel dʼenregistrement et la conduite dʼentretiens individuels « à chaud », forme de « confessionnal » philosophique que j’anime avec d’autres membres de l’équipe organisatrice ; y sont livrées (ou gardées pour soi) confidences et déclarations sur l’avancée de l’écriture et les difficultés rencontrées, participant aussi à la conduite du travail collectif. Enfin, un vaste jardin sur lequel donne la salle, permet la tenue de discussions informelles sous les arbres de lʼÉcole des Mines, en marge des lieux de travail officiels que sont les salles d’étude et de réunion.
À côté des lieux physiques qui forment une première intrication de cadres hétéroclites pour la construction du texte, on en trouve un autre, peut-être plus étrange : une page web « Google Document » sur laquelle chacun des groupes contribue à la portion de texte qui lui est attribuée, découpée en une série de grandes notions – baptisées « faux problèmes » dans le cadre de cette semaine – dont il s’agit de proposer une redéfinition (« nature », « politique », « religion »,…). La « page » web du Google Document présente simultanément un contenu – lui-même formaté selon un système de pages affichées à l’écran et simulant de manière suffisamment proche le document imprimé à venir – et une interface dʼédition. Elle est affichée sur les écrans qui peuplent les tables de travail, mais aussi projetée sur un mur par un vidéoprojecteur, de manière intermittente. Objet familier pour les uns, source dʼapprentissage (peut-être même de distraction) pour les autres, elle est aussi un obstacle technique infranchissable et effrayant pour certains des chercheurs les moins habitués à ce type dʼarsenal numérique. Quand le Google Document est projeté sur le mur, le remplissage des pages et divers amendements est visible de tous. Par ailleurs, les modifications sont affichées en temps réel sur chacun des écrans qui affichent le document, non sans provoquer un émerveillement manifeste de la part des individus les plus réfractaires à lʼutilisation de l’exotique dispositif qui leur est proposé. C’est ainsi un document « partagé » entre plusieurs lieux et plusieurs personnes. C’est aussi le lieu où se départagent « graphiquement »1 divers groupes au sein du collectif, un lieu de tension dramatique où sont déposées des phrases et des paragraphes qui matérialisent des convergences, des controverses, des différences de points de vue.

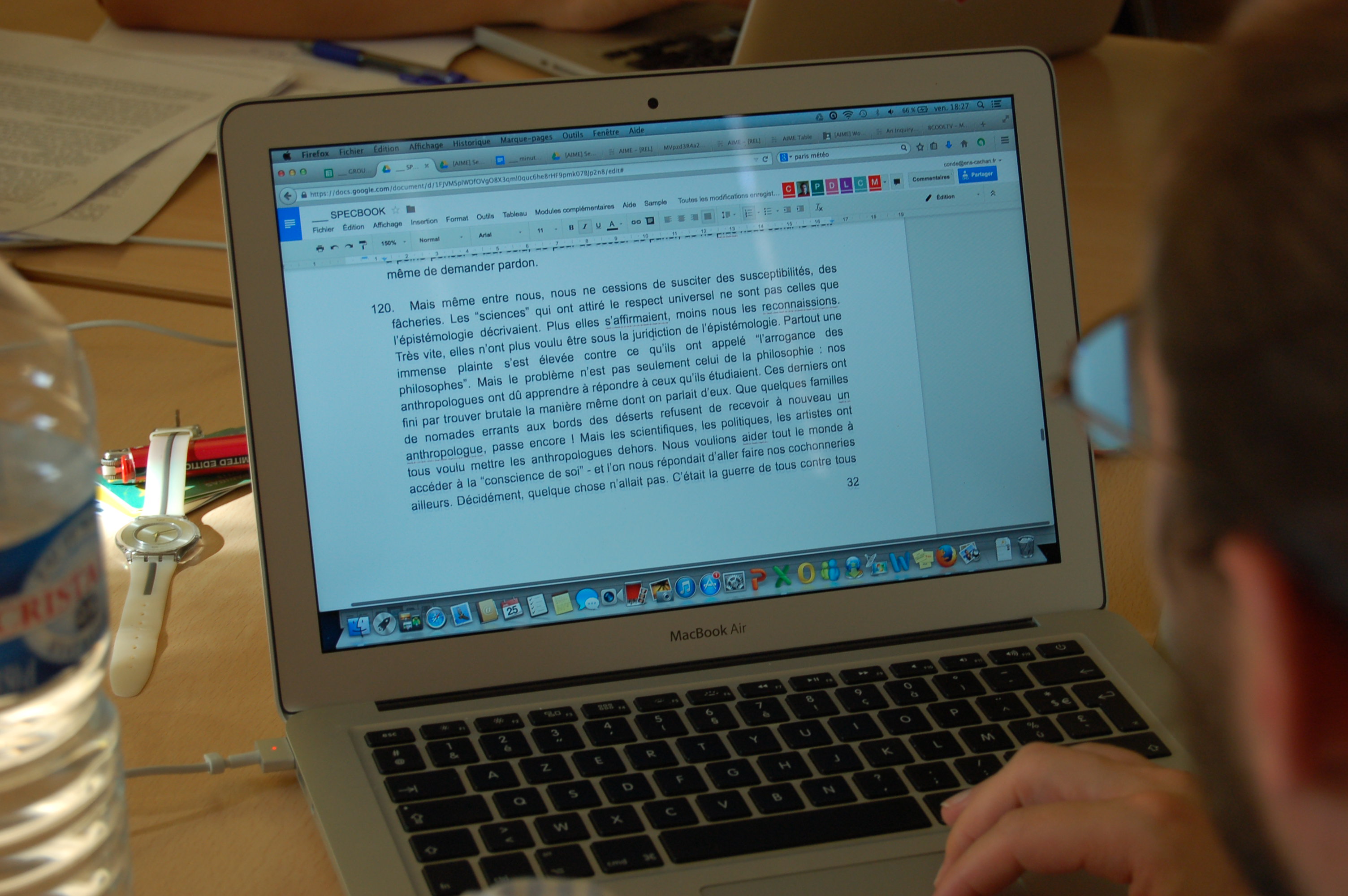
Pour toute la semaine, un programme de travail a été établi. À partir de l’activité d’un ensemble de participants nommés co-enquêteurs (sur lesquels je reviendrai plus tard dans ce chapitre), l’équipe a rédigé un ensemble de « doléances », écrites en français et en anglais, qui sont censées fournir une base pour le travail de la semaine. Ces doléances ont été regroupées au sein d’ateliers centrés sur un « faux problème » particulier – « politique », « religion », « économie au sens ATT », etc. – auquel il s’agira de trouver une « bonne issue » via l’écriture du « Specbook ». Sur cette base, le programme consiste à alterner entre des « séances de travail » en petits groupes organisés par ateliers et des « séances plénières » durant lesquelles chaque partie du texte est présentée par le groupe qui l’a travaillée. À l’issue de chaque séance plénière, les groupes tournent et se reconfigurent, de manière à permettre à chacun des ateliers d’être un lieu de débat entre les différents participants, mais aussi de rechercher une forme d’homogénéisation.
Les « séances plénières » de présentation prennent plusieurs formes au sein de la semaine, de lectures simples du travail effectué jusqu’à de véritables performances théâtrales. Les débats sont souvent animés. Mais ces derniers le sont moins que le court moment qui les suit, durant lequel doit être discutée la recomposition des groupes d’écriture et la circulation des auteurs entre les ateliers. Se jouent alors une série dʼépisodes dramatiques et de mouvements tacticiens. Tel participant souhaite rester dans le groupe où il se trouvait déjà, craintif de voir tel point de son avancée balayé par un congénère aux pensées antagonistes. Tel autre, de retour dans un groupe quʼil avait laissé deux jours plus tôt, découvre avec surprise et désolation la disparition de quelque morceau de bravoure intellectuelle quʼil avait laborieusement inscrit dans le Google Document et aurait aimé voir encore à son retour. Tel autre enfin, me confie avec enthousiasme son désir de sʼintroduire dans un nouveau groupe de travail afin de « faire passer » un argument qui lui est apparu à lʼissue de la séance plénière qui vient de se terminer.
Je me trouve témoin de cette semaine de réécriture au titre dʼobservateur-participant et designer associé au projet EME, au sein de lʼéquipe dans laquelle jʼévolue depuis quatre mois et demi. Durant cette semaine-ci, je contribue à la conduite dʼentretiens dans le « confessionnal » de la salle attenante, et à lʼenregistrement vidéo des échanges et des séances plénières. Cela dit, ma position me permet également d’évaluer les conditions d’organisation matérielles et procédurales de la négociation, et de questionner l’amélioration possible du processus d’écriture de ce texte.
J’observe attentivement, en compagnie de Donato Ricci – alors designer principal de l’Enquête sur les Modes d’Existence – les dynamiques de recomposition des groupes d’écrivains affectés à l’une ou l’autre des parties du texte à écrire et signer collectivement, et les manœuvres diverses qu’elles provoquent au sein du collectif de chercheurs, composé d’individus aux cultures disciplinaires et intellectuelles hétérogènes2 et aux attentes divergentes vis-à-vis du texte en cours d’écriture. À ce titre, nous remarquons l’apparition de différentes stratégies dʼinformation et de désinformation entre les groupes, jouant notamment sur le « camouflage » ou « l’affichage » des différentes directions qui sont en train dʼêtre imprimées au texte, secrètement concoctées dans les étanches espaces de travail des groupes avant leur révélation en séances plénières. Ces stratagèmes pivotent tous autour du « Google Document » et de son mode particulier de mise en visibilité. Tantôt espace dʼexpression, tantôt brouillon obscur – cette obscurité serait-elle parfois le fruit dʼune tactique dʼobfuscation consciente ? – tantôt menace de dévoilement pour les groupes en train de « préparer leur coup », il est, sinon le théâtre principal, au moins l’un des ressorts cruciaux de lʼévénement politique et intellectuel qui est en train de produire ce document partagé. Certains des participants, dans une stratégie de transparence totale, lʼutilisent dans un premier temps comme support des « minutes » des discussions (ou produisent des liens vers dʼautres documents contenant leur retranscription) – et élaborent collectivement, dans un esprit de consensus et de représentativité des points de vue, la partie du texte qui leur est attribuée. Dʼautres préfèrent discuter librement et charger lʼun des leurs de retranscrire de manière cohérente leur discussion à lʼissue de la séance : ce choix charge lʼédition du Google Document dʼune tension dramatique, faisant planer sur le secrétaire de chaque groupe lʼinquiétude dʼune trahison et, corollairement, lʼexpression envers celui-ci dʼune forme de confiance voire dʼalliance intellectuelle. Dʼautres enfin, mus par un manque d’aisance technique ou par une véritable tactique de dissimulation, vont même jusquʼà écrire à la main des morceaux de texte clandestins quʼils tenteront dʼintégrer dans le document au moment opportun.
En tant que designers, nous réfléchissons aux moyens de permettre la ratification du texte dans le temps imparti en jouant avec la matérialisation du texte en train de s’écrire – entendu à la fois dans le sens des mots et des phrases qui le constituent, mais également comme un ensemble vivant et instable de points de désaccords, de zones en construction, dʼîlots de consensus, etc. Sensibles aux protestations de certains des participants vis-à-vis de la difficulté à suivre et infléchir sur lʼévolution du « Google Document », nous tentons d’expérimenter un dispositif qui permettrait de suivre conjointement lʼévolution du texte et lʼexpression des positions de chacun durant les différents temps de la négociation. Pour nous, le problème est au premier abord assez limpide : les modifications du texte et son évolution manquent de lisibilité et il est donc nécessaire de les rendre davantage apparentes pour faciliter la discussion entre les groupes de travail. De plus, lʼexotisme du dispositif numérique dʼécriture proposé aux participants semble être un frein à la participation de certains. Le « google document », transposition des premiers logiciels de bureautique de type Microsoft Word sous la forme dʼune application collaborative en ligne, ne permet pas une vision dʼensemble satisfaisante des contenus. De plus, il propose certes un système de commentaires et de suggestions permettant une collaboration entre les groupes, mais la quantité de co-auteurs le rendrait vite illisible si chacun se mettait à l’annoter et à le discuter. Enfin, bien que le service propose un système de versionnage permettant d’afficher et de restaurer une version passée du texte, il nʼest pas possible dʼappréhender ces évolutions sur un mode synchronique – et encore moins de « restaurer » une portion du texte sans affecter les autres. Ce problème nous semble pouvoir être travaillé au moyen des moyens et de l’attitude du design : tenter de favoriser la mise en relation des participants via l’expérimentation matérielle, en traçant visuellement lʼévolution du texte pour permettre à chacun une meilleure prise de position vis-à-vis des autres forces en présence. Cette expérimentation, à nos yeux, devrait alors permettre la constitution d’un collectif davantage conscient de sa composition et de la diversité des intentions et des positionnements qui le constituent.
Nous nous mettons ainsi au travail pour reconcevoir le protocole d’écriture du texte en cours. Dans le hall de lʼespace qui nous est attribué, nous trouvons de poussiéreux panneaux dʼaffichage – ceux-là mêmes qui supportent habituellement les affiches dʼévènements et autres posters scientifiques – que nous disposons au milieu de la salle principale, bien visibles de tous. Nous imprimons une version du texte tel quʼil sʼest présenté lors de la dernière séance plénière, et nous l’affichons sur les panneaux. Puis, armés de feutres colorés, nous commençons à marquer par des traits de couleur verticaux certains des paragraphes du texte manifestement en débat. Nous demandons un moment dʼattention aux chercheurs pour leur proposer la méthode de communication que ce dispositif est censé supporter : il sʼagit pour eux, au moyen des feutres de différentes couleurs, de marquer les parties du texte quʼils souhaitent voir modifiées, celles avec lesquelles ils sont en total désaccord, ou au contraire celles quʼil leur semblerait indispensable de voir figurer dans le texte final. En procédant à ce rituel de marquage régulièrement (à l’orée de chaque séance plénière, pour faire le point sur sa position et la faire connaître aux autres participants), et en affichant côte à côte les différentes versions du texte imprimées ainsi annotées au fur et à mesure de lʼavancée de la semaine, chacun devrait être en mesure de faire un point synthétique sur les avancées de chaque partie et des points à débattre lors des séances plénières.
Notre intervention, si elle découle de la spécificité de cette situation, n’est pas spontanée ou dénuée d’arrières-pensées quant à la signification de ce geste, car elle est pour nous une manière de mettre à l’épreuve quelques hypothèses développées dans le champ de la recherche en design participatif contemporain. La notion de participation impliquée ici n’est pas à entendre dans les termes d’une « co-conception » du dispositif avec les chercheurs, mais plutôt d’une forme d’équipement du collectif sur les plans méthodologiques et conceptuels. Nourris par la notion d’infrastructuring (que je traduirai dans cette thèse par le néologisme d’infrastructuration) telle qu’elle a été développée notamment par Carl DiSalvo et Christopher Le Dantec (Dantec & DiSalvo, 2013), nous entendons faire valoir une pratique du design qui chercherait davantage à équiper une communauté donnée de moyens de penser et de travailler ses manières de faire, plutôt que de concevoir pour celle-ci des « solutions » et des dispositifs définitifs. C’est aussi une manière de mobiliser le design sur un registre que Carl DiSalvo a qualifié d’adversériel, c’est-à-dire en cherchant davantage à déclencher le dévoilement de désaccords et de malentendus, qu’à obtenir des solutions consensuelles ou la résolution de problèmes définis par avance (Disalvo, 2015). Étant donné qu’une situation de diplomatie n’est possible qu’à la condition que soient clarifiés les conditions et les intérêts antagonistes de chacune des parties, cette attitude nous semble appropriée. Notre proposition de transformation de l’espace en un lieu de traçage en temps réel des points de désaccord participe, selon nos présupposés, d’une activité à même de faire apparaître les forces en présence et d’engager ainsi une négociation authentique.
Pourtant, une fois notre scène mise en place et notre proposition énoncée, nous sommes accueillis par une forme d’incrédulité et de réticence circonspecte, qui se transforme rapidement, sous les coups de notre insistance, en un rejet explicite, unanime et définitif de la part du parterre des chercheurs. Plus tard dans la journée, nous trouvons l’occasion de discuter avec certains des « diplomates » de notre collectif et trouvons ainsi l’occasion de mieux comprendre ce qui a motivé un tel degré de consensualité dans le rejet de notre offre de design. Les motifs sont de trois types. Un premier auteur nous avance que lʼentreprise est vaine et inutile, tant « la pensée se fait dans lʼécriture » et non dans une vision dʼensemble du document – dʼautant plus que le mode dʼannotation proposé, plutôt rudimentaire, ne permettrait pas dʼatteindre la précision nécessaire pour développer une réelle discussion à propos des désaccords et des moyens de les surmonter. Une autre nous explique quʼelle est déjà suffisamment occupée et pénalisée à devoir utiliser cet outil étrange quʼest le Google Document pour en plus se prêter à des jeux graphiques avec des stabilos. Un dernier, peut-être le plus malicieux, nous explique quʼune telle entreprise serait « moins amusante » dans la mesure où elle priverait le collectif de la dimension de manœuvre et de ruse indispensable à la négociation de ce texte commun, fondée entre autres sur les tactiques de dissimulation et de dévoilement qui se jouent lors des séances plénières, lorsque chacun expose les positions prises lors de la phase de travail qui vient de se terminer. Présenter le travail du texte sous le régime de la transparence anéantirait, selon cette personne, toute cette dimension diplomatique.
Ainsi, l’infrastructuration que nous proposons est manifestement inadaptée et, chose souvent tue dans les récits d’expériences accessibles dans la littérature scientifique sur ce genre de pratique, elle est refusée par ses supposés « bénéficiaires » mêmes ! L’est-elle à cause de notre manière de la présenter ou leur apparaît-elle comme dénuée d’intérêt dans son principe même ? Elle s’inscrit pourtant dans la droite continuité d’une longue suite d’expérimentations matérielles et conceptuelles du même ordre qui avaient constitué le moteur méthodologique du projet de l’EME : le test d’une série d’hypothèses philosophiques via les épreuves successives impliquées par diverses pratiques de reprise et de transformation, supportées par des activités à la fois discursives et matérielles et notamment par des processus de publication multiples et hétérogènes. Ces dernières, comme on le verra dans ce chapitre, aboutissent à la production d’éditions multiples et interconnectées : un ouvrage imprimé, un espace web présentant un appareil critique collectif, un autre réorganisant les contenus sous la forme dʼune archive multi-thématique, un blog, un compte twitter, un espace Google Drive, des rencontres physiques, pour ne citer que celles-ci. Ces différentes éditions valent à la fois comme un ensemble d’éléments complémentaires, conçu pour soutenir la construction d’un collectif de recherche autour du projet, et comme les différentes itérations d’un processus de reprise et de reformulation continue qui s’est placé au cœur de la méthodologie du projet. Dans ce contexte, lʼajout dʼun équipement supplémentaire aura peut-être été celui de trop.
Dans les termes d’un design attaché à lʼinfrastructuration des pratiques de recherche, on peut alors considérer le projet de l’EME comme le projet d’établir une infrastructure pour le collectif qu’il entend impliquer dans une situation de diplomatie. Pour ce faire, il serait bien sûr aussi absurde d’entendre ce terme dans un sens exclusivement technologique et institutionnel – celui compris par exemple dans l’expression « Très Grandes Infrastructures de Recherche », ces installations socio-techniques qui sont constituées d’outils et d’instruments « mutualisés » et « adaptables » à une multiplicité de questions et de collectifs. En effet, l’EME n’est pas faite pour être « adaptable » à une multiplicité de questions : elle est au contraire construite pour faire travailler une question très précise qui est celle d’une définition empirique et ontologiquement pluraliste de l’expérience des Modernes. D’autre part, les collectifs qu’elle entend soutenir, s’ils sont censés faire la démonstration d’une forme de pluralité, sont eux aussi très spécifiques et amenés à être contraints par la présence inexpugnable et fortement influente d’un dénominateur commun – son investigateur et auteur principal Bruno Latour. On ne peut décrire l’EME comme une infrastructure que dans le sens où elle est conçue pour agir comme telle, à savoir comme un ensemble d’équipements – conceptuels, discursifs, pratiques – à même de se soutenir mutuellement pour structurer la conduite de l’enquête et des échanges qu’elle occasionne. Ainsi, si l’EME est imaginée, conçue, designée, comme une infrastructure, il faut décrire le projet dans les termes de sa capacité à habiliter le public qu’elle appelle à se former et à s’emparer de l’enquête qui lui est proposée.
Cela dit, si l’on accepte que l’EME ne peut être décrite que comme une infrastructure – impliquant l’idée d’une diversité d’équipements et un certain « retrait » de cette dernière au profit des activités qu’elle est censée supporter – il faut alors admettre que cette infrastructure n’était pas nécessairement perçue et rencontrée de manière uniforme par la diversité des individus qui l’ont fréquentée. Ainsi, si l’EME a tenté d’agir comme une infrastructure, c’est son format qui est rencontré par le public, au sens de l’ensemble de protocoles et de connotations produites par la rencontre de ses divers « équipements » durant l’enquête, fussent-ils des instances imprimées, numériques ou évènementielles. Or, ce format n’a lui non plus rien d’uniforme ou de partagé puisque les différentes personnes entrées au contact avec le projet l’ont d’abord fait via une seule de ses diverses excrescences, attirées vers ce projet au détour d’un tweet énigmatique ou des étagères d’une librairie. En ce sens, les équipements – je parlerai à partir de maintenant plus volontiers d’éditions – composant l’infrastructure du projet EME n’apparaissent jamais simultanément aux publics, mais plutôt selon une multiplicité de séquences et de détours, à la fois parce qu’elles n’ont pas été publiées en même temps, mais aussi parce que chaque participant se voit « aspiré » dans l’EME depuis un environnement et des attentes différents. Comment, alors, le format-produit de l’EME a-t-il interagi avec les formats-cadres multiples projetés sur lui par l’implication d’une diversité de publics hétérogènes ? Pour traiter cette question, il paraît important d’examiner les multiples points de vues à lʼœuvre dans l’élaboration de l’EME et les problématisations qu’ils génèrent.
Dans ce chapitre, à travers l’étude du cas EME, je décris la manière dont le travail expérimental du format de publication d’une recherche – à savoir les modalités selon lesquelles sa matérialité dialogue avec des dynamiques de formation collective, et qu’on peut maintenant faire correspondre avec une pratique de design entendue comme infrastructuration – permet de travailler les modalités de constitution du collectif de recherche auquel cette dernière est attachée. En ce sens, il met en regard des pratiques de fabrication et de formulation émises par le « premier cercle » du projet avec leur réception et la réaction des environnements plus étendus dans lesquels ces dernières se développent. Comment le format-produit élaboré par l’équipe, qui inclut des procédures et des conventions imaginées en amont de la mise en « fonctionnement » effective de son infrastructure, rencontre-t-il les pratiques de ses publics ? Comment dialoguent l’ensemble de formats spécifiques à cette enquête – manières de faire, d’interpréter et d’écrire – avec les formats préexistants déjà pratiqués par les collectifs dans lesquels un projet s’installe ?
Sur le plan anthropologique et philosophique et dans les termes de son investigateur principal3 , le projet EME consiste à produire un « instrument » à même de repérer puis de négocier la description de la pluralité de manières d’être qui caractérisent notre modernité. La dimension métaphysique du projet s’appuie en ce sens sur un empirisme radical qui entend la question de l’être comme étant toujours située localement, et constituée par des processus de différenciation : elle repose sur l’hypothèse qu’il existerait différentes expériences, valeurs et genres de véridiction propres aux Modernes qu’il s’agirait de mieux décrire afin d’en faciliter la cohabitation, une approche des questions d’ontologie et de métaphysique synthétisée par Bruno Latour dans le concept d’être-en-tant-qu’autre. Face à un tel projet philosophique, comment la construction d’une infrastructure (textuelle, conceptuelle, matérielle, technique, etc.) située socialement et intellectuellement peut-elle recueillir l’expression d’une pluralité authentique ? Comment la proposition méthodologique et théorique d’un auteur défini – Bruno Latour – peut-elle dans le même temps permettre l’instauration d’une diversité de manières de dire, de faire, et d’être ? Face à cette contradiction originelle et inévitable, le projet de l’EME est paradoxal et difficile dès sa définition, et c’est en cela qu’il est intéressant.
Partant de son paradoxe fondateur – le caractère nécessairement situé d’un énoncé appelant pourtant à l’expression d’une pluralité de manières d’être – les discussions portant sur l’infrastructure du projet se répandent alors à toutes les « couches » de sa composition, depuis ses dimensions les plus matérielles – par exemple son implémentation numérique dans les termes d’une « plateforme », terme ambigu qui propose un programme tout autant qu’il promet une forme de neutralité – jusqu’aux plus discursives – notamment via l’omniprésence du « métalangage » latourien dans le texte et sa capacité à faire office de matrice pour une négociation authentique. Elles permettent de questionner l’EME comme une expérimentation à la fois technique, sociale et discursive, et ainsi d’interroger la relation entre les formats qu’elle déploie et la trajectoire méthodologique intrinsèque qu’elle entend poursuivre. Elles invitent également à questionner la dimension performative de tout geste de publication, mettant en regard, d’une part, une interprétation du protocole de l’EME comme la performance (entendue au sens scénique) d’un argument prédéfini par Bruno Latour dont les participants seraient pour ainsi dire les « personnages », et d’autre part une approche de ce même protocole comme condition nécessaire d’une rencontre authentique avec les matériaux d’une question de recherche difficile. Ainsi, le projet EME est -il véritablement une enquête collective, et si oui selon quelles modalités ?
En raison de la particularité de son projet intellectuel, le cas de AIME trouve une place centrale dans ma recherche dans la mesure où l’ensemble de ses dimensions me semble exemplaire du problème du geste de la publication, entre formation de communauté et assemblage de collectifs hétérogènes, portant cette cohabitation conflictuelle à son paroxysme du fait de ses objectifs et modalités spécifiques. C’est par ailleurs un lieu privilégié pour interroger la relation entre pratiques expérimentales et conventionnelles, dans la mesure où le projet fait l’objet d’une forte résonance sociale et médiatique, et ce dès le début du projet. Il est ancré dans une institution reconnue – le laboratoire médialab, et son institution de tutelle Sciences Po – et attaché à la figure de Bruno Latour, massivement lu et cité dans les mondes universitaires français et anglo-saxon. Ainsi, dès ses débuts, l’expérimentation EME se déroule et se déploie ainsi sous les regards d’une communauté de curieux, de « fans », mais aussi de détracteurs ; cette relation de visibilité opère cela dit dans les deux sens : le public du projet ne cesse également de se manifester auprès de l’ équipe du projet elle-même, qui l’observe, s’en étonne et s’en inquiète, modifie ses plans en fonction de ses réactions. Pour ce faire, des dispositifs de captation de l’activité sur les instances numériques du projet sont mobilisés, ainsi qu’une batterie d’étudiants – dont je fais partie4 – qui s’y impliquent pour conduire entretiens et observations auprès des personnes engagées dans cette aventure collective. L’EME est donc un projet dans lequel la publication joue un rôle central et multiple dans la conduite même de la recherche, mais c’est aussi et surtout, un projet qui se développe avec son public en vue et à la vue de son public, soit encore un projet en train de se faire en public.
Dans le même temps, il serait trompeur de considérer ce public comme une masse homogène mue par des intérêts alignés entre eux et avec ceux de Bruno Latour et du médialab de Sciences Po. Les multiples registres d’expérimentation de l’EME, ainsi que l’extrême diversité des « domaines » à la « redescription » desquels elle s’attèle – « Droit », « Politique », « Science », « Religion », « Art », etc. – attirent à elle une multitude d’individus aux cultures et aux intérêts divergents : philosophes pluralistes, anthropologues de l’ici et de l’ailleurs, économistes, religieux, artistes et designers, etc. chacune de ces incursions dans la communauté des « co-enquêteurs » de l’EME va susciter des attentes, des reconnaissances et des pratiques différentes. Comment, alors, mobiliser la publication de recherche comme une dynamique de recherche participative tout en tirant parti des divergences d’attente et de pratiques à lʼœuvre dans le geste d’une publication ?
EME est enfin un lieu d’investigation privilégié pour cette recherche parce qu’il permet d’interroger de manière précise et détaillée les enjeux de pratiques de design qui entendraient infrastructurer des démarches de recherche par le travail de leurs formats de publication. Il s’agit de comprendre ici les pratiques de design comme un ensemble de manières de faire et de produire qui incluent sans s’y limiter les activités des designers professionnels impliqués dans le projet. Comment dialoguent les problématiques de conception techniques et esthétiques avec le canevas théorique et méthodologique de la recherche ? Comment envisager des pratiques matérielles censées stabiliser l’équipement et l’infrastructure (technique, intellectuelle, sociale, esthétique) de pratiques savantes tout en permettant une enquête authentique dont les finalités ne seraient définies à l’avance ? Quel est le rôle du faire dans l’exécution du « cahier des charges » fixé initialement par le philosophe ? Est-il à entendre seulement dans les termes de l’exécution plus ou moins parfaite d’un plan préalablement conceptualisé, ou plutôt comme une enquête elle-même, au sens où l’entend Tim Ingold, à savoir une expérience de transformation réciproque marquée par l’imprévisibilité et le dialogue ? Jusqu’où le design des formats de publication peut-il participer d’une authentique démarche de recherche dans la conduite socio-méthodologique d’une enquête en SHS et de son écriture ?
Afin de comprendre les enjeux qui sous-tendent l’infrastructure de publication de l’Enquête sur les Modes d’Existence, il est d’abord nécessaire d’en expliquer le projet philosophique du point de vue de ses implications pour les protocoles et pratiques de lecture, d’écriture et de discussion qu’il requiert. Cette recherche ne portant ni sur une discussion conceptuelle et philosophique de ce projet ni sur la pensée de son investigateur principal, il ne s’agit pas d’en faire la critique ou le commentaire exégétique, mais plutôt de faire émerger les enjeux relatifs aux relations multiples établies entre son « contenu » philosophique et conceptuel et le « cahier des charges » de l’infrastructure méthodologique, sociale et matérielle du projet. En ce sens, la spécificité de la dimension collective de l’EME ne prend son sens qu’à la lumière du projet de pluralisme ontologique qui le sous-tend : son insistance sur diverses formes de documentation empirique ne se comprend que parce que la méthodologie de l’EME s’ancre dans une conception locale et située de la métaphysique appelant à des méthodes anthropologiques, et le projet d’une écriture distribuée et partagée avec des « co-enquêteurs » ne se comprend que selon l’ambition diplomatique – et non seulement philosophique – du projet. Il s’agit donc de reconstituer ces diverses connexions pour pouvoir en comprendre les déploiements et les mises en tension par la pratique du projet5 .
À partir de cette esquisse conceptuelle, je décris l’infrastructure matérielle du projet Enquête sur les Modes d’Existence, afin de démontrer en quoi son approche implique la constitution d’un collectif ouvert constitué par des pratiques de reprise et de traduction multimodale de l’argument philosophique proposé par Bruno Latour. Je présente dans un même mouvement son infrastructure technique et sociale, en détaillant les différentes composantes de cette dernière à un moment précis du projet, correspondant à sa phase la plus riche en termes de publication. Puis, je m’attache à retracer la dynamique processuelle et évolutive de cette infrastructure à travers une remise en contexte généalogique et historique. Il s’agit de décrire le mouvement par lequel le format-produit de l’EME se déploie, se complexifie et rencontre progressivement une série de publics, de participants et autres acteurs hétérogènes attirés par l’assemblage des différents éléments de l’Enquête ; il s’agit également de cerner ses bifurcations et ses évolutions, de manière à pouvoir plus tard en évaluer les conséquences sur la constitution des collectifs de lecteurs et de contributeurs. En tant que projet développé en public et partiellement modifié en cours de route, les dynamiques de négociation et de réajustement à lʼœuvre dans l’équipe de développement de l’infrastructure sont indissociables de la manière dont cette dernière a fait geste de publication au sens fort.
Je détaille ensuite le rôle et la position que j’ai été amené à jouer dans le projet, et les activités d’équipement et d’analyse que j’ai mis en place pour saisir les vacillements multiples et mouvants qui animent l’infrastructure de cette entreprise collective. Activité d’enquête tout autant que de participation à la constitution du collectif autour du projet, mon intervention a endossé un rôle intermédiaire et complexe à l’intérieur du groupe : en situation d’observation participante, j’ai opéré, à différents moments du projet, plusieurs opérations de reconstitution visant à retracer et re-présenter publiquement les formes d’implication des différents cercles collectifs en activité auprès du projet.
Sur la base des activités de reconstitution que j’ai menées, il s’agit ensuite de conduire l’enquête à mon tour pour comprendre les modalités de réception et d’appropriation de l’infrastructure de l’EME : à partir des différentes traces laissées par le projet (discursives – issues des textes et des entretiens que j’ai conduit – et pratiques – traces numériques de l’activité des participants), il s’agira de décrire comment le format de l’EME a été reçu et investi par les différents « co-enquêteurs » auxquels il est adressé. Les modalités de description (et donc de compréhension) de ce dispositif complexe, son investissement plus ou moins fidèle aux scénarios d’utilisation initialement imaginés par l’équipe, comme la question de la contribution des lecteurs et la transformation effective de l’enquête de son initiateur en une enquête collective, permettra de préciser les modalités de socialisation d’une telle démarche de recherche.
Un cahier des charges pour redécrire les expériences des Modernes
Bruno Latour dessine en 1985 la première esquisse d’une théorie des « régimes d’énonciation » dont il dresse un schéma trois ans plus tard 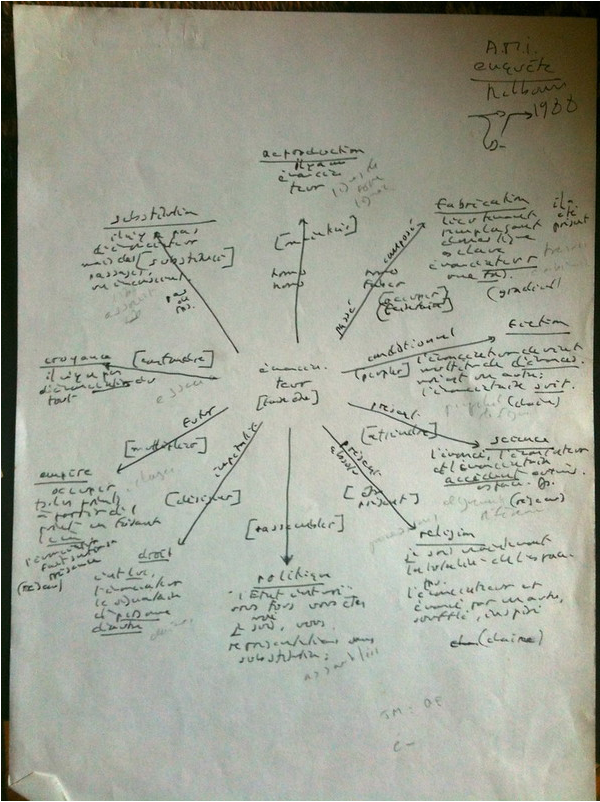 . Ce travail individuel est transformé une première fois en une entreprise collective en 2007 à l’occasion d’un colloque d’une semaine à Cerisy durant lequel un premier manuscrit de l’Enquête sur les Modes d’Existence est soumis à quatre-vingt chercheurs appelés à le critiquer et le discuter. Trois ans plus tard, en 2010, le projet EME est soumis à l’instance de financement de recherche European Research Council (ERC) qui l’accepte sur la base d’un financement de 3 ans. S’ensuit alors l’épisode qui fait l’objet de mon terrain de recherche. Je n’entends pas ici entreprendre une analyse ou une critique de lʼœuvre et de la pensée de Bruno Latour – qui ne correspondrait ni à l’objet ni à la position de cette thèse – cependant il est nécessaire de replacer les choix et les conditions de production et de réception de l’EME en regard avec la trajectoire de son acteur principal.
. Ce travail individuel est transformé une première fois en une entreprise collective en 2007 à l’occasion d’un colloque d’une semaine à Cerisy durant lequel un premier manuscrit de l’Enquête sur les Modes d’Existence est soumis à quatre-vingt chercheurs appelés à le critiquer et le discuter. Trois ans plus tard, en 2010, le projet EME est soumis à l’instance de financement de recherche European Research Council (ERC) qui l’accepte sur la base d’un financement de 3 ans. S’ensuit alors l’épisode qui fait l’objet de mon terrain de recherche. Je n’entends pas ici entreprendre une analyse ou une critique de lʼœuvre et de la pensée de Bruno Latour – qui ne correspondrait ni à l’objet ni à la position de cette thèse – cependant il est nécessaire de replacer les choix et les conditions de production et de réception de l’EME en regard avec la trajectoire de son acteur principal.
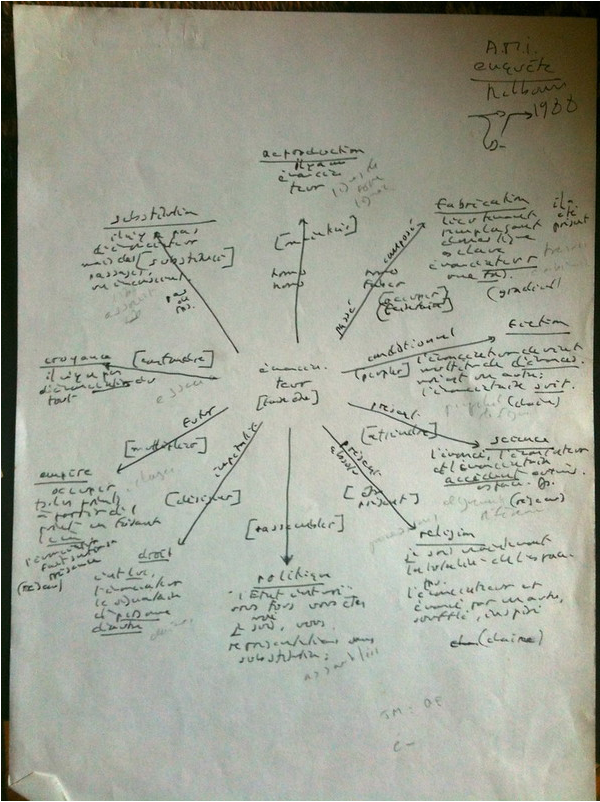 . Ce travail individuel est transformé une première fois en une entreprise collective en 2007 à l’occasion d’un colloque d’une semaine à Cerisy durant lequel un premier manuscrit de l’Enquête sur les Modes d’Existence est soumis à quatre-vingt chercheurs appelés à le critiquer et le discuter. Trois ans plus tard, en 2010, le projet EME est soumis à l’instance de financement de recherche European Research Council (ERC) qui l’accepte sur la base d’un financement de 3 ans. S’ensuit alors l’épisode qui fait l’objet de mon terrain de recherche. Je n’entends pas ici entreprendre une analyse ou une critique de lʼœuvre et de la pensée de Bruno Latour – qui ne correspondrait ni à l’objet ni à la position de cette thèse – cependant il est nécessaire de replacer les choix et les conditions de production et de réception de l’EME en regard avec la trajectoire de son acteur principal.
. Ce travail individuel est transformé une première fois en une entreprise collective en 2007 à l’occasion d’un colloque d’une semaine à Cerisy durant lequel un premier manuscrit de l’Enquête sur les Modes d’Existence est soumis à quatre-vingt chercheurs appelés à le critiquer et le discuter. Trois ans plus tard, en 2010, le projet EME est soumis à l’instance de financement de recherche European Research Council (ERC) qui l’accepte sur la base d’un financement de 3 ans. S’ensuit alors l’épisode qui fait l’objet de mon terrain de recherche. Je n’entends pas ici entreprendre une analyse ou une critique de lʼœuvre et de la pensée de Bruno Latour – qui ne correspondrait ni à l’objet ni à la position de cette thèse – cependant il est nécessaire de replacer les choix et les conditions de production et de réception de l’EME en regard avec la trajectoire de son acteur principal. D’un point de vue de design, le contexte et la trajectoire de l’EME en tant que dynamique de fabrication et de mise en forme doit d’abord être mise en perspective avec les expérimentations diverses conduites préalablement par son auteur sur le plan des médiums et des formes d’écriture : dʼabord un rapport très libre à l’écriture philosophique et anthropologique, qui n’hésite pas à faire usage de multiples outils littéraires, incluant la mobilisation de (semi-)fictions, d’emprunts et d’interpolation avec des genres tels que ceux de l’échange épistolaire ou du roman policier, ou encore de montages typographiques et graphiques complexes6 . Ensuite, un travail également caractérisé par l’expérimentation de formes alternatives au seul texte écrit, via des activités aussi variées que l’organisation d’expositions – entendues comme « expériences de pensée » (Weibel & Latour, 2002) – et de leur catalogue multimédia en ligne7 , la conduite de performances théâtrales (Latour, Latour, & Ait-Touatti, 2010), ou encore l’expérience de simulations et jeux de rôles divers8 . Ce souci constant pour la reformulation et la remédiation des arguments dans une diversité d’idiomes et de médiums, se doit d’être articulé avec le projet intellectuel qui motive et englobe le projet de l’EME. Comment comprendre, dans l’EME, les notions de traduction, de réécriture et d’enquête à la lumière des travaux antérieurs de son initiateur ?
Par ailleurs, la question du pluralisme ontologique, nécessaire à une description des différentes expériences des Modernes, au centre de l’argument et de la finalité de l’EME, appelle un cahier des charges exigeant pour l’infrastructure du projet en termes de « pratiques d’enquête » et de rapport à la dimension « empirique » des activités qu’elle entend soutenir. D’abord, comment l’EME peut-elle être à la fois un projet de métaphysique et d’anthropologie, les deux termes renvoyant généralement à des plans d’existence radicalement différents ? Et, corollairement, comment mener un projet qui consiste à décrire une « ontologie des modernes », quand l’ontologie est d’habitude entendue comme une réflexion générale et indépendante d’un contexte quelconque ? Quelle est la nature des « comptes-rendus empiriques » dont il est question dans le projet ? Comment alors envisager le rôle de l’infrastructure dans la médiation des expériences collectées et discutées à travers elle ?
Enfin, il s’agit de préciser la nature des collectifs appelés à être constitués par l’infrastructure du projet, et de situer la dimension participative de ce dernier, dans son rapport plus large aux finalités et aux modalités de la recherche universitaire. La dimension diplomatique du projet de l’EME – qui se défend d’être exclusivement un projet de connaissance, malgré les nombreux marqueurs universitaires dont il est affublé – implique la distribution des activités de lecture et d’écriture à une diversité d’acteurs et à travers une diversité d’instances. Que signifie cette dimension diplomatique pour les relations établies par les « co-enquêteurs » appelés à participer au projet ? Qu’y a-t-il à « négocier » et quel est le statut de cette négociation dans le projet plus général de l’Enquête ?
La reprise comme projet intellectuel et comme pratique de recherche
Le travail de Bruno Latour est marqué par la question de la médiation et de la reprise dès ses débuts. Cette question se retrouve dès sa thèse de théologie soutenue en 1985 portant sur les textes religieux, dans laquelle est proposée une version de Dieu dans laquelle ce dernier n’apparaît pas comme transcendance absolue mais plutôt où « son être même se révèle dans la reprise d’une exégèse par une autre » (Maniglier, 2012a, p. 921) à travers une série de « mini-transcendances » impliquées par les réécritures et les reprises des écrits sacrés. La question de la réécriture est ici comprise comme l’instrument d’une réinvention perpétuelle qui passe par la reprise des textes :
Parce qu’ils échappaient à une forme inexplicable de transcendance et d’immobilité, parce qu’ils devenaient localisés, historiques, situés, artificiels, oui, inventés et constamment réinventés, en se reposant à chaque passage de relais la question de leur véracité, ces textes devenaient enfin actifs et proches. (Latour, 2012a, p. 551)
Le chercheur se dirige ensuite vers les sciences sociales et l’anthropologie, au moment d’un mouvement plus large de renouvellement de la discipline via le choix de terrains d’étude s’inscrivant dans les pratiques et les cultures de l’Occident du XXème siècle9 . Après une étude ethnographique portant sur « l’ivoirisation des cadres » en Côte d’Ivoire (Latour, 2012a), il vient reposer la question de la (ré)écriture et de la reprise déjà engagée en s’intéressant aux pratiques de la science en œuvre dans les laboratoires de recherche. Bruno Latour expérimente alors en compagnie de Steve Woolgar une nouvelle approche sociale de la « Science » qui se fonde sur la présupposition d’une étrangéité et d’un malentendu radical avec les « observés » pour décrire l’activité des scientifiques avec les moyens de lʼethnographie, et la comprendre en termes de pratiques et de rituels (Latour & Woolgar, 2006). Dans ces premières enquêtes de terrain, il s’agit de décrire le fait scientifique non pas comme une « réalité objective » indépendante des pratiques et pour ainsi dire « découverte » par les méthodes expérimentales, mais plutôt comme le produit d’un ensemble de relations entre des humains et des non-humains qui, par une suite d’opérations de référence et de reprise successives, font se déplacer l’information scientifique depuis les terrains d’observation jusque dans les publications scientifiques. La qualification du fait comme scientifique se définit alors moins par le contenu de l’information ainsi transportée que par la possibilité laissée par l’activité scientifique de reparcourir la « chaîne de références » qui a permis de transporter cette information depuis un lieu éloigné jusqu’à un autre tout en maintenant sa constance – ce que l’auteur nomme un « mobile immuable » (Latour, 2005). Ces travaux font de Bruno Latour l’un des acteurs principaux de l’émergence du champ desdites Sciences & Technology Studies (STS) qui se développe ensuite de manière internationale.
Les travaux de Bruno Latour sur l’anthropologie et l’étude des Sciences lui valent une grande notoriété mais également de nombreux détracteurs, notamment dans les disciplines des Sciences de la Nature, au sein desquelles certains scientifiques voient dans son approche « réaliste » une tentative de décrédibilisation de leur activité et une forme de « relativisation » de la vérité et de la raison moderne héritée de l’histoire des sciences et des lumières. Cette tension trouve son apogée dans la « guerre des sciences », un vif conflit entre universitaires survenu à la fin des années 1990 et mené à coups de canulars, de tribunes médiatiques et même parfois de manœuvres de blocage socio-professionnel et de campagnes de décrédibilisation symbolique (Jeanneret, 2000). Il n’est pas anecdotique de rappeler cet épisode et la question de la réception des travaux du philosophe, dans la mesure où la question de la pluralité des manières d’envisager les rapports au « vrai » et au « faux » ici mise en jeu se voit mobilisée dans l’EME comme un problème cardinal de diplomatie, visant à trouver le moyen de « mieux parler » aux Modernes de ce à quoi ils tiennent mais également de se présenter à d’autres collectifs.
En tant que tel, le projet de l’EME est l’histoire de deux continuités. D’abord, il s’inscrit dans la suite de l’autre livre philosophique majeur publié par Bruno Latour en 1993, Nous n’avons jamais été modernes (Latour, 1991/2006), marqué par le projet inachevé d’une « anthropologie symétrique ». Dans ce dernier, la notion de Modernité désigne le type de culture qui émerge en Occident conséquemment à lʼinstitutionnalisation de la science aux alentours du XVIIème siècle. Latour s’attaque ici principalement à la division que cette dernière a établi entre Nature et Culture dans la suite de notre histoire moderne et contemporaine. Selon l’auteur, les « modernes » ont construit la représentation qu’ils se font d’eux-mêmes comme le récit d’une émancipation toujours plus grande vis-à-vis de la Nature, là où, dans la pratique, ces mêmes sciences auraient en fait provoqué la prolifération d’attachements et de relations multiples avec une quantité de « non-humains » auxquels les modernes n’ont cessé de s’hybrider et de se lier depuis tout en les ignorant. Le projet d’une « anthropologie symétrique » que Latour appelle de ses vœux dès cet ouvrage invite à démentir la distinction conventionnelle entre cultures « développées » et « en développement », « modernes » et « bientôt-modernes », impliquant tout collectif dans un processus de « modernisation » et un rapport plus ou moins retardé avec le « progrès » orienté par la perspective téléologique d’une émancipation par la raison. Il s’agit au contraire de retourner en direction de la Modernité les méthodes qu’elle avait établi pour étudier les divers Autres rencontrés son chemin – à savoir celles de l’ethnographie et de l’anthropologie – afin de retrouver le fil d’une description qui tiendrait compte des multiples attachements et relations qui se cachent sous les discours de la modernisation. Si « nous n’avons jamais été modernes », le projet de l’EME est alors de proposer une version positive de la modernité telle qu’elle s’est faite, répondant à la question : « Qui avons-nous été ? » (Latour, 2012b, p. 23).
L’autre continuité dans laquelle l’EME peut être située, relève des travaux de Bruno Latour à propos de la sociologie de la traduction et de la « théorie de l’acteur-réseau », mise en place au Centre de Sociologie de l’Innovation avec Madeleine Akrich et Michel Callon. Celle-ci s’attache à questionner les rapports d’échelle constitutifs de la sociologie et la relation entre « macroacteurs » et « individus » telle qu’elle est abordée dans les compte-rendus sociologiques. Postulant qu’« aucun acteur n’est plus grand qu’un autre sinon par une transaction (une traduction) qu’il faut étudier » (Schaffer & Shapin, 1993, p. 15), la sociologie de la traduction invite à redécrire la production des techniques et des faits scientifiques en termes « d’hybrides » et de « chimères » constitués par des relations de traduction entre une série toujours plus hétérogène d’acteurs, qu’il s’agisse d’individus, d’institutions, de textes, d’êtres vivants ou d’objets scientifiques. Le réseau ici en question est un réseau d’associations entre des acteurs hétérogènes, qui permet de décrire les situations sans faire appel aux catégories postulant la préexistence d’une société et de ses structures, et d’une dichotomie nette entre « le tout » social et ses partie. La méthode de la sociologie de la traduction se présente alors comme un outil d’enquête qui permet de repérer et de découvrir les relations insoupçonnées à lʼœuvre dans la constitution d’une situation sociale ou d’un cours d’action donné. Elle présente cependant, selon les mots de l’auteur, l’insuffisance de n’expliquer en rien le mode d’extension des réseaux et la manière dont s’établissent lesdites « traductions » à lʼœuvre dans la constitution des cours d’action (Latour, 2012b, pp. 45‑47).
Une approche simultanément métaphysique, anthropologique et sémiotique
Pour opérer le travail de continuation impliqué par le projet d’une « anthropologie symétrique » et d’une interprétation métaphysique des assemblages repérés par la théorie de l’acteur-réseau, l’EME se nourrit de nouveaux alliés théoriques en s’inscrivant dans l’empirisme radical ou second empirisme porté par les travaux d’Alfred North Whitehead (Whitehead, 1979) puis de William James dans le champ de la philosophie pragmatique (James, Garreta, & Girel, 1906/2007). Ce qui est en jeu, c’est le rôle de l’expérience dans la définition de l’être, et notamment une critique de la manière dont elle se voit envisagée par la tradition dualiste occidentale. Dans cette tradition, le premier empirisme de Locke puis de Hume propose de réduire la question de l’expérience aux données de la perception et autres sensory data, là où le second empirisme porte également son attention sur l’ensemble des relations, nervures, et médiations qui font partie de l’expérience. Pour ces auteurs, il n’y aurait pas d’un côté « un monde », et de l’autre « des sujets », qui échafauderaient dans leur esprit un ensemble de relations à partir des « données » apportées par les sens, ce que Whitehead appelle la « bifurcation de la Nature » pour dénoncer l’opposition instaurée par la culture occidentale entre l’en soi et le pour soi, entre le sujet et l’objet, entre la raison et la non-raison, entre le monde de la Science et celui de la Vie (Whitehead, 1920/2006). Plutôt, lesdites relations feraient directement et pleinement partie de l’expérience, in rerum natura, ouvrant par là-même une pensée métaphysique qui entendrait la question de l’Être selon une forme d’ontologie « plate », qui ne postule pas de différence de « dignité ontologique » a priori entre les êtres et repose plutôt sur les relations qui les font exister dans un monde commun. Cette version de la métaphysique invite alors à entendre la question de l’être sur un registre transitionnel et processuel, un être toujours en train de se faire par les relations par lesquelles il s’établit, ce que Bruno Latour qualifie dans l’EME d’être-en-tant-qu’autre (par opposition à ce qu’il appelle l’être-en-tant-qu’être).
Le concept de modes d’existence est notamment hérité de lʼœuvre de Gilbert Simondon, qui postulait déjà les sujets et les objets comme des constructions ultérieures et contingentes issues de processus d’individuation et de « concrétisation » réciproques (Simondon, 1958/2012). Le « mode d’existence des objets techniques » est alors envisagé comme une manifestation ontologique intimement associée à la formation de l’Homme, et prise dans une généalogie qui le fait s’ajouter aux modes d’être religieux puis esthétiques et ainsi de participer d’une pluralité de manières d’être. (Simondon, 1958/2012, p. 160).
Mais, plus encore que dans lʼœuvre de Simondon, c’est du travail du philosophe Etienne Souriau, avec son ouvrage Les différents modes d’existence (Souriau, 1943/2009), que se réclame le plus l’EME. Ce dernier, ouvrage d’esthétique tout autant que de métaphysique, échafaude une théorie du « pluralisme existentiel » dans lequel l’être possède une diversité de formes et de modes. Outre la notion même de modes d’existence que Latour reprend en réinterprétant les cinq modes initialement proposés par Souriau (Latour, 2007b) et leur en adjoignant de nouveaux, il lui emprunte également les notions de préposition et d’instauration qui sont cardinales pour interpréter l’infrastructure conceptuelle du projet.
La préposition permet d’envisager la question du pluralisme de l’être sans segmenter ce dernier en domaines ou en substances, mais plutôt en la posant sur le registre de la modalité. Une préposition « engage tout ce qui suit et pourtant ne participe pas directement à ce qui suit » (Latour, 2012i), et permet de penser l’expérience en termes d’adverbes plutôt que de substantifs : elle permet de se demander ce que signifie de parler « religieusement » plutôt que de parler des religions instituées, de parler « politiquement » plutôt que de parler de sujets politiques, etc. Ainsi, la préposition infléchit sur les propositions et les oriente sans pour autant les constituer, permettant de questionner les situations en termes de « comment » plutôt que de « quoi ».
L’utilisation latourienne du concept de préposition est fortement marquée par la culture de la sémiotique, et il la fait explicitement équivaloir aux concepts de force illocutoire développée par Austin (Austin, 1962/1991). Ce n’est pourtant pas uniquement de « manière de parler » dont il s’agit ici, entendues comme des représentation d’une réalité qui serait par ailleurs invariante et indépendante. Il s’agit au contraire de « joindre les questions de langue et celle d’être » pour « différencier la recherche des prépositions de celle des substances ou des fondements » (Latour, 2007b, p. 7) à travers des modes de description appropriés. Les prépositions engagent tout autant des modes d’énonciation que des modes de l’être.
Les prépositions, ou modes d’existence, ou régimes d’énonciation de l’être, nécessitent par ailleurs d’établir une théorie de la relation qui permette d’envisager les termes d’une constitution réciproque des acteurs. À ce titre, le concept d’instauration permet d’équiper l’enquête sur les modes d’existence d’un outil qui ne repose pas sur la distinction entre un objet et un sujet – une œuvre et son artiste, un fait et son savant, etc. – mais d’envisager ces deux positions comme le résultat d’une action réciproque et constitutive10 . Elle implique également une relation de symétrie entre chacune des parties dans l’établissement de la situation, également impliquées dans la construction d’une situation sans que l’une soit « l’acteur » unidirectionnel de l’autre. Ainsi écrit-il :
L’artiste, dit Souriau, n’est jamais le créateur, mais toujours l’instaurateur d’une œuvre qui vient à lui mais qui, sans lui, ne procéderait jamais vers l’existence. S’il y a une question que ne se pose jamais le sculpteur, c’est la question critique : « Est-ce moi ou est-ce la statue qui suis, qui est l’auteur de la statue ? » On reconnaît là le redoublement de l’action d’une part, l’oscillation du vecteur de l’action, d’autre part. Mais ce qui intéresse Souriau avant tout, c’est le troisième aspect, celui qui porte sur l’excellence et la qualité de lʼœuvre instaurée : si le sculpteur se réveille la nuit, c’est parce qu’il doit encore se laisser faire pour achever lʼœuvre ou la rater. (Latour, 2012b, p. 166)
Les processus d’instauration sont alors compris comme l’expression de trajectoires particulières dont les prépositions seraient le « fluide » ou la « tonalité » adéquate. Fidèle au projet multi-réaliste ou pluri-ontologique de Souriau, le projet de Bruno Latour consiste alors à engager une enquête visant à extraire une série de valeurs auxquelles les Modernes disent tenir (les différents modes dʼexistence), en qualifiant les prépositions qui ont permis les diverses trajectoires d’instauration par lesquelles s’est faite la modernité. Ce projet d’investigation se double alors d’une dimension anthropologique.
C’est parce qu’elle est fondée sur une approche de l’ontologie qui entend l’être-en-tant-qu’autre que l’EME peut et doit relever d’une enquête anthropologique. L’anthropologie fonde ses opérations de connaissance sur le repérage de différences dans les cours d’action vécus directement sur le terrain. Elle permet ainsi de poser des questions de métaphysique au sens de l’EME dans la mesure où les différences ainsi repérées permettent de distinguer des trajectoires aux modalités divergentes. L’analyse de l’EME proposée par le philosophe Patrice Maniglier éclaire bien la complémentarité nécessaire entre le projet de pluralisme ontologique de Bruno Latour et la méthode anthropologique, entendue comme une science des différences, que ce pluralisme implique :
Il n’y aurait donc pas d’un côté l’esprit (ou la culture ou le langage), et de l’autre l’être (ou la réalité ou le monde), mais plusieurs manières d’être. L’ontologie devient le discours de l’anthropologie, parce que la notion d’être apparaît comme le comparant le plus puissant. Cela ne signifie pas qu’il est le plus indéterminé, mais au contraire qu’il est le plus intense, celui qui nous oblige au déplacement et au dépaysement le plus grand. L’ idée de culture n’est qu’une conséquence d’une certaine « ontologie ». Il faut ici être radical : par « ontologie » nous n’entendons pas une « théorie » quant à l’Être, ni même des idées ou une « entente » de l’Être ; nous entendons bien des manières de déterminer quelque chose comme étant. […] La question n’est donc pas d’accepter comme étant tout ce qui est déclaré tel par les uns ou les autres, mais plutôt de mieux comprendre ce qui est effectivement dans notre monde par différence avec ce qui est dans les autres. (Maniglier, 2012a, p. 919)
Ainsi, parce qu’elle est processuelle et pour ainsi dire passée par les trajectoires d’instauration que l’on peut détecter, la métaphysique proposée par Bruno Latour n’existe non pas sur un plan de transcendance mais est contenue dans l’expérience. C’est à ce titre que cette métaphysique n’est pas une métaphysique générale mais une métaphysique locale et située, qui peut être la métaphysique d’un collectif particulier, celui des Modernes. Le projet de l’EME consiste alors à conduire une Enquête pour distinguer, mais également accorder ou composer, les diverses manières d’êtres qui ont tenu ensemble la modernité et son déploiement. Cela implique également que l’ensemble des « modes d’existence » peut être limité en nombre et en définition, dans la mesure où il s’adresse à un agencement particulier de situations :
Seulement, Souriau ne faisait aucun effort pour être anthropologique, il croyait parler de toute ontologie. Moi, je m’adresse à des gens qui ont extrait de toutes les altérations possibles de l’être-en-tant-qu’autre, un tout petit nombre, en tout cas qui en ont élaboré un tout petit nombre, et qui ont ensuite encombré le monde avec ce petit nombre. (Latour & Marinda, 2015, p. 8)
L’enquête sur les modes d’existence est donc simultanément métaphysique, anthropologique, et sémiotique. Pour pouvoir être conduite, elle nécessite l’équipement d’outils de description et de comparaison permettant à une démarche collective de se mettre en place.
Une « sorte de grammaire de l’existence » pour se rendre sensibles à une pluralité de manières d’être
L’infrastructure conceptuelle de l’EME s’articule via une grammaire systématique permettant de comparer et de croiser les modes d’existence au moyen du « métalangage de l’enquête ». Ainsi, l’hypothèse de l’être-en-tant-qu’autre suppose une description de l’expérience comme la « libre association » d’un ensemble d’acteurs hétérogènes, ceux-là mêmes étudiés par la sociologie de la traduction et permettant d’envisager la description d’une situation donnée comme un réseau d’associations qui peut être étendu indéfiniment par l’enquêteur. Ces derniers s’incarnent alors dans ce que l’enquête nomme le mode [RES] pour Réseau.
Parce que le réseau est nécessairement constitué d’associations hétérogènes, il implique une série de décrochages et de déraillements dans l’expérience. Pour comprendre l’existence des réseaux d’acteurs malgré de telles discontinuités, il est donc selon Latour nécessaire de penser l’existence de « mini-transcendances » qui expliqueraient la continuité des cours d’action sans pour autant nier l’hétérogénéité des réseaux. Ce qu’il nomme hiatus intervient alors comme le nom de ces décrochages. Ces derniers sont appelés à être comblés par des passes qui représentent les différents modes de passage entre les interruptions impliquées par un hiatus. À chaque mode d’existence l’épreuve d’un hiatus particulier, et le type de passe qui permet de le surmonter, de telle sorte qu’« un mode d’existence se caractérise par la nature des passes qu’il entraîne » (Famy, 2017). Les passes spécifiques à chaque mode d’existence se caractérisent alors par une trajectoire, qui permet au mode d’être instauré selon les « conditions de félicité et d’infélicité » qui définissent comment le mode de l’être en question engage ce qui est de l’ordre du « vrai » ou du « faux ». Hiatus, passe, trajectoire et conditions de félicité constituent la grammaire de description des modes d’existence abordés par l’enquête. Ce mode de description est lui-même instauré par son propre mode d’existence, le mode [PRE] pour préposition, « nécessaire à l’enquête puisqu’il permet de revenir en arrière vers les clefs d’interprétation qui permettent de se préparer à ce qui suit. » (Latour, 2012h). Ainsi :
Si l’on résume, un mode d’existence quelconque est un réseau [RES] spécifié et identifié par une préposition [PRE], la seconde donnant la clef d’interprétation du premier. Cette clef d’interprétation, cette tonalité propre au mode d’existence, entraîne un type de passes particulier et donc une trajectoire particulière, qui elle-même implique l’instauration d’êtres spécifiques propre au mode concerné. (Famy, 2017)
À partir des méthodes d’investigation du mode [RES] pour réseau et du protocole de description de PRE11 , l’ensemble du texte de l’EME présente successivement et sous une forme narrative une série de 12 autres modes visant à faire un bilan provisoire – mais le plus cohérent possible – des différentes « prépositions » utilisées par les modernes pour composer la pluralité de leurs manières d’être. Les douze modes d’existence décrits par le « métalangage de l’enquête » sont alors décrits sous la forme de quatre groupes visant à complexifier et reconfigurer ce qui aurait été sinon décrit par le biais des grands dualismes entre Sujet et Objet ou encore Nature et Culture. On y trouve ainsi, les modes « sans quasi-objet et sans quasi-sujet », les « quasi-objets », des « quasi-sujets », et enfin les « liens entre quasi-objets et quasi-sujets ».
Dans le premier groupe des modes, le mode de la reproduction (REP) vise à décrire les situations d’engendrement et de continuation – des vivants, mais également des institutions, des personnes, etc. – et la manière dont ces derniers entendent continuer d’exister, alors que celui de la métamorphose (MET) intervient « chaque fois que l’on s’adresse à la façon dont les existants sont transformés ou transforment pour parvenir à subsister » (Latour, 2012g). Celui de l’habitude (HAB), enfin, permet de se rendre attentifs aux situations d’uniformisation par la répétition, dans lesquelles « hésitations et ajustements » se voient surmontés par le sentiment de l’habitude.
À partir du second groupe des modes d’existence, on retrouve progressivement un compte-rendu et un réinvestissement synthétique de l’ensemble des enquêtes de terrain de Bruno Latour. Au premier rang de ces dernières, la question de la référence (REF), mode d’alignement de « chaînes de références » qui permet de transporter de l’information au cœur de la description de certaines pratiques scientifiques. Celui de la technique (TEC) désigne non pas un ensemble de dispositifs technologiques ou même « socio-techniques » mais plutôt une manière de conjurer des obstacles par une série de « détours » et de « zigzags » inventifs, « ce que l’on fait saillir chaque fois que l’on s’intéresse aux détours inattendus par lesquels les existants doivent passer pour parvenir à subsister » (Latour, 2012j). Le mode de la fiction (FIC), enfin, confondu à tort avec les domaines de l’Art ou de la Culture, désigne les rapports conflictuels entre matérialité et figures, ces « petits mondes qui ne peuvent ni se détacher de ces matériaux ni s’y réduire », et leur manière de les déjouer par les jeux du « faux semblant » et de la « multiplication des mondes » (Latour, 2012f).
Le troisième groupe redéfinit le « quasi-sujet » moderne à l’aune des modes d’existence politiques (POL), religieux (REL) et juridique (DRO). Le premier, POL, s’attache à décrire les situations combinant représentation et obéissance de manière problématique, invitant un « parler politique » pour faire constamment reprendre le cercle qui unit et mélange les représentés et les obéissants – mode par ailleurs développé dans l’ouvrage Politiques de la Nature (Latour, 2004b). Le second, REL, permet de suivre la trajectoire des modes d’être religieux comme le maintien d’une forme de fidélité à un message constamment transformé et converti, et résulte des enquêtes conduites dans l’ouvrage Jubiler ou les tourments de la parole religieuse (Latour, 2002). Vient enfin le « passage du droit » (DRO) qui « relie aux yeux du juriste de façon continue des sources qui, aux yeux des plaignants, n’ont aucune espèce de relation (par exemple une maison avec un titre de propriété) » (Latour, 2012e) préalablement étudiée dans son enquête de terrain sur le Conseil d’Etat (Latour, 2004a).
Le tour d’horizon des modes tels que présentés dans le texte initial de l’EME s’attache enfin à la description du « continent économique » à travers la distinction entre trois manières d’être propres aux relations que ce dernier implique entre les « quasi-sujets » et les « quasi-objets ». L’attachement (ATT) décrit les relations entre ce que l’on pourrait nommer des « personnes » et ce que l’on pourrait nommer des « biens », à travers une modalité « d’intérêts passionnés » qui s’instaurent dans des situations de consommation, d’achat ou de production (Latour & Lépinay, 2008). À l’attachement répond l’organisation (ORG) qui permet de suivre des « scripts » (programmes ou séquences d’opérations qui lient les différents acteurs d’une situation) malgré la confusion impliquée par les ordres qu’ils impliquent. Le mode de la « morale » (MOR), enfin, porte sur les relations entre fins et moyens et la recherche d’une composition optimale pour arriver à une finalité déterminée.
Ainsi, partiellement alignés avec des institutions qui nous sont familières – Droit, Religion, Politique, etc. – l’enquête consiste à démêler une série de confusions entre les modes d’existences et les « domaines » établis par les modernes pour rendre compte des valeurs qui les sous-tendent. Dans le récit latourien, ils sont difficiles à saisir notamment parce qu’ils sont recouverts par une série de « compte-rendus officiels » qui ne correspondent pas aux trajectoires qu’ils entendent protéger. Un travail est alors nécessaire pour spécifier les modes et en préciser la définition au-delà des expériences ayant permis à Bruno Latour de les esquisser.
Par ailleurs, à la différence d’autres pensées tournées vers la valorisation d’une forme de pluralisme ontologique, le projet de Bruno Latour est compositionniste en ce qu’il vise non seulement à reconnaître une diversité de manières d’être, mais également à trouver le moyen de les faire cohabiter sur un sol commun. Le nombre et la définition des modes d’existence déployés au début du volet collectif du projet est à la fois présenté comme une contingence de son enquête et de l’histoire occidentale12 , et défendus comme une proposition cohérente et solide qu’il sera difficile de réévaluer13 . La dimension collective de l’enquête consiste alors à proposer à d’autres enquêteurs de remettre en jeu la première définition des modes faite par l’auteur initial.
Équiper collectivement un protocole d’enquête et de diplomatie
La thèse des modes d’existence s’accompagne d’une nécessité méthodologique quant à la manière de les saisir et de mieux les instituer collectivement. Trajectoires d’être subtiles plutôt que royaumes fièrement signalés, les modes d’existence se déploient au cœur des pratiques mais ne se dévoilent pas de manière évidente. En accord avec la méthode anthropologique impliquée par le pluralisme ontologique des modes d’existence, EME suppose donc qu’ils ne peuvent pas être détectés directement mais uniquement lorsque sont commises des « erreurs de catégories » qui mettent en lumière la concurrence de deux prépositions ou clef d’interprétation pour résoudre une situation donnée – ce que l’enquête nomme des croisements. Dans ce cas, leur dissonance dans l’expérience produit des « malentendus métaphysiques » (Maniglier, 2012a, p. 928) à propos du type d’être engagé dans la situation en cours et la méthode anthropologique peut être mobilisée pour démêler la situation et rétablir la trajectoire propre à chacun des deux modes rencontrés14 . Cette détection n’est ainsi rendue possible que par la saisie des aspérités d’un terrain construit grâce à un corpus de documents progressivement collectés et rassemblés pour documenter les croisements entre modes dʼexistence. C’est en cela que l’infrastructure d’EME requiert un équipement pour la collecte des situations permettant une meilleure définition des modes d’existence à travers leur croisement.
Ainsi, dans le cahier des charges de l’EME, les « co-enquêteurs » sont appelés à une série d’activités dont l’hétérogénéité n’est pas complètement explicitée. Il s’agira pour eux de « proposer d’autres comptes rendus […] pour interpréter les expériences que nous aurons collectivement retracées » (Latour, 2012b, p. 7), mais également de « proposer d’autres métaphysiques, que celles proposées dans ce rapport provisoire ». Il s’agit enfin pour eux de participer à une scène de négociation pour établir une composition dans laquelle chacun des modes d’existences repérés trouverait une trajectoire d’instauration satisfaisante sans pour autant imposer un mode d’énonciation hégémonique à chacun des autres modes.
L’EME est en effet inscrite dans la tradition pragmatique dans la mesure où l’enquête n’est pas un pur « projet de connaissance » mais vise à résoudre un problème, que Latour identifie comme celui de « la préservation de la diversité des modes », contre l’hégémonie possible de l’un d’entre eux (Latour, 2012b, p. 479). L’Enquête pose ainsi la question du « que faire ? » plutôt que du « qu’est-ce que ? »15 , et envisage comme sa finalité la négociation collective de la fameuse définition positive de la modernité déjà appelée dans Nous n’avons jamais été modernes. C’est pourquoi l’auteur propose, outre la dimension empirique et anthropologique de la transformation de son enquête en entreprise collective, de la qualifier de procédure diplomatique. La notion est à entendre contre l’idée d’une enquête scientifique ou philosophique qui mettrait en scène un sujet à la recherche d’une vérité destinée à être dévoilée. Elle est diplomatique dans le sens où, dans l’approche d’empirisme radical de l’enquête, « il n’y a pas d’arbitre extérieur – la raison du plus fort, la raison universelle, l’État, la loi, les lois de la nature, etc. » (Latour, 2012d) à même de faire prédominer un mode dans la recherche en cours. C’est également parce que l’altérité radicale postulée par le pluralisme ontologique implique « d’organiser le repérage tâtonnant des positions négociables et non-négociables des uns puis des autres » sans en connaître à l’avance de définition exacte (Latour, 2012d). Parce qu’ils sont l’expression d’une altérité toujours renouvelée par l’expérience, les modes d’existence ne doivent pas être seulement détectés mais également négociés dans un collectif fait de parti-prenantes aux valeurs divergentes.
La dimension d’enquête et la dimension collective de l’EME se voient donc indissociablement liées dans un projet qui est à la fois celui d’une détection des modes d’existence par leurs croisements et celui de la négociation de leur composition au sein d’un monde commun à tous et à chacun d’entre eux. En ce sens, la dimension collective de l’infrastructure de l’EME doit donc être comprise selon au moins deux directions. La première relève de la tâche de collecte qui consiste à re-décrire les modernes, et de la somme des documents – et expériences afférentes – à rassembler pour mener à bien son programme. En ce sens Bruno Latour décrit-il l’EME comme la transformation du « travail d’un ethnographe solitaire en l’aventure d’un collectif élargi de co-enquêteurs » (Ricci, De Mourat, Leclercq, & Latour, 2014). Le second sens de cette dimension collective est celui impliqué par la nécessité d’une négociation diplomatique entre les représentants des différents modes à lʼœuvre dans la modernité, une fois ce travail de clarification effectué. Dans cette enquête collective, les documents rassemblés opèrent donc non seulement comme lieux de détection et d’observation mais également comme un lieu de partage des expériences. Ce partage s’opère à la fois dans le sens d’une mise en commun, d’un constat partagé entre les représentants des différents modes (à la manière d’un constat à la suite d’un accident quelconque, « nous nous accordons sur le fait qu’il y a là un problème ») ; et dans le sens d’un partage diplomatique entre les différents modes d’existence, celui d’une négociation authentique. Cette négociation est présentée comme la finalité du processus collectif appelé à se déployer par le projet :
Il faut être naïf pour croire au succès de tels pourparlers ? Eh oui, mais le diplomate est une figure hybride, naïve autant que retorse. Je prétends que le seul moyen de vérifier s’il s’agit là d’une illusion ou non, c’est de mener pour de vrai, en face à face, ces négociations avec ceux qui sont directement intéressés à formuler d’autres versions de leurs idéaux ; ce que nous allons pouvoir faire avec ce projet de recherche collaborative dont la troisième année suppose de tels pourparlers menés sur les zones de conflit de valeurs les plus « chaudes ». (Latour, 2012b, p. 482)
EME se présente donc comme une enquête collective à plusieurs dimensions. À la lecture de l’édition de l’EME écrite par Bruno Latour, il n’est cependant pas évident de savoir qu’attendre exactement des contributions d’un public encore peu visible, ni les modalités de facilitation envisagées pour permettre un dialogue avec une proposition aussi large et touffue sur le plan théorique. Par ailleurs, la scène diplomatique « parfaitement imaginaire » (Latour, 2012b, p. 25) reste encore à définir, et doit être équipée et concrétisée pour transformer l’enquête individuelle en enquête collective. Il s’agit maintenant de revenir sur l’instauration – pour reprendre le vocabulaire du projet de manière peut-être cavalière – effectuée par la mise en place conjointe de l’infrastructure matérielle, sociale et discursive de l’EME et du collectif que cette dernière a assemblés.
Situer le format d’une infrastructure de publication-comme-enquête
Il s’agit maintenant de décrire les différentes modalités de rencontre possible avec l’infrastructure de l’EME telle qu’elle est pratiquée par le collectif appelé à l’utiliser pour mener l’enquête dite collective. Je propose de nommer publication-comme-enquête le type d’instrumentation des pratiques éditoriales effectué par l’EME, et ce dans au moins deux des sens de la notion de publication. D’abord, il s’agit d’insister sur l’intégration des pratiques d’enquête avec les pratiques d’écriture et d’édition convoquées – la publication est ici entendue au sens d’un processus éditorial qui prend ici une valeur heuristique en mobilisant et en retravaillant les matériaux de la recherche. Ensuite, la notion de publication-comme-enquête permet également dans s’inscrire dans une approche deweyenne de l’enquête qui entend le terme comme la constitution d’un collectif face à une situation problématique (Zask, 2008) – la publication est alors entendue dans le sens politique et épistémologique de la construction d’un public de parties-prenantes concernées par un problème donné. Il s’agit ainsi de désigner les documents-publications produits par les pratiques des collectifs de recherche non pas comme des objets visant à communiquer des résultats établis, mais comme des lieux d’élaboration et d’investigation individuelle et collective.
Le projet de l’EME se déploie de 2012 à 2014 sous la forme de plusieurs « éditions » reprenant et retravaillant l’hypothèse des modes d’existence sous diverses formes, mais également d’un protocole d’investigation impliquant les personnes intéressées au projet dans une diversité de pratiques : lire, naviguer, écrire, discuter, etc. Ce protocole repose à la fois sur son inscription dans des instances matérielles diverses (spatiales, imprimées, numériques) permettant de fréquenter et d’interagir avec l’enquête – ce que je nomme l’infrastructure du projet pour insister sur la dimension pratique de ces éditions dans la perspective de l’enquête collective – et dans une série de rencontres et d’activités menées par le biais de ces instances.
L’infrastructure de l’EME fonctionne comme un instrument pour la négociation et la détection des modes d’existence. Elle fonctionne cela dit également comme un format, dans le sens où elle oriente et facilite des pratiques de lecture, d’écriture et de discussion, par le truchement de sa présence matérielle et sociale auprès du public qui la fréquente. Elle le fait parfois de manière intentionnelle et maîtrisée, mais aussi parfois de manière spontanée et exploratoire, déstabilisée notamment par les dynamiques de collaboration et de fabrication qui sont nécessaires à son établissement et qui viennent « perturber » le plan initial. Cette partie est donc découpée en deux temps. Dans un premier temps, il s’agit de décrire sur un mode synchronique l’infrastructure de l’EME, constituée par l’ensemble de ses éditions, telle qu’elle a été décrite par notre équipe comme la pratique idéale de l’enquête et en vue de participer à son aventure collective. Dans un deuxième temps, Il s’agira ensuite de replacer la question de la fabrication au centre de la description, en adoptant cette fois une approche historique permettant de restituer les hésitations, les épaisseurs et les transformations effectuées par l’équipe constituée au cœur du projet simultanément à la constitution de son public.
Fréquenter un ensemble d’éditions distribuées : l’infrastructure EME, 22 Mai 2014
Au 22 Mai 2014, le curieux qui décide de s’intéresser au projet EME – et peut-être, à terme, devenir l’un de ses co-enquêteurs – se voit invité à fréquenter un assemblage hétérogène d’éditions distribuées et pourtant complémentaires. Ces dernières diffèrent d’abord de par leurs dimensions et leurs qualités – d’un « livre » imprimé à une salle dédiée à un atelier philosophique, d’un écran d’ordinateur au complexe réseau de contenus présentés sur les instances numériques de l’enquête – mais également de par leur rôle et le type d’activités qu’ils entendent susciter et permettre.
Pour les besoins de la démonstration, notre curieux est dans une disposition que l’on pourrait qualifier d’« idéale » du point de vue de l’équipe, c’est-à-dire conforme aux conditions envisagées par les concepteurs du projet pour entraîner les lecteurs vers l’activité de contribution à l’enquête. Il a à sa disposition toutes les éditions de l’EME et se trouve donc, en ce 22 Mai 2014, dans un lieu précis, au 13 rue de l’Université dans les locaux de Sciences Po, salle dite du Conseil, où se déroule ce jour-là un « atelier philosophique ».
Édition imprimée
Notre curieux a à sa disposition un premier élément matériel de « l’écosystème » de EME, appelé dans le vocabulaire du projet le « rapport provisoire », mais que j’appellerai l’édition imprimée pour laisser ouverte aux interprétations la fonction et les qualités propres à cet artefact. Ce dernier existe à ce moment en deux versions : la version française publiée aux éditions de La Découverte, publiée sous la forme d’un ouvrage imprimé de 17,2 x 3,1 x 24,2 cm à couverture souple, et la version anglaise publiée aux éditions Harvard University Press, publié sous la forme d’un ouvrage imprimé de 6-1/8 x 9-1/4 pouces à couverture rigide. Si les dimensions et les couvertures différent, on retrouve la même organisation des contenus et les mêmes caractéristiques de design éditorial – fontes de caractère, organisation des sections, éléments tabulaires et diagrammatiques. Celui-ci se présente comme un texte offrant trois entrées et modes de lecture complémentaires.
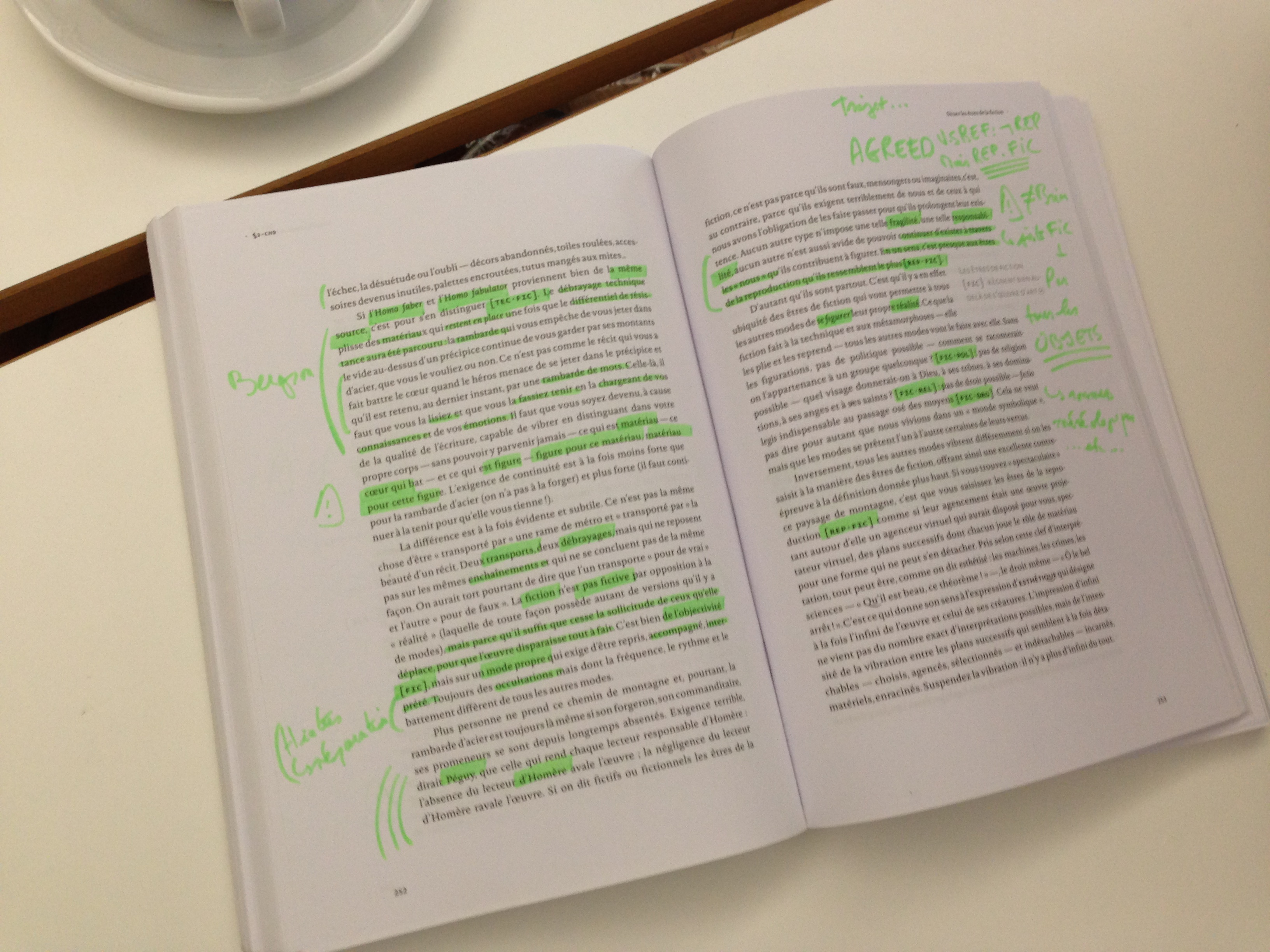
La première des entrées de l’édition imprimée est un texte linéaire organisé comme une succession de paragraphes découpés en parties, chapitres et sous-chapitres. Ainsi qu’énoncé précédemment, cette première entrée se présente, dans sa forme, comme un argument qui vacille entre le récit à la première personne (notamment dans l’introduction), le récit ouvertement fictionnel d’une anthropologue effectuant une étude sur la modernité16 , et le développement d’une argumentation qui déplie progressivement les différents modes d’existence proposés. Après l’introduction qui présente les enjeux anthropologiques et politiques d’une meilleure définition des modernes, une première partie introductive porte principalement sur la déconstruction et la dénaturalisation d’un mode qu’il intitule Double-Clic et qui porte une conception du monde divisée entre « représentations » et « choses », ou « sujets connaissants » et « choses connues », et refuse de voir le rôle transformateur des médiations de tous types ; elle se concentre également sur la description de la connaissance scientifique comme un mode d’existence particulier intitulé REF. La seconde partie de l’ouvrage s’intéresse aux « quasi-objets » en revisitant le mode d’existence des êtres invisibles ([MET]amorphose), ceux de la [TEC]hnique, de la [FIC]tion et de l’[HAB]itude. La troisième partie et dernière partie s’adresse enfin aux « quasi-sujets », en abordant les questions du [REL]igieux, du [POL]itique, du [DRO]it, de la [MOR]ale, de l’[ORG]anisation. Enfin, un long épilogue vise à resituer les enjeux du continent économique via le mode [ATT]achement. La conclusion de l’ouvrage se présente comme un programme qui explicite le cahier des charges de la phase collective du projet et en dessine les enjeux.
La seconde entrée de l’édition imprimée est une table des matières qui se présente elle-même comme un texte en prose – à la manière de certains rapports d’état ou d’entreprise qui cherchent ainsi à se présenter sur deux niveaux de lecture imbriqués – et permet de lire une version abrégée du mouvement du livre. Cette deuxième vue est non seulement utilisée au titre d’un mode de lecture alternatif, et comme une carte qui sera facilement connectée aux éditions numériques du livre.
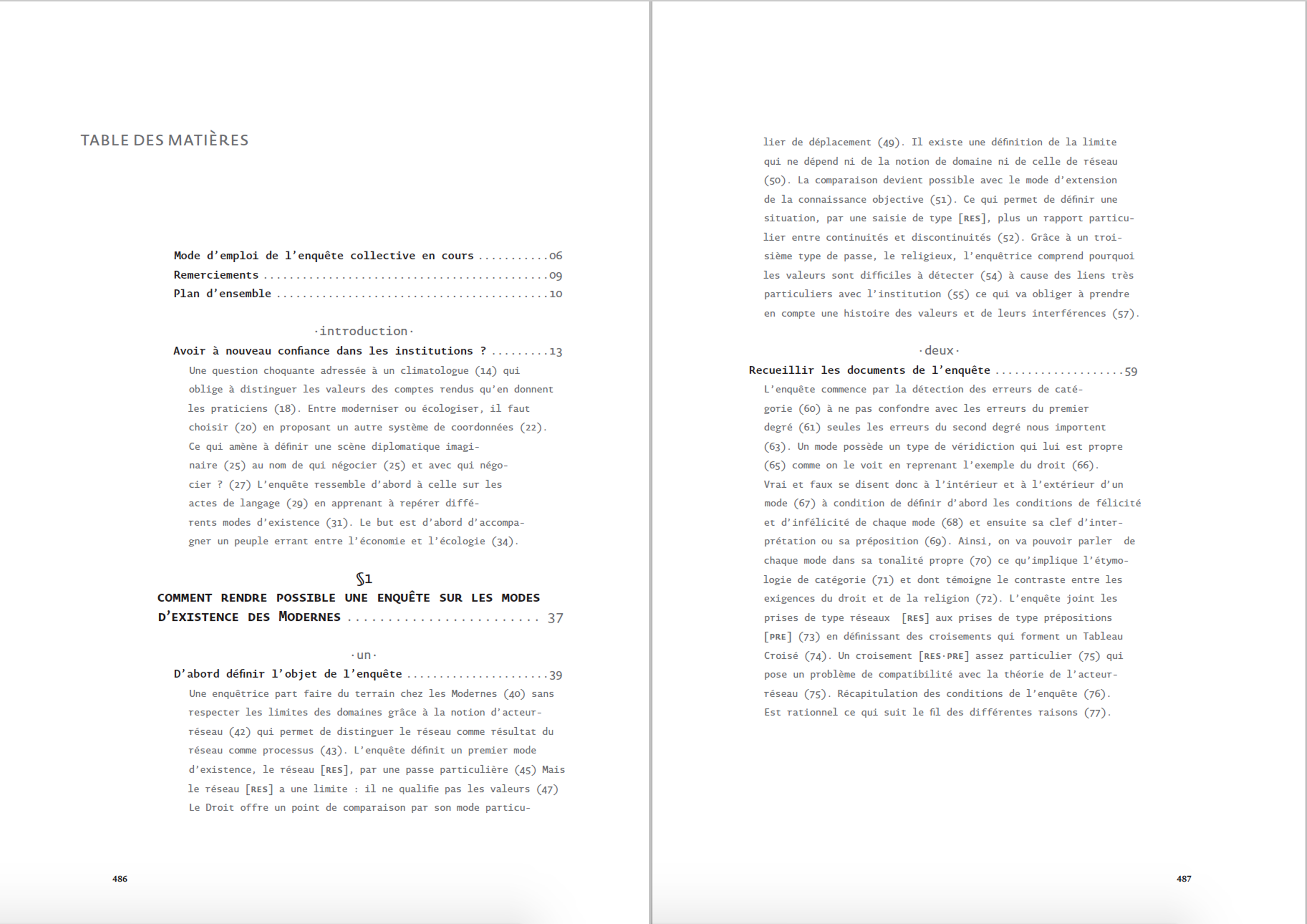
La troisième entrée, enfin, est un « tableau croisé » qui reprend chacun des modes d’existence en les décrivant systématiquement selon la grammaire de l’enquête – hiatus, passes, trajectoires,… Si l’on prend par exemple le mode de la référence – abrégé [REF] dans l’enquête – on peut apprendre à reconnaître dans une situation les « hésitations et dissemblances des formes » (hiatus) qui malgré tout génèrent un « pavage des inscriptions » (passe) pour permettre des « constantes par transformations » (conditions de félicité). C’est ainsi une présentation systématique des modes qui est proposée, en grand contraste avec le mode narratif des deux autres entrées de l’instance écrite, et que l’on retrouvera par ailleurs faire écho aux instances numériques de l’enquête.
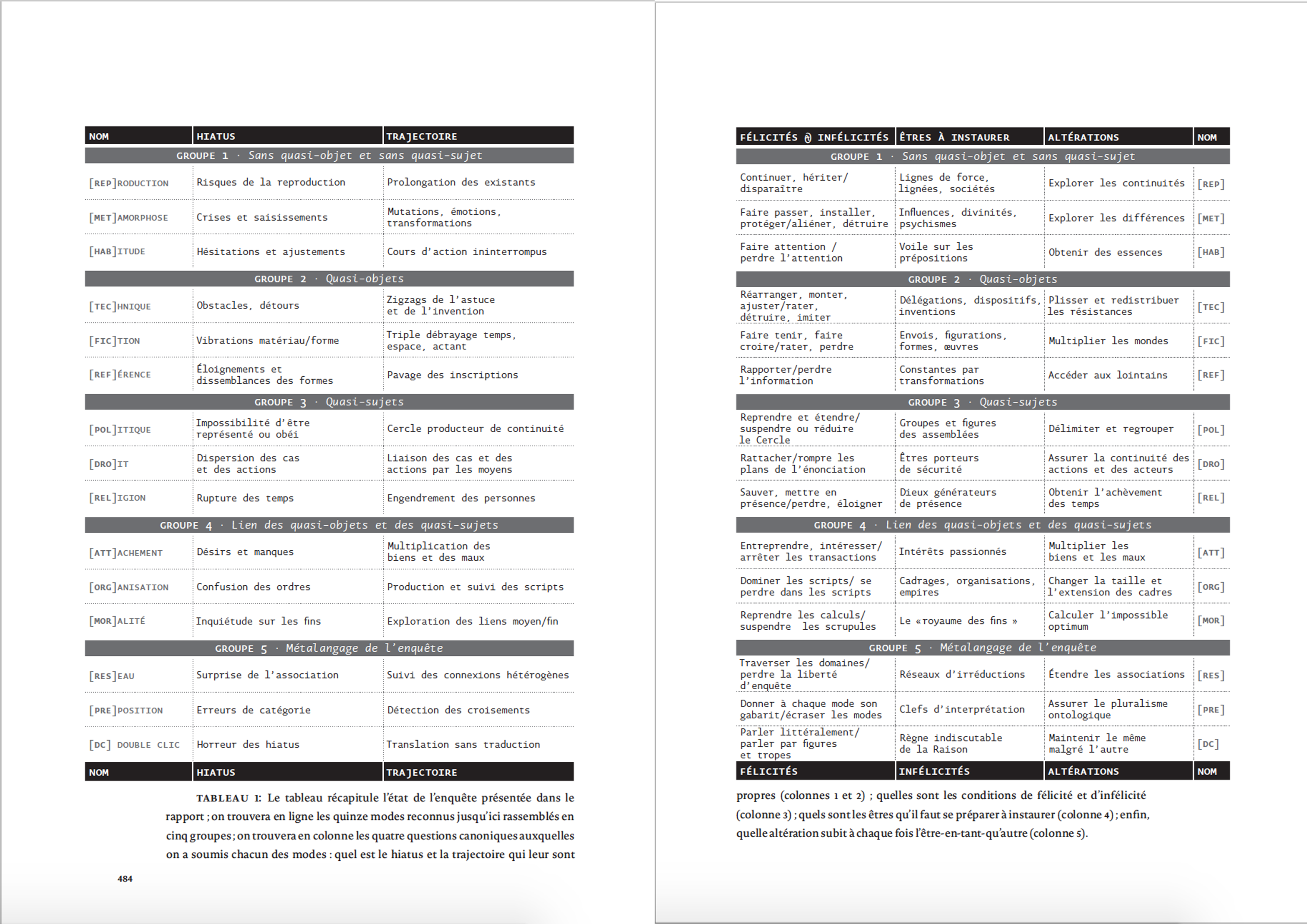
Du point de vue de son organisation textuelle, l’ouvrage ne présente aucune note de bas de page, ni glossaire, ni liste de références bibliographiques. D’autre part, du point de vue de sa mise en page, l’organisation des pages laisse environ ⅓ de la largeur de la page pour l’annotation et présente un certain nombre de pages blanches en fin de rapport. Enfin, d’un point de vue typographique, les corps de texte se voient ponctuées par une série de mots en gras et/ou en majuscule qui signalent la mention des modes d’existence ou d’un terme de vocabulaire auquel répondent des contenus supplémentaires sur les éditions numériques.
L’édition imprimée est donc un objet complexe qui joue de manière ambigüe entre le récit anthropologique, le traité philosophique et le rapport d’ordre technique ou administratif. Cet artefact propose à la fois plus et moins qu’un livre philosophique traditionnel dans la mesure où une série d’absences – au premier rang desquels celle d’un apparat critique – opèrent comme des appels pour le lecteur afin d’établir une complémentarité entre les différentes éditions à fréquenter pour participer au projet.
Éditions numériques
Le deuxième élément matériel de l’EME est un site web, caractérisé par le nom de domaine modesofexistence.org, auquel notre curieux accède par le biais d’un ordinateur portable. Si ce site est qualifié de « plateforme » dans le vocabulaire de l’équipe, on peut y distinguer au moins trois types d’entrées bien distinctes. L’arrivée sur le site donne accès à une première entrée, que nous appellerons « le blog », qui fait office de présentation d’ensemble du projet. Elle en détaille les finalités, l’équipe, mais aussi et surtout le déroulement historique, en proposant une frise chronologique constamment mise à jour. Elle présente par ailleurs une série de publications datées, écrites par le chef de projet Christophe Leclercq, qui portent sur des sujets et des registres variés : annonce et restitution des rencontres physiques du projet17 , informations pratiques portant sur les contributions et les relations avec les contributeurs18 , textes de mise au point et de complément produits directement par Bruno Latour au cours de l’enquête19 . Ces dernières entrées de blog sont ouvertes à un commentaire sans modération.
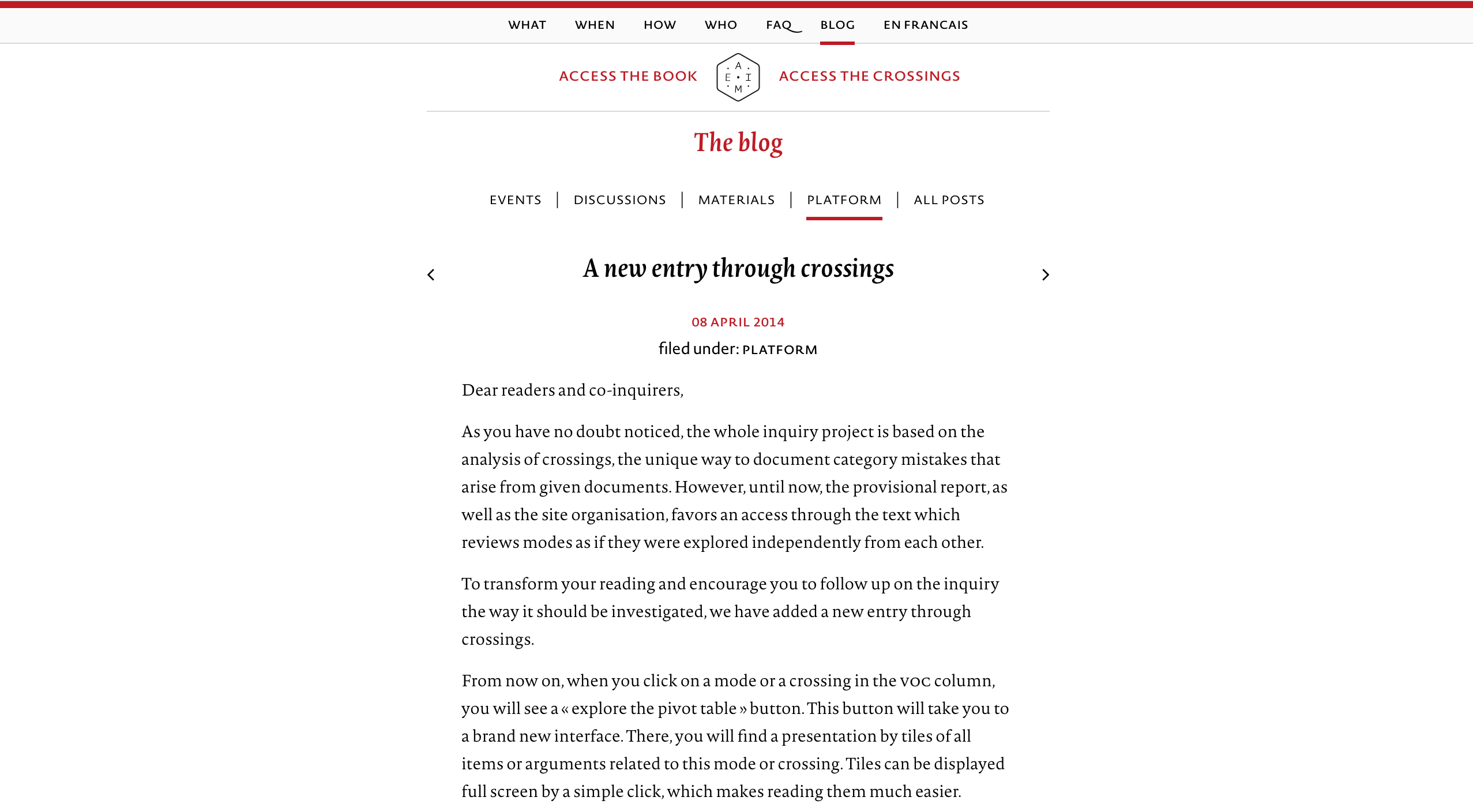
La plateforme est ensuite composée d’une interface distincte dénommée « entrée livre ». Deuxième mode d’accès à l’enquête en ligne, elle est composée au 22 Mai 2014 d’une interface organisée en quatre colonnes, chacune composée d’une liste d’items pouvant être dépliés et manipulés par le lecteur. La colonne de gauche, dite « Texte », présente un découpage des contenus présentés dans l’édition imprimée au niveau des parties, sous-parties et paragraphes qui le constituent. Si l’on parcourt cette dernière, une complexe animation permet de visualiser un paragraphe donné tout en gardant en vue la partie et la sous-partie dans laquelle il est placé. La deuxième colonne, intitulé « Vocabulaire », liste une série d’entrées qui correspondent à des points de vocabulaire utilisés dans l’enquête, l’équivalent d’un glossaire. La troisième colonne, « Documents » présente une série d’items rendant compte d’expériences empiriques par le truchement d’éléments multimédias variés, tels que images, vidéos, documents textuels, et autres éléments embarqués depuis le web. La quatrième colonne enfin, intitulée « Contributions », est composée de contenus écrits par les internautes et publiés par l’équipe, dont la finalité théorique est de réviser ou d’enrichir une partie du texte original. Suivant l’orientation empirique de l’ensemble de l’enquête, ces contributions sont formatées selon une organisation bien précise composée d’un résumé de 500 mots, puis d’une série de « diapositives » qui associent chacune un document à son commentaire.
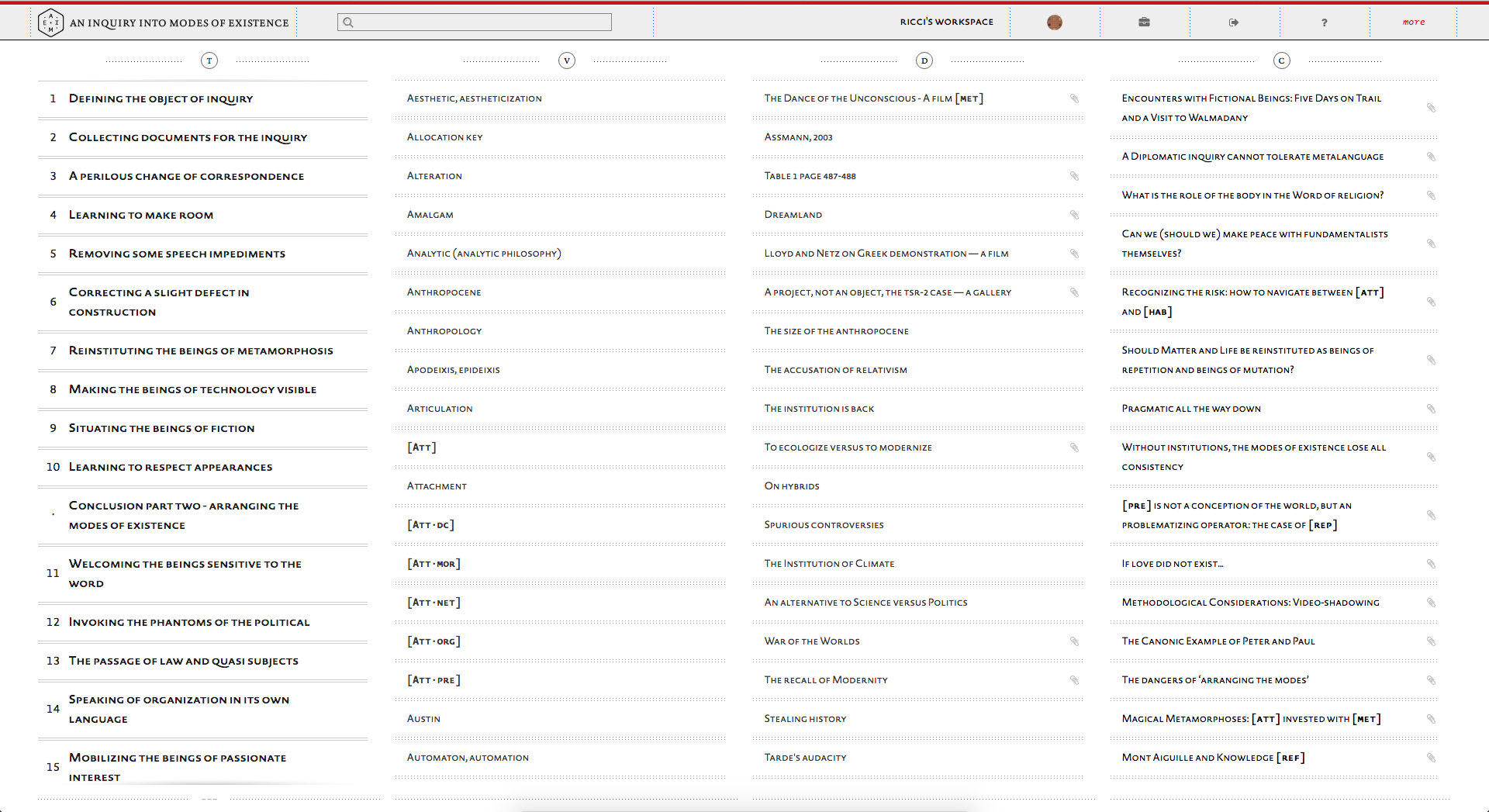
Au premier abord très structurée et synthétique, l’ensemble de l’interface se reconfigure et change d’organisation spatiale dès lors que l’on commence à la parcourir. L’ouverture de l’un des « items »20 dans une des colonnes provoque la recomposition des 3 autres en fonction des connexions qui lui sont attachées. En effet, chacun de ces éléments – qu’il s’agisse d’un paragraphe de texte, de vocabulaire, ou de contribution – est associé par des liens hypertextuels à un ou plusieurs autres éléments de l’enquête. Ainsi, par exemple, les items de paragraphe correspondant au texte de l’instance imprimée se voient annotés avec des liens vers des points spécifiques de vocabulaire dont la définition est détaillée dans leurs sections afférentes, et à des documents qui donnent accès à des expériences empiriques des modes et de leurs croisements – surlignés en vert. Le clic sur un élément en particulier provoque un réagencement des contenus dans lequel ne sont plus visible que l’élément sélectionné, présenté sur la moitié de l’espace disponible, et la liste des éléments qui lui sont reliés, sous une forme condensée. La navigation dans l’EME se présente donc comme une succession de configurations (typo)graphiques présentant sur deux dimensions une section et les différents éléments qui lui sont rapportés. Si l’on clique sur l’un de ces éléments rapportés, ce dernier devient à son tour l’élément organisateur d’une nouvelle composition, dans lequel il se voit présenté sous une forme étendue et ses éléments connexes sous une forme condensée. Il est à noter que, si l’interface propose dans l’une de ses colonnes une liste d’items qui correspondent à l’enchaînement séquentiel et narratif que l’on retrouve dans l’édition imprimée de l’enquête, ce mode de navigation par recomposition autorise des logiques de lecture multiples, qui peuvent certes choisir l’enchaînement des paragraphes comme fil de lecture, mais aussi se lancer dans une trajectoire de lecture associative qui ne suivrait pas du tout l’organisation initiale du livre.
Pendant les évènements de la journée, notre curieux ne se contente pas de naviguer silencieusement entre les différentes configurations graphiques qui se présentent à lui alors qu’il reparcourt le chapitre du rapport préliminaire dédié au mode religieux – thème de la journée. Il dispose également d’une série de fonctionnalités avec lesquelles il travaille sur le contenu que lui propose l’interface « livre ». Dans la colonne de droite, dans laquelle figure la liste des contributions effectuées par les co-enquêteurs, figurent des items légèrement grisés ou bleutés qui représentent les contributions qu’il a lui-même écrit à propos de passages du livre qui l’intéressent. Ces derniers, attachés à un élément précis de l’une des trois autres colonnes, sont des contenus écrits par le lecteur et restés à l’état privé, ou bien en cours de modération par le dispositif de médiation de l’équipe.
Enfin, il dispose également de deux manières distinctes de modifier encore une fois l’apparence des contenus de l’enquête comme ils se présentent à lui. Premièrement, s’il clique sur l’icône de valise présent en haut de son écran, notre curieux pourra également disposer d’une autre vue des contenus fondées sur les passages qu’il a surlignés grâce à la fonction afférente proposée par l’interface. Cette vue, intitulée « calepin », lui donne à voir une version abrégée, toujours en 4 colonnes, des contenus qu’il a, durant sa lecture, « mis de côté » pour une lecture ultérieure, ravivant la pratique des commonplace books, ces carnets de citations et d’extraits consignés pour une remobilisation ultérieure (Blair, 1992).
En revenant à l’entrée « blog » du site, notre curieux accède maintenant au troisième point d’entrée de l’enquête proposé par la plateforme numérique, intitulé « croisements ». Ce dernier propose une interface vers les mêmes unités de contenu que celles de l’entrée « livre », mais sous un mode de présentation et de manipulation différent. Les unités sont en effet alors présentées sous la formes de « tuiles » ou blocs typographiques, entre lesquels il est impossible de distinguer au premier abord ce qui désigne un paragraphe issu de l’édition imprimée, un élément de vocabulaire, un document, ou une contribution proposée par un co-enquêteur. S’il clique sur l’une des tuiles, le curieux accède à une nouvelle mise en page qui lui présente, sous la forme d’un contenu en une seule colonne et plein écran, le contenu d’une seule unité.
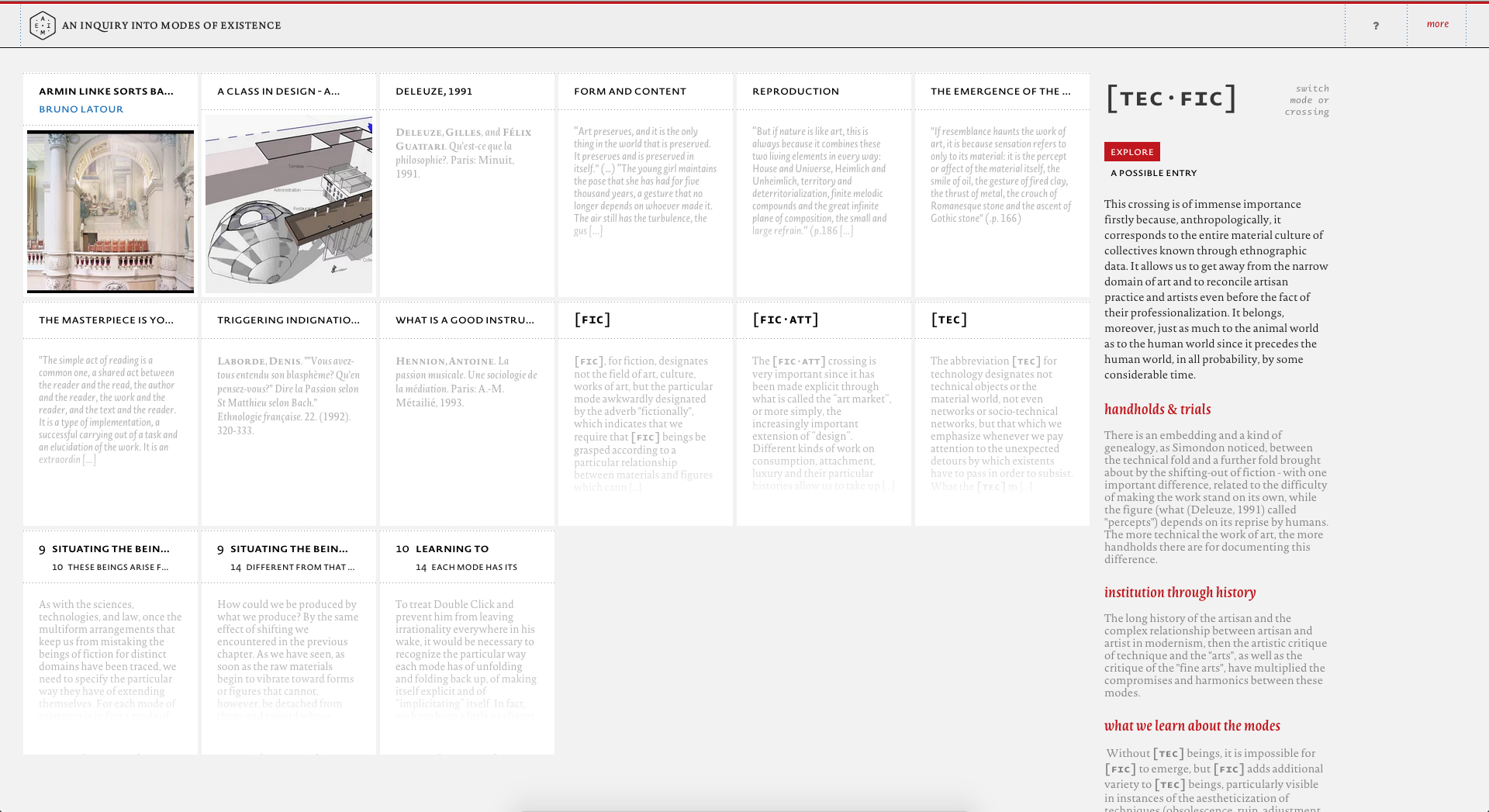
Si la composition et l’ordre des « tuiles » présentes à l’écran lors de l’arrivée sur l’entrée « croisements » n’est pas évidente, ils n’ont pourtant rien d’aléatoire et correspondent à un choix précis. Sur la droite de l’écran, un panneau informatif affiche en gras l’acronyme « [TEC-FIC] » qui correspond dans le vocabulaire de l’enquête, au croisement entre le mode d’existence propre aux êtres techniques et à ceux de l’art. Les « tuiles » présentées sur la colonne principale correspondent en fait à l’ensemble des éléments de l’enquête qui sont associés au point de vocabulaire correspondant à ce croisement précis, soit dans ce cas toutes les tuiles qui permettent de mieux détecter le croisement « [TEC-FIC] ».
En haut du panneau latéral figure une liste, avec, dans ce cas, deux choix intitulés « explore » et « possible introduction ». Le clic sur l’un d’eux provoque la réorganisation des tuiles affichées à l’écran selon un ordre nouveau, au moyen d’une animation qui rappelle les interpolations d’un jeu de carte. Ces différents agencements correspondent à autant de « scénarios » qui proposent de rendre compte de ce croisement selon divers enchaînements de contenus. La colonne latérale, outre son interface de navigation, liste d’ailleurs une série de points (« prises et défis », « institution dans l’histoire », « ce qu’on apprend des modes », ..) qui répondent à un questionnaire que l’on retrouvera dans d’autres états de l’interface21 . En la faisant basculer au moyen d’un bouton dédié, il est possible d’accéder à une représentation graphique de l’ensemble des quinze modes et de leurs 225 croisements, et de mettre à jour la liste des tuiles en fonction d’un mode ou d’un croisement en particulier.
L’entrée croisements propose donc encore un autre mode d’entrée dans l’enquête, faisant cette fois-ci davantage écho au tableau récapitulatif de l’instance imprimée qu’à son texte en prose. De la même manière que l’entrée « livre » permettait de filtrer les contenus pléthoriques de l’enquête au moyen d’annotations ou d’une recherche, l’entrée « croisements » propose un autre type de filtre pour lequel les mêmes contenus se voient redistribués selon une série de « coupes » qui proposent un abrégé séquentiel selon le point de vue spécifique d’un mode d’existence ou d’un croisement. Les différents scénarios alternatifs d’agencement pour les tuiles visant à décrire un mode ou un croisement font office d’autant de « tests » proposés à l’internaute pour en faire l’expérience.
Notre curieux, absorbé par l’exploration de l’entrée « croisement » et de ses ballets interactifs complexes, lève alors la tête de la complexe « plateforme » qui se présente à lui sur l’écran de son ordinateur, et se rappelle alors qu’il était également présent dans un autre lieu, physique cette-fois, où se déroulait et se déployait une autre édition du projet EME baptisée par l’équipe successivement de « rencontre face-à-face », « d’atelier philosophique » ou de « rencontre diplomatique ».
Rencontres diplomatiques
La Salle du Conseil est une pièce allongée, occupée par une large table en bois de forme ovoïde flanquée de diverses prises et micros. La pièce elle-même, pourtant agrémentée d’une baie vitrée sur un de ses murs les plus longs, est baignée dans une certaine obscurité que percent difficilement les éclairages jaunâtres du mur qui se disputent leur lumière avec les murs recouverts d’une épaisse moquette noire. Dans cette ambiance intimiste, un film est projeté sur l’écran déployé sur un des murs : il s’agit d’une des rares captations vidéos du rituel de la réclusion initiatique conduite dans le cadre du Candomblé, une religion syncrétique répandue au Brésil et objet de plusieurs expériences de terrain de l’anthropologue Patricia de Aquino, qui présente le film lors de cette rencontre (De Aquino, 1998).
Les différents participants de la journée – une dizaine, allant et venant suivant les disponibilités de chacun – sont disposés autour de la table, accompagnée d’une petite quantité d’observateurs venus à l’atelier en tant que spectateurs – dont notre curieux – ainsi que de membres de l’équipe. Parmi eux se tiennent une majorité de chercheurs universitaires spécialisés dans l’anthropologie et l’étude des pratiques religieuses, mais également un prêtre jésuite. Je circule pour ma part entre l’extérieur du cercle de parole, duquel je fais ce jour-là office de photographe, et le centre de la pièce au centre duquel nous avons installé un nécessaire de captation vidéo, et nous nous relayons avec Pierre Jullian de la Fuente, alors ingénieur informatique sur le projet. Bruno Latour se tient en bout de table, absorbé dans une prise de note en compagnie de Milad Doueihi, qui a organisé avec l’équipe cette double journée d’ateliers dédiée au mode d’existence de la [REL]igion autour d’un aphorisme de Nietzsche, auparavant communiqué aux participants via un document Google Drive22 .

Avant et après le visionnage commun du document vidéo, Patricia de Aquino présente en détail le culte du Candomblé et ses particularités rituelles. Elle complète son exposé par la présentation d’un exemplaire papier d’article de Paris Match écrit en Mai 1951 et proposant un premier mode de dépiction du culte au grand public, et par la présentation des cauris, coquillages rituels utilisés par ce culte du Candomblé qui se situe à la croisée entre croyances chrétiennes et animismes importés depuis l’Afrique noire, et dont elle est la spécialiste. Les matériaux passent entre les différentes mains durant la discussion. Autant d’éléments empiriques qui sont dans un deuxième temps utilisés comme matière de discussion pour explorer le croisement problématique entre [REL]igion et [MET]amorphose, remarquablement incarné par ce culte du Candomblé.

Les présentations et discussions s’alternent au fil de la journée. L’écran de projection est fortement mobilisé à chacune d’entre elles pour afficher images, vidéos et autres documents attachés aux expériences – majoritairement inscrites dans la discipline universitaire de l’anthropologie – rapportées par les divers participants. Un compte-rendu est réalisé en direct sur un document Google Drive23 sur la base des échanges de la séance. Il est ouvert à tous ceux présents dans la salle, cette journée édité par les membres de l’équipe – Christophe Leclercq, Pierre-Laurent Boulanger, Clémence Coursault, et moi-même. La suite d’outils de stockage et d’édition en ligne – dite de « cloud computing » – fournie par Google, fait office de quatrième instance du projet, et elle est aussi l’un des lieux indéniables de déroulement du projet, notamment en amont et pendant les rencontres physiques. Pendant la journée, une cinquième instance est activée : le compte Twitter du projet, identifié par le nom de @AIMEproject24 . Tenu alternativement par Bruno Latour et par le chef de projet Christophe Leclercq, celui-ci est utilisé pour rendre compte de réactions et d’avancées remarquables en direct au cours de la rencontre.
Au cours des échanges, l’écran central est utilisé à des fins multiples pour reconnecter l’édition en cours d’utilisation – « l’atelier philosophique » – aux autres éléments de l’infrastructure de l’EME : rapport, plateforme, google drive, compte twitter. En début de séance, Christophe Leclercq affiche sur l’écran un récapitulatif de la série de documents préparatifs qui leur sont proposés sur l’instance Google Drive. À un autre moment, quand un point précis du texte initial de l’édition imprimée sera discuté, c’est l’instance « livre » qui est affichée selon la vue correspondante de manière à fournir à tous un point de discussion commun – un exemplaire de l’édition imprimée tournant toujours dans la pièce. À la fin de la journée, une période de 30 minutes est dédiée à accompagner les participants qui en manifestaient le besoin, dans la transformation de leur expérience de la journée en une contribution formatée pour être intégrée au corpus global de l’enquête via sa plateforme numérique. Les participants sont invités à se connecter sur la plateforme, et pour certains d’entre eux, à apprendre à utiliser l’interface complexe qui leur est proposée pour écrire une contribution. Dans les faits, cette phase n’aboutit à l’écriture d’aucune contribution sur le moment mais donnera lieu ultérieurement à la production de plusieurs d’entre elles25 . Un dernier jeu de correspondance s’observe alors que les tweets publiés lors de la journée seront quelques jours plus tard rassemblés et publiés sur l’instance « blog » du projet pour faire office de compte-rendu26 .
Développer en/un public
Les éditions qui composent l’infrastructure EME pour accueillir l’enquête collective sont appelées à se répondre et se soutenir mutuellement afin de permettre un ensemble d’activités distribuées. Cependant, l’infrastructure de l’EME ne se construit pas de manière séquentielle – telle une gestation à l’ombre des regards suivie par une phase d’enquête au moyen d’un outil propre et stabilisé. Au contraire, elle se construit en même temps que la trajectoire d’enquête qu’elle porte et les collectifs qu’elle mobilise, invitant à penser conjointement les dynamiques de fabrication, de modification et de mobilisation publique dont elle est l’objet.
La transformation progressive de la recherche solitaire de Bruno Latour en un dispositif collectif donne lieu à des processus de publication plus ou moins contrôlés qui s’ajustent en cours de route. La multiplication des rencontres et des communications alors que l’infrastructure continue d’être développée implique un entremêlement constant entre construction des énoncés et construction des contextes d’énonciations, expérimentation de modalités d’écriture et de négociation, et mise en correspondance des différentes instances et mécanismes de l’infrastructure. Il s’agit donc d’éloigner une présupposée représentation de l’infrastructure de l’EME comme un tout cohérent et évident, en retraçant la trajectoire de développement de sa lourde infrastructure sociale, technique et esthétique, pour en restituer les hésitations, les bifurcations et les épaisseurs matérielles et temporelles. Il s’agit aussi, de manière concomitante, de décrire l’effet de la socialisation progressive – et précoce – du projet sur ces dernières. Une telle description devrait permettre d’éclairer de manière plus précise les dynamiques de co-construction à lʼœuvre entre les dimensions sociales, méthodologiques, technologiques et esthétiques de l’infrastructure de l’EME.
Cette partie est construite sur la base de trois sources, en plus des éléments accessibles à tous que sont les interfaces numériques publiques du projet ainsi que les ouvrages imprimés. La première est une série d’entretiens semi-dirigés que j’ai conduits en juin et juillet 2014 avec dix des personnes impliquées dans le projet à divers stades de son développement. Je me fonde également sur l’analyse de la très dense documentation privée du projet – réunie par le chef de projet et par ailleurs historien de l’art Christophe Leclercq. J’ai eu ainsi accès à une grande part des documents de travail du projet, aux captations effectuées durant les réunions de conception privées et les rencontres publiques, à l’archive des échanges mails avec les contributeurs, ainsi enfin qu’au code source des plateformes numériques. La dernière source utilisée pour la construction de ce récit est mon expérience de première main du projet concernant tous les événements ultérieurs à mars 2014.
L’exposition progressive du projet à un public de plus en plus hétérogène et important a dû être segmentée afin de pouvoir mieux en percevoir la dynamique de déploiement. Je propose donc, pour faire ce récit, de diviser l’histoire du projet en quatre périodes distinctes. Durant la période d’incubation, le projet se développe dans des formats de données utilisés personnellement par Bruno Latour, sous la forme d’une base de données personnelle et d’un manuscrit – alors que l’environnement social dans lequel le projet collectif sera mené, est esquissé. S’en suit une phase de développement durant laquelle une équipe de concepteurs – ingénieurs, designers, et autres « scénographes de concepts » – se constitue pour mettre en scène l’infrastructure et les matériaux produits précédemment sous la forme d’un ensemble d’éditions. La troisième phase, que j’appelle « la rencontre », commence avec la publication du livre et le début des rencontres en face-à-face. La dernière phase, la « négociation », concerne la période la plus intense des échanges puis le processus de préparation de la semaine de négociation et de réécriture, suivie de la « conférence d’évaluation finale ».
L’incubation (avant 2011)
Un projet développé au médialab de Sciences Po
Le projet EME, en tant qu’enquête collective, est développé dans l’enceinte du médialab, nouvelle unité scientifique placée sous la tutelle de la Fondation Nationale des Sciences Politiques (« Sciences Po »). Le médialab est créé en 2009 par Bruno Latour et Valérie Pihet avec la première mission d’être un centre visant à expérimenter de nouvelles méthodes numériques pour les sciences sociales. Sous l’action de Bruno Latour, alors également directeur scientifique de l’École, il deviendra progressivement un laboratoire de recherche développant son propre programme scientifique. Le projet scientifique du laboratoire consiste, dans la lignée des travaux précédents de Bruno Latour sur les questions d’échelle et de l’approche « associationniste » proposée par la sociologie de la traduction, à exploiter les traces numériques disponibles sur le web pour construire de nouvelles représentations du fait social qui se libéreraient de la traditionnelle opposition entre individus et sociétés (Latour, Jensen, Venturini, Grauwin, & Boullier, 2012). Il s’agit alors de développer des méthodes « quali-quantitative » permettant d’explorer des modalités d’association et d’agrégation intermédiaires, rendues explorables et manipulables par des formes d’instrumentation et de publication web dénommées datascapes.
Le terme de datascape désigne à la fois une méthodologie et un genre de publication. La méthodologie consiste à conduire simultanément et collectivement la définition d’une question de recherche dans une discipline définie – histoire de l’art, sciences politiques, etc., l’élaboration d’une base de données nourrie et structurée selon la perspective interprétative induite par cette question, et le développement d’une publication web interactive apte à faire office d’instrument d’analyse et d’interprétation. Cette dernière publication permet de naviguer entre plusieurs perspectives à l’intérieur de la base, sous la forme de visualisations de données qui peuvent être recomposées selon le point d’un vue d’un acteur en particulier dans le phénomène observé (Leclercq & Girard, 2013). Le datascape se présente donc à la fois comme une méthode de collaboration entre chercheurs et concepteurs (ingénieurs et designer), aptes à affiner leur perspective sur un phénomène par le développement itératif du datascape, et comme une publication-instrument destinée à un public de chercheurs spécialistes de la question traitée par le site.
La conception des datascapes requiert l’exploration de configurations de travail interdisciplinaires dans lesquelles les pratiques professionnelles du design, notamment, consistent à concevoir des outils de visualisation et d’exploration des données numériques mais aussi à faciliter la collaboration interdisciplinaire par des pratiques de reformulation et de mise en forme distribuées tout au long du processus de fabrication.
Du fait de la nature expérimentale et fortement technique de la démarche scientifique à l’origine du médialab, l’organisation tire une forme de spécificité dans sa composition et son approche professionnelle de la recherche, qui tente de conjuguer sur un même plan méthodologique des activités de design, d’ingénierie et de sciences sociales. C’est l’environnement du médialab – et l’expérience des datascapes en termes de formes de collaboration et de restitution – qui pousse Bruno Latour à imaginer la publication de son manuscrit sur les modes d’existence sous une forme incluant une instance numérique :
Cʼest seulement quand jʼai vu ce que le médialab était capable de faire, et quand jʼai vu toutes les choses sur le travail collaboratif – wiki et toutes ces choses – jʼai pensé que si je voulais rendre la tâche publique, ma propre limitation serait trop évidente, et il serait vraiment intéressant de partager le projet, lʼintérêt, aussi lʼénergie, avec les autres. Et je me suis dit : ‹ Comment tu fais ça ? › – Eh bien, le support numérique était un moyen évident de le faire. Jʼavais en quelque sorte exploré – et cʼétait un échec total – lʼoutil numérique dans la grande exposition sur ‹ Making things Public › que jʼai faite à Karlsruhe – donc, ça a échoué mais jʼai réalisé quʼil y avait beaucoup dʼautres moyens de connexion, car nous avions une exposition spéciale dans lʼexposition avec la première – cʼétait en 2005 – plateforme collaborative précoce.27
Le médialab constitue donc l’environnement intellectuel et technique, articulant théorie et pratiques notamment numériques, depuis lequel est appelé à se développer l’enquête collective. La contribution de l’organisation est envisagée avant tout selon une perspective instrumentale visant à contribuer à des questions formulées par son créateur. Cela dit, dans le même temps, le médialab fait également une place à une forme dʼexpérimentation dans les dispositifs méthodologiques qui engage parfois à explorer leur logique propre et leur intérêt intrinsèque. Dans cette trajectoire, le médialab avance dans un équilibre précaire entre le développement instrumental de méthodes de recherche au service de projets scientifiques définis dans les sciences sociales, et le développement expérimental des qualités et des valeurs interférentes – qu’elles soient esthétiques, technologiques, ou sociales – que ces dispositifs méthodologiques portent en soi et pour soi. Il s’agit ainsi d’interroger comment dialoguent les nécessités d’un équipement impliquées par le cahier des charges établi par l’investigateur principal avec les pratiques de fabrication et d’expérimentation propres à l’élaboration de l’infrastructure de l’EME.
… sous la forme d’un projet de recherche européen
Le projet de l’EME en tant qu’enquête collective démarre par un dossier de demande de financement. Dans le cadre proposé par l’European Research Council (ERC), il est demandé aux chercheurs de définir à l’avance un budget, des rôles et un calendrier fait de « workpackages » et de « milestones » pour baliser et planifier la conduite attendue de la recherche. Ce format à la grammaire complexe fait peser sur le projet l’attente d’une ponctualité et d’une efficacité rythmées par la production de « livrables » publiés régulièrement afin de justifier du bon usage de l’investissement dans le projet. Il nous permet également de disposer d’un instantané du projet avant son déroulement effectif, utile pour faire office de point de comparaison avec ce qui se développe par la suite dans la pratique. Dans ce dernier, une finalité est déjà énoncée de manière explicite :
Lʼobjectif principal de lʼAIME est de trouver un moyen de trouver une définition alternative acceptable de ce quʼa signifié lʼaventure de la modernité maintenant quʼelle est largement terminée en raison du double phénomène de la perte de lʼhégémonie idéologique occidentale et de la montée des crises écologiques. Pour atteindre cet objectif, je veux construire un instrument spécifique conçu spécifiquement pour aborder cette double question de théorie sociale et dʼanthropologie comparée. Cʼest cet instrument qui devrait pouvoir transformer une poursuite individuelle en une enquête collective. Je ne mʼappuierai cependant pas sur un ensemble quantitatif dʼessais car il nʼy a aucun moyen dʼextraire des opinions avant dʼavoir renégocié les termes du débat. Cʼest précisément parce que la définition des modes dʼexistence nʼa pas de sens commun et quʼelle exige néanmoins dʼêtre empiriquement ancrée quʼil faut inventer un dispositif très spécifique et original.28
Dans le dossier, si la demande se présente directement comme le projet de combiner un ouvrage imprimé, des rencontres physiques et des espaces en ligne, elle insiste particulièrement sur la dimension numérique du projet qui se formule alors comme le projet de deux plateformes numériques complémentaires, visant respectivement à fournir une documentation étendue complémentaire au livre, et à conduire les négociations nécessaires sur la composition des modes d’existence. Cet ensemble est baptisé l’instrument AIME, pour insister sur la dimension ouverte et non-finalisée de l’hypothèse des modes d’existence.
La première plateforme est présentée au moyen d’un argument quantitatif qui repose principalement sur l’incapacité du médium imprimé à restituer correctement l’ampleur de l’enquête à restituer, soit à permettre aux lecteurs de proprement enquêter sur le travail et la proposition de l’auteur. Le texte met ainsi en avant la profusion des matériaux déjà disponibles pour accompagner le texte qui sera celui de l’édition imprimée : un « vaste fichier […] d’environ 1500 pages », un « document d’environ 2000 pages » détaillant les modes d’existence, celui qui « comprend un Vocabulaire général (800 pages) », sans compter celui qui consigne « les commentaires que j’ai reçus pendant les vingt-deux années du projet ». Elle est également promue comme un moyen de proposer une logique de navigation tirant partie de l’hypertexte pour permettre une lecture associative de l’ensemble de la proposition. C’est à cette tâche qu’est mentionnée une première fois la nécessité de compétences en design pour concevoir ces systèmes de navigation et de visualisation29 .
La seconde plateforme envisagée dans le projet est dédiée à la construction d’un public et de contributeurs et la réception. L’investigateur principal y détaille le paradoxe de sa démarche – une thèse tentant de rendre compte d’une réalité touchant l’ensemble des modernes, à partir d’expériences ethnologiques situées et individuelles – tout en présentant le projet de l’EME comme une manière de dépasser ce paradoxe en mettant en place un processus de révision collective. Pour ce faire, il propose de renverser le processus de réception traditionnel de l’édition en intégrant l’épitexte de son ouvrage – recensions, commentaires, présentations – comme une modalité méthodologique d’évolution de la recherche faisant du texte publié un point de départ davantage qu’une finalité :
Ainsi, au lieu de publier dʼabord un livre et dʼattendre que la critique fasse son travail plus ou moins au hasard, lʼidée mʼest venue de transformer la critique en un protocole de recherche organisé pour tester et, surtout, réviser les propositions que jʼavais faites initialement dans le livre.30
Il s’agit, par le biais de la seconde plateforme, de « recueillir lʼexpérience des autres par un protocole de recherche original afin de réviser les propositions faites au départ »31 mais aussi de conduire à « imiter le plus fidèlement possible les ‹ pourparlers de paix › et les ‹ parlements › nécessaires pour accepter de pluraliser lʼensemble des conditions de félicité qui doivent être simultanément respectées sans multiplier les erreurs de catégorie ni se perdre dans le dédale des hybrides »32 . À partir du fonctionnement de l’instrument AIME et de son utilisation dans une série d’ateliers de recherche dans lesquels seront présentés de nouveaux « comptes-rendus » et leurs appuis empiriques, une dernière étape est envisagée qui devrait aboutir à la réécriture du livre et la restitution de l’enquête enfin collective :
La deuxième partie de lʼinstrument AIME est finalisée. A travers une conférence – et probablement une petite exposition sur les rouages du projet AIME du début à la fin – toutes les reformulations et re-descriptions des propositions originales seront proposées et rapportées dans lʼenquête originale (si possible le livre original sera réécrit et republié).33
Dans ce texte projectif, les métaphores et le champ lexical des sciences expérimentales sont omniprésents pour décrire le fonctionnement de « l’instrument AIME ». Il s’agit de « comparer » des jugements pour en « tester la validité » afin de « confirmer, falsifier ou compléter des essais précédents », pour enfin proposer une version « révisée » du travail initial. Cela dit, d’autres pans de l’infrastructure sont encore décrits avec un vocabulaire hésitant. Les expérimentations envisagées sont rapportées avec prudence à des genres existants, l’« anthropologie philosophique » pour la démarche globale, « l’enquête » pour la méthodologie34 . Les futurs « co-enquêteurs » sont alors appelés des correspondants. Des points d’appuis sur des pratiques et genres associés à l’édition scientifique sont convoqués de manière répétée pour décrire ce qui est envisagé, comme la pratique de la recension de monographies35 . Ces hésitations laissent à voir un ensemble de choix et de développement appelés à se préciser dans le fabrication de l’infrastructure.
Les activités des co-enquêteurs à venir sur l’instrument EME, plus grandes inconnues à ce stade du projet, sont également décrites de manière assez ouverte et spéculative. Il est envisagé de convoquer les services de designers de service pour préciser les fonctionnalités nécessaires, comme leur permettre de « fournir des balises, leur permettre dʼajouter des documents, de créer leurs propres chemins dans la documentation, de partager leurs commentaires avec les autres utilisateurs, etc. »36 . L’identité des « co-enquêteurs », quant à elle, est envisagée de manière plus précise comme relevant de ce que l’auteur appelle « des praticiens », pour désigner une série d’acteurs extérieurs aux mondes de la philosophie et de l’anthropologie et appelés à rendre compte des croisements entre les différents régimes d’énonciation auxquels ils tiennent dans leur pratique, comme par exemple « des biologistes confrontés à des opposants religieux ; des artistes en conflit avec des revendications politiques ; des économistes et des écologistes ; des ingénieurs obligés de prendre en compte les avocats ; etc. ».37 Le texte de demande de financement fait état du risque principal d’échouer à faire participer de tels co-enquêteurs, à cause de l’exigence théorique de l’ensemble de l’entreprise mais aussi de la difficulté à obtenir de leur part des contributions dépassant la seule expression d’opinion pour participer de la négociation des modes d’existence :
Cʼest la partie la plus difficile et la plus risquée puisquʼil faut parier, dʼune part, sur le fait que toute lʼenquête nʼest pas idiosyncrasique au point dʼexclure toute collaboration et, dʼautre part, sur la possibilité de concevoir une plateforme suffisamment riche pour permettre un jugement partagé. Je nʼai pas lʼintention de laisser les gens réagir ouvertement dans le genre de Wikipédia ou dans la culture des blogs qui est maintenant si bien établie. Dʼune part, lʼoriginalité des définitions des différents modes exige un prix dʼentrée trop élevé ; dʼautre part, si les conditions à remplir pour participer sont trop étroitement définies, aucun outsider ne pourra y accéder. (…) Cʼest bien sûr la partie la plus difficile puisquʼil sʼagit de repérer les lignes de front qui sont assez chaudes pour intéresser les gens à participer à une telle entreprise et pas assez chaudes pour quʼaucune rencontre diplomatique ne soit possible. Lʼautre difficulté est de trouver des participants prêts à essayer le dispositif, même sʼil a été défini, au moins au début, par un philosophe individuel.38
En accord avec le format méthodologique imposé par les financements de recherche européens, les temps du projet sont définis à l’avance sous la forme d’une série « d’étapes » ou milestones et de livrables, conditionnant pour l’avenir les indicateurs d’évolution qui seront utilisés par l’Union Européenne pour contrôler le bon usage de ses crédits. Au bout de douze mois, une plateforme numérique devra être en ligne. Puis six mois plus tard, le lancement des « négociations » via la combinaison de fonctionnalités de collaboration et de rencontres directes autour du projet.
Quelques mois plus tard, la demande de financement est acceptée et un budget confortable est attribué à l’EME pour une période de trois ans. En 2011, une équipe constituée de Christophe Leclercq, chef de projet, et de Dorothea Heinz, assistante de recherche, est intégrée au sein du médialab, et l’organisation de la dimension numérique du projet est confiée à Paul Girard, alors directeur technique du médialab. S’engage un premier travail d’état de l’art et de prospection autour des formes à attribuer au dispositif.
Le développement (2011 – 20 Septembre 2012)
Quand le projet EME commence officiellement, en 2011, certaines parties de l’infrastructure sont déjà en place : un texte, écrit et révisé une première fois, déroule la thèse des modes d’existences sur un mode narratif. Sa documentation, organisée selon le canevas théorique des modes et de leur croisement, existe déjà en partie sous la forme d’une base de données dans un logiciel intitulé NoteTaker (« NoteTaker », 2002) qui permet d’organiser une base de connaissances personnelles sous la forme d’un ensemble d’entrées textuelles connectées par des liens hypertexte. Le médialab constitue une ressource identifiée et relativement stable, et un répertoire d’expériences voisines. Bruno Latour dispose également d’une relation privilégiée avec deux maisons d’édition, celle française de La Découverte et celle américaine de Harvard University Press, qui permettent d’entrevoir l’environnement de déploiement des éditions imprimées du projet.
Formater les contenus …
Les contenus sont construits progressivement à partir de documents écrits dans des formats numériques préexistants : un fichier word pour le rapport préliminaire de l’enquête, et un fichier tiré du logiciel de base documentaire personnelle NoteTaker. Intervient alors un double travail de définition éditoriale et de conception technique, puisqu’il demande déjà d’établir un modèle de données à même de rendre compte de la diversité des éléments de contenu – texte, éléments de vocabulaires, documents, critiques établies sur les premiers manuscrits de l’enquête – mais aussi d’envisager le caractère bilingue de l’ensemble du projet.
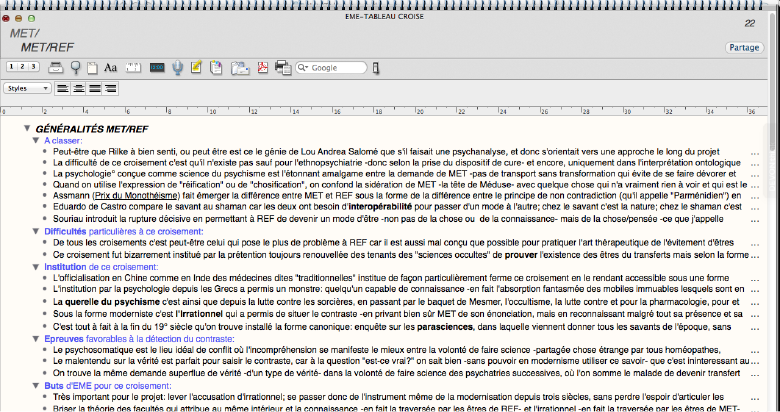
Le travail engagé est alors un travail de complétion et de reconstruction à partir des notes de terrain de Bruno Latour. L’équipe constituée autour de Christophe Leclercq, assisté à partir de 2012 par Anne-Lyse Renon, effectue un travail de documentation et de mise en récit visant à structurer, enrichir et vérifier l’appareil documentaire de la future base de données. Le travail à effectuer est à la fois un travail de formatage39 mais également un premier travail de réécriture collective dans la mesure où l’ensemble de la documentation est recomposée et augmentée à six mains à l’intérieur du tableau partagé via le service Google Spreadsheet (Renon, 2016, p. 298). Parallèlement à cette entreprise, la conception des deux « plateformes numériques » annoncées par la demande de financement peut s’engager.
… tout en imaginant une infrastructure à venir …
En janvier 2012, l’équipe est rejointe par Donato Ricci (designer) et Heiko Müller (développeur), qui se lancent dans la conception de l’ouvrage imprimé et de la plateforme numérique. La recherche qui est menée par l’équipe commence d’abord par l’exploration de différentes modalités de représentation du réseau constitué par le texte et ses multiples couches d’explicitation conceptuelle, de documentation empiriques, et de commentaires divers. Le défi qui se présente alors consiste à trouver une échelle intermédiaire de lecture dans l’hypertexte des contenus alors construits, permettant à la fois de lire qualitativement une portion de contenu de l’enquête et les divers éléments « voisins » auxquels cette dernière est liée.
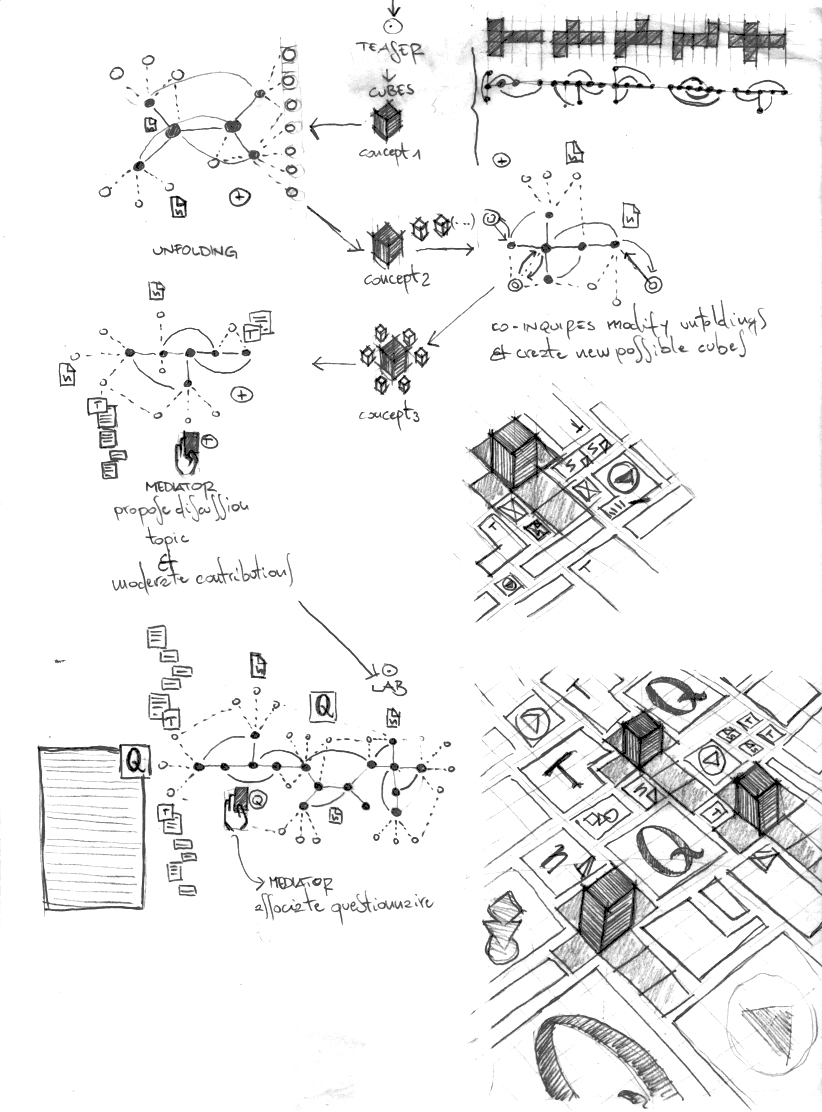
Les esquisses alors réalisées ne permettent pas toujours de distinguer ce qui relève de la représentation schématique de la structure technique des contenus, de principes de navigation, ou d’esquisses d’éléments d’interface à proprement parler. Elles donnent à voir des tentatives différentes visant à investir le réseau selon différentes méthodes ou métaphores de spatialisation et de visualisation de la topologie des contenus, qui se stabilisent progressivement dans des métaphores visuelles et kinétiques reposant sur des dynamiques de déploiement ou de dépliage progressif.
Le travail de design participatif et interactif de la plateforme est conduit conjointement avec la constitution des contenus et la mise en place de choix techniques pour le développement des éditions numériques. Cette conjonction d’activité se heurte à des différences de culture et de modes de travail, mais aussi à une difficulté partagée de compréhension du projet de Bruno Latour et d’intégration des enjeux qu’il implique. Ainsi, la conception du projet se confronte également à des problèmes de communication importants. Les activités de design sont alors mobilisées comme une manière de produire une représentation partagée du projet à travers des représentations et des propositions dessinées. Ainsi, Donato Ricci évoque la difficulté à partager une vue d’ensemble de l’infrastructure à concevoir :
Tout le monde venait dʼhorizons différents, donc le tout début était dʼétablir clairement quel sens donner à tous les mots que nous utilisons dans le projet. Et cela a pris un certain temps, dans le sens où cela a été un processus vraiment douloureux, parce quʼil est évident que construire un fond commun est presque la tâche la plus difficile dans un projet. Mais nous y sommes parvenus, et cʼest à ce moment-là que nous avons commencé à planifier, ou à… de nouveau à prévoir lʼensemble de la machine, ou tout lʼécosystème des technologies aurait pu être mis en place. […] Et même dans ce cas, le processus ne sʼest pas déroulé sans heurts, en ce sens que pour prévoir quelque chose qui nʼa jamais été vu auparavant, il suffisait que les gens imaginent quelque chose, et chacun imagine quelque chose de différent, on ne peut homogénéiser lʼimagination ou la volonté dʼatteindre un but donné dʼune certaine manière par tous les participants du groupe.40
Le design est ainsi mobilisé pour faire une proposition apte à articuler les composantes éditoriales, techniques et scientifiques de l’équipe. En Mars 2012, le livre et les deux plateformes annoncées par le projet se sont transformées en cinq « instances » dédiées à des finalités différentes : la première, l’ouvrage imprimé, doit maintenant faire office de « rapport préliminaire » au moyen d’un texte annoté de symboles typographiques « special words », et d’un tableau croisé représentant les rencontres de modes ; à celle-ci s’ajoute une interface intitulée « trail » (qui deviendra par la suite l’interface « enquête », « livre » ou « colonnes ») qui représente la connexion entre le texte initial et la documentation de Bruno Latour ; cette dernière doit être accompagnée d’un ensemble de visualisations interactives intitulées « concept clouds », permettant de naviguer spécifiquement à travers le vocabulaire de l’ensemble, et d’une entrée « laboratoire » représentant l’ensemble des contenus sous la forme d’un réseau ; ces deux premières entrées numériques, qui ne traitent pas la question de la participation à l’enquête en propre, sont pensées en corrélation avec une entrée intitulée « cube » qui permettrait aux lecteurs d’assembler les concepts sous la forme d’assemblages entre portions de textes et documents. On retrouve dans cette proposition certains des éléments de l’infrastructure telle qu’elle s’est ensuite développée, mais également une dimension distribuée plus importante que ce que le calendrier de l’ensemble de l’entreprise a finalement permis.
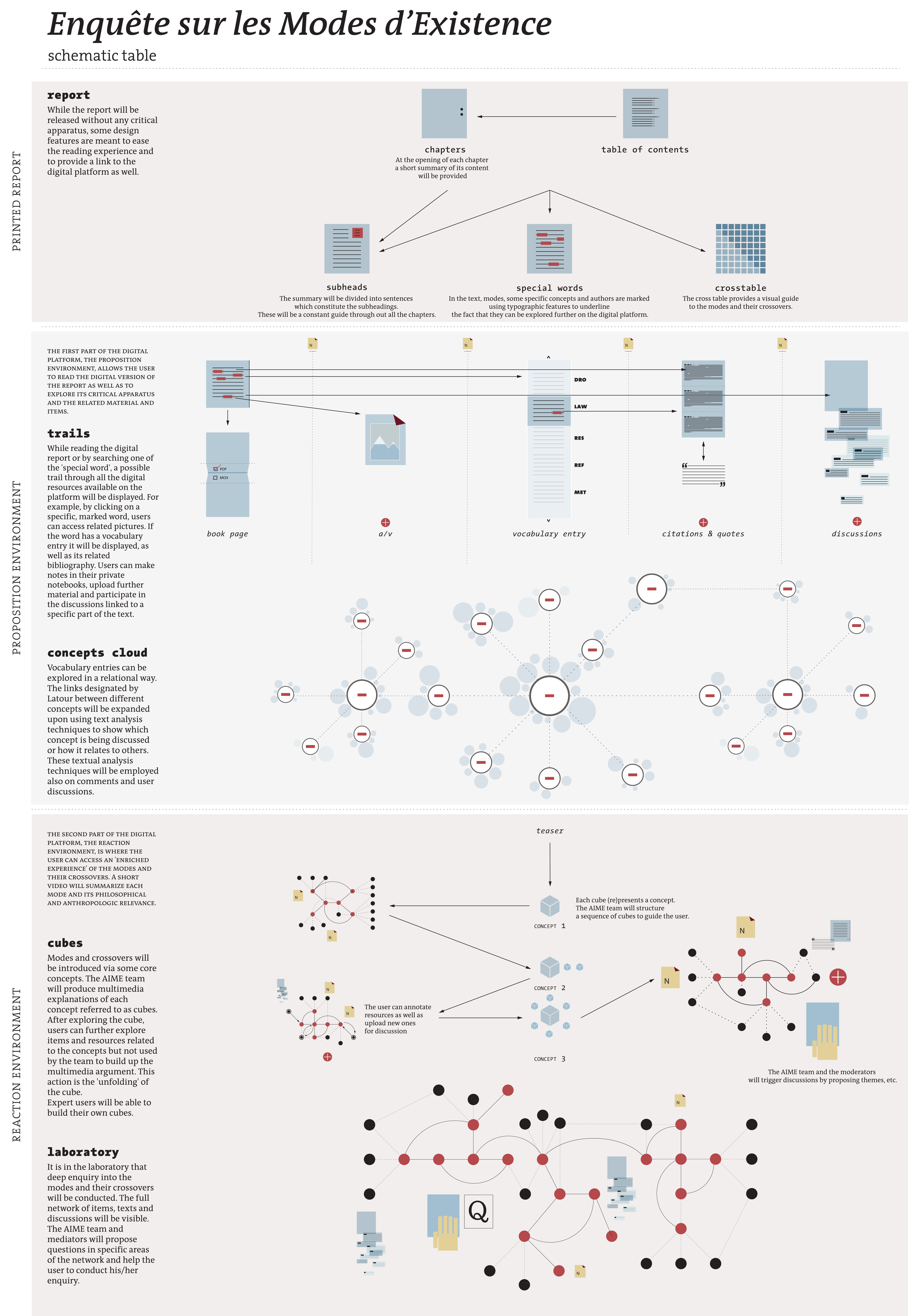
Les croquis et maquettes du projet montrent également comment est perçu le futur « co-enquêteur », encore imaginé et fantasmé à ce stade. Celui-ci est envisagé selon une typologie séparant le public en trois catégories distinctes : « chercheur », « étudiant » et « praticien ». L’approche universitaire est privilégiée dans la mesure où l’interface prévoit une fiche de renseignements très précise pour ces derniers à même de permettre un suivi « disciplinaire » des intérêts universitaires dans le projet par la suite, alors que ces informations ne sont pas demandées pour les autres « catégories » de co-enquêteurs amenés à être intégrés au collectif du projet.
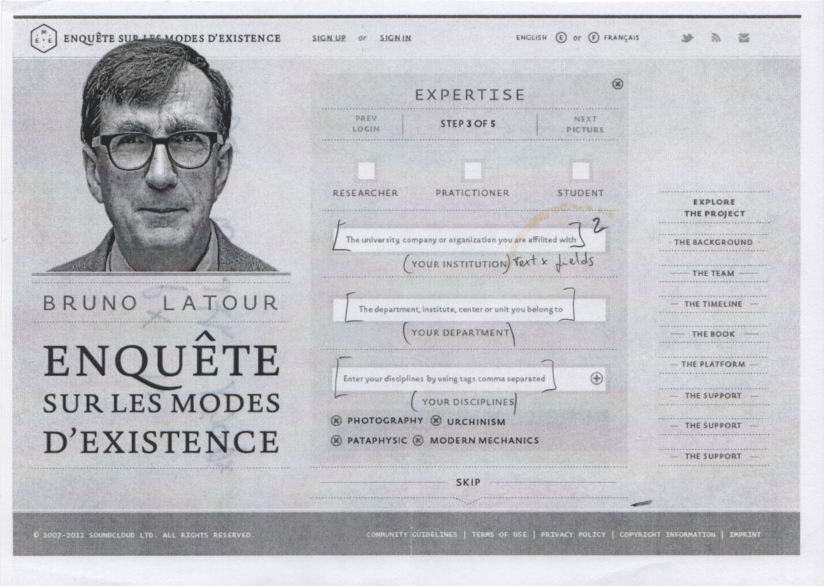
La modélisation des interfaces s’accompagne en parallèle d’une modélisation technique qui prend forme peu à peu. Cette question est cruciale car elle pèsera énormément sur l’ensemble des points de contact de l’infrastructure. Les choix méthodologiques et de design induisent progressivement des spécifications techniques sur les programmes à développer. Ainsi, face au modèle de données très densément hypertextuel des contenus apportés par l’investigateur principal, l’équipe se retrouve face à un choix déterminant concernant le type de base de données à implémenter. Elle a le choix entre des technologies de base de données « relationnelle », consistant à représenter les données sous la forme d’une série de tables pouvant être connectées entre elles par des pivots, et une base de données en « graphes » qui stocke paragraphes, chapitres et autres entrées de vocabulaires sous la forme d’une série de noeuds et de liens. La première est robuste et facilement manipulable, mais elle s’applique mieux à des cas d’usages dans lesquels les données sont tout convoquées sous la forme de « listes » d’objets et leurs relations exploitées de façon moins importante. L’autre, la base de données en graphes, est beaucoup plus expérimentale et difficile à manipuler, mais plutôt adaptée au parcours hypertextuel de réseaux d’informations complexes. L’équipe fait le choix de la première option, et met alors en place un schéma de données fixant et matérialisant une certaine forme de représentation des données, adaptée à ce choix technique. Les éléments de design des interfaces doivent alors être ajustés en fonction de ces contraintes et limitations techniques, et des ressources de développements à disposition, participant de stabilisations et de déstabilisations constantes entre le travail de modélisation technique, la conduite méthodologique de l’enquête et les choix effectués en termes de mise en forme et en pratique.
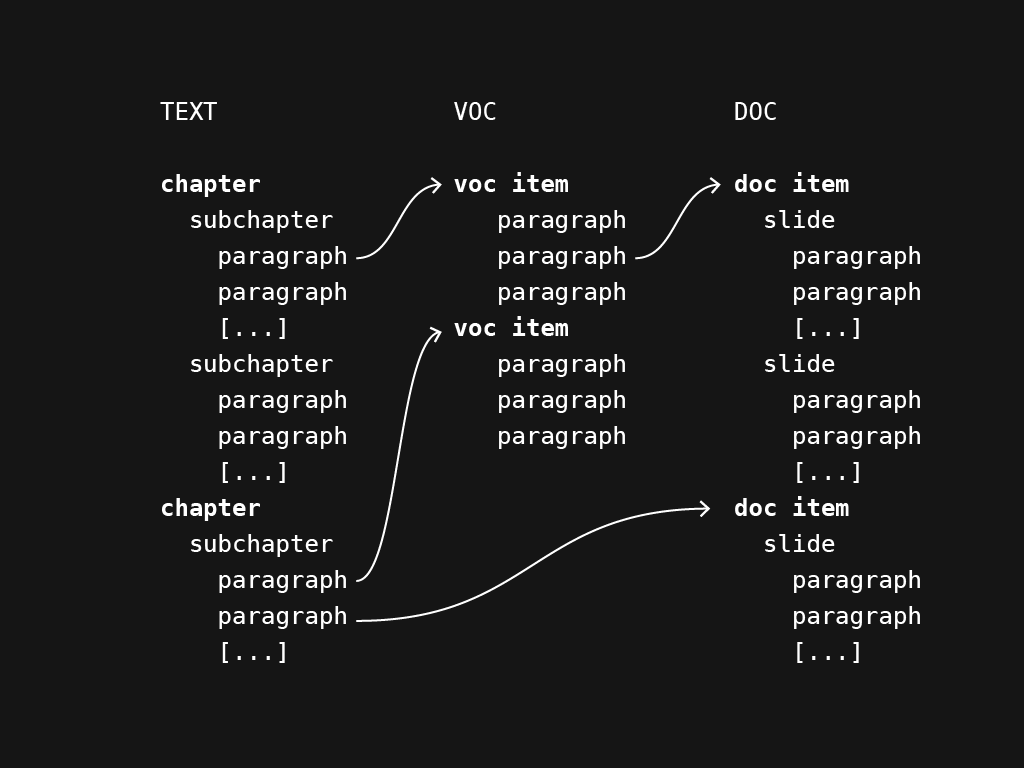
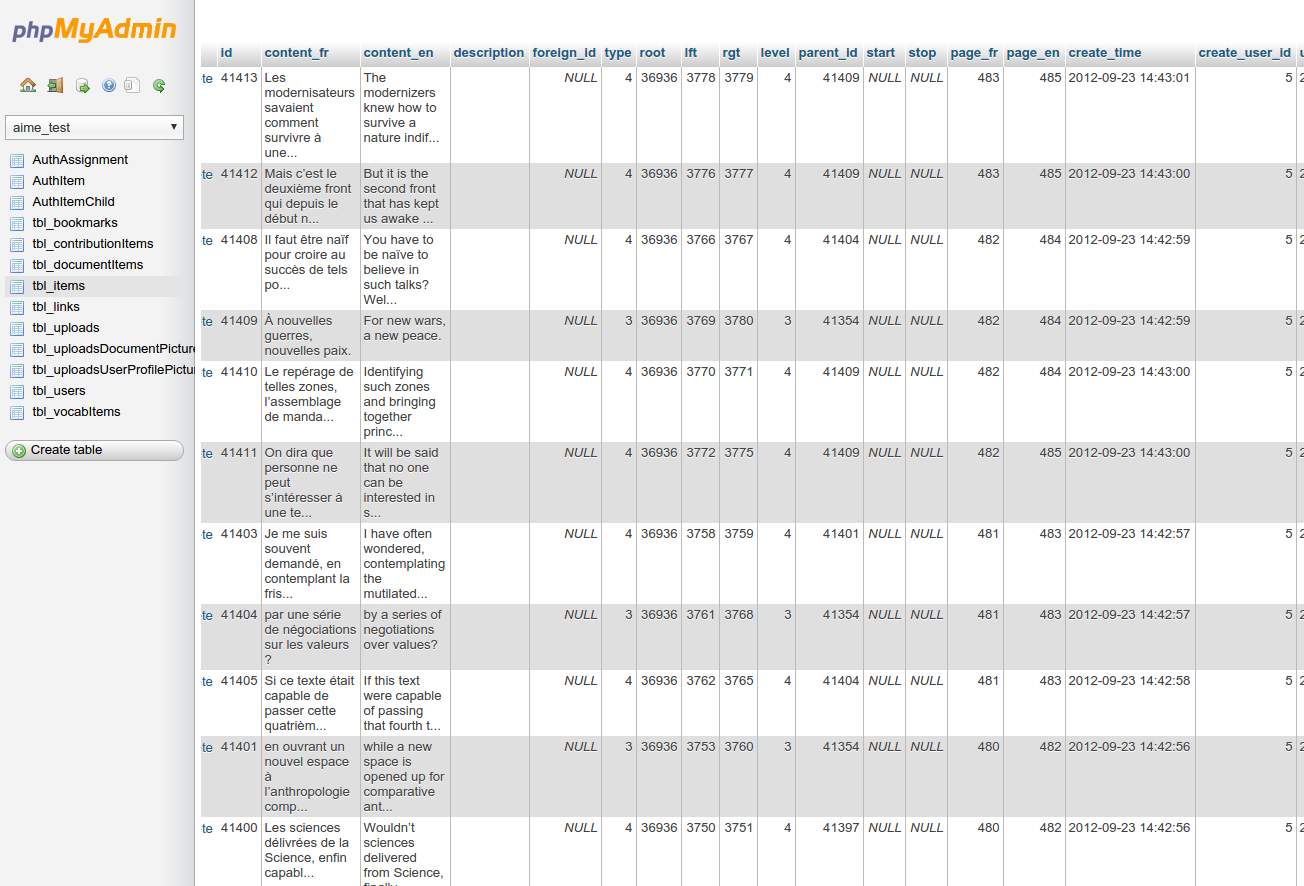
Alors que les fondements techniques et les contenus de la base de données de l’EME se stabilisent, au printemps 2012, à quelques mois de la sortie du livre, commence le développement d’une première interface centrée sur le livre, organisée selon une logique de colonnes présentant le texte et sa documentation. L’enjeu principal de la conception est alors de permettre un jeu de navigation dans la documentation de Bruno Latour, visant à éviter de perdre les lecteurs dans la masse des contenus. Le choix est fait de mettre en scène au moyen d’animations une métaphore visuelle représentant les contenus comme une grille pliée et dépliée selon la navigation du lecteur. Cette métaphore implique des transitions très complexes. En Avril et Mai 2012, une première esquisse de l’édition numérique « livre » de la plateforme ainsi qu’une proposition globale pour l’écosystème des instances est effectuée par Donato Ricci. Elle est présentée à un petit collectif de « testeurs »41 qui en font l’expérience sous la forme d’une maquette en papier. Le projet commence alors à être présenté à différentes occasions publiques. Alors qu’elle est encore en train d’être définie, l’infrastructure rencontre petit à petit un public de curieux qui s’intéressent tant à son projet philosophique et anthropologique qu’aux mécanismes numériques qu’elle déploie pour mettre en œuvre ce dernier.
Sur le plan du développement informatique, les mécanismes de l’interface numérique concernant l’entrée « livre » amènent l’équipe à expérimenter en cours de route de nouveaux procédés, tout en étant contrainte de publier régulièrement des mises à jours. Le choix d’une interface de lecture originale – et non tirée de technologies stabilisées telles que moteurs de blogs et autres modèles de livres numériques – conduit les développeurs à multiplier les essais et les bricolages pour arriver au résultat projeté par les activités de design, mais met en péril le respect des délais nécessaires pour établir une complémentarité entre les instances imprimées et numériques. Daniele Guido, designer et développeur sur le projet, témoigne en ce sens :
Nous avons tout expérimenté, du modèle à la façon de faire défiler… Au début nous utilisions beaucoup de plugins et à la fin nous nous sommes débarrassés de tout et nous avons reconstruit une structure plus solide. Il y a donc eu beaucoup dʼexpérimentation. Le code de l’interface doit être suffisamment flexible pour supporter cette charge. On attendait beaucoup des expérimentations qui ont échoué, et nous avons dû réfléchir à nouveau à la structure. Cela nous a obligés à suivre un processus étape par étape afin de publier, donc des règles strictes ont été mises en place afin de ne pas produire de bazar– parce qu’avec beaucoup de gens [du projet], cela pouvait devenir le bazar…42
Ainsi, le début du développement de la plateforme implique un appesantissement dans lequel les choix techniques et pratiques effectués se transforment en investissements temporels importants, faisant peser sur les développeurs le poids d’un dilemme sans cesse renouvelé entre prise de retard et « endettement technique » (développer vite au détriment de la qualité du code, au risque de rendre les prochaines modifications plus difficiles). Ce dilemme est progressivement compensé par l’adoption de méthodologies plus strictes issues de l’industrie informatique, imposant la publication et la revue régulière du code de l’équipe43 . Alors que le design et le développement de la plateforme bat encore son plein, l’ouvrage Enquête sur les modes d’existence est publié aux éditions de la Découverte le 20 Septembre 2012. Le projet est désormais développé sous le regard d’une communauté en attente et la pression sur l’équipe n’en est alors que plus grande.
La rencontre (20 Septembre 2012 – Octobre 2013)
La plateforme numérique n’est pas prête …
Le 30 novembre 2012, deux mois après la sortie de l’édition imprimée de l’enquête, une version « bêta » de l’instance « livre augmenté » est mise en ligne. Elle comporte deux colonnes qui présentent respectivement le texte du rapport préliminaire et l’ensemble des éléments de vocabulaire. Elle est cependant alors extrêmement lente et présente des problèmes de fonctionnement très fréquents, dont se font l’écho les premières recensions du livre (D. Berry, 2014). Au fur et à mesure de l’avancement du projet, et alors que la date de sortie de la plateforme annoncée dans le projet ERC approche rapidement, l’équipe qui était originellement composée d’un seul développeur, agrège alors progressivement un nombre conséquent de nouveaux ingénieurs et designers déjà présents au sein du médialab – Daniele Guido, Alexis Jacomy – ou engagés pour l’occasion – Dario Rodighiero, afin de ne pas prendre trop de retard sur le calendrier. L’équipe technique du médialab doit alors apprendre à se reconfigurer au contact de dates limites très exigeantes, d’une équipe plus importante et d’une attente de résultats très forte. L’intégration de « designers-développeurs » hybrides dans le groupe permet d’améliorer les interactions entre la conception visuelle du site et sa structure sous-jacente. Le rôle des premiers « co-enquêteurs » du projet consiste alors notamment à rapporter les problèmes et les retours techniques et visuels permettant de corriger l’édition en cours de route.
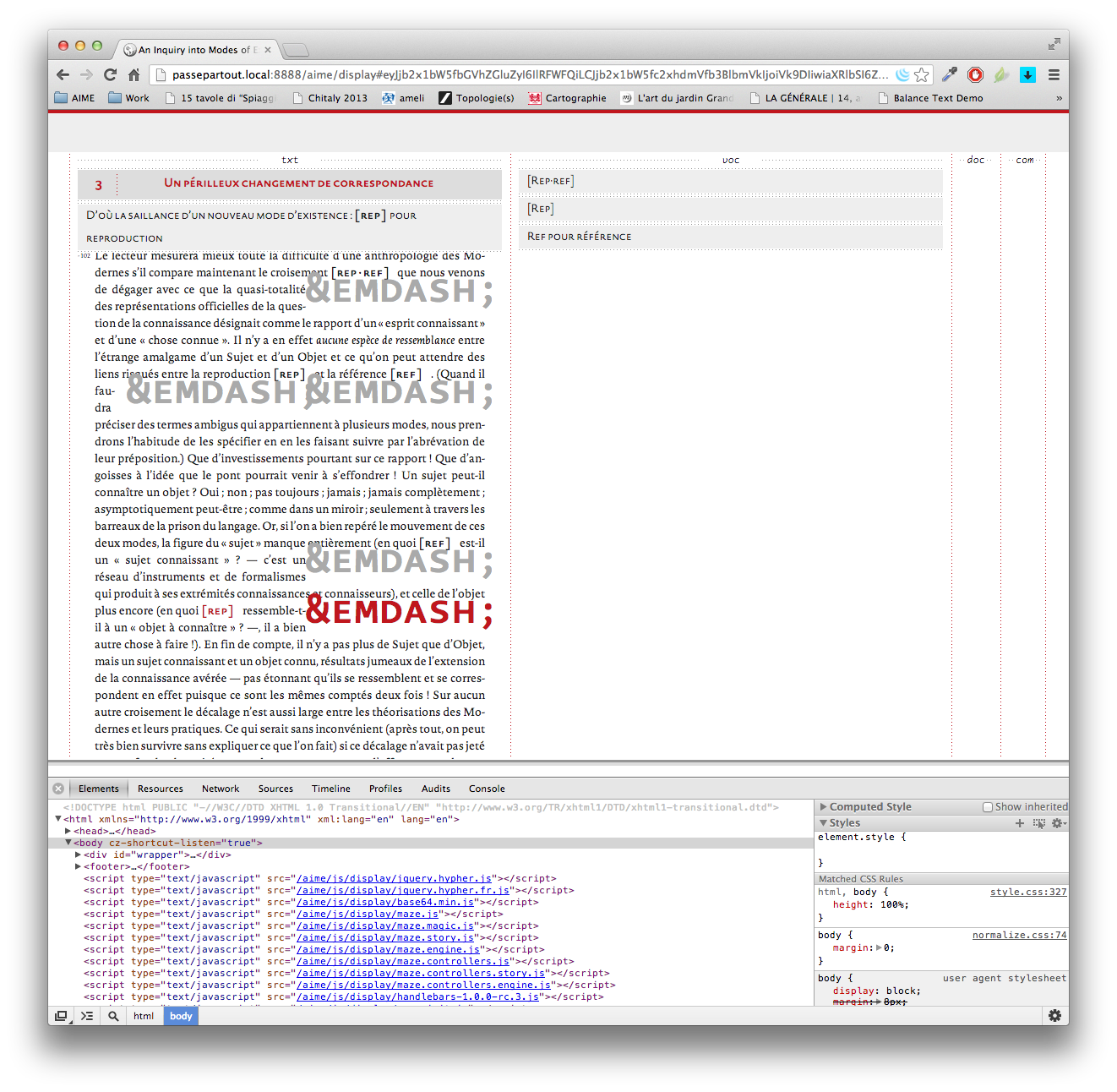
Le caractère expérimental du projet transparaît bien dans la structure technique de ses modules. Un schéma réalisé ultérieurement par l’ingénieur Pierre Jullian de la Fuente (engagé plus tard dans le cadre de la stabilisation de la plateforme) rend compte de cette complexité, représentant sous la forme d’un archipel les différentes parcelles de l’infrastructure technique. Dans chacune des « îles » de la structure on peut reconnaître des Urls (adresses faisant office de point d’entrée pour l’un des services utilisés par le projets), des noms de formats et de technologies utilisées (« json », « xml ») et des noms de personnes. Ce schéma correspond à la fois aux différentes parties de l’infrastructure destinées à la faire fonctionner, et à l’histoire du projet et de son développement contraint dans le temps et réalisé par une équipe croissante de développeurs. Il permet de lire l’entrelacement entre technologies et personnes, et donne une visibilité à la masse de code, de ressources et de temps que représente l’infrastructure technique à manœuvrer de concert avec l’enquête et les activités du collectif, évoluant maintenant « au grand jour ».
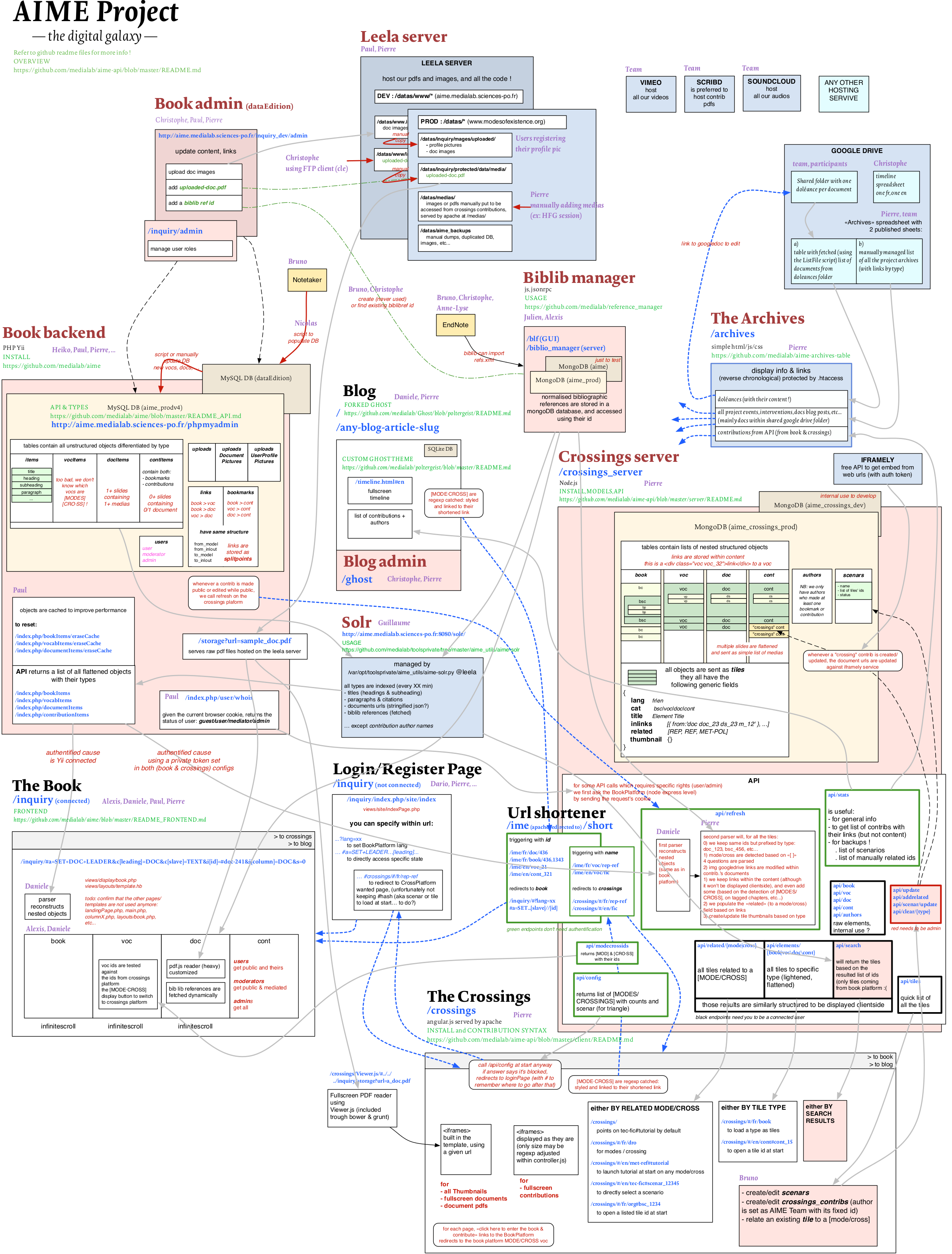
L’étude du code source de la plateforme durant cette période nous révèle par ailleurs la longue succession d’essais, de corrections et de restructurations qui ponctue l’histoire technique du projet. À titre d’exemple, sur un ensemble de 3100 versions successives enregistrées sur le répertoire du code source de la plateforme de l’époque44 , on note à l’étude des libellés 140 mentions du mot « bug », 330 du mot « fix » (réparer), 63 du mot « problem », 119 du terme « remove ». L’historique des versions et la quantité de lignes de code ajoutées et supprimées au fil des versions, présentées dans la figure suivante, témoignent également du caractère mouvementé du développement et de son histoire expérimentale.
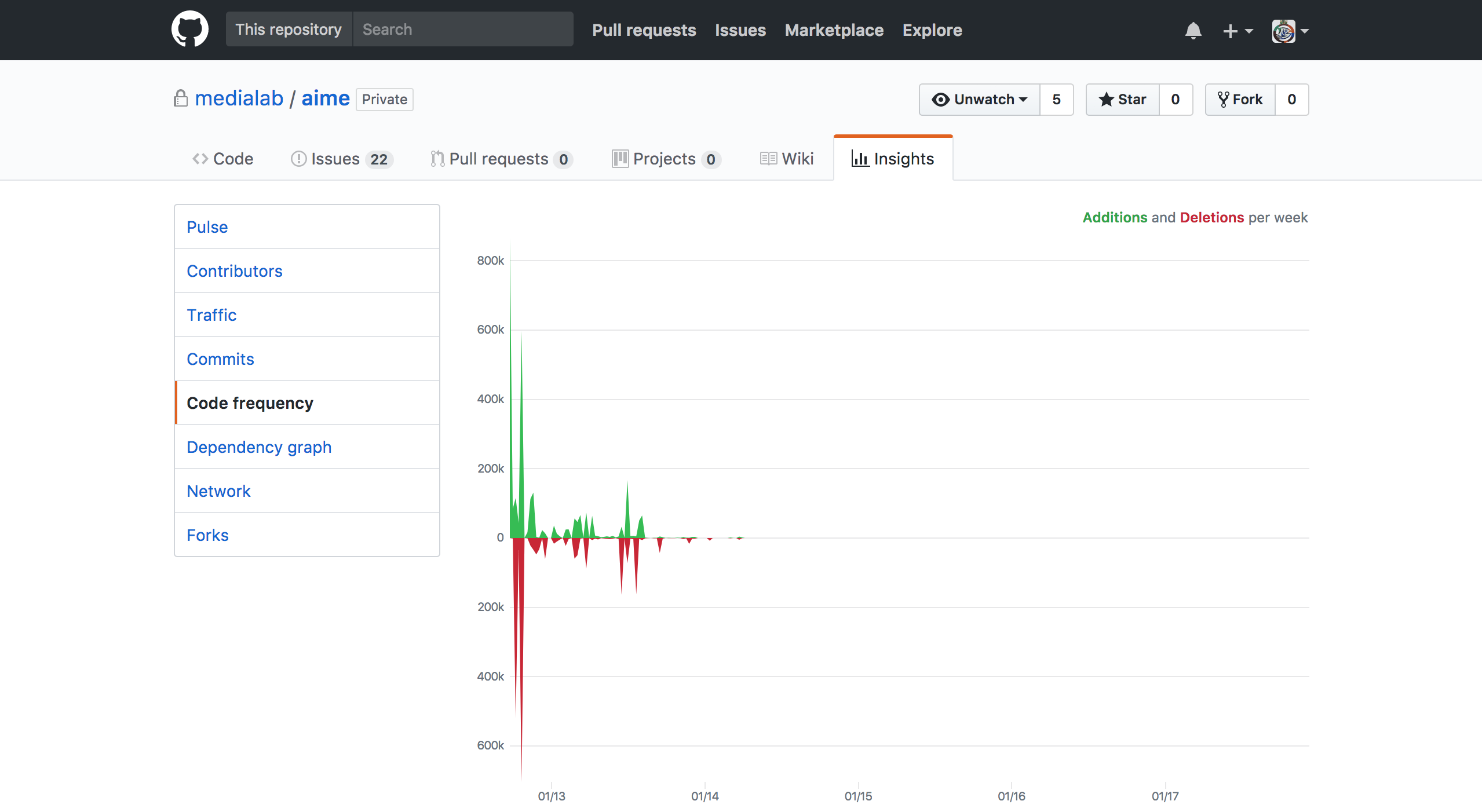
De manière concomitante à la sortie de la « première plateforme », l’équipe commence à organiser une série de « journées d’enquête » qui sont des séminaires ouverts consistant à présenter l’avancement du projet et à travailler les thématiques du livre. En parallèle, à partir d’août 2012, lʼéquipe collabore avec plusieurs artistes – dont le photographe Armin Linke – afin de commissionner différentes productions multimodales originales (notamment à des artistes, designers ou architectes, et étudiants en arts politiques) faisant écho à certains points du rapport préliminaire. Une série de vidéos et d’images exclusivement produites pour le projet sont progressivement intégrées à la base de données de la plateforme. Par ce biais, l’infrastructure prend forme grâce à ces premières interactions entre le versant collectif et évènementiel de l’infrastructure et sa plateforme numérique, encore en gestation. La publication de l’édition imprimée jette sur cette dernière une lumière qui attire un public de plus en plus hétérogène.
… mais le public est déjà là…
La parution et la promotion de l’édition imprimée donne l’occasion d’une série d’articles de presses et de recensions universitaires qui portent l’EME rapidement à la connaissance d’un public d’abord francophone élargi. Elle s’accompagne de l’attribution, en 2013, du prix Holberg de sciences sociales à Bruno Latour, qui lui donne alors une visibilité supplémentaire. La publication est alors l’objet de nombreuses recensions à la tonalité contrastée, entre éloges dithyrambiques et critiques acerbes, certaines soulignant le caractère novateur de la proposition sur le plan philosophique (Maniglier, 2012b) et sociologique (Boltanski, 2012) alors que d’autres s’agacent du caractère spectaculaire et intimidant du projet et de ses promesses, auxquels il est reproché en creux d’empêcher une véritable discussion du texte (Rumpala, 2013)45 .
Au moment de la publication de la plateforme, cette dernière ne propose qu’un mode d’entrée dans le réseau des contenus, et pas les autres modes d’entrées davantage « participatifs » et détachés de l’édition imprimée, envisagés au début du projet. Du fait du temps demandé par les développements techniques, l’entrée « livre » prend ainsi une place centrale inattendue dans le versant numérique de l’infrastructure de l’EME. Les présentations publiques du projet et les ateliers doivent ainsi opérer une forme de médiation et d’explication visant à préserver l’intérêt des « co-enquêteurs » à venir malgré l’inachèvement de l’infrastructure et l’impossibilité pour eux de participer à l’enquête comme on le leur avait annoncé. Le chef de projet Christophe Leclercq expose ainsi la situation de l’équipe de développement :
Donc on est un peu dans cette situation inconfortable où on mène une expérimentation, mais une expérimentation à une certaine échelle – le public sʼest retrouvé dans la position de bêta testeur – cʼest quelque chose quʼon a dû gérer.
Afin de mitiger les décalages impliqués par la difficulté de l’entreprise, les propositions de design sont réajustées en cours de route pour couvrir une superficie moins grande et ne comprendre que deux des quatres plateformes envisagées à des stades antérieurs du projet, ainsi qu’en témoigne Dorothea Heinz :
Par exemple au début avec la mise en question de lʼinstitution scientifique, si on avait organisé le livre à partir des controverses réelles et puis on avait élaboré autour le dispositif conceptuel, lʼenvironnement avec les quatre colonnes aurait peut-être pu mieux faire avec la diplomatie, et il est un peu limité par rapport à cela. […] Finalement les quatre colonnes ont dû absorber des choses qui nʼont pas été prévues pour cet environnement-là.46
Parallèlement à ces rencontres qui constituent l’infrastructure « officielle », financée, contrôlée, du projet, une série de blogs de lecteurs créés à l’extérieur de l’écosystème humain de l’équipe se développent pour discuter et commenter le projet. Certains relèvent de groupes de lecture47 , d’autres d’une critique et d’une exégèse de la démarche et du positionnement philosophique du projet48 . Ils constituent un deuxième cercle autour de l’assemblage initialement construit par l’équipe qui dialogue de manière croissante avec l’infrastructure au fur et à mesure qu’elle s’ouvre à la participation.
… et la rencontre se formalise progressivement…
À partir de Mars 2013, le principe des rencontres avec le public se stabilise, et les rencontres physiques sont renommées « ateliers » pour insister sur la finalité contributive de ces événements – la rédaction de nouvelles contributions et leur versement dans la plateforme numérique. À partir de ce moment, les ateliers commencent à se dérouler à raison d’un tous les deux mois, puis à un rythme plus rapide. Il y en aura au total vingt-six. Pour chaque atelier, une procédure est mise en place. Un appel à contribution est publié sur le blog du site, et envoyé à la liste de quelques milliers de personnes ayant créé un compte sur le site de l’EME, afin de demander aux personnes intéressées d’envoyer un document à même de mettre à l’épreuve l’un des chapitres du texte initial ou de proposer directement des contributions sur la plateforme. Les documents sont déposés à l’avance sur l’entrée livre ou sur un dossier Google Drive, qui servira ensuite de support lors de la séance. S’en suit une présentation et une discussion lors de la rencontre en face à face. Une fois l’atelier terminé, les propositions sont parfois rédigées et archivées sous la forme de contributions en bonne et due forme (constituées de diapositives associant pour chacune un document et son commentaire) sur la plateforme numérique.
… pour l’accueil des contributeurs et autres « praticiens » des modes d’existence
L’équipe est rejointe en Septembre 2013 par le philosophe Pierre-Laurent Boulanger, qui a pour mission d’animer le collectif de co-enquêteurs et de coordonner la prise en charge des propositions de contribution sur la plateforme numérique. Il est notamment en charge de coordonner une équipe de « médiateurs », analogue à un comité de relecteurs, qui doivent faire la revue des contributions proposées et accompagner leurs auteurs dans leur révision. Ces derniers – Milad Doueihi, Vincent Lépinay, François Cooren, Noortje Marres, Didier Debaise, Nicolas Prignot, Aline Wiame – sont choisis dans le voisinage socio-intellectuel de Bruno Latour, mais également parce qu’ils sont susceptibles dʼapporter des critiques constructives au projet et ainsi en mesure d’apprécier l’originalité de propositions non parfaitement alignées avec le cadre théorique initial.
L’arrivée des contributions invite également l’équipe de conception à envisager plus précisément les modalités permettant de faire évoluer les éditions numériques dans le sens d’une démarche participative. À ce sujet, la captation par Christophe Leclercq d’une réunion de travail datant de Septembre 2013 impliquant designers, ingénieurs et médiateurs autour de Bruno Latour à propos des modalités de contribution en ligne éclaire bien les problématiques rencontrées à ce stade du projet. Dans cette dernière, l’équipe discute des contributions valides et non valides. Bruno Latour y rejette les expériences de « scholastique » ou de description formelle des modes. Les personnes présentes font alors une typologie des contributions envisagées : sont attendues celles proposant une « expérience » empirique à même de rendre compte d’un croisement49 , et une deuxième catégorie de contributions qui recouvre celles concernant le travail de « diplomatie », c’est-à-dire visant à critiquer les comptes-rendus proposés par l’enquête à propos des modes. On se demande comment « formater » le protocole de contribution afin de centrer la discussion sur le texte original et son amélioration, plutôt qu’une critique d’ordre général (« ce qui nous intéresse c’est l’ancre. Pas d’ancre pas de contribution. »). Les membres du groupe cherchent des exemples de contributions valides pour envisager les interactions entre ateliers et contributions. Ils abordent également la question de la réécriture, et notamment celle du texte original de Bruno Latour :
Paul Girard : ‹ est-ce que ça irait jusqu’à réécrire des parties du livre ? ›
Bruno Latour : ‹ Non on touche pas au texte [rires]. On vient pas me saloper mon texte [rires]. ›
Ils envisagent la relation au public à venir. Les outils pour l’imaginer sont minces, malgré la sortie des premières instances. Les contributeurs sont imaginés à partir des premières mesures de fréquentation de la plateforme, dont l’affluence alors à hauteur de 300 « visiteurs uniques » par jour permet d’estimer l’ordre de grandeur des contributions à venir. Leur profil et leur provenance est encore inconnue, et ils sont toujours décrits selon une typologie ambiguë qui recherche à la fois des « praticiens » des domaines associés aux modes d’existence mais également des personnes capables d’en rendre compte dans un cadre universitaire (« ce qui m’intéresse ce sont des praticiens du sujet, ou des académiques du sujet, gênés par le fait qu’il n’y a pas de pluralisme des modes. »). Ils sont imaginés selon leurs capacités en termes de philosophie et de sciences humaines mais également selon leurs compétences techniques ( « faut pas oublier qu’il y a un énorme effort pour les gens un peu académiques, ou un peu âgés, d’aller sur le web. »). Concernant le processus de modération, il est envisagé de modérer les contributions avant ou après leur publication voire d’éviter de les modérer totalement (Bruno Latour demande : « Est-ce que ça ferme trop d’avoir toujours un médiateur ? ou alors au contraire est-ce que ça donne bien l’esprit ? »)50 . Les participants de la réunion se demandent également s’il faut laisser la possibilité aux lecteurs d’engager une discussion entre eux, via le commentaire des contributions effectuées. Ils se demandent par ailleurs comment rétribuer – au moins symboliquement – leur investissement (« à la fin on fige et on met la liste des gens en contributeurs […] c’est vrai que les gens contribuent à titre gracieux »). Le public pointe alors à l’attention de l’équipe sans vraiment apparaître, et il n’a pas encore la parole.
Le 30 septembre 2013, une quatrième colonne autorisant des contributions est mise en ligne sur l’entrée de la plateforme intitulée « livre ». Elle est structurée par un format très net qui impose aux participants une série de contraintes : chaque contribution doit être attachée à une portion précise des contenus existants, qu’il s’agisse de portions du texte principal ou d’éléments de vocabulaire. Par ailleurs, la contribution elle-même doit être structurée sous la forme de « diapositives », qui associent chacune un document (vidéo, images, référence bibliographique ou fichier pdf, etc.) avec un commentaire à même de développer le sens de la contribution proposée. Cette contrainte est pensée pour obliger les contributeurs à ancrer leur contribution dans la même démarche empirique que celle de l’enquête initiale, et décourager l’expression de simples opinions, ou des considérations « exégétiques » visant à commenter le texte plutôt que participer à la négociation des modes d’existences. Par défaut, les « contributions » rédigées par les lecteurs ont un statut privé et peuvent rester au stade de notes personnelles, à moins que ces lecteurs en demandent la publication via l’interface. Une fois qu’une contribution soumise par le lecteur via le clic d’un bouton dédié, cette dernière est traitée selon un protocole hybride durant lequel un mail automatique est envoyé à l’équipe pour initier une correspondance privée dédiée à la révision ou l’acceptation de la contribution. La contribution est alors envoyée à l’un des « médiateurs » – choisi en fonction du contenu et de l’objet de la contribution – qui engage un dialogue éditorial avec le contributeur jusqu’à la fabrication d’une contribution conforme au « protocole » proposé pour faire fonctionner le mécanisme de collaboration de l’enquête. C’est en fin de compte l’administrateur de la plateforme qui valide, à travers une interface de back-office, les contributions à même de devenir publiques et visibles pour l’ensemble de la communauté de lecteurs.
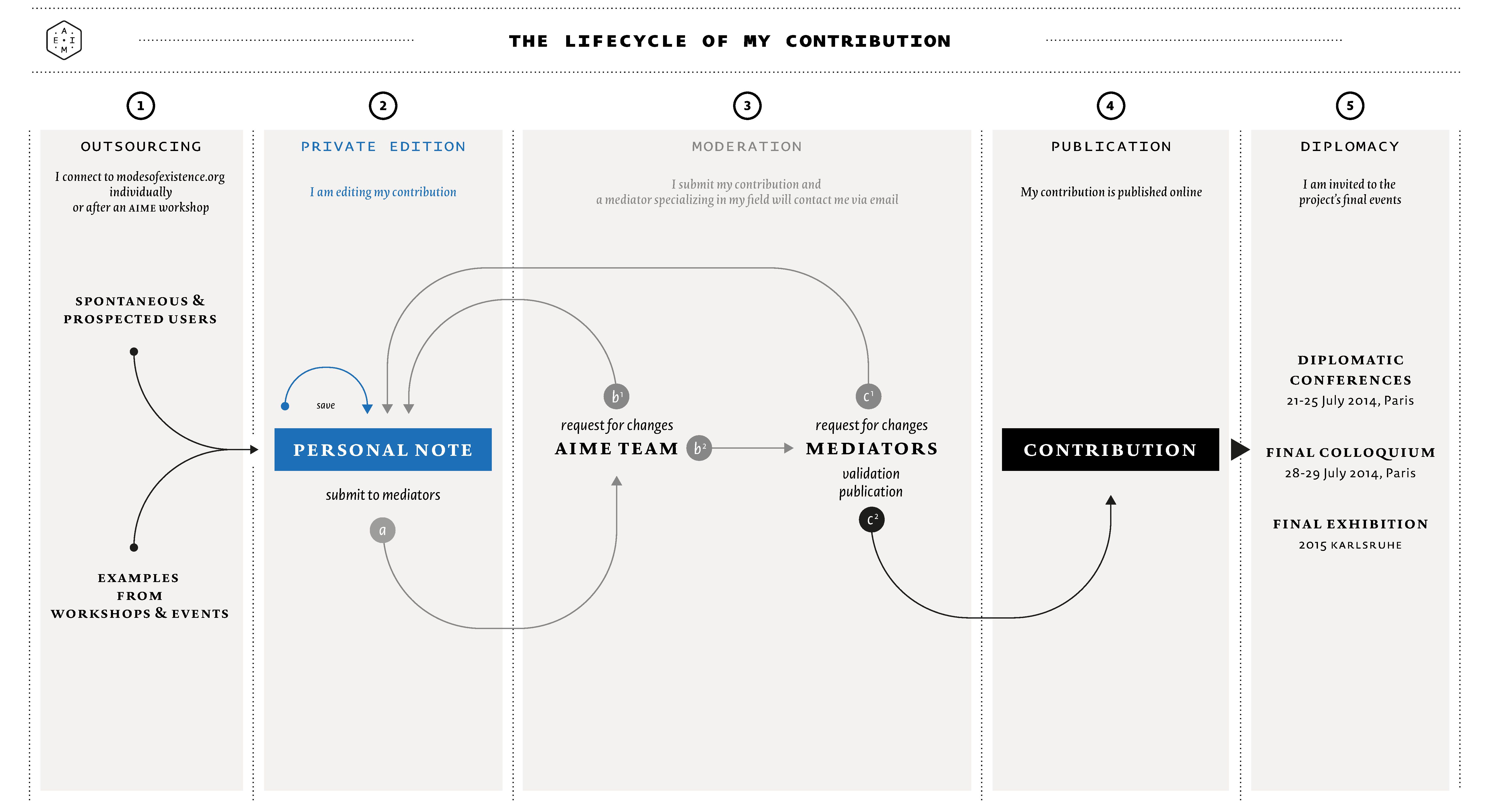
Le déroulement de la contribution et son articulation avec la plateforme numérique et les ateliers d’enquête sont l’objet d’une démarche de conception dans laquelle interviennent les activités de design – ici exclusivement conduites par Donato Ricci – au-delà de la conception exclusive des éléments matériels des éditions. Ces activités portent à la fois sur la médiation de la négociation interne du protocole, sur sa communication auprès du public mais également auprès des médiatrices et médiateurs censés en assurer la majeure partie. Dans les faits, cependant, ce processus ne se déroule pas comme prévu et une part de la modération est finalement assurée par Bruno Latour, qui prend en charge la « médiation » de parties importantes de l’enquête, et de l’équipe, qui se charge de convertir les « communications » présentées durant les rencontres en contributions renseignées dans la plateforme.
La négociation (Octobre 2013 – Juillet 2014)
Les ateliers se multiplient et les contributions arrivent modérément …
En réaction aux difficultés rencontrées face aux contributions proposées exclusivement en ligne – et non associées à des rencontres physiques à l’occasion des ateliers diplomatiques du projet – le format des contributions sur l’interface numérique évolue en cours de route en fonction des propositions reçues, pour réagir aux pratiques des contributeurs. Par exemple, l’équipe introduit une limitation à 500 caractères pour les diapositives des contributions, en cours de route. Pierre-Laurent Boulanger raconte les évolutions et les inquiétudes de l’équipe quant à la lisibilité et la stabilité du dispositif, à cette occasion, qui ne cesse d’être questionné dans son ajustement avec les activités des contributeurs :
Et donc le format a évolué et toute la difficulté étant dans un projet expérimental comme celui-là de savoir faire bouger les choses sans non plus avoir lʼimpression dʼun manque de rigueur, dʼun manque de stabilité ou de fermeté sur des principes dʼinvestigation scientifique.
À partir de Janvier 2014, les ateliers continuent et s’accélèrent, passant à un par mois, puis à deux (sur les mois de février, mars, avril, mai, juin). En raison de l’urgence de la procédure mais également d’un désir de renouer avec le projet de convier des « praticiens » des modes d’existence aux négociations, le modèle des premiers ateliers, fondés sur des appels à contribution, est supplémenté par des présentations directement commissionnées par Bruno Latour, des membres de l’équipe ou des médiateurs, parfois en suite de contributions remarquées sur la plateforme numérique51 . Le processus de documentation de la plateforme se stabilise autour de l’utilisation de documents collaboratifs tels que Google Documents lors des présentations, et du blog lors des restitutions : la plateforme de « l’entrée livre » est ainsi articulée avec un assemblage étendu d’outils et de formes d’écriture, et prend de fait une place moins centrale dans la conduite de l’enquête collective. À travers ces différentes instances, divers modes de restitution sont expérimentés, utilisant des enregistrements vidéos, des compte-rendus écrits ou des agrégations de tweets52 publiés sur le blog du projet.
… alors que l’infrastructure se stabilise…
À partir de la rentrée 2013, l’équipe, rejointe par l’ingénieur Pierre Jullian de la Fuente, commence le développement d’une nouvelle interface numérique dans les contenus, intitulée « croisements », qui correspond à ce qui avait été initialement labellisé comme le « laboratoire » de l’EME. Cette dernière, aux dires de l’équipe, correspond à ce qui aurait dû être la pierre angulaire de l’infrastructure numérique de l’enquête collective dès son commencement, permettant notamment aux lecteurs de réassembler les différents documents proposés par Bruno Latour afin de produire différentes formes de comptes-rendus des modes d’existence.
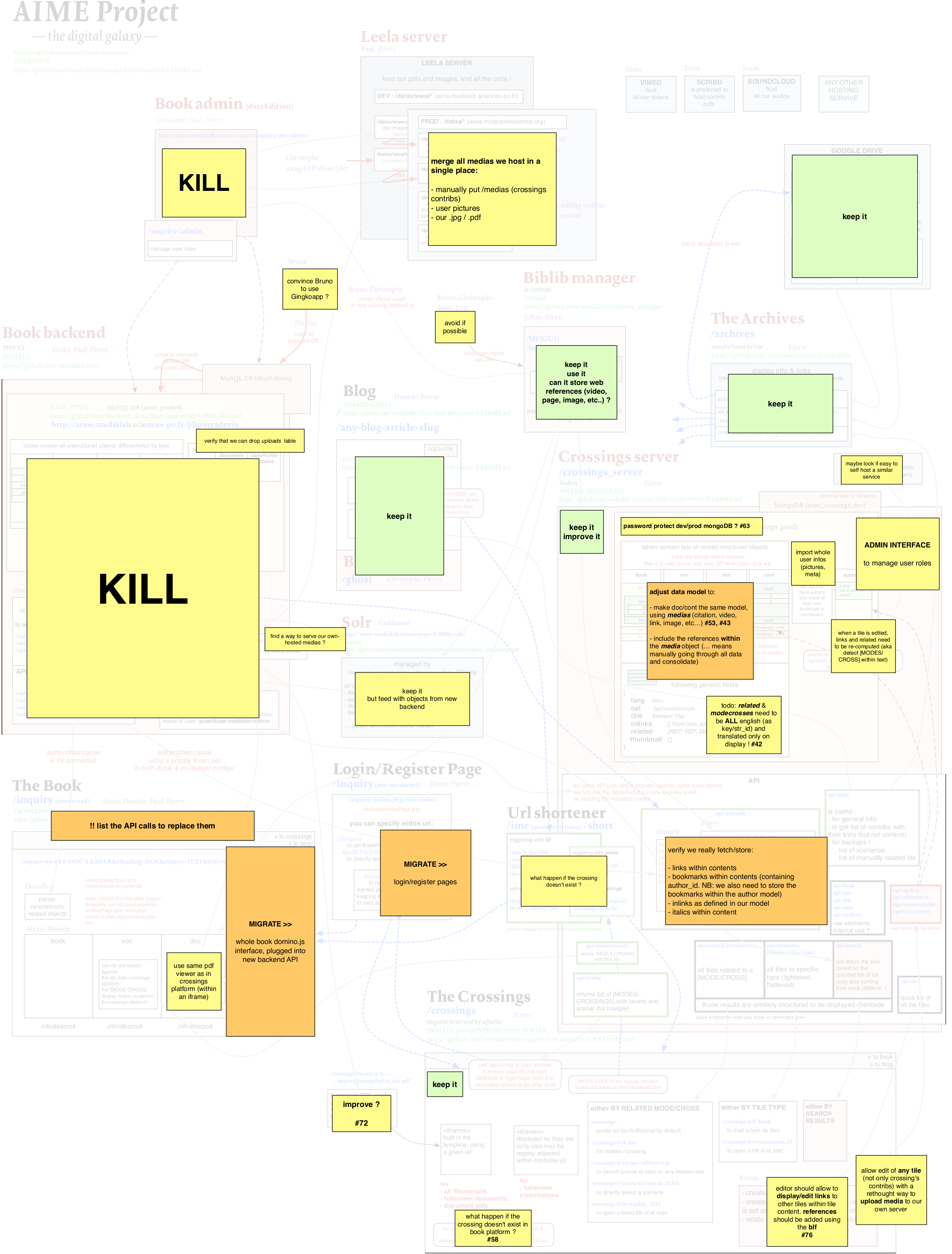
Pour le développement de la seconde partie de la plateforme numérique, l’équipe adopte une organisation différente de la première phase dans laquelle des itérations quotidiennes sont organisées entre designers et ingénieurs. En parallèle du développement de cette seconde entrée, le projet est alors « refactorisé » en cours de route, c’est-à-dire que certaines parties de son code informatique sont re-développées afin d’atteindre une meilleure stabilité et de meilleures performances techniques. Ces « refactorisations » sont périlleuses dans la mesure où elles ne doivent pas mettre en danger les données déjà produites par le public ou en cours de rédaction ou modération, et éviter de mettre en panne l’ensemble du site.
… et que la réécriture prend la forme d’un « cahier des charges » …
Alors que le projet approche de la fin de sa troisième année d’existence, la question de la réécriture et de l’aboutissement du processus collectif occupe toutes les discussions au sein de l’équipe. Faut-il envisager de réécrire le rapport préliminaire en fonction des contributions, comme cela a été plusieurs fois avancé au cours du projet ? L’archive des échanges et des contributions enregistrées sur la plateforme et le blog ne suffisent-elles pas à rendre compte de cette contribution collective ? Ou faut-il produire un document complètement différent ?
À l’approche de l’été 2014, l’équipe éditoriale et l’équipe des médiateurs se lance dans un travail de synthèse de l’ensemble des ateliers et des contributions proposées sur la plateforme numérique. Elles en tirent une série de « doléances » organisées sur un modèle standardisé qui vise à décrire précisément les points du rapport préliminaire nécessitant un « amendement », les documents empiriques permettant de faire l’épreuve de cette nécessité, ainsi que des propositions relatives à une meilleure version. La revue des 84 propositions ainsi rédigées permet aussi de voir l’étendue de l’infrastructure mobilisée alors, puisqu’on y trouve, dans la section « document » de chaque doléance, à la fois des extraits d’interviews, des références à des ateliers philosophiques, des portions de la plateforme numérique ou des documents restés sur le versant « Google Drive » de l’enquête. Ce moment est également l’occasion d’observer un glissement depuis un vocabulaire essentiellement inspiré des sciences expérimentales vers un vocabulaire juridico-politique qui marquera toute la fin du processus de négociation.
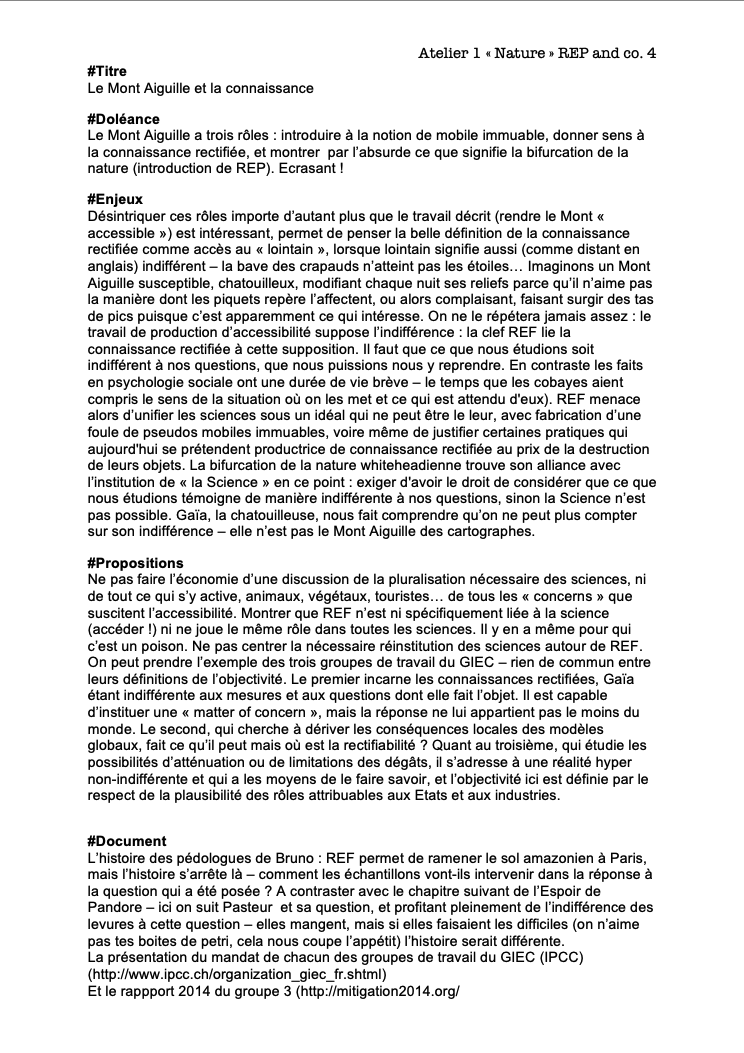
Le 21 Juillet 2014 se tient la semaine « d’écriture diplomatique » visant à réécrire un cahier des charges pour les parties les plus problématiques du rapport préliminaire53 , et labellisé « Specbook », visant à mieux présenter les Modernes face des « chargés d’affaires » lors d’une « conférence d’évaluation finale » du projet organisée les 28 et 29 juillet. L’équipe constitue un collectif de vingt-quatre chercheurs, sélectionnés par l’équipe à partir de membres du réseau de collaborateurs de Bruno Latour, mais également des personnes rencontrées à l’occasion des ateliers philosophiques ainsi que quelques-uns des contributeurs ayant participé au projet uniquement sur son volet numérique. Un ensemble de 6 ateliers est créé autour d’autant de « faux problèmes » à travailler via l’enquête – « nature », « politique », « religion », « économie au sens ATT », « économie organisation », « méta ». Chaque atelier se voit ainsi attribuer, comme point de départ, une sélection issue des doléances et des contributions publiées sur la plateforme. Dans l’urgence et selon le déroulement décrit précédemment dans ce texte, la semaine de réécriture aboutit au « Specbook » qui se compose de deux parties distinctes : une première signée collectivement, et une seconde intitulée « nos désaccords sur tout ce qui précède » dans laquelle chaque personne explicite ses oppositions et ses objections au texte ainsi fabriqué. La « conférence dʼévaluation » de deux jours, qui vise à simuler le moment de « retour » des diplomates vers les personnes qu’ils sont censés représenter conclut ainsi provisoirement cette séquence. L’évènement réunit dans cette perspective un collectif de huit « chargés dʼaffaires »54 de pays et d’intérêts différents, qui se voient solennellement remettre le « Specbook », et sont invités à y réagir et éventuellement à le ratifier.
Durant les mois qui suivent les « négociations finales », différentes parties des textes produits dans le cadre de l’enquête sont remaniés pour être publiés dans les circuits institutionnels de la communication scientifique. Une partie du « Specbook » est publiée par Stephen Muecke dans la revue Environmental Humanities (Muecke, 2017). Le 18 septembre, Vincent Lépinay présente la partie du « Specbook » intitulée « Notre économie » lors d’une rencontre à l’Université de Goldsmith (Boulanger et al., 2015). Par ailleurs, de multiples publications issues des contributions et des interventions durant les « rencontres face-à-face » se retrouvent également progressivement essaimées sous la forme d’articles de revues universitaires, de chapitres d’ouvrages voire même d’ouvrages entiers conduits en fonction du programme proposé par l’EME sans pour autant y être directement affiliés (Thoreau & D’Hoop, 2018).
En août 2014, le projet reçoit une extension de dix mois pour l’année 2014-2015. Cette dernière est consacrée à la valorisation du travail effectué (notamment la publication de contributions issues du travail de la semaine de réécriture), la reprise technique du site en vue de sa pérennisation, et la conduite du projet « Open AIME » dont je traiterai plus loin dans ce texte. L’interface d’écriture de l’EME est notamment reprise afin de permettre à son auteur principal de continuer à l’augmenter, et de gérer seul les contributions à venir, sans l’assistance des huit médiateurs, dans un souci de stabilisation et de pérennisation que le directeur technique Paul Girard nomme « décroissance heureuse ». Sur le plan informatique, la plateforme est par ailleurs une nouvelle fois « refactorisée » avec l’arrivée dans l’équipe de l’ingénieur Guillaume Plique, qui assure le nettoyage et la publication du code source de la plateforme en open source. Son travail consiste notamment à revenir sur le choix effectué en début de projet pour préférer une base de données dite « de graphe » à la base de données relationnelle initialement développée pour soutenir la plateforme. Outre ses qualités en termes de performance technique, ce changement permet notamment à l’équipe de disposer de modes inédits de visualisation des contenus – jusqu’ici principalement manipulés au moyen de tableaux – donnant à voir la complexité du réseau bilingue de paragraphes, documents et autres éléments de vocabulaire, manipulés par le collectif pendant trois ans d’enquête collective. L’infrastructure, enfin stabilisée, se donne finalement à voir alors que le projet est quasiment terminé.
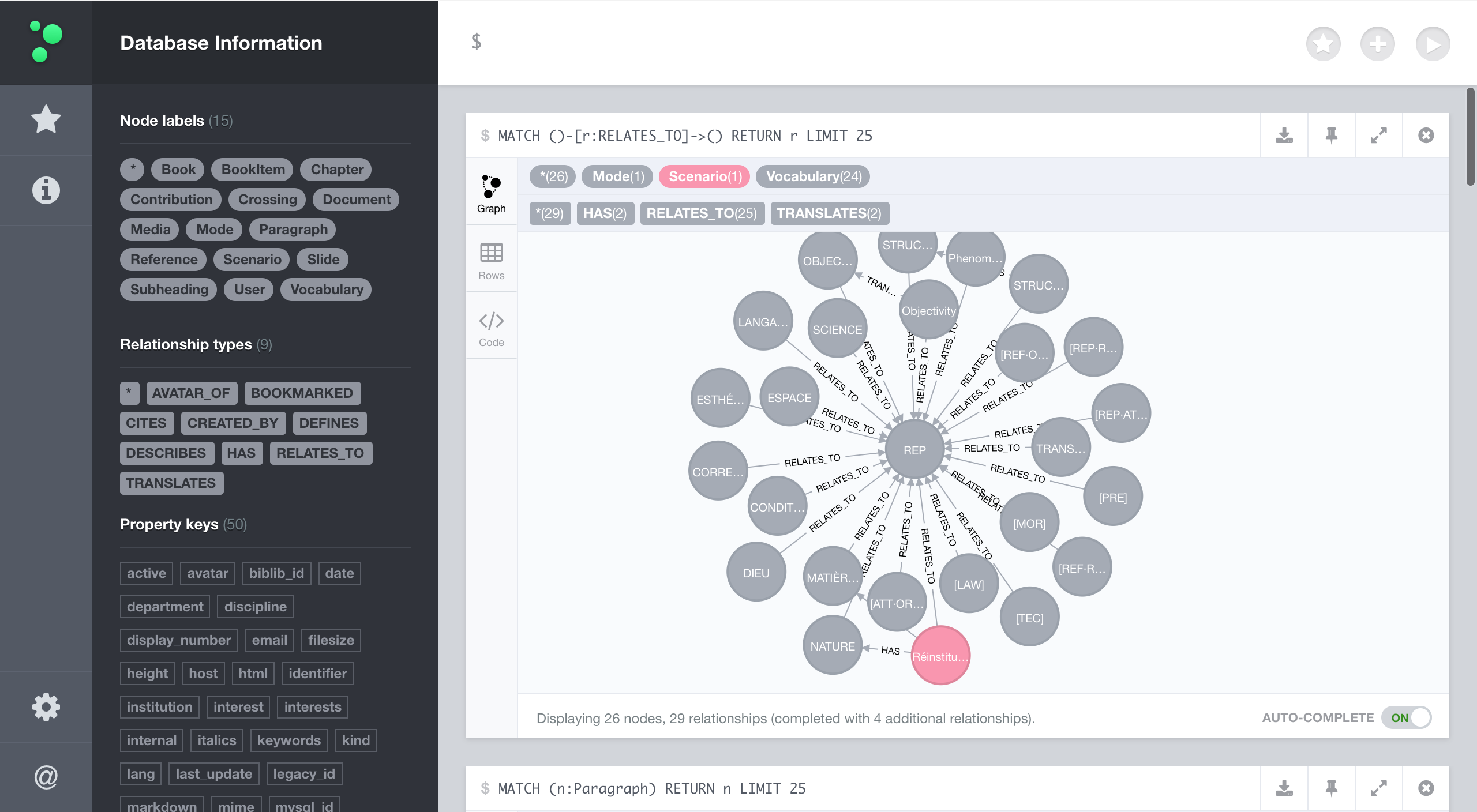
… puis d’une exposition, entre bilan et nouvelle direction de recherche, conçue comme une « expérience de pensée »
La réécriture de l’EME, prévue depuis les débuts du projet et pour ainsi dire constitutive de la méthode de recherche de son auteur principal, prend une forme inattendue, puisque la réécriture du « rapport préliminaire » initialement prévue est abandonnée. À la place, ce qui devait être une « petite exposition portant sur la machinerie du projet EME depuis son inception jusqu’à sa fin » devient un projet d’envergure qui porte à la fois sur un dispositif scénographique et sur un nouvel ouvrage collectif impliquant une partie des « contributeurs » de l’enquête sur les modes d’existence. À partir de Décembre 2015, l’équipe s’investit dans la préparation de ce qui devient l’exposition Reset Modernity!, au Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) de Karlsruhe, du 15 avril au 21 août 2016, et qui participera d’une conclusion partielle et ouverte du projet, dans la mesure où elle évite de mobiliser explicitement le vocabulaire de l’Enquête, et ouvre de nouvelles directions de recherche.
Cette dernière se présente comme une « exposition de pensée »55 visant à équiper les visiteurs d’une série d’outils culturels et conceptuels leur permettant de « réinitialiser » (reset) leurs repères et représentations de la condition moderne. Ce décalage dans le cadrage conceptuel et narratif de l’enquête – et la mise en retrait du très important appareil philosophique qui l’a permis – participe du développement d’une métaphore spatiale et navigationnelle que l’on retrouvera dans les publication antérieures de Bruno Latour, notamment avec l’ouvrage Où atterrir ? Comment s’orienter en politique (Latour, 2017). Le dispositif scénographique de Reset Modernity! est ainsi composé comme un parcours ordonné pour donner à expérimenter aux visiteurs une série de six « dysfonctionnements » du programme descriptif et prescriptif de la Modernité (on retrouve les « erreurs de catégorie » au centre de la détection des « croisements de modes » de l’EME, sans pour autant que ce concept soit mobilisé) et six « procédures » permettant d’y remédier par une forme de « réinitialisation » (reset). Chacune des sections de l’exposition est alors l’occasion d’une rencontre entre pratiques scientifiques et artistiques, mêlant un ensemble de « stations documentaires » présentant certains des documents discutés durant l’EME avec des œuvres artistiques contemporaines (filmiques, spatiales, ou photographiques). Afin de suivre le protocole proposé, les visiteurs sont munis à l’entrée de l’exposition d’un « carnet de terrain » faisant office de mode d’emploi très guidé et « dogmatique », ainsi que le qualifie Bruno Latour lors de l’inauguration de l’exposition.
Une construction à la fois matérielle et discursive
Dans cette partie, j’ai retracé l’histoire du développement en public de l’Enquête sur les Modes d’Existence. Il en ressort deux conclusions principales. La première révèle la dimension heuristique et productive de la fabrication de l’infrastructure, observable via le décalage et les bifurcations productives opérées entre le projet initialement envisagé dans le cadre de la demande de financement et le déploiement effectif du processus d’écriture collective et de négociation visé par le projet. La seconde, concomitante de la première, est l’intrication intime entre les trois lignes d’activités ayant ponctué l’histoire de cette aventure collective, à savoir la conception et le développement informatique, le design graphique et interactif des instances, et la conduite des discussions, des échanges et des activités d’écriture. Ce qui aurait pu être pensé initialement comme une « cascade » de spécifications émanant directement des besoins méthodologiques de Bruno Latour, pour se traduire en spécifications de design, pour enfin être implémentées par des activités de développement techniques, se révèle dans la pratique relever d’un jeu perpétuel d’ajustements et de reprises dans lequel chacune de ces activités a infusé les autres de son vocabulaire, de ses métaphores et de ses modes de travail, faisant de l’EME dans son ensemble un produit singulier et profondément interdisciplinaire.
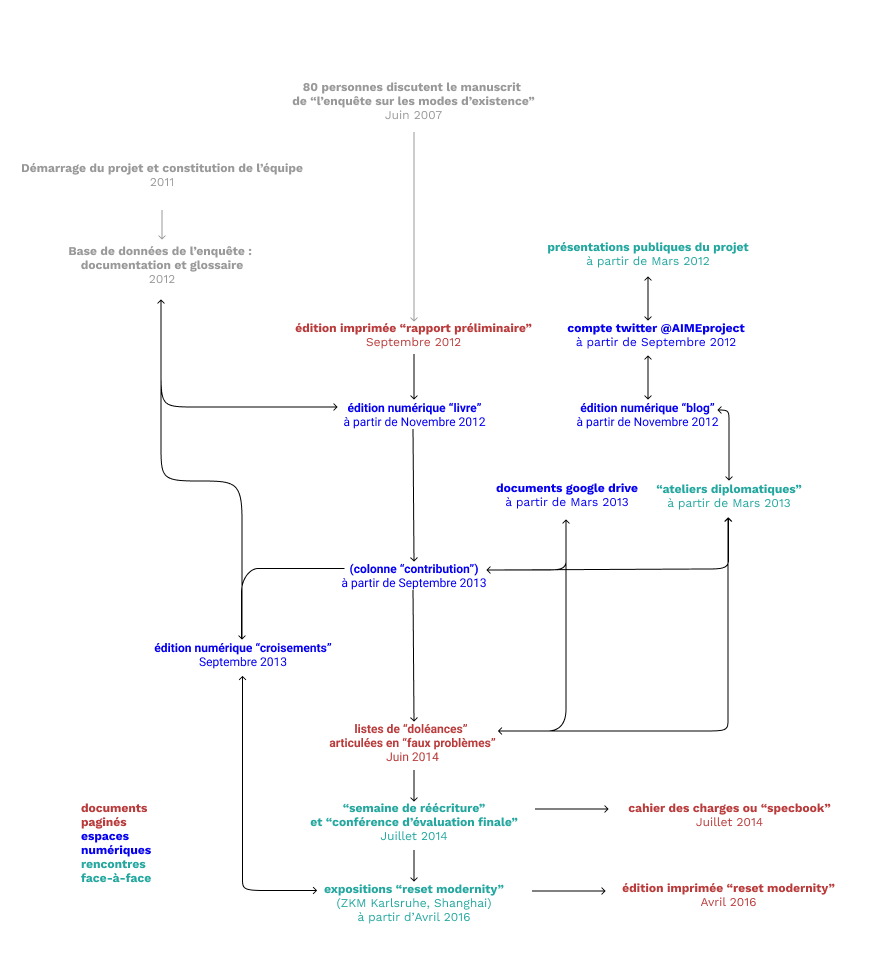
Dès sa formulation en tant que demande de financement, le projet EME s’écrit lui-même – non sans un certain sens du tragique et de l’ironie caractéristique de son auteur – comme une « entreprise risquée » qui entend toucher à un (trop) grand nombre de domaines et champs d’expertise simultanément – risquant et trouvant bien souvent une incompréhension totale de la part de ses contemporains – et expérimenter sur un (trop) grand nombre de plans56 . La multiplication des registres, des métaphores, et des pratiques, produit un « labyrinthe » dans lequel le curieux non « initié » peut facilement voir des airs de mystagogie voire d’hermétisme énigmatique. La réinscription de l’EME dans le travail de Bruno Latour permet pourtant de reconnaître une grande partie des concepts, des propositions, mais aussi des procédés déjà mis en œuvre dans d’autres expériences d’écriture et de publication. Son étrangeté et son idiosyncrasie n’en rendent pas moins la conduite de l’enquête collective difficile.
La généalogie de l’enquête révèle par ailleurs un projet marqué par une série de paradoxes : il est fortement centralisé autour de son investigateur principal tout en se pensant comme l’instrument de formation de collectifs authentiquement pluriels et d’altérités radicales ; par ailleurs il est marqué par le sceau de l’urgence alors même que la ligne d’action qu’il propose relèverait plutôt du ralentissement et de la sensibilisation à la profusion des manières d’êtres qui vivent sous les marches bruyantes du progrès moderne. Au milieu de ces paradoxes, le rapport aux « publics », si importants pour le caractère diplomatique de l’enquête, est alors marqué par une dichotomie entre, d’une part, les « ateliers » dont les participants appartiennent souvent préalablement à l’entourage socio-professionnel de Bruno Latour, et, d’autre part, les diverses parties-prenantes « extérieures » attirés par le projet grâce à la renommée et la résonance médiatique de son investigateur principal, et mis en situation de critiques, de commentateurs ou tout simplement de lecteurs. Entre ces deux pôles, les composantes numérique de l’infrastructure de l’EME interviennent comme un point de contact et de rencontre entre les deux collectifs – les « proches » et les « lointains » – permettant la participation à l’enquête moyennant une modération et une centralisation contestée. Mon rôle dans l’EME est alors de mener une investigation au cœur de cette zone de frontière ou d’indécision pour reconstituer les interactions entre les diverses dimensions de l’infrastructure de l’EME et du format de publication qu’elle a produit au contact de ses publics.
Enquêter sur l’enquête : tactiques de reconstitution
L’histoire collective de l’Enquête sur les Modes d’Existence est celle d’une succession mouvementée de reprises et de transformations dans laquelle une infrastructure instable se modifie au fur et à mesure qu’elle rencontre ses participants. Sa construction auprès des publics médiatiques et universitaires est indissociable de l’histoire de sa conception, de son design et de sa fabrication collective. Afin de comprendre empiriquement comment dialoguent les dimensions respectivement technique, esthétique, sociale et diplomatique du projet, il me faut initialement trouver une position intermédiaire permettant de comprendre le projet du double point de vue des acteurs mobilisés au sein du médialab de Sciences Po d’une part, et des lecteurs, commentateurs et contributeurs intéressés à l’Enquête d’autre part.
Pour ce faire, je suis impliqué dans le projet de l’EME en tant qu’observateur participant sur une période de dix mois qui s’étend de mars 2014 à janvier 201557 . J’entre en recherche avec une connaissance très restreinte de l’EME, du médialab et de Bruno Latour, mais avec le projet de travailler de manière expérimentale et empirique les relations entre pratiques de recherche, pratiques d’écriture et pratiques de publication. Je pense dans un premier temps pouvoir contribuer directement au design et au développement des éditions de l’EME en y développant des prototypes d’interface nouveaux, avant de me détourner de ce projet à cause de l’organisation du groupe aux positions clairement fixées d’abord, du calendrier du projet ensuite, enfin de doutes sur la pertinence d’une telle démarche au vu du caractère unique de l’EME et de la liberté offerte par mon statut de doctorant. Je me transforme alors en enquêteur, et dois trouver une autre place dans ce collectif. J’entreprends en ce sens de parler le langage du médialab en m’équipant d’outils permettant d’approcher les différentes traces numériques de l’infrastructure de l’EME. Je consacre, simultanément à mes activités d’investigation et de participation au projet, un temps très important à améliorer mes compétences en programmation informatique et en design d’information et d’interfaces, pour être capable d’analyser ces dernières, mais aussi pour construire une certaine légitimité au sein du collectif dans lequel je m’inscris. Dans ce contexte, j’effectue une série hétéroclite d’activités. Ma position est participante dans la mesure où je contribue à la documentation du projet – archivage, captations diverses lors des évènements physiques, entretiens multiples – et à son analyse réflexive via les traces d’activité numérique laissées dans le sillage du projet ; de manière corollaire, mon activité participe également de la communication de l’équipe vers ses publics via la production de contenus pour le blog, la newsletter et quelques communications orales du projet.
Pendant mon « terrain », l’avancée et les résultats de mes activités sont présentées de manière régulière à l’équipe, entraînant parfois des ajustements dans sa stratégie de communication en suite de mes retours. Mon rôle au sein de l’équipe, peu balisé et mobile du fait de mon intervention hors du cadre défini par le projet de recherche et son financement, me conduit à endosser de nombreux rôles. Ainsi, lors des présentations de l’équipe aux visiteurs extérieurs, je suis successivement labellisé comme : ethnographe, photographe, cameraman, analyste des usages, communiquant, informaticien, doctorant, ergonome, analyste, designer. Ces désignations me semblent éclairantes pour refléter la variété de positions depuis lesquelles j’ai été en mesure d’approcher le projet pour tenter de comprendre son agencement complexe58 . Mon étude de l’EME pourrait ainsi être décrite comme un jeu de « triangulation » visant à saisir une chimère en mutation perpétuelle grâce à un système de positions que j’ai établies autour de cet objet, et pour lesquelles j’ai tenté de développer à chaque fois des instruments appropriés.
Ma recherche s’inscrit dans le contexte d’une grande attention médiatique et universitaire pour le projet, et la visite de nombreux étudiants, intéressés et autres curieux. Avant mon arrivée, le projet EME fait l’objet d’un premier terrain de doctorat mené par Anne-Lyse Renon, en 2012-2013, dans le cadre d’un travail portant sur la place du design et de l’imagerie dans les pratiques de la Science (Renon, 2016). Ce travail propose une observation des dynamiques de collaboration entre ingénieurs, designers et chercheurs au sein de l’équipe du médialab ainsi qu’un récit de son expérience de terrain portant sur la constitution des contenus de ce qui allait devenir la colonne « document » de la plateforme en ligne. Mon étude couvre une phase un peu plus tardive de l’expérience – celle du développement de sa plateforme puis de sa rencontre avec les publics. Je ne suis par ailleurs pas le seul à étudier le projet durant mon séjour, et collabore notamment avec Joachim Presn Thomsen et Thomas Nyrup, deux étudiants en Science & Technology Studies à la IT University de Copenhague, venus également rejoindre l’équipe pour explorer les modalités et les effets du processus de contribution à l’intérieur du projet.
L’histoire de ma rencontre avec le projet de l’EME est d’abord celle d’un vertige et d’une sidération face à un environnement et des connaissances qui me sont alors totalement étrangères. Démuni et intimidé par le texte de l’édition imprimée, la profusion des éditions numériques, et toute la tradition pragmatiste, spéculative et anthropologique qu’elles convoquent, je suis très rapidement pris par un dilemme vis-à-vis de ma recherche sur les enjeux de design de la publication universitaire d’une part, et la dynamique très spécifique du projet d’autre part. Se pose notamment la question de ma relation avec le « contenu » de l’EME et son influence rétroactive sur le cadre théorique de mon travail : je ne veux pas transformer mon enquête en un commentaire, une apologie ou une critique universitaire des thèses de Bruno Latour – travail déjà engagé dans d’autres disciplines et par des individus mieux équipés que moi pour ce faire – sans pour autant vouloir réduire mon approche de design à une série de questionnements tactiques qui ne verraient dans le projet qu’un cas d’étude générique apte à être l’objet de méthodes d’expérimentation et d’évaluation. S’agit-il d’évaluer une implémentation du projet de « pyramide éditoriale » rêvé par R. Darnton (Darnton, 2012), enfin expérimenté en conditions réelles ? Ou encore de rapprocher l’EME d’un projet de recherche citoyenne ou contributive, et tenter d’établir des correspondances avec ce type de pratiques ? Chacune de ces questions trouve une certaine pertinence sans pour autant pouvoir pleinement être détachée de l’idiosyncrasie et de la cohérence matérielle et discursive de l’EME, ainsi que des multiples jeux de rétroaction qu’elle demande pour pouvoir être étudiée dans les termes d’une recherche en design.
L’autre difficulté méthodologique de ma position est liée aux marqueurs d’autorité symbolique qui peuplent cet environnement – « Sciences Po », « Bruno Latour », sans parler de la renommée universitaire d’une part importante des « co-enquêteurs ». Mes compétences préexistantes et mon attitude d’enquête par le design me conduisent à rapidement produire des visualisations et autres dispositifs d’interprétation « montrables » dans le cadre de ma recherche. Or durant les présentations de mes travaux – intervenant dès avril 2014 – j’expérimente très rapidement une difficulté à faire exister mes questions et expérimentations propres « à l’ombre » des associations polarisantes suscitées par le projet, au premier rang desquelles celles avec la figure de Bruno Latour – qui m’était très peu familière au début de mon terrain – dont je découvre progressivement qu’elle fait de moi un intermédiaire de premier ordre pour approcher (pour ses admirateurs) ou pour attaquer (pour ses détracteurs) le personnage. La dimension « participante » de mon observation révèle alors des enjeux insoupçonnés et est ainsi tout autant un facilitateur qu’un générateur de difficultés méthodologiques.
La dernière difficulté méthodologique réside dans la multiplicité des matériaux rencontrés et fabriqués au cours du développement de mon étude sur l’EME : textes, traces d’activité numérique, recueil de paroles à travers des entretiens, observation directe à l’occasion de ma participation, voire remise en jeu à l’occasion d’activités dans laquelle j’ai repris le rôle de designer… la nature de ces matériaux de recherche hétérogènes implique nécessairement un « bricolage méthodologique » et une écriture hétéroclite. C’est par l’approche de la reconstitution des associations plurielles à lʼœuvre dans la dynamique de publication que j’ai tenté d’aborder cette dernière difficulté et d’en faire sens dans le présent texte.
Reconstituer l’enquête au prisme des traces de son public
La formation d’un collectif au contact de son infrastructure demande d’utiliser toutes les traces à disposition pour essayer de cerner ce qui, dans les pratiques et dans les discours, traduit l’influence du format sur ses modes d’appropriation et d’implication dans le projet. Certaines de ces traces se sont présentées à moi déjà constituées, d’autres ont dû être produites avec les participants.
Mon enquête sur l’EME repose d’abord sur les traces numériques laissées dans le sillon du projet : les activités de consultation des visiteurs de la plateforme numérique telles que reflétées par les métriques de fréquentation Google Analytics du site ; la collecte, la lecture et l’analyse des tweets associées aux discussions entourant le projet ; les traces d’activités des participants inscrits sur l’entrée « livre » via sa base de données – et notamment les activités d’annotation et de contribution privées qu’elle autorise ; enfin une analyse du code source des différentes versions de cette même plateforme numérique.
Ce volet numérique est complété par la conduite d’une série d’entretiens semi-dirigés, d’abord avec douze membres de l’équipe de développement et d’animation du projet, puis avec les contributeurs et autres personnes intéressées au projet, dans le cadre de ma collaboration avec Joachim Thomsen et Thomas Nyrup59 . Ces deux séries permettent de disposer d’une diversité d’informations et de discours sur les questions d’appropriation et d’implication impliquées par la dimension publique de l’EME.
Cette enquête par entretiens est complétée par mon expérience d’observation directe, qui couvre notamment une partie des activités de développement – à travers l’observation de réunions de conception notamment, une demi-douzaine d’ateliers philosophiques et la phase finale du projet composée de la « semaine de réécriture » et de sa « conférence d’évaluation finale » en juillet 2014.
Elle s’adjoint par ailleurs un questionnaire envoyé aux 4000 participants du projet qui comptabilise 261 réponses et porte à la fois sur les pratiques effectives générées par le caractère distribué du projet, et sur la récolte de retours qualitatifs sur les modalités et l’expérience de la « contribution » au projet.
L’ensemble de ces matériaux est mobilisé dans le cadre de mon enquête à travers une série de « reconstitutions » mettant en relation, sous la forme d’applications numériques, différentes dimensions du projet. Il s’agit ainsi de situer les propos récoltés durant les entretiens par rapport à l’évolution du développement des instances matérielles, de comparer la configuration graphique des interfaces de la plateforme numérique avec leur fréquentation par le lectorat, ou encore de mettre en regard le calendrier des rencontres et autres ateliers philosophiques avec l’activité numérique de contribution sur le site.
Le dernier matériau qui nourrit mon enquête est la préparation et la conduite de l’évènement Open AIME en 2015 (Leclercq et al., 2015), un projet spéculatif visant à traduire l’infrastructure de l’EME pour trois autres situations et projets de recherche. Dans ce cadre, je reprends un rôle plus familier de designer de participation et d’interaction en tentant d’accompagner des « binômes » constitués de membres de l’équipe et de nouveaux chercheurs dans la sélection et la remobilisation de portions de l’EME – par exemple, le principe d’écriture conjointe à la constitution d’une base de données de matériaux de recherche. Cette dernière activité ouvre la voie à l’activité de production logicielle expérimentale relatée dans la suite de cette thèse, mais elle permet également de questionner, d’une nouvelle manière encore, les relations intimes entre le projet diplomatique, l’infrastructure et le public de l’Enquête sur les Modes d’existence.
Une enquête sur les statistiques de fréquentation
Ma première activité consiste à analyser l’ensemble des données de fréquentation de la plateforme numérique, collectée au moyen du service Google Analytics60 . Ce dernier service permet d’injecter un script dans les pages d’un site afin d’y suivre les activités et la provenance des visiteurs, de la localisation de leur page d’arrivée à leur comportement de navigation en passant par leur temps de présence sur le site ou leur origine géographique. J’en ai produit une série d’analyses statistiques révélant un nombre conséquent d’utilisateurs uniques sur le site mais ne permettant pas d’avoir des indications très précises sur les pratiques des lecteurs au vu de l’interface proposée par le service Google Analytics.
Ce service propose en effet différents modes de représentation visuelle des données de fréquentation, fondées sur des techniques de visualisation standards telles que des histogrammes ou des cartes thématiques. Le jeu de données produit par Google Analytics permet d’aborder ces données selon plusieurs approches incluant des points de vue démographiques, géographiques ou comportementaux. C’est ce dernier aspect qui entrait dans le champ d’investigation de ma recherche : comment l’édition « livre » a-t-elle été parcourue et pratiquée ? La plateforme Analytics propose, en 2014, un onglet « comportement » qui permet de visualiser les statistiques attachées à différentes pages du site analysées. Elle propose différentes techniques de visualisation de l’évolution des fréquentations de page dans le temps et leur répartition61 , des parcours et des temps de lecture des visiteurs sur les éditions numériques du projet.
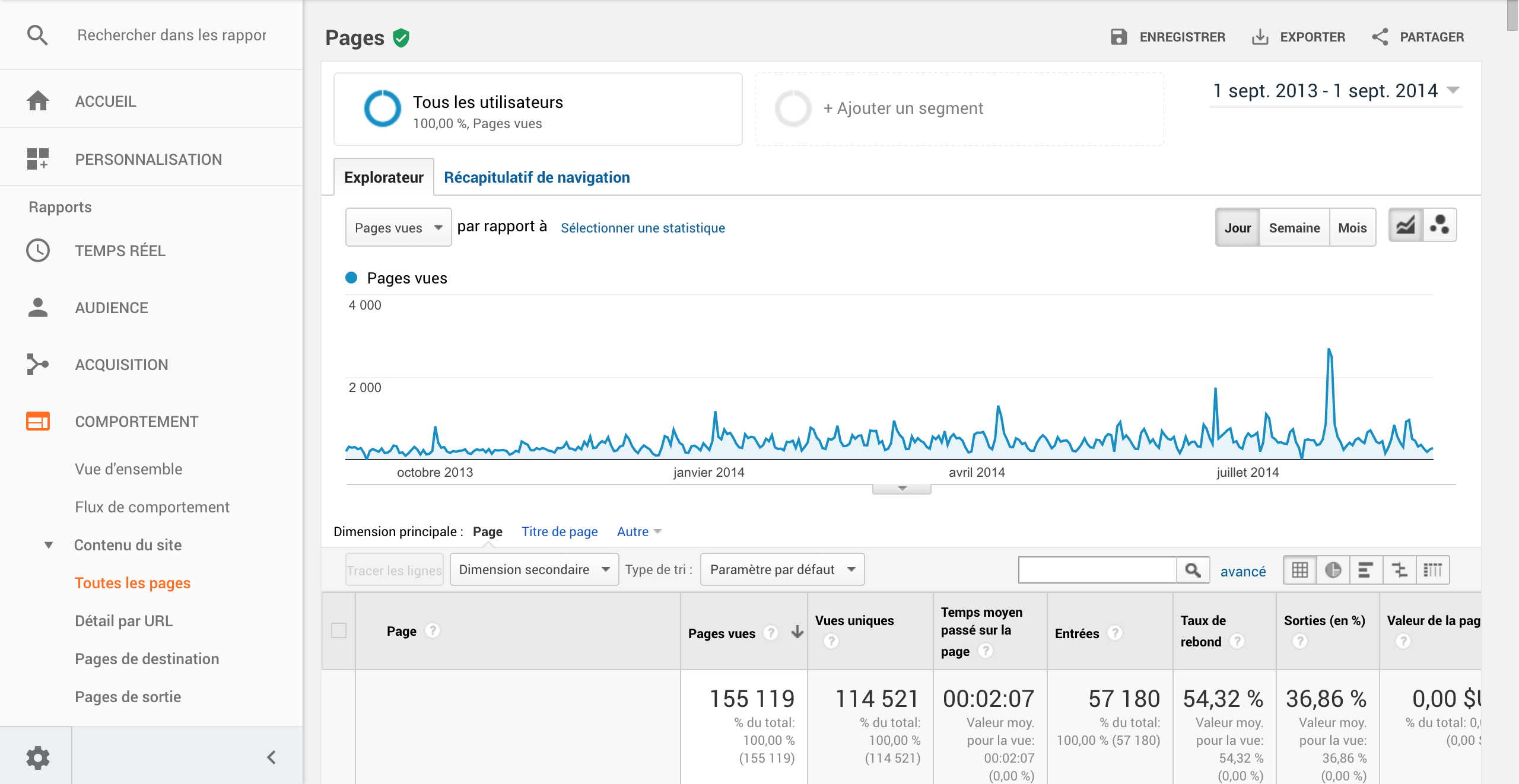
Malgré la sophistication de son interface, l’outil en ligne proposé par Google pour visualiser les données collectées au moyen de son service est très mal adapté à la structuration spécifique du site web attaché à l’EME. En effet, ce dernier, et en particulier son interface « livre », ne se présente pas sous la forme d’une série de pages mais au contraire comme une interface dynamique reconstruite et recomposée à la volée. Outre les vues spécifiques telles que la vue de bloc-note, le projet présente autant de « compositions » possibles qu’il y a d’éléments constitutifs du réseau hypertexte des contenus. À chacune des 1200 « vues » possible correspond une adresse URL possible. Il faut alors rajouter à ce décompte toutes les vues rendues possibles par la fonction recherche de l’interface, dont les statistiques révèlent qu’elle a été utilisée de manière assez importante. En conséquence, l’analyse du site de l’EME révèle un peu moins de 4257 adresses de navigation différentes enregistrées dans les statistiques de fréquentation sur la période du 30 Novembre 2012 au 1er septembre 2014. L’analyse des pratiques de lecture de l’interface demande donc de déployer une démarche d’analyse et une technique de visualisation propre.
J’ai effectué une analyse et un retraitement des données liées aux statistiques de comportement de navigation sur le site. Il m’a fallu d’abord les récupérer62 puis analyser leur structure. Ces dernières étaient organisées sous la forme d’une liste représentant l’ensemble des adresses web mobilisées lors de la navigation sur le site, qu’il s’agissait alors de regrouper au moyen d’une série de règles à appliquer sur les adresses selon une procédure itérative afin de repérer tous les « patterns » ou principes sous-jacents à l’organisation des URLs. Dans cette démarche, j’ai regroupé l’ensemble des adresses en quatre groupes – « inquiry » pour les adresses associées à l’entrée livre, « crossings » pour les entrées associées à l’entrée croisement, « site » pour les entrées associées au mini-site de présentation et au blog, « autres » pour les adresses de maintenance telles que les confirmations d’inscription et les changements de mots de passe. J’ai par ailleurs également extrait des informations telles que les termes les plus recherchés au moyen de l’interface de recherche du site.
| query | Pages vues | Vues uniques | Temps sur page | requete | Temps sur page en secondes | Domaine | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 63136 | 44661 | 00:02:39 | 159 | site | site - page principale | |
| /index.php/site/index | 24820 | 18689 | 00:03:41 | 221 | site | site - page principale | |
| /inquiry/index.php/site/index | 16000 | 10645 | 00:01:35 | 95 | inquiry | inquiry - vue d'arrivée | |
| /inquiry/index.php | 6641 | 6134 | 00:04:13 | 253 | inquiry | inquiry - vue d'arrivée | |
| /crossings/ | 6321 | 4154 | 00:00:14 | 14 | crossings | crossings - accueil | |
| /index.php/ | 6004 | 3774 | 00:03:02 | 182 | site | site - page principale | |
| /inquiry/ | 5256 | 3232 | 00:03:43 | 223 | inquiry | inquiry - vue d'arrivée | |
| /index.php/render/book | 4737 | 3277 | 00:04:04 | 244 | site | site - blog | |
| /evaluation-conference-streaming/ | 3954 | 2722 | 00:03:28 | 208 | site | site - blog | |
| /user/activate | 3684 | 2865 | 00:00:47 | 47 | autre | autre |
Ce travail de traitement de données s’est avéré aussi être un travail d’archéologie technologique, puisque la richesse du corpus d’URL n’est pas uniquement due à la richesse des contenus mais aussi aux très forts changements dans l’organisation des URLs impliqués par l’histoire de son développement difficile.
| domaine | détail | Pages vues | Vues uniques | Temps sur page en secondes |
|---|---|---|---|---|
| site | site - page principale | 95718 | 68385 | 781 |
| inquiry | inquiry - vue d'arrivée | 30901 | 22701 | 6104 |
| crossings | crossings - accueil | 9613 | 6027 | 57 |
| site | site - blog | 36297 | 26927 | 19467 |
| autre | autre | 6388 | 5256 | 20420 |
| crossings | crossings - tutorial | 1742 | 1170 | 4416 |
| inquiry | inquiry - notebook | 1408 | 1337 | 941 |
| crossings | crossings - exploration | 6600 | 5036 | 42358 |
| inquiry | inquiry - index.php (veilles versions non analysables) | 2482 | 2182 | 6296 |
| inquiry | inquiry - autres vues | 115 | 86 | 383 |
Après avoir produit une analyse statistique générale du site et de sa fréquentation, j’ai tenté de produire un instrument d’analyse plus adapté à la spécificité de l’interface de l’édition numérique de lʼEME. J’ai donc produit une visualisation interactive dont l’objectif était de comparer les statistiques de fréquentation à la structure particulière de « l’entrée livre » et ses quatre colonnes (pour rappel : texte, vocabulaire, documentation, contributions). Ces dernières sont dimensionnées (dans leur largeur) en fonction du nombre de vues qui leur sont attachées pour une période de temps définie. Cette visualisation est mise en regard avec une frise temporelle qui conjugue une représentation des différents évènements ponctuant la vie du projet avec les statistiques de fréquentation globales de ce dernier pour chaque jour, exprimées en nombre de pages consultées. Cette première permet de mettre en relation les différentes variations du taux de fréquentation du site avec les évènements, qui semblent être corrélés en partie.
Cette approche ne manque cependant pas de poser plusieurs problèmes. Des étrangetés dans les structures des données et leur discussion de concert avec les ingénieurs du projet font émerger des doutes quant à la précision des mesures, et agissent au cours de mon terrain comme des révélateurs de problèmes à régler63 . Par ailleurs, la forte évolutivité technique du site en ce qui concerne l’organisation des adresses web rend très très difficile une analyse homogène des statistiques d’utilisation, pour lesquelles il faut à chaque fois retracer la typologie de variations. Ces premiers tâtonnements jouent cependant un rôle déterminant dans mon expérience de participation, dans la mesure où ils permettent de donner à l’équipe du projet une première présence à des groupes partiellement invisibles associés au projet.
Retracer les choix de design à travers la documentation
En parallèle de mon travail sur les métriques, j’opère également un travail de mise en relation de l’ensemble des documents de conception du projet. Ces derniers ont été produits par les différents designers du projet (Donato Ricci, Daniele Guido et Dario Rodighiero) et les autres concepteurs (Paul Girard, Dorothea Heinz, et bien sûr Bruno Latour). Je les ai ensuite organisés et connectés, avec le concours de l’équipe, selon une forme de généalogie permettant de retracer les pistes envisagées et rejetées, les différentes formes de représentation de l’architecture globale du projet et de ses interfaces particulières. J’ai tenté d’en produire une représentation permettant de les afficher sous la forme d’un réseau d’éléments dirigés. Cette activité permet de nourrir les entretiens conduits sur le registre de lʼélicitation visuelle, en reconstruisant avec les participants la trajectoire de conception du projet au moyen de la reconstitution des trajectoires et du commentaire des documents archivés.
Réunir les voix des multiples membres de l’équipe
Durant le temps de mon terrain, je conduis une série d’entretiens semi-dirigés avec les différents individus employés dans le cadre institutionnel du projet de l’EME. Mes questions portent principalement sur deux points. D’abord, sur les dynamiques de formation interdisciplinaire et les relations entre design, ingénierie et philosophie dans les choix effectués : il s’agit, en s’aidant notamment des documents de conception, de comprendre pourquoi et comment s’est stabilisée l’infrastructure que je découvre. Deuxièmement, mon intérêt se porte sur les contributeurs et la relation globale du projet au collectif ouvert, appelé à permettre la réécriture de l’EME.
Après avoir effectué la retranscription manuelle des entretiens, je développe un outil numérique permettant d’effectuer des recherches dans le discours des personnes questionnées et de naviguer dans la vidéo en sélectionnant des extraits liés à un point en particulier. J’utilise cet outil afin d’étiqueter le contenu, de le découper en séquences signifiantes et de dégager des thématiques communes.
Je synthétise ensuite l’ensemble de ces observations sous la forme d’un site web intitulé « Enquête sur AIME » (de Mourat, 2014b) qui présente les différents entretiens sous une forme permettant d’en parcourir simultanément la transcription et l’enregistrement vidéo. Il s’agit à la fois d’une démarche d’écriture visant à faire le point sur cette série vis-à-vis de la ma recherche, et d’un instrument réflexif à destination de l’équipe, qui le visionne et le discute dans le cadre d’une réunion de conception de l’EME.
Rendre visible la rencontre avec le format de « l’entrée livre »
Grâce à mon implication dans l’équipe du projet, je récupère une copie de la base de données de la plateforme numérique sous la forme d’un fichier de données purgé de toutes données personnelles (noms d’utilisateurs, etc.). J’obtiens un fichier très complexe, héritant sa structure de son histoire technique difficile, et je m’engage dans sa réorganisation en vue d’en faire ressortir les activités des inscrits de la plateforme. À partir du travail effectué, je fabrique un outil d’exploration permettant d’observer et de reclasser les différents profils anonymisés de la base, en retraçant la nature et la localisation de leurs activités d’écriture et d’annotation dans la matrice de « l’entrée livre », et en étant en mesure de la comparer à des informations minimales les concernants.
Dans la visualisation, les participants sont représentés par une série de points à la couleur et la taille variable dont les informations peuvent être affichées au survol. Il est possible de les filtrer selon plusieurs critères comme leur « profil » tel que déclaré lors de l’inscription (« universitaire », « étudiant », « autre profession »), selon le nombre de surlignages qu’ils ont effectués sur la plateforme ou encore selon les contributions écrites et éventuellement soumises à la publication. Par ailleurs, l’interface permet de regrouper ces derniers en grappes en fonction de divers paramètres permettant de croiser les données et de chercher des corrélations. En bas de l’instrument, une frise chronologique permet de visualiser l’état de la communauté des utilisateurs sur une période temporelle définie, et un encart intitulé « insights » (trouvailles) permet d’accéder à des vues choisies et incorporées dans l’interface à la suite de mon analyse.
Je m’attache ensuite à remobiliser les mêmes données en centrant l’attention davantage sur les contenus de l’enquête et les formes d’appropriation auxquelles ils sont soumis dans le temps du projet. L’expérimentation « entrées livre » consiste à matérialiser les informations des activités des lecteurs et co-enquêteurs au prisme de la structure visuelle et interactive du site. Pour ce faire, j’ai construit un jeu de données reconstituant l’ensemble des items composant l’interface, en stockant pour chacun d’entre eux l’historique des surlignages et des contributions publiques, refusées et privées64 . J’ai ensuite construit une interface reproduisant de manière schématique la structure visuelle de « l’entrée livre » à différentes périodes de l’année scolaire 2013-2014, durant laquelle cette dernière est passée de trois à quatre colonnes. L’interface produite à partir de cette démarche permet de déformer la représentation de la structure de l’interface en fonction des traces qui y sont attachées, et ainsi de déformer notre perception de la plateforme numérique à la lueur des activités effectives du public qui l’a investie.
Les déformations proposées par l’interface permettent de mettre en regard des informations d’ordre morphologique (longueur de texte et nombre de connexions entre les items) et des données de l’ordre de l’activité du public (annotations, contributions). À cela s’ajoutent des modes de déformations thématiques qui tentent de fournir une perspective précise à partir d’un calcul croisant des données issues de ces deux catégories. Le premier consiste à déformer les items en fonction du nombre de surlignages divisé par le nombre de connexions hypertextes, ce qui permet de normaliser la lecture des activités d’annotation des éléments par rapport à la centralité des items en question dans le réseau des contenus. Ainsi, il est possible d’estimer si tel item fortement annoté l’a été en raison de sa position dans la liste des items sur l’interface, de sa centralité dans le réseau, ou, le cas échéant, si sa popularité doit s’expliquer par un autre facteur (mention dans un atelier ? connexion à un élément particulièrement remarqué du rapport préliminaire ? etc.). Un second mode de déformation par agrégation permet de visualiser les rapports entre contributions refusées et acceptées sur certains éléments pour faire voir les zones les plus « contestées » de l’enquête.
Reconstituer les désaccords matérialisés par le « Specbook »
Enfin, j’ai conduit une expérience de reconstitution du « Specbook » – ce document signé collectivement à l’issue de la « semaine de réécriture » du projet de lʼEME – en matérialisant les différences et divergences entre les co-signataires. Pour ce faire, j’ai traité de manière normalisée les différentes déclarations de chacun des participants consignées dans la section « nos désaccords sur tout ce qui précède » qui faisait suite à la ratification du texte. Pour chacun des auteurs, j’ai identifié les paragraphes sur lesquels est exprimé un sentiment mitigé, et ceux sur lesquels est exprimé un désaccord profond. J’ai ensuite construit une interface permettant de visualiser l’ensemble du texte et de le déformer en fonction de ces informations.
À travers ce dispositif, l’analyste peut dans le même temps lire le contenu de cette déclaration finale et visualiser la géographie de la consensualité sur le document de réécriture collective. Il peut le faire en modifiant la couleur, la taille ou l’opacité du texte en fonction de la quantité d’accords et de désaccords pour chaque paragraphe. Par ailleurs, s’il clique sur un paragraphe, les noms des co-auteurs de la colonne de gauche sont colorés en fonction de leur déclaration à propos de ce paragraphe particulier (affichés en vert s’ils n’ont pas exprimés de désaccord, en orange pour une déclaration réservée, en rouge pour un désaccord), permettant de deviner les groupes et les factions qui se sont assemblés lors de la construction du texte. Dans l’autre sens, en cliquant sur le nom d’un auteur particulier, il est possible de voir le texte s’afficher en fonction de sa déclaration particulière à propos du « Specbook » et ainsi obtenir une vision kaléidoscopique du texte collectif.
Ainsi, mon enquête à propos du projet EME s’est construite à mi-chemin entre analyse, documentation et reconstitution. À travers mes diverses expérimentations, j’ai tenté, pour moi comme pour ce texte, de re-produire le projet selon la double perspective de ses animateurs et de ses participants, et de faire place à chacune des facettes multimodales de ses diverses éditions.
La reconstitution comme un geste analytique et réflexif
Les pratiques d’enquête que j’ai présentées dans cette partie participent davantage d’un tâtonnement expérimental que de l’application ou de la formulation d’une « méthodologie » d’analyse définie. Je développe mes premières expérimentations dans l’enceinte du médialab, en contact quotidien avec l’équipe et en parallèle de mes activités d’observation et d’aide sur le projet. Cependant, alors que mon analyse se précise, je rencontre une série de déconvenues concernant la capacité des données récoltées à rendre compte de l’activité des publics et de la complexité du projet, dont les différentes dimensions sont inextricablement liées. J’en viens alors à pratiquer les différents projets de reconstitution que j’ai présentés. Ces diverses activités permettent de restituer l’EME comme une histoire polyphonique, en rendant audibles une multitude de discours, et visibles une diversité de pratiques, donnant ainsi à l’EME le relief qui serait facilement gommé par le temps et la lumière braquée sur son investigateur principal.
Les diverses expérimentations méthodologiques que j’ai conduites résultent d’une démarche conjointe d’appropriation et d’équipement face à l’analyse d’un projet de recherche à la configuration alors peu commune. Elles sont simultanément le lieu d’activités d’interprétation dans le cadre de mon enquête, d’un apprentissage professionnel en terme de développement informatique et de design de l’information, et d’une pratique visant à fluidifier l’acceptation et les échanges avec l’équipe – notamment de développeurs – du médialab. Elles sont également, via le geste de la reconstitution, l’occasion d’un geste qui me semble faire sens vis-à-vis de la résonance qu’il implique avec son objet d’étude. De la même manière que le projet de l’EME réécrit et reprend une même hypothèse philosophique et diplomatique dans une diversité de médiums et la teste auprès d’une diversité de collectifs, j’ai tenté de poursuivre le cycle des transformations du projet en contribuant à la « réécriture » de l’enquête avec mes outils de recherche par le design.
À ce titre, le geste de reconstitution en tant que tel est à la fois un outil de documentation, d’archivage, et de dialogue permettant de développer une perspective réflexive sur le projet tel qu’il s’est déroulé. En commentant les pratiques en train de se faire, il participe d’une « pratique réflexive » (Schon, 1984) qui utilise le réfléchissement du projet au service d’une réflexion collective sur le rapport de l’équipe à des questions telles que celles de la contribution, de l’ouverture, ou de l’expertise des parties prenantes du projet.
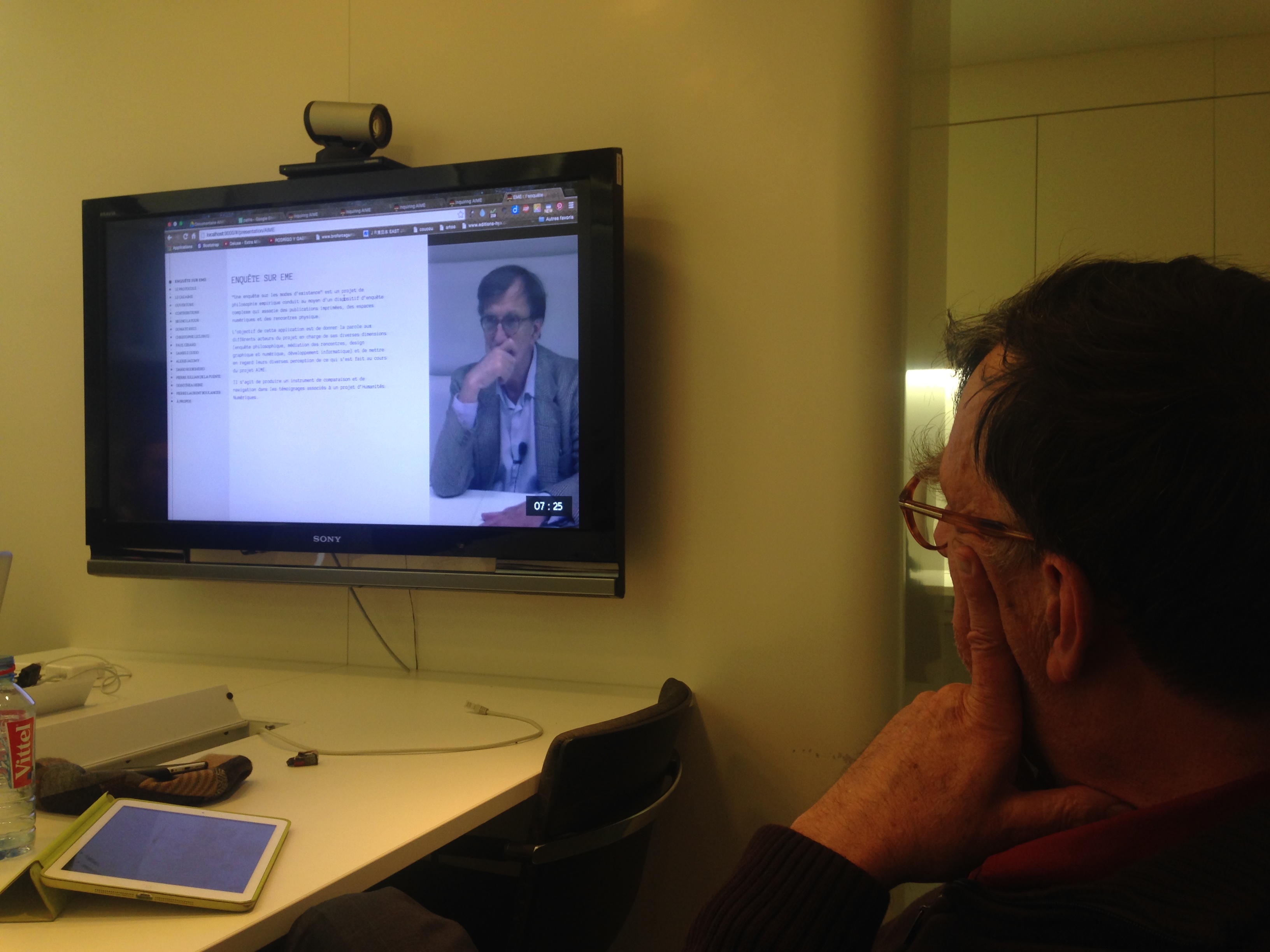
Les différentes pièces de reconstitution présentées dans cette partie permettent d’apprécier les liens entre conception visuelle et interactive, choix techniques et informatiques, et animation sociale à lʼœuvre dans la co-constitution de l’infrastructure de l’EME et la rencontre de son format par une diversité de publics. Il s’agit maintenant de restituer mon enquête sur un mode davantage séquentiel, en décrivant les formes d’appropriation de l’infrastructure EME par les divers collectifs qui l’ont rencontrée, et les modalités de participation qu’elle a impliquées pour son public.
Sur les traces des publics de l’EME
La scène diplomatique imaginée par l’équipe de l’EME demande et promet la rencontre d’une variété d’intérêts et de valeurs à même de constituer le public de l’enquête des modes d’existence. Cette partie vise à décrire comment ce collectif « étendu » investit et pratique l’infrastructure mise en place par l’EME. Il s’agit de comprendre, au prisme des traces empiriques disponibles et des témoignages récoltés, comment le format du projet dialogue avec ses diverses formes d’appropriation, au premier rang desquelles la question de la contribution des « co-enquêteurs ». Comment a été investie la dimension multimodale impliquée par la multiplicité et la complémentarité des éditions du projet ? Comment l’infrastructure a-t-elle été effectivement pratiquée par ses lecteurs et contributeurs, et comment ce collectif s’est-il composé ? Quelles ont été les modalités de « transformation » de certains lecteurs en contributeurs ?
Il s’agit donc d’interpréter la formation du public de l’EME à travers des degrés et des modes d’implications variés, depuis la découverte et la recension du projet jusqu’à la pratique de la contribution. Pour ce faire, je décrirai d’abord la provenance et les modes de description du projet par ses visiteurs et critiques, puis les pratiques d’appropriation effectives des différentes éditions imprimées ainsi que numériques comme dispositifs de lecture. Je décrirai enfin les modalités de la contribution en ligne, centrale dans le déroulement et l’ouverture de l’enquête à des « co-enquêteurs » inattendus, du point de vue des pratiques qui les ont permises et du collectif interdisciplinaire ainsi assemblé par les formats de l’EME.
Découvrir l’enquête : entre reconnaissance et désorientation
L’EME sur les réseaux sociaux et la « constellation Bruno Latour »
Suivant le fil d’une découverte progressive de l’infrastructure de l’EME, on peut commencer par analyser les échos et les mentions du projet sur le réseau social Twitter, lieu d’un ensemble important de discussions et d’échanges à propos de l’enquête dès ses premiers mois d’existence publique. L’analyse du réseau des hashtags et des utilisateurs associés au projet65 nous apprend que la figure de l’Investigateur Principal, Bruno Latour, joue un rôle structurant dans l’ensemble des discussions autour de l’enquête. En masquant le « nœud » de Bruno Latour de cette géographie, on se rend compte que persistent des mentions répétées à des évènements ou des thèmes (exemple : « #STS », « #mooc ») qui ne sont pas directement associés au projet mais à des activités antérieures ou parallèles de son investigateur principal.
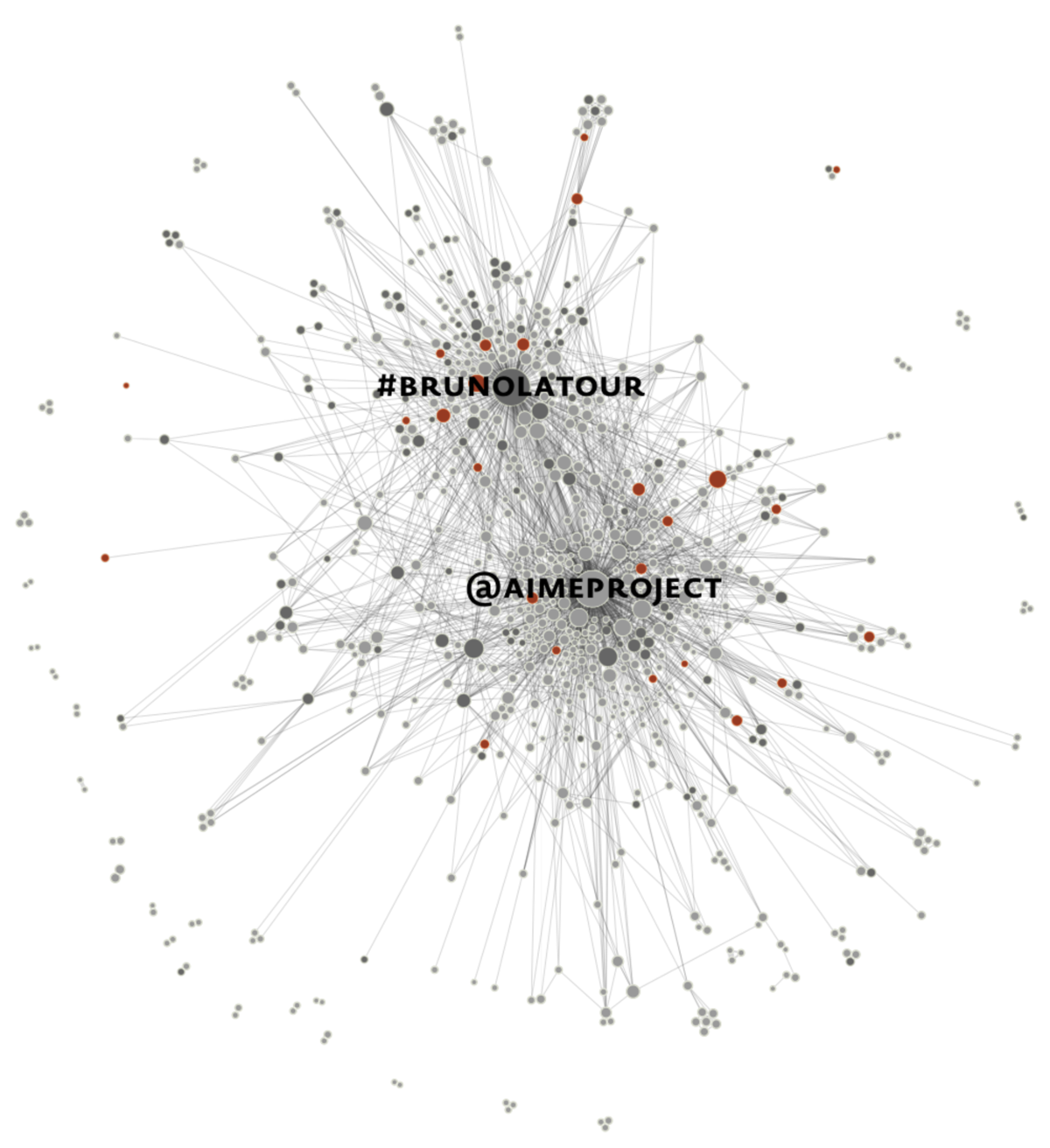
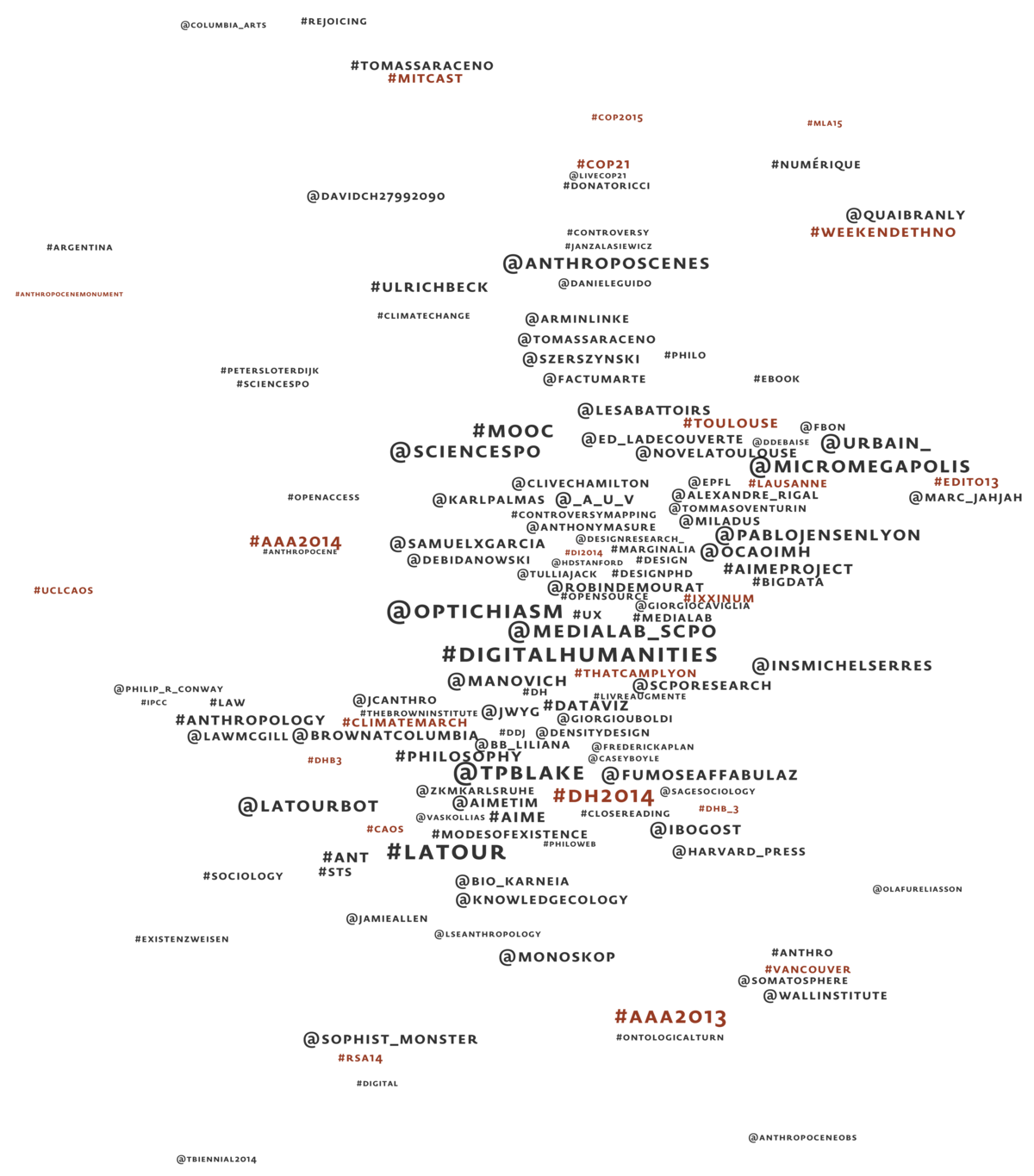
En ce sens, l’étude temporelle des hashtags associés aux tweets mentionnant le projet sur le temps de son déroulement public révèle par ailleurs l’association très forte du projet avec des événements dans lesquels se voient impliqués les membres de l’équipe, relatifs par exemple aux théories de l’acteur réseau, à l’anthropologie, au design d’interaction, etc. Ces différents évènements sont la trace d’une série d’associations effectuées par les utilisateurs de Twitter entre l’EME à proprement parler et une série de préoccupations qui sont autant de points d’entrée – et de perspectives d’interprétation – relatives à la découverte du projet lui-même et probablement de la visite de ses éditions numériques.
Du point de vue des éditions numériques, sur la période du projet courant jusqu’à l’été 2014, la plateforme EME a été l’objet de 820 002 visites effectuées par plus de 40 500 internautes différents. L’analyse des métriques d’utilisation de la plateforme numérique révèle un public français (29% des sessions), mais également américain (20%), britannique (14%), canadien (13%), allemand (13%), belge (13%) et brésilien (13%). Les visites sont souvent corrélées, de manière non surprenante, aux différentes présentations et évènements associées à la découverte, témoignant son ouverture progressive à une diversité de scènes nationales.
| query | Sessions | Temps moyen sur page |
|---|---|---|
| France | 23 795 | 00:03:39 |
| United States | 12 093 | 00:02:51 |
| Germany | 6 262 | 00:03:13 |
| Brazil | 5 118 | 00:02:46 |
| United Kingdom | 4 720 | 00:02:58 |
| Canada | 4 242 | 00:03:25 |
| Belgium | 3 487 | 00:03:04 |
| Denmark | 2 644 | 00:02:57 |
| Switzerland | 2 004 | 00:03:47 |
| Netherlands | 1 841 | 00:03:24 |
Si l’on s’intéresse plus précisément à la provenance des visiteurs des éditions numériques, on découvre que ces derniers viennent principalement de requêtes effectuées sur un moteur de recherche, ou de sites de référence. On peut noter trois grandes origines pour la découverte des éditions numériques : les institutions associées (Sciences Po, le médialab), les sites associés à son Investigateur Principal (site personnel de Bruno Latour), puis progressivement les recensions multiples dans la presse et dans la blogosphère, qui témoignent d’autant de cadres pour l’interprétation de la visite et sa mise en contexte.
Passer en revue une expérimentation à tous les niveaux
Pour comprendre la manière dont la découverte du projet se voit cadrée et préfigurée par son mode d’accès, on peut également envisager l’EME du point de vue de ses modes de désignation et de description dans les médias de la presse écrite et radiophonique, les cercles universitaires et les communautés numériques produites par les réseaux sociaux. Pour ce faire, j’ai réalisé une étude d’un ensemble compte-rendus « publics » du projet en analysant 65 recensions qui ont accompagné la sortie de son édition imprimée66 .
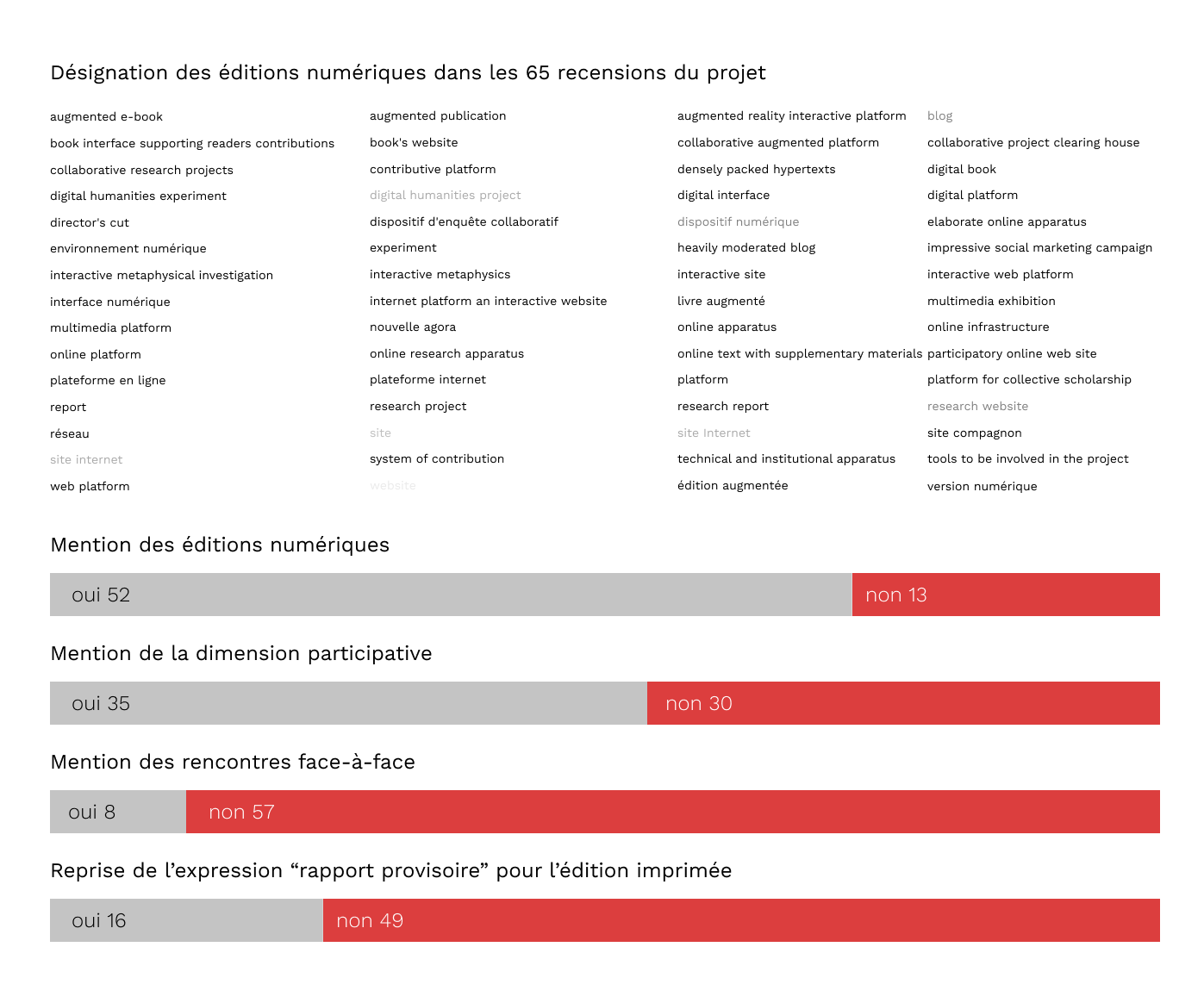
| source | url | date | nom | auteur | appellation de "livre/book" | mention des éditions numériques | appelation de "rapport/report" | mentionnent les rencontres | mentionnent la dimension collaborative | rattachent aux "Digital Humanities" | denominations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| queries duckduckgo 2015 | academia.edu/10903264/EVALUING_BRUNO_LATOURs_AIME_PROJECT | 2015/2/18 | EVALUING BRUNO LATOUR's AIME PROJECT | Terence Blake | o | o | n | o | o | o | |
| queries duckduckgo 2016 | academia.edu/4865714/Review_of_Bruno_Latour_An_Inquiry_into_Modes_of_Existence | 2013/10/1 | / | / | o | o | n | n | o | n | |
| queries duckduckgo 2017 | academia.edu/6040252/Book_Review._Bruno_Latour_An_enquiry_into_modes_of_existence._An_anthropology_of_the_moderns | 2015/5/20 | Book Review. Bruno Latour, An enquiry into modes of existence. An anthropology of the moderns. | Daniel Chernilo | o | n | n | n | o | n | |
| queries duckduckgo 2018 | academia.edu/9522930/Bruno_Latours_Inquiry_into_Modes_of_Existence_review_ | 2014 | Bruno Latour's "Inquiry into Modes of Existence" (review) | Henning Schmidgen | o | o | o | n | o | n | |
| queries duckduckgo 2021 | arcade.stanford.edu/blogs/social-science-and-profanity-dh-2014#footnoteref6_dcom586 | 2014/7/26 | Social Science and Profanity at DH 2014 | Andrew Goldstone | n | o | n | n | n | o | |
| queries duckduckgo 2022 | artsrn.ualberta.ca/mengel/huco5102014/2014/02/14/science-and-technology-studies-sts-through-the-looking-glass-eyeing-the-digital-humanities/ | 2015/2/14 | / | / | o | o | n | n | n | o | |
| queries duckduckgo 2023 | avant.edu.pl/wp-content/uploads/Nikolaus-Fogle-Manifesto-for-the-New-Humanities.pdf | 2013 | Manifesto for the New Humanities | Nikolaus Fogle | n | o | n | n | o | o | |
| queries duckduckgo 2024 | avillez.org/day-of-dh-eh-thats-nice-but-whats-dh-again/#more-41 | 2014/8/4 | Day of DH, eh? That’s nice. But what’s DH again? | André Avillez | n | o | n | n | o | o | |
| queries duckduckgo 2025 | blog.uvm.edu/aivakhiv/2013/08/22/latourian-inquiries/ | 2013/8/22 | Latourian inquiries | Adrian Ivakhiv | o | o | n | n | o | n | |
| queries duckduckgo 2026 | blogs.ubc.ca/msts/2013/09/10/bruno-latour-aime-launch-of-the-english-version-of-the-website/ | 2018/10/9 | Bruno Latour @ AIME Launch of the English version of the website | / | o | o | n | n | n | n |
Tout d’abord, il est important de noter des disparités majeures dans les manières de rendre compte des diverses dimensions et composantes du protocole de recherche et de l’infrastructure qui le porte. Une part importante des recensions ne mentionne pas les éditions numériques – sans que l’on sache s’il s’agit d’un choix induit par le fait que les recensions portent uniquement sur l’édition imprimée, ou si les recenseurs n’en ont pas du tout eu connaissance. Par ailleurs, le scénario global de réécriture et l’organisation des ateliers diplomatiques est mentionné encore plus rarement. Enfin, la reprise de l’appellation de « rapport provisoire », en ce qui concerne l’édition imprimée, est très rarement reprise ou commentée par les divers comptes-rendus publics du projet.
Ensuite, en ce qui concerne les éditions numériques, l’étude des recensions révèle une diversité très importante d’appellations qui traduit une hésitation ou une hétérogénéité dans les modes d’appréhension et d’interprétation du rôle de la plateforme en ligne. On peut notamment repérer trois catégories d’appellations remarquables : d’une part, les recensions qui mettent l’accent sur une certaine dimension documentaire et archivistique (ex. « online research apparatus », « densely packed hypertext ») ; d’autre part, celles qui insistent sur sa finalité participative (ex. « nouvelle agora », « system of contribution », « platform for collective scholarship ») ; enfin, celles qui mettent en avant le caractère expérimental et indéterminé de l’artefact (« digital humanities experiment », « interactive metaphysical investigation »).
Les disparités observables dans la description de l’ensemble de l’infrastructure – voire de son appréhension comme une enquête en cours, et non comme une publication définitive – laissent supposer une disparité dans leur perception et leur investissement par les lecteurs. Elles créent une série de correspondances manquées entre les différentes parties de l’infrastructure. Une partie des recensions reproche par exemple l’absence d’apparat critique dans l’ouvrage imprimé, alors qu’il est développé généreusement sur l’entrée numérique « livre » ; ou encore la fixité du système philosophique proposé, alors que celui-ci est censé être négocié au cours de l’enquête collective. Par ailleurs, les difficultés techniques des premiers temps de la « plateforme » numérique ne facilitent pas la prise en main, conduisant à questionner la pertinence de l’existence de cette dernière67 , et expliquent aussi les difficultés des critiques à rendre compte du projet :
Le lecteur un peu déboussolé ne pourra d’ailleurs pas s’appuyer sur ce qui peut aider habituellement en science sociales, à savoir des notes de bas de page avec des références ou une bibliographie indiquant les points d’appui de l’auteur. Était-il censé faire des allers-retours constants entre le livre et le site ? Ce site compagnon l’aidera en fait peu puisqu’il ne semble guère avoir évolué depuis sa mise en ligne et qu’il en est resté, malgré les mois écoulés, à une présentation des grandes orientations de l’enquête. (Rumpala, 2013)
De manière notable, la diversité dʼappellations à laquelle est soumise l’infrastructure s’accompagne, pour plusieurs des recenseurs, d’une forme d’embarras quant à l’évaluation et la critique de l’ouvrage dans les termes de la recension universitaire, d’autant plus qu’elle intervient au moment où le programme collectif du projet n’est pas encore expérimenté en pratique mais seulement annoncé68 . La description du projet est ainsi soumise à une série d’hésitations et de questionnements sur la finalité de son infrastructure.
On remarque que bien peu des recensions à lʼœuvre font cas des moyens de communication plus conventionnels utilisés par l’équipe, qu’il s’agisse du blog, du compte Twitter ou de la liste de diffusion par email – pourtant fort actifs et cruciaux dans le déroulement de l’enquête : elles se concentrent, quand elles font mention de son volet numérique, sur la seule « plateforme ». Ce faisant, on peut penser que les recenseurs semblent présumer que les éditions imprimées et numériques conçues et fabriquées spécifiquement pour l’enquête sont supposées collecter l’intégralité des échanges, critiques et dynamiques de formation collective associées au projet. Ce présupposé de totalité de certaines parties de l’infrastructure au détriment d’autre est peut-être lié à l’homogénéité visuelle de ces dernières, et l’impression de complétude qu’elles renvoient. Il fait écho à l’invisibilité relative – dans les discours de présentation du projet par l’équipe, mais également dans les témoignages des lecteurs et co-enquêteurs – de la complexe chaîne d’outils et de lieux qui permet à l’ensemble de l’infrastructure de fonctionner.
Concernant la plateforme numérique, l’analyse des recensions nous révèle également l’utilisation répétée d’une série de références à des formats existants, utilisée pour définir des attentes et évaluer la capacité du projet à les combler. On note par exemple des références multiples à la dimension encyclopédique de l’EME. Cette dernière comparaison est souvent dérivée de la présence de la colonne vocabulaire dans l’entrée « livre », qui laisse entendre l’usage d’un « vocabulaire contrôlé » dans la plateforme. En découlent notamment des remarques portant sur l’absence de certains sujets, rendue criante par l’organisation systématique et l’existence d’une fonction recherche :
Étant donné le rôle prépondérant accordé au vocabulaire dans la plateforme AIME, jʼai recherché un certain nombre de termes pour me faire une idée du champ discursif quʼil permet. Les phénomènes au centre de mes préoccupations nʼont guère été évoqués. La pétrochimie, par exemple, nʼétait présente que parce quʼelle offre un contraste Moderne par rapport au traditionnel. Sur une page, figure un chameau accompagné en arrière-plan dʼun terrain dʼusine pétrochimique, avec un commentaire ironique sur ce contraste cliché. Les produits pétrochimiques ne faisaient par ailleurs pas partie du vocabulaire, de la documentation ou des commentaires.69 (Fortun, 2014)
De la même manière, le projet est plusieurs fois comparé aux technologies wiki70 et son instance la plus célèbre, l’encyclopédie collaborative Wikipedia. On retrouve des mentions de cet ordre dans 4 des 65 recensions étudiées, et dans plusieurs des réponses fournies à mon enquête par questionnaire (« J’ai l’impression que nous avons participé à une évaluation géante des processus de construction de connaissance à la Wikipedia »). Dans ces dernières, on compare la plateforme numérique de l’EME à Wikipedia en termes de gestion des communautés, ou de variabilité des contenus. Le parallèle est utilisé non seulement pour faciliter la compréhension du dispositif pour les lecteurs des recensions au moyen d’un point de repère supposé partagé, mais aussi pour effectuer un ensemble de comparaisons – et d’évaluations ou de critiques – en termes de mode de gouvernance, de modération, et d’animation de collectifs :
An Inquiry into Modes of Existence (AIME) est un livre et fait partie dʼun projet web (projet AIME), comprenant trois livres : un livre numérique (imprimable) lors du lancement ; ce livre (Latour 2013a) ; et un qui accompagnera une exposition en août 2014. Le projet comporte trois phases : la conception de Latour ; un environnement de réaction avec des « co-enquêteurs » formés qui modèrent, filtrent et façonnent étroitement les contributions de toute personne qui sʼinscrit pour participer (une sorte de modèle Wikipédia) ; et une présentation finale.71 (Fischer, 2014)
Par ailleurs, le format du blog est aussi mobilisé à de nombreuses reprises comme point de référence pour faire état du projet auprès de lecteurs néophytes, ou pour réfléchir sur les choix effectués pour la constitution de la plateforme numérique de l’EME. Il est parfois utilisé pour discuter le rapport entre auteurs et commentateurs (« Enquête sur “Les Modes d’existence” de Bruno Latour : une publication augmentée », 2014), parfois pour évaluer l’originalité du dispositif72 , ou pour en envisager l’échelle et la temporalité (Terence Blake, 2016).
Ces différentes comparaisons sont intéressantes dans la mesure où elles traduisent non seulement des manières de faire sens d’un dispositif expérimental à partir de points de référence connus, mais également d’investir ce dernier d’une partie des attentes, des finalités et des modes de fonctionnement des dispositifs déjà pratiqués et connus par les lecteurs. On peut qualifier ces différentes descriptions et contextualisations de l’expérimentation EME comme autant d’attentes incorporées par lesquelles le format – unique – du projet se voit rattaché à des formats existants pour repérer et définir ce qui peut être attendu et ainsi produire des horizons de pratique structurants pour l’appréhension et la participation au projet. Ces derniers permettent à la fois l’entrée de nouveaux membres dans le collectif, et l’import de nouvelles attentes dans ce dernier dont l’influence conduit, comme je l’ai montré précédemment dans ce texte, à modifier le format des contributions, ou à faire un usage plus intensif de l’entrée « blog » de la plateforme.
S’approprier l’infrastructure : l’articulation difficile de pratiques distribuées
Une fois le projet découvert, une partie des visiteurs se procure l’ouvrage imprimé et/ou s’engage dans la consultation de l’imposant répertoire numérique proposé. Au moyen des entretiens, de l’étude par questionnaire, et de l’analyse des traces laissées par les lecteurs sur les éditions numériques, il s’agit maintenant de retracer les alignements et les dissonances entre les usages initialement projetés par l’équipe et les pratiques effectives générées par les composantes (notamment numériques) de l’infrastructure.
Jouer le jeu de la multimodalité
Les expériences de lecture de l’édition numérique témoignent de stratégies de combinaisons multiples, insistant sur les différentiels et les variations de temporalité impliqués par l’expérience. Ainsi un lecteur explique-t-il qu’il « arrête la lecture du texte principal à chaque fois qu’un nouveau mot est défini ou précisé » alors qu’un autre indique que « pour la version numérique de la plateforme, [il a] juste ‹ butiné › à temps perdu, faute de temps pour parcourir de manière plus approfondie. » Certains lecteurs font par ailleurs état de stratégies de synchronisation, tendant de maintenir une forme de « correspondance » entre les versions numériques et imprimées en mettant en œuvre conjointement des pratiques d’annotation papier et l’utilisation de la fonction « calepin » de l’édition livre :
Oui, je… jʼai surligné le texte, jʼai pris mes propres notes. Parfois, quand je lisais le livre, et quʼil y avait quelque chose que je voulais surligner là, je venais sur la plateforme, et je le surlignais là aussi. Pour essayer de faire un peu de correspondance entre le texte.73
Une partie importante des personnes enquêtées relate un usage des éditions conforme au scénario imaginé, commençant par la lecture du rapport puis se lançant dans une étude approfondie via l’édition numérique « livre » sur la plateforme, faisant notamment une mention très fréquente de l’usage de la fonction recherche. D’autres récits, cela dit, relatent des modes de lecture davantage délinéarisés, qui commencent par la rencontre de l’édition numérique « livre » et la recherche de termes en lien avec leurs thèmes de recherche, puis continuent par l’acquisition de l’édition imprimée et sa lecture partielle. Pour ces derniers, l’utilisation des éléments de vocabulaire correspondant aux différents modes d’existence (par exemple : [POL] ou [REL]) opèrent comme des points d’entrée pour une lecture « en coupe » des différents contenus qui leur sont attachés. Ces derniers modes correspondent souvent à des lecteurs universitaires qui « piochent » ainsi les parties des contenus latouriens relatifs à leur domaine d’étude privilégié.
L’édition numérique semble cependant ne pas se suffire à elle-même, pour la plupart des lecteurs, pour conduire à une fréquentation prolongée de l’EME. Les « butineurs » ont rarement parcouru l’ensemble des contenus, et encore moins participé à la dimension collaborative de l’enquête. Ainsi, la plupart de ceux qui avaient déclaré avoir lu le rapport en entier disposaient aussi d’une copie imprimée de l’Enquête et ont signalé avoir lu la documentation du projet en ligne. De manière similaire, les participants aux « ateliers diplomatiques » sont également ceux qui ont écrit et publié le plus de contributions. L’édition numérique « livre » semble donc nécessiter sa mise en relation avec d’autres modes d’interaction avec l’infrastructure pour permettre une participation fructueuse à l’enquête collective.
Pratiques des éditions numériques
Le point d’entrée constitué par les éditions numériques agit comme un goulot d’étranglement qui dessine un collectif en plusieurs cercles définis par des degrés d’implication progressive. Sur les 40 000 visiteurs du site, 3760 font la démarche de s’inscrire sur la plateforme afin d’accéder aux entrées « livre » et « croisement » de cette dernière74 . Quelle est alors leur fréquentation des éditions numériques ? Si l’on entre dans une analyse plus détaillée des traces disponibles via les métriques d’utilisation, on s’aperçoit que la fréquence d’utilisation du site est fortement corrélée avec certains des évènements associés au projet, soulignant là encore l’importance d’une articulation avec des assemblées physiques. Plus précisément, on voit une corrélation entre certains évènements et les entrées « vocabulaire », puis aux contributions déjà publiées, correspondant aux termes discutés lors des ateliers. D’un point de vue diachronique, on note par ailleurs au fil des mois une décroissance des navigations sur la colonne « texte » au profit de la colonne « contribution », qui dénote un déplacement progressif des activités de lecture depuis les textes originaux de Bruno Latour vers les produits de l’enquête collective.
L’utilisation plus avancée de l’édition numérique « livre » révèle le partage entre de nouveaux groupes de lecteurs, identifiables du point de vue de leur investissement des diverses fonctionnalités de la plateforme. Dans l’ensemble des 3760 lecteurs inscrits sur la plateforme durant la période étudiée, 420 utilisent effectivement la fonctionnalité « marque-page » permettant de sauvegarder des portions des contenus et 69 se lancent dans la rédaction d’au moins une contribution (qui peut être une note privée, ou proposée à la publication). Les deux activités ne s’avèrent pas forcément liées, ce qui implique que les contributeurs ont utilisé d’autres moyens pour s’acclimater à l’enquête et préparer leur travail, déjouant dans une certaine mesure les usages projetés par l’équipe.
L’étude des activités des lecteurs permet par ailleurs d’appréhender – de manière certes partielle, mais éclairante – la manière dont ont été fréquentés et investis les contenus eux-mêmes. La quantité d’annotations effectuées par chapitre révèle une activité de lecture savante sur l’ensemble de l’ouvrage. Il en va de même pour l’étude des annotations associées à des modes d’existence en particulier, qui se voient annotés et fréquentés progressivement, de manière corrélée avec l’ordonnancement de l’ouvrage original – présentant successivement les quatre groupes de modes dans différents chapitres – mais également en fonction des différents ateliers organisés.
Cela dit, l’organisation graphique particulière de l’édition numérique « livre » semble avoir joué un rôle important dans cette appropriation, dans la mesure où une majorité d’annotations se concentre sur les contenus du début du texte initial – correspondant visuellement au coin supérieur gauche de l’écran à l’arrivée sur l’édition – ainsi que sur les différents éléments de vocabulaire et de documentation liés à ce dernier 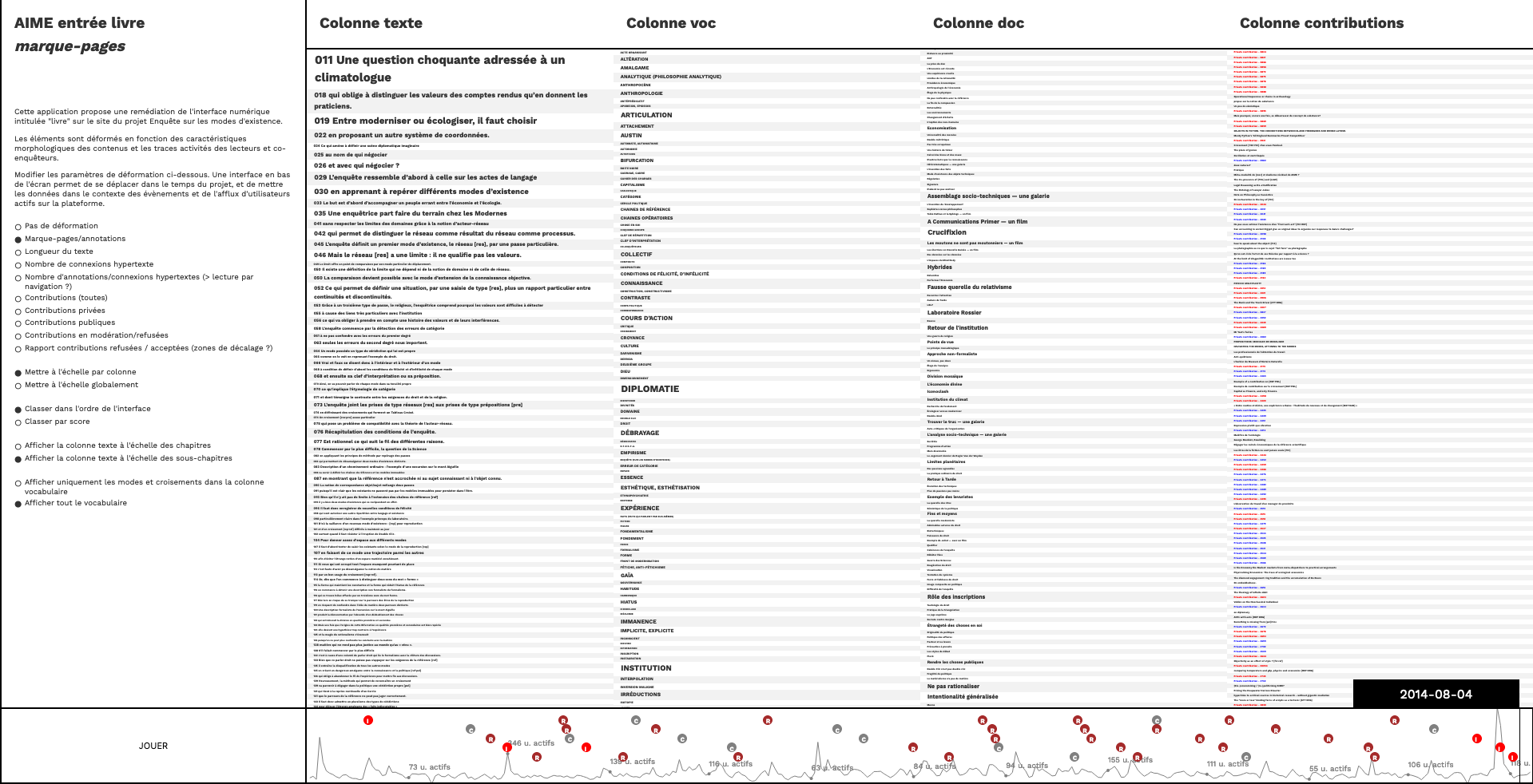 .
.
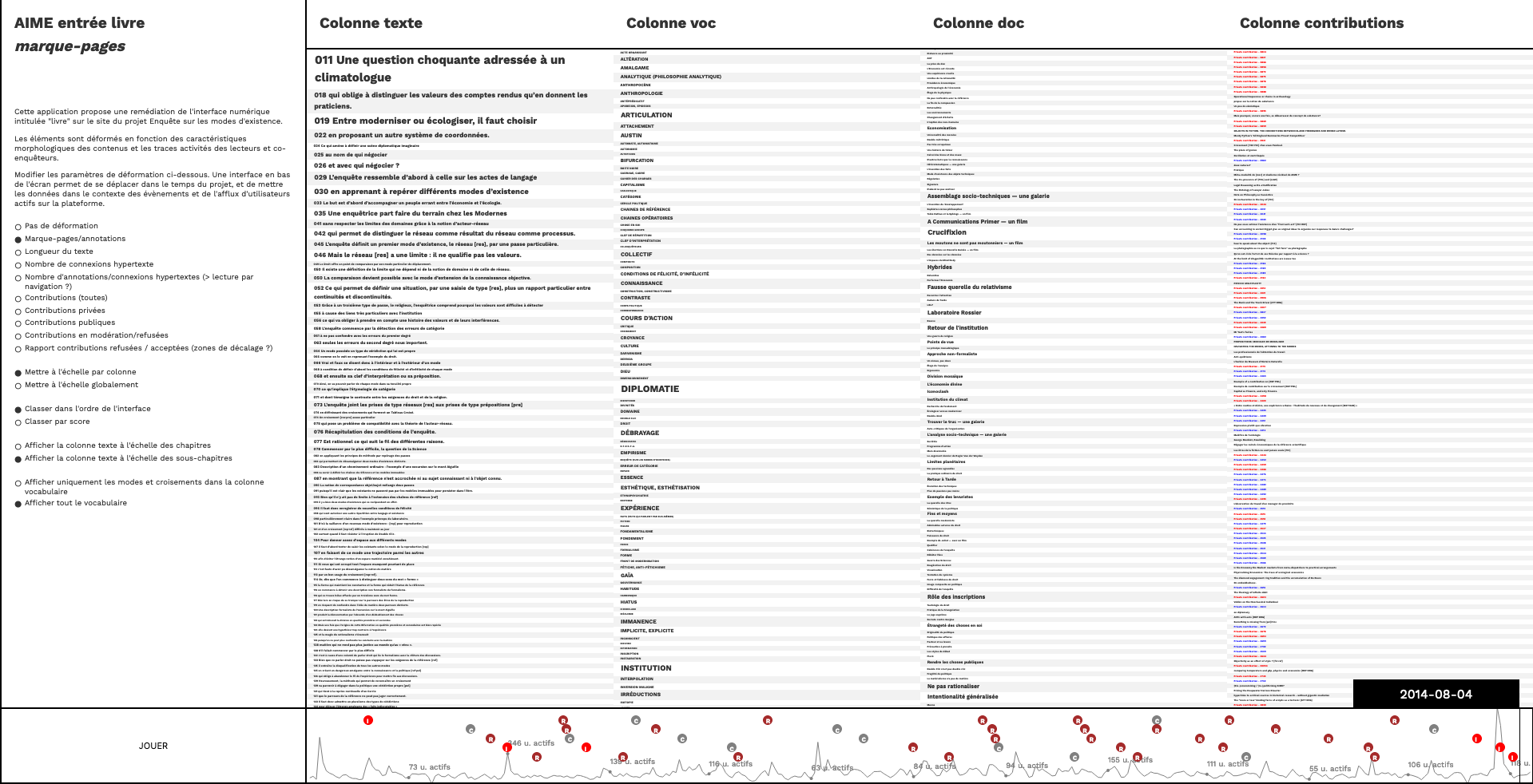 .
.Les retours écrits, entretiens et rencontres effectuées avec les lecteurs – ainsi que les diverses recensions de l’ouvrage – laissent à voir une diversité de sensibilités à la lecture sur écran des composantes de l’enquête. Certains lecteurs font état d’un « sentiment de flux »75 impliqué par la valse des compositions et des reconfigurations de l’écran, et rapprochent l’expérience de l’interface de lecture de celle d’un jeu vidéo, questionnant les effets rhétoriques impliqués par la configuration interactive du dispositif. La dimension numérique de l’EME est, pour d’autres, interprétée comme une manière de correspondre avec le projet philosophique de l’enquête, autorisant une multiplicité de points de vue et de compte-rendus – mais risquant également de perdre les lecteurs dans une abîme de complexité76 . Certains lecteurs partagent ainsi l’expérience d’une « atemporalité labyrinthique »77 pour qualifier leur expérience de lecture sur l’entrée numérique livre, témoignant, pour certain, d’un temps très important passé avec l’enquête en ligne78 .
Si une part des récits d’utilisation de l’édition numérique se trouvent alignés avec les intentions de conception de l’équipe, on trouve aussi de nombreuses mentions de situations de dérive et de désorientation lors des situations de lecture79 . L’omniprésence du texte et de la typographie est vécue comme pesante pour certains (Lousley, 2016, p. 118), alors que la prolifération des acronymes et des symboles donne à d’autres l’impression d’arriver dans une conversation à laquelle ils n’ont pas été invités (Brown, 2016). Les témoignages laissent en ce sens voir un paradoxe important quand à l’apparence soignée et finalisée des éditions. Pierre-Laurent Boulanger, qui se fait le porte-parole des nombreux « co-enquêteurs » avec qui il a eu la charge d’échanger et de collecter les retours, relate qu’« on a pas lʼimpression de rentrer dans une plateforme dʼenquête collective, mais on a lʼimpression de rentrer dans un livre déjà écrit, qui se présente un petit peu sous une forme très léchée, très belle, comme une bible, et ça a un effet intimidant ». Des comparaisons avec des ouvrages d’autorité – au premier rang desquels les ouvrages sacrés – se retrouvent dans plusieurs des comptes-rendus, et sont vus par Pierre-Laurent Boulanger comme des freins pour l’encouragement à la contribution. Dans ce cadre, l’ensemble des éléments de l’édition numérique – son contenu, ses systèmes typographiques, mais également sa mise en scène graphique et interactive – sont mêlés pour rendre compte de la disposition sensible induite par l’interface numérique :
Les quatre colonnes par exemple, à trois reprises cʼest revenu cette idée que cʼest les quatre colonnes avec cette idée très sacrée, très belle quoi. Et le fait que ce soit très beau avait un effet aussi contre-productif, parce que cʼest pas un « draft »80 , si cʼest si beau cʼest que cʼest pas un « draft », or ça se présentait comme un rapport provisoire.
Ce dernier point se retrouve dans les réponses de questionnaire, faisant la mention de situations d’auto-censure (« j’ai apprécié l’exigence des contributions, mais ne me suis pas sentie à la hauteur de cette exigence pour contribuer ») ou encore de « paralysie devant la somme qu’est l’enquête ». Dans ces différents comptes-rendus, il est difficile voire impossible de distinguer ce qui relève des « contenus » de l’enquête en propre – sa difficulté, son échelle – et des dispositions induites par le design de l’interface. Ces différents éléments concourent à dessiner à l’intérieur du collectif des utilisateurs de l’édition numérique un groupe de « lecteurs » appelés à rester passifs du point de vue du projet, et d’autres se lançant dans la contribution.
Des prérequis exigeants
Outre les facteurs inhérents à l’infrastructure elle-même, le profil et les compétences des potentiels « co-enquêteurs » jouent également un rôle extrêmement important dans la mise en œuvre du collectif recherché par l’EME. La question de la « littératie numérique », entendue comme la « possession des connaissances et compétences en lecture et écriture permettant à une personne de s’engager efficacement dans une variété de contextes et d’activités » (Gerbault, 2012, p. §17) relatifs aux interfaces graphiques et conventions incorporées dans les dispositifs numériques, s’est avérée également un facteur de filtrage important. Ainsi, aucun des répondants au questionnaire qui avaient déclaré une faible ou très faible littératie numérique n’a écrit, ne serait-ce qu’une contribution.
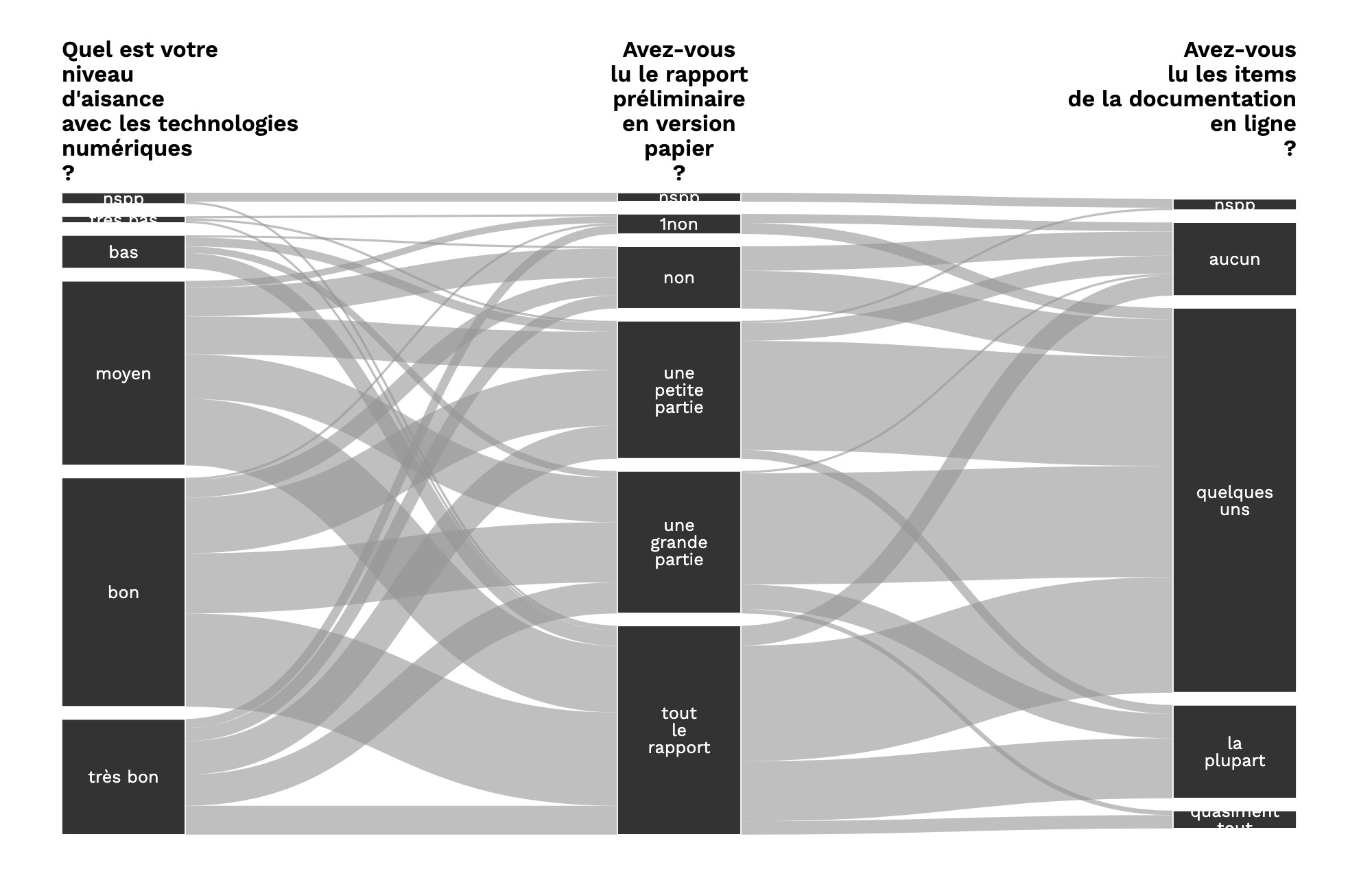
Cela recoupe mon expérience d’observation du processus de contribution sur le terrain, où l’équipe a consacré un temps important à travailler et accompagner les participants aux ateliers philosophiques dans la rédaction de leurs contributions. Cela est corroboré par une corrélation très fréquente entre la participation aux ateliers et la contribution effective sur la plateforme.
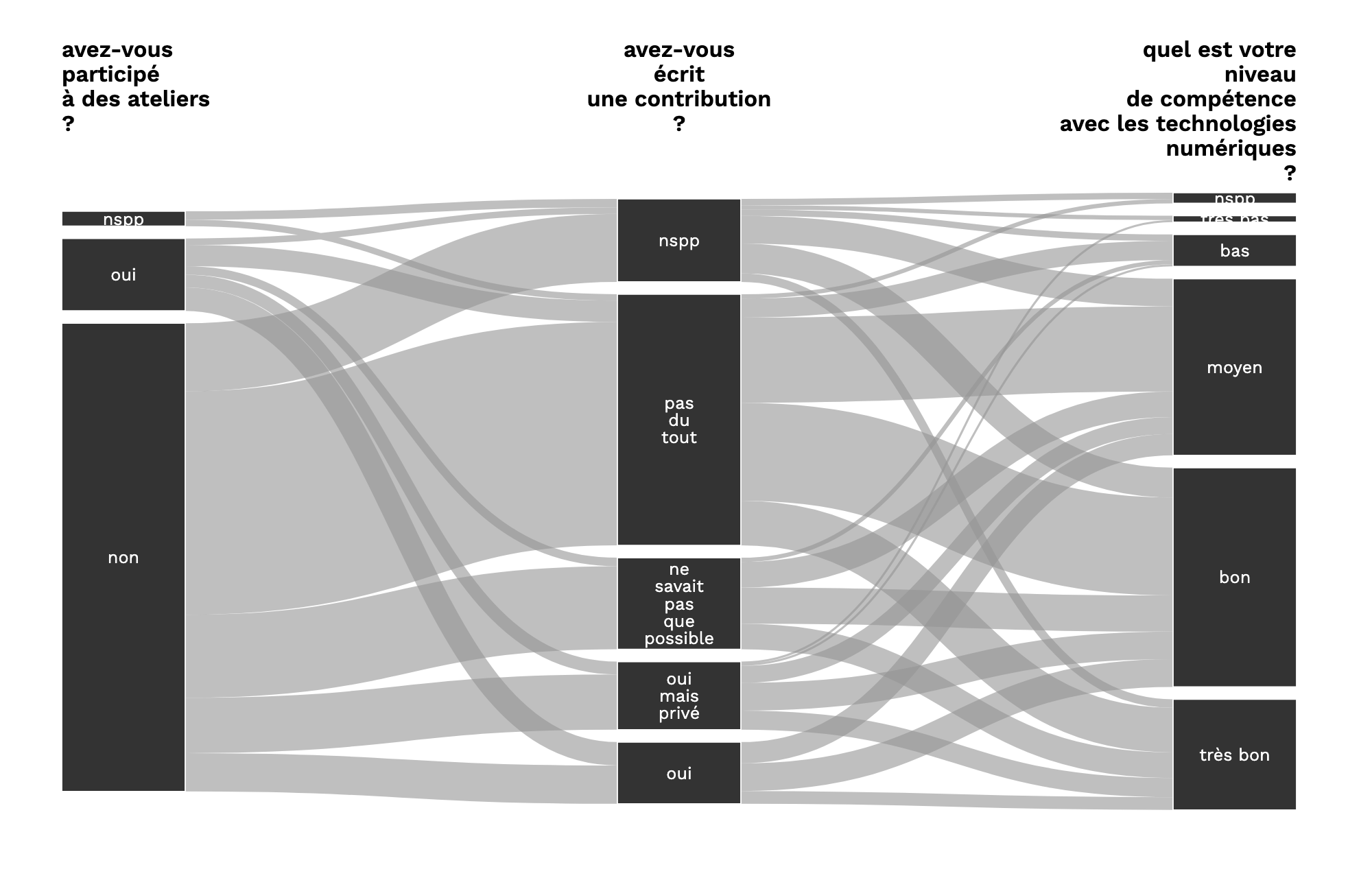
Ainsi, on peut supposer qu’une part importante de personnes ayant accédé à l’enquête exclusivement par son versant numérique et n’ayant pas profité d’une aide supplémentaire lors des rencontres physiques, sont restées en dehors de la dynamique de contribution. Les personnes en capacité de devenir co-enquêteurs par le biais seul de la plateforme numérique correspondent à une petite portion d’individus à la fois compétentes en philosophie et sciences humaines et en usage des dispositifs numériques. D’autres facteurs – et notamment la proximité sociale et/ou géographique avec les lieux de rencontre diplomatique – permettent de préciser comment s’est formé le public des contributeurs de l’EME.
Contribuer à l’enquête : la formation négociée d’un collectif de recherche
La participation en ligne à l’EME – et l’éventuelle publication de « contributions » sur les éditions numériques – est un point central pour comprendre la constitution du collectif formé par le projet, parce qu’elle est le seul moyen pour des contributeurs « inattendus » – non fréquentés a priori par l’équipe et son investigateur principal – de rejoindre le travail de réécriture et de redéfinition collective des modes d’existence.
Lʼatypique combinaison de pratiques requise par le scénario de participation en ligne de l’EME demande aux lecteurs de passer par une série d’étapes conçues pour transformer leur travail en une contribution concordante avec le projet diplomatique et empirique de l’enquête. Pour ce faire – suivant la suggestion de réagir à des parties spécifiques du texte plutôt que d’apporter des remarques générales – les internautes sont censés sélectionner, dans un premier temps, un point d’ancrage pouvant être un mot ou un paragraphe, provenant du texte, du vocabulaire ou de la documentation, et ensuite lui attacher une « contribution ». Cette dernière doit être écrite dans l’interface proposée sur le site selon un format bien précis, constitué d’un résumé puis d’une série de « diapositives » imposant d’associer à chaque temps du développement écrit un document empirique – qui peut être un texte, une image, ou un document vidéo.
Le statut des « co-enquêteurs » impliqué par la procédure de contribution de l’interface est hybride : il se situe à l’intersection entre les régimes d’autorité propres à la communication scientifique et les nouveaux modes d’écriture collective impliqués par le web, aux premiers rangs desquels les blogs et plateformes contributives. Il est par ailleurs l’objet de nombreux débats et discussions tout au long du projet. À l’issue de la phase de négociation, à l’automne 2014, il est décidé, afin de les valoriser, que les contributeurs publiés sur la plateforme en ligne soient présentés sur la page principale du site – associés aux contributions qu’ils ont écrites. Ils constituent alors la partie la plus visible du collectif de l’enquête, et correspondent à la communauté des « co-enquêteurs » imaginée par le projet de l’EME.
Ce « deuxième cercle » recoupe une partie des « compagnons de route » de Bruno Latour (Latour, 2012a), sans pour autant s’y résumer. En effet, sur les 61 contributeurs ayant vu au moins une de leurs propositions publiée sur le site, 16 avaient déjà publié des textes avec l’investigateur principal de manière antérieure à l’enquête et 18 – dont une part importante recoupe le premier groupe – participé à des communications communes, les deux tiers du collectif étant des personnes associées à la recherche par le biais de l’édition numérique et des journées d’étude. Ces informations permettent d’apprécier la composition d’un réseau articulé par le nœud central de son investigateur principal sans pour autant s’y superposer totalement.
Par ailleurs, la dimension nécessairement interdisciplinaire de la négociation des différents modes conduit une diversité de métiers et de disciplines universitaires à trouver une voix à l’intérieur de la plateforme, sans pour autant pleinement réussir à impliquer des personnes non issues du monde universitaire dans le processus de réécriture de l’enquête. Les contributeurs acceptés, au moins aux deux tiers, sont des membres de la communauté académique (professeurs, doctorants, chargés de recherche, etc.) provenant d’une diversité de disciplines et de pays. Les « non-universitaires » incluent des artistes, architectes, des écrivains, des ingénieurs, et des avocats, qui constituent une diversité de représentants pour les modes abordés dans l’enquête sans pour autant les couvrir totalement, mais constituent une relative minorité dans le groupe des contributeurs ayant proposé des contributions.
Un périmètre de contribution mouvant et varié
On peut maintenant s’intéresser à la composition effective des contributions et leur alignement avec les ambitions initiales de l’enquête. Tout d’abord, la visualisation des contributions publiées par chapitre du rapport préliminaire laisse à voir que l’ensemble du texte semble avoir été l’objet de contributions, avec cependant des disparités dans la couverture des différents modes abordés dans les différentes sections du texte. Ainsi, le chapitre portant sur le mode d’existence de la FICtion, et l’ensemble des derniers chapitres dédiés à la redescription du « continent économique » (modes ATTachement, MORale et ORGanisation) semblent avoir été l’objet d’une attention particulière, qui s’explique aussi par la quantité importante de rencontres qui leur a été consacrée – les derniers chapitres de l’Enquête en constituant la partie la plus inédites dans les recherches latouriennes.
Ensuite, il semble que la dimension « multimodale » mise au centre du design de l’interface et de la configuration des situations d’écriture de la contribution n’ait effectivement été que partiellement mise en pratique – du point de vue exclusif de la plateforme numérique – puisque quarante-et-une des cent-trente-quatre contributions contiennent des images et/ou des vidéos visant à rendre compte d’expériences empiriques. La complémentarité entre les composantes numériques et « physiques » de l’infrastructure est par ailleurs directement visible dans 11 des contributions qui mentionnent explicitement l’un des « ateliers diplomatiques » de l’enquête, d’autant plus que l’analyse quantitative des contributeurs révèle que la quasi-moitié d’entre eux a participé à moins l’une des rencontres diplomatiques. Ce dernier point suggère en creux l’influence invisible des comptes-rendus et présentations empiriques – dont j’ai été le témoin durant mon terrain – lors des rencontres face-à-face sur un nombre plus important de contributions.
| titre | url | langue | auteur | cible | document texte | document image | document vidéo | extrait de rencontre | type de contribution | mention d'un atelier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The "more or less" binding force of scripts as.. | www.modesofexistence.org/aime/doc/133 | en | Nicolas Bencherki | texte | 1 | versions alternatives des modes et de leurs croisements | ||||
| Les professionnels de l'obtention du travail | www.modesofexistence.org/aime/doc/68 | fr | marlène benquet | texte | 1 | versions alternatives des modes et de leurs croisements | 1 | |||
| Expérience religieuse et expérience amoureuse .. | www.modesofexistence.org/aime/doc/182 | fr | Pierre Beslay | texte | 1 | 1 | versions alternatives des modes et de leurs croisements | |||
| Ivan Illich et les pratiques des modernes | www.modesofexistence.org/aime/doc/194 | fr | Pierre Beslay | texte | 1 | versions alternatives des modes et de leurs croisements | ||||
| PSYCHIC MULTIPLICITY | www.modesofexistence.org/aime/doc/53 | en | Terence Blake | texte | 1 | versions alternatives des modes et de leurs croisements | ||||
| PREPOSITIONS: MODULER OR MODALISER | www.modesofexistence.org/aime/doc/66 | en | Terence Blake | texte | 1 | remarques de méthode et de positionnement fondamental de l'enquête | ||||
| NAVIGATING THE MODES, ATTUNING TO THE MOODS | www.modesofexistence.org/aime/doc/67 | en | Terence Blake | texte | 1 | versions alternatives des modes et de leurs croisements | ||||
| MODES AND COUNTER-MODES IN THE PLURIVERSE | www.modesofexistence.org/aime/doc/248 | en | Terence Blake | texte | 1 | proposition de mode(s) | ||||
| (Dis-)economizing / (re-)politicizing AIME? | www.modesofexistence.org/aime/doc/130 | en | Anders Blok | texte | 1 | 1 | versions alternatives des modes et de leurs croisements | |||
| Death by Document [MET-LAW] and [LAW-ORG] | www.modesofexistence.org/aime/doc/164 | en | Boris H. J. M. Brummans | texte | 1 | versions alternatives des modes et de leurs croisements | 1 |
Par ailleurs, le ton et la finalité des contributions publiées s’avèrent en fin de compte plus divers que les descriptions effectuées par l’équipe elle-même ou par ses recensions, bien qu’elles soient pour une majorité concordantes avec les pratiques envisagées. En effet, en accord avec le scénario initialement déclaré dans les présentations du projet, une majorité de contributions (102/134) propose des versions alternatives de certains comptes-rendus des modes d’existence et de leurs croisements, ou propose des documents – photographiques, vidéographiques, textuels – en rendant compte de manière plus fine et détaillée. Un autre ensemble de contributions (13/134) s’attache par ailleurs à travailler directement le texte et en proposer des reformulations, dans l’optique de la « réécriture » collaborative de l’ouvrage imprimé telle qu’elle était envisagée au départ du projet. Un dernier ensemble (18/134), cela dit, relève davantage de remarques méthodologiques générales vis-à-vis de l’enquête qui étaient pourtant à première vue présentées comme non valides vis-à-vis de la fonction de la contribution sur la plateforme. La moitié de ces contributions est produite par le Groupe d’Études Constructivistes (composé notamment de Didier Debaise, de Nicolas Prignot, d’Aline Waime et d’Isabelle Stengers – interlocuteurs fortement concernés par les enjeux de philosophie pragmatique et spéculative soulevés par l’EME), ce qui manifeste une forme d’hétérogénéité des statuts et des rôles dans laquelle le périmètre des contributions « autorisées » n’est pas aussi figé que dans ses présentations préalables.
La question de la redéfinition de nouveaux modes d’existence – sur laquelle le rapport préliminaire se termine sur le registre d’un « défi » aux co-enquêteurs – semble quant à elle peiner à trouver sa place dans l’infrastructure. On trouve une seule proposition de mode dans les contributions de la plateforme (Terence Blake, 2015), accompagnée d’un autre cas développé à côté de l’édition numérique au cours d’un entretien avec Lorenz Engell, Michael Cuntz et Yves Citton, sur la possibilité d’un mode « média » (Latour, Engell, & Citton, 2014). Dans ce même entretien, Bruno Latour revient sur le « cahier des charges » proposé par son enquête et la capacité des nouveaux modes à décrire chacun des autres :
En fait, il y a 75 000 modes d’existence possibles, bien entendu, la liste n’est pas finie. Chacun peut faire ce qu’il veut avec la notion de mode d’existence, je n’ai pas de quality control à exercer sur cette notion… Mais puisque vous me demandez mon avis sur l’intérêt d’un [MED], je dirais que cela pose trois questions : premièrement, est-ce qu’on voit des erreurs de catégories qui sont particulièrement repérables ? Deuxièmement, est-ce que ce mode a été élaboré dans la tradition des Modernes, de façon à ce qu’on puisse réflexivement le ré-instituer, et comprendre pourquoi il a été mal institué ? Et, troisièmement – c’est ce qu’on essaie de faire maintenant avec le travail de « diplomatie » – est-ce qu’il est urgent de souligner ce mode d’existence pour pouvoir se repérer dans la négociation actuelle ? Dans tous les cas, il faut avoir des documents face auxquels on se dise que si on n’a pas ce mode d’existence, on rate quelque chose et que les êtres propres à ce mode sont maltraités. (Latour et al., 2014)
L’exigence représentée par l’ensemble de critères présentés ci-avant, et l’absence de l’édition « cube » – abandonnée par manque de temps – initialement envisagée comme composante de l’infrastructure permettant aux lecteurs de composer plus librement avec les éléments du répertoire, se conjuguent pour expliquer les résultats numériques de l’enquête sur ce point.
Tactiques d’appropriation du format d’écriture de l’EME
Dans les récits des pratiques de contribution par les lecteurs, l’interface numérique prend une place centrale et se voit diversement prise en main par les différents internautes. Une partie d’entre eux témoigne d’une attitude expérimentale vis-à-vis du dispositif proposé, tentant d’apprendre à utiliser la fonction de contribution par des pratiques d’essai-erreur qui les conduisent progressivement à stabiliser une manière de travailler et de contribuer à l’enquête :
La première [contribution] était juste une sorte de test, un jeu, pour voir comment cette chose fonctionne. Et puis je lʼai lu, ou jʼen ai lu des parties, et ça a déclenché le travail que je suis en train de faire, et puis jʼai fait dialoguer ces choses. […] Je suppose que jʼavais un certain sens de ce quʼétait le langage, de ce quʼétaient les attentes intellectuelles, je faisais déjà un travail assez empirique, euh… alors je me suis dit que cʼétait la meilleure chose [une contribution empirique] que je pouvais apporter… […] Donc, je sais aussi que je ne savais pas si jʼétais censé pointer vers dʼautres documents, dʼautres réf… Jʼétais censé pointer des références et dire, ‹ regardez ça, ça croise ›, ou si jʼétais censé développer ça un peu plus. Et jʼai fait un peu des deux, et jʼai continué à développer.81
D’autres participants se placent davantage dans une situation d’apprentissage supervisé, valorisant la dimension de guidage de l’interface et du protocole de révision, et attendant du processus de « médiation » une sorte de formation philosophique via l’exercice d’écriture et de correspondance proposé82 . Cependant, pour d’autres encore, le caractère contraignant et protocolaire de la pratique d’écriture impliquée par la contribution est désigné comme un point bloquant et rédhibitoire en raison de la préparation qu’il implique. En ce sens, une grande quantité de répondants pointent le manque de temps impliqué par le calendrier du projet face à la spécificité de l’activité proposée d’une part, et l’exigence en termes de prérequis multiples et de la diversité des pratiques impliquées par l’infrastructure83 , d’autre part.
Le mécanisme de modération et de révision des contributions déclenché par la proposition d’une contribution sur la plateforme, qui déplace la discussion vers une correspondance épistolaire par email, provoque quant à lui un certain nombre de frustrations et de difficultés dans la communication avec les médiateurs. Un certain nombre de « décrochages » dans les échanges mail avec les médiateurs de l’enquête se produit alors, et provoque parfois des difficultés à transformer les correspondances privées issues de la contribution en modifications effectives dans l’interface de la plateforme :
Quand la contribution est validée en l’état, avec peu de corrections cela fonctionne bien selon le dispositif en place. Mais dès que le contribution est plus compliquée, car elle implique des modifications importantes suite à un rejet, le fil de la discussion peut vite se couper car l’échange par mail éloigne le commentaire et les arguments de la contribution présents sur la plateforme.84
À cette occasion, les différentes composantes et modalités de communication de l’infrastructure provoquent des correspondances manquées et cessent de « fonctionner » dans le sens de l’enquête collective. Elles témoignent cependant également du caractère ouvert du procédé, qui conduit la discussion à prendre des objets et des modalités non envisagées au moment du design de la plateforme.
Par ailleurs, dans la pratique même de la rédaction, l’interface de l’EME est souvent utilisée en articulation avec d’autres techniques d’écriture. Dans les réponses à l’enquête par questionnaire, un quart des lecteurs ayant écrit une contribution déclare l’avoir préalablement rédigée dans un logiciel de traitement de texte, et un autre quart l’avoir rédigée de manière manuscrite avant de la soumettre sur la plateforme (« Je ne lʼai pas utilisée non pas parce que je la juge inutile, mais dans mon cas, je nʼimagine pas contribuer autrement quʼà partir dʼune lecture papier, dʼune écriture manuscrite, débouchant seulement sur une publication numérique, recopiée en quelque sorte »). Par ailleurs, certains des contributeurs utilisent leur blog personnel pour écrire une première version de leur texte et la discuter dans cet espace avant de la proposer sur l’édition numérique du projet et la « soumettre » au processus de médiation plus institutionnalisé et centralisé85 .
Dans les échanges portant sur l’interface de contribution, les points de discussion principaux portent sur la double contrainte d’organiser les contributions en « diapositives » ancrées dans des références documentaires, et dans l’obligation d’attacher chaque contribution à une portion du texte ou du vocabulaire initialement écrit par Bruno Latour et ses assistants de rédaction. Cette dernière contrainte s’avère décourager un nombre important de contributeurs, qui ne trouvent pas l’opportunité d’engager un échange malgré des apports possibles :
Vous devez régler votre… le bouton, la souris – cliquer sur un point du texte et ensuite vous réagissez sur celui-ci. Et je nʼai pas trouvé beaucoup de points auxquels je pensais vraiment, cʼest là que je voudrais ajouter quelque chose, mais jʼavais des idées plus générales sur ce que je ressentais.86
On observe alors, en lisant les contributions et les correspondances qui leur sont attachées, se mettre en place différentes tactiques de contournement plus ou moins explicitées vis-à-vis de la contrainte de l’ancrage. Pour certaines des contributions, une négociation par mail aboutit à une relocalisation du lien hypertexte à effectuer. Pour d’autres, elles se retrouvent explicitement questionnées dans le corps des contributions publiées :
Cette contribution sʼefforce dʼintervenir sur un point général propre à la démarche de toute lʼEnquête. Cʼest pourquoi elle sʼancre sur le dernier chapitre et porte son attention sur lʼaboutissement de lʼontologie proposée à savoir le mode de la moralité [MOR], dernier mode du dernier groupe avant le groupe du méta-langage de lʼEnquête. (Viveiros de Castro, 2013)
Le caractère contraignant de l’interface des éditions numériques, manifestation processuelle du « protocole » d’enquête du projet, n’est cependant pas l’expression d’un impensé de la part de l’équipe de conception. Elle est, durant tout le temps du projet, au cœur des négociations internes à l’équipe quant au périmètre ou au volume de contributions attendues, qui ne fait pas consensus. Ainsi, les entretiens avec l’équipe révèlent des vues différentes sur le sens de la « contribution ». Pierre-Laurent Boulanger attend davantage de contributions, alors que Christophe Leclercq est, eu égard aux contraintes d’édition mentionnées et la sous-estimation du travail de médiation, peu surpris par la quantité atteinte. Les retours de Pierre-Laurent Boulanger, coordinateur des médiateurs et des correspondances avec les co-enquêteurs, font état de la difficulté des lecteurs à entrer dans le processus de médiation, mais aussi de longues discussions internes qui aboutissent au choix de ne pas trop encourager la contribution, pour des raisons de ressources humaines et techniques. Le rôle de l’interface de l’édition livre est alors crucial, puisqu’il devient le filtre conditionnant la quantité et la « qualité » des contributions reçues :
La prise en main du design de lʼinterface nʼétait pas évidente. Et je me suis rendu compte assez rapidement quʼil y avait un goulot dʼétranglement important sur le simple fait que toute lʼenquête reposait sur un tout petit dispositif technique qui était la capacité des gens à voir sʼafficher ce menu contextuel avec une étoile bleue et une petite bulle, un petit… une infobulle mais ça porte un nom grec qui mʼéchappe… un phylactère. Un petit phylactère qui veut dire ‹ vous pouvez commenter ça ›, et donc ce petit menu contextuel déjà il y avait beaucoup de gens qui arrivaient même pas à le faire sʼafficher, il y avait beaucoup de gens qui une fois quʼil sʼaffichait ne comprenaient pas quʼest-ce quʼon attendait, et ça ça a été très difficile.
Si elle est le lieu central du processus de contribution numérique de l’enquête et son artefact le plus visible, l’interface de contribution de l’édition « livre » n’est cela dit pas le seul lieu de développement numérique de l’enquête. Une quantité importante de contributions refusées ou laissées en suspens sur la plateforme de l’EME trouvent en effet d’autres vies à l’intérieur d’espaces de publication non prévus à l’avance.
Refusants et refusés : stratégies d’externalisation et de réappropriation
Dans l’écart entre la communauté des lecteurs et le collectif des « co-enquêteurs » publiés sur la plateforme et souvent également invités dans les « rencontres face-à-face », se trouvent un troisième cercle constitué par des personnes aptes à la contribution – sur le plan de leurs compétences techniques et intellectuelles – mais n’ayant finalement, de leur propre gré ou à cause du processus de modération a priori, pas intégré le collectif de l’enquête. Il est difficile, par définition, d’obtenir une connaissance exhaustive de ces personnes ayant pris connaissance du projet et ayant pourtant évité voire refusé d’y participer. Cependant, dans les entretiens conduits ainsi que mon expérience de terrain, j’ai identifié trois types de « refus » vis-à-vis de l’utilisation de la fonction de contribution.
Une première catégorie de « refusants », regroupant notamment des universitaires attachés à l’étude sociale des techniques, aux cultures du web et ou encore aux humanités numériques, invoquent le manque d’ouverture technique de la plateforme – par exemple, l’incapacité de citer une contribution effectuée, ou l’absence d’intégration et de respect des standards de publication de données. La non-participation relève alors à la fois d’un refus de principe visant à encourager des initiatives moins centralisées, et de problèmes relatifs à la reconnaissance du travail intellectuel fourni sur la plateforme.
Au manque d’ouverture technique et éditoriale s’ajoutent des réticences vis-à-vis du contrôle du processus de contribution et de médiation, perçu comme un mécanisme « d’autodéfense » n’autorisant pas la critique des présupposés de l’enquête – certains lecteurs allant jusqu’à parler de « censure » au cours des entretiens. Là où la contribution publique à des démarches de « science contributive » en ligne telles que la transcription de documents historiques ou la recension d’animaux ne semble pas susciter de protestations sur le caractère « fermé » de leur protocole, la conjonction entre la méthode philosophico-anthropologie de l’enquête et l’appel à une « contribution » à la finalité très cadrée n’est pas acceptée par une part importante des personnes rencontrées au cours de mon terrain. Cette répulsion est accentuée par les propos de Bruno Latour au cours des présentations publiques du projet, qui présente la « fermeture » du protocole de l’EME comme la garantie de sa qualité, et stigmatise la pratique du commentaire sur les espaces du web comme intrinsèquement non-constructive. Ce faisant, il s’attire ainsi notamment les foudres et le rejet d’une grande partie de la communauté des « chercheurs-blogueurs » qui, pour une part, boycottent la plateforme (Ruiz, 2015). D’autre part, l’investigateur principal associe à plusieurs reprises la « clôture » de la plateforme (closeness) avec la nécessité de créer un espace attentionnel protégé, approprié pour des pratiques de lecture soutenue (close reading). Il met ici en œuvre une association qui est critiquée notamment dans le champ des humanités numériques en termes de discours et d’ethos de recherche. La perception de la plateforme et du projet se voit alors recadrée dans un débat – quelque peu abstrait de chacune des parts – reposant sur la déclaration de valeurs divergentes entre des tenants de « l’openness » et un projet EME supposément marqué par un projet de « clôture ».
Enfin, un dernier groupe de refusants mobilise des raisons éthiques liées cette fois à ce qui est perçu comme une asymétrie dans le crédit symbolique et intellectuel des écrits publiés sur la plateforme. Durant les échanges autour du projet – notamment suscités par la présentation de mes reconstitutions – le projet se voit à plusieurs reprises critiqué comme relevant d’une forme de crowdsourcing non rétribué, soit une délégation injuste du travail de recherche. Ainsi, par exemple, durant un évènement français dʼhumanités numériques (THATCamp Saint-Malo 2013 : Non actes de la non conférence, 2014) la nature collective du projet EME est remise en question du fait de la non-réciprocité de crédit entre lʼauteur principal et les contributeurs : les co-enquêteurs soulignent qu’ils dédient un temps colossal à lʼenquête sans être suffisamment reconnus comme dʼauthentiques auteurs. Durant cette rencontre, le principe même de la contribution est discuté selon des modalités de reconnaissance du travail intellectuel, qui se retrouve cité comme raison chez les « refusants » intéressés par le projet mais n’ayant pas participé aux activités proposées. Si d’autres pratiques éditoriales – participation à des comités éditoriaux et scientifiques, revue d’articles – est par ailleurs acceptée par ces lecteurs non-contributeurs comme une forme de travail légitime, elle ne l’est pas dans le cas de l’EME, à la fois à cause du cadre institutionnel centré autour d’un seul auteur bien identifié, et de la particularité des dispositifs et des termes utilisés pour décrire les attendus de cette forme de contribution.
Par ailleurs, le processus de « médiation » des contributions proposées sur la plateforme numérique de l’EME, et ses insistances répétées et matérialisées dans l’interface sur la spécificité des productions attendues via son format d’écriture, implique qu’une part des lecteurs entrés en contact avec l’EME sont restés malgré eux à l’extérieur du collectif des « co-enquêteurs ». Outre les « refusants », le projet et sa dynamique de modération produit également des « refusés », dont certains ont vu l’ensemble de leurs propositions laissées en suspens par le processus de modération : 31 sur les 92 contributeurs ayant proposé au moins une contribution à la publication sont ainsi dans cette situation.
Les refus et impasses dans le protocole de médiation épistolaire provoquent alors des réactions fortes chez certains des co-enquêteurs les plus investis et les plus actifs dans les espaces publics numériques. Les correspondances manquées avec les médiateurs et les contraintes impliquées par l’infrastructure de l’enquête sont alors mises en balance avec l’investissement fourni pour faire connaître et expliquer la démarche de l’enquête, perçu comme un décalage entre ce qui est perçu comme des pratiques de participation et leur reconnaissance sociale et symbolique :
Jʼai écrit et publié sur mon blog, sur Scribd, et sur academia.edu, plus dʼune centaine de pages résumant mes réactions au projet AIME. Jʼai analysé le statut philosophique du livre, examiné ses sources philosophiques et discuté des projets comparables menés par dʼautres philosophes contemporains (notamment Hubert Dreyfus et Bernard Stiegler), et je me suis concentré sur lʼexamen critique des récits des modes scientifique, métamorphique et religieux. Je nʼai reçu aucune réponse.87 (Terence Blake, 2014)
Ces co-enquêteurs deviennent alors à leur tour – pour un temps ou de manière durable – des « refusants » vis-à-vis de la participation à la plateforme, mais mettent néanmoins en œuvre une série de stratégies de contournement pour continuer à écrire à propos de l’enquête. Une partie d’entre elles s’inscrivent dans la section « commentaires » du blog de l’EME, non soumise à la modération88 , ou encore sur le réseau social Twitter. Une autre s’exprime via la re-publication de tout ou partie de leurs propositions dans des espaces autres, sur les blogs personnels des chercheurs et via la publication de documents sur le réseau social scientifique academia. Certaines de ces productions relèvent de critiques générales du projet, alors que d’autres sont d’authentiques contributions « apocryphes », qui sont à leur tour commentées et parfois relayées sur le blog du projet. Un contributeur explique à ce titre la manière dont le caractère contraignant de la plateforme s’est vu compensé par une multiplication des médias et des lieux de déroulement de la discussion collective :
Ehm… parce que jʼai considéré la contribution sur la religion que vous pouvez… Jʼai considéré que cʼétait une bonne contribution. Jʼy ai travaillé, je lʼai écrite, je lʼai réécrite plusieurs fois… et jʼai pensé quʼil nʼétait pas acceptable quʼil [Bruno Latour] ne la publie pas. Jʼavais beaucoup plus à dire mais lʼéchange et la discussion qui est exclue par la structure de la plate-forme, est possible pour moi, parce que jʼai un blog. […] Et je ne vais pas faire … venir et supplier pour faire accepter une contribution dans la ligne du parti. Cʼétait une… pour moi une invitation à parler encore plus librement eh… sur mon blog, sur Facebook… et sur Tumblr, Youtube et Facebook et Twitter. Jʼai donc décidé que je parlerais en mon nom propre.89
Les différents jeux d’externalisation et de reformulation des « refusés » vis-à-vis de la plateforme témoignent de la plasticité de l’enquête collective et de l’expansion de son infrastructure, en cours de projet, au-delà des seules éditions conçues et fabriquées par l’équipe. La multiplicité des modes d’écriture traduit diverses stratégies de négociation avec la plateforme – mais également avec l’équipe du projet – pour tenter d’infléchir sur la direction et les règles de conduite de l’enquête collective, démonstrative de la diversité des intérêts et des finalités établies collectivement par les publics amenés à pratiquer les éditions numériques.
Entre négociation d’un cadre commun et horizons de pratique divergents : comment un format de publication fabrique-t-il un public ?
Le format de publication de l’EME est multiple et hétérogène dans la mesure où il est distribué dans la diversité de ses éditions et des différentes pratiques et protocoles que ces dernières instaurent sur un mode processuel, mais également par le fait des différentes connotations et genres de pratiques auxquelles elles ont été rattachées lors de la découverte et de la participation au projet. Dans un entrelacement complexe et rétroactif entre discours – de la part de l’équipe elle-même, des recenseurs et des participants – et pratiques de fréquentation des éditions, le projet EME s’est vu investi d’une multiplicité d’horizons de pratique divergents ayant concouru à son appropriation mais également à sa négociation et sa contestation en cours de route. Les publics de l’EME se sont ainsi construits par l’adhésion et la contribution à un projet commun, mais également par le biais d’un ensemble de décalages et de distanciations provoqués par l’idiosyncrasie du dispositif matériel et discursif proposé à la participation.
Le format de publication de l’EME est également multiple parce qu’il évolue au gré de son déroulement, sous la double influence des lourds processus de fabrication matérielle et numérique qui en jalonnent le déroulement, et des tactiques d’appropriation par les participants, par lesquelles détournements et traductions font entrer de nouvelles composantes et horizons de pratique dans l’infrastructure de l’enquête, et font évoluer son format socio-technique d’écriture. L’utilisation des blogs, par exemple, introduit ses propres modalités de régulation et de cadrage de la production textuelle comme l’un des horizons de pratique participant de l’EME. Certaines manières de pratiquer les éditions sont alors renforcées et mises en visibilité plus que d’autres, alors que d’autres éditions encore se voient discutées et remises en question par les dynamiques de comparaison avec des formats existants. Cela traduit la capacité de ce format expérimental à produire un effet de réflexivité fort chez les participants, qui les conduit à discuter la pratique de l’EME, mais également à mettre en examen leur pratique plus étendue des rituels et des institutions de la publication universitaire.
Pour décrire l’effet produit par la remise en contexte permanente de l’EME dans des pratiques et des horizons plus étendus, je propose d’utiliser le vocabulaire associé à l’étude des cadres expérientiels telle qu’elle est construite par le sociologue Erving Goffman (Goffman, 1991). Pour Goffman, les cadres désignent les « principes d’organisation qui structurent les événements » (Goffman, 1991, p. 19) et participent ainsi de la définition d’une situation sociale par les individus. Un cadre participe de la perception d’un cours d’action autant que de sa « pratique », dans la mesure où il correspond à un ancrage de l’activité qui définit la manière dont un individu se comporte en fonction des règles et des finalités qu’il attache à la situation qu’il est en train de vivre. L’activité est alors construite par des mécanismes de reconnaissance qui conduisent à identifier un cadre donné et agir en fonction de ce dernier. Cependant, ces mécanismes peuvent être complexifiés par un processus dit de modélisation, qui consiste pour les participants à reconnaître de nouvelles règles d’interprétation par lesquelles une activité déjà pourvue de sens en prend un autre en prenant la première comme modèle90 – Goffman utilise ce concept pour décrire des activités telles que des compétitions sportives, des cérémonies, ou des performances théâtrales. Dans le même sens, l’auteur introduit également le concept de fabrication pour définir des activités délibérées de production de cadres qui viennent désorienter et requalifier l’expérience des individus par l’ajout d’autant de modèles à la compréhension de la situation.
Selon cette perspective interprétative, la conception du format de l’EME agit comme la fabrication de cadres visant à conduire les participants dans le protocole de l’enquête collective. Cependant, on l’a vu, l’appréhension de ces cadres entre en dialogue avec les modèles déjà connus des participants, dans le cadre de leurs activités de communication scientifique, qui apportent ainsi des strates d’interprétation nouvelles à la situation et en modifient le déroulement. La réaction et la participation – ou non – des lecteurs au protocole de l’enquête participent alors d’un ancrage de l’activité dans un enchevêtrement de cadres discordants qui concourent à en faire un lieu de débat réflexif autant que de conduite de la participation en elle-même. Ainsi, le collectif de l’EME se constitue par une série de mécanismes de reconnaissance déjouée inhérente à son caractère expérimental à plusieurs niveaux, qui invitent constamment de nouveaux membres dans un collectif, sans qu’il existe pour ces derniers une préoccupation uniforme, un problème unique à résoudre, un cadre commun consensuel pour l’interprétation de la situation d’enquête collective.
La diversité des attitudes et des individus amenés à interagir avec le projet n’est cependant pas due qu’à des mécanismes d’interprétation « passive » et de réaction à la proposition qui leur est faite, mais découle aussi de l’hétérogénéité des attentes et des préoccupations des participants de l’enquête : suivant qu’elle soit abordée par des passionnés d’ontologie pluraliste, d’humanités numériques, de collaboration en ligne, d’anthropologie ou de design participatif – sans parler de la diversité des attachements de ces derniers aux différents modes d’existence mis au cœur du projet – l’EME se présente selon des traits et des « cahiers des charges » différents.
Pour éclairer les conditions de constitution collective impliquées par cette diversité, je propose de réemprunter le concept de philosophie politique de public élaboré par John Dewey dans son ouvrage Le public et ses problèmes (Dewey, 1927/2010). Les publics de Dewey ne sont pas des masses ou des objets contextuels existant a priori : ils ne sont ni des abstractions, ni la définition de groupes ou de milieux sociaux particuliers – comme le serait la « sphère publique » décrite par Habermas par exemple (Habermas, 1988). Ce sont plutôt des « faits », dans le sens où un public se fait par les activités qui le constituent, ancrées dans des situations, des matérialités et des activités individuelles et collectives. Plus précisément, ces activités sont définies par un certain régime dʼanticipation des conséquences à venir dʼun problème donné – ou, dans le vocabulaire deweyien, d’une activité d’enquête. Les publics de Dewey sont donc avant tout situés : ils dépendent des contextes et conditions dʼexpérience dʼun problème, d’un souci, ou d’une préoccupation. Ceci implique quʼil peut exister de nombreux publics pour un même problème – chaque public étant défini par son type dʼanticipation spécifique – mais également que des publics peuvent être assemblés par « intersection » de problèmes aux conséquences partagées. Ainsi le problème du public deweyien n’est pas qu’il manquerait d’une définition : c’est plutôt un problème d’action, construit par des pratiques.
Le problème de l’EME, tel que défini par Bruno Latour, est posé par la question du pluralisme ontologique et le projet diplomatique sous-jacent à l’ensemble de son enquête personnelle. C’est cette motivation et ce projet qui conduisent à la fabrication et à la mise en pratique de l’infrastructure du projet et de son format socio-technique d’écriture. Cela dit, dans le même temps, ainsi que le propose Carl DiSalvo, en reprenant notamment la question posée par Bruno Latour et Peter Weibel sur « comment rendre les choses publiques » (Weibel & Latour, 2005), on peut retourner la question en se demandant en retour comment les choses fabriquent-elles des publics (« how are publics made with things ? ») à leur tour91 . L’imposante collection d’éditions et de « choses » qui constituent l’EME peut alors être vue comme l’intersection d’un ensemble de préoccupations, d’intérêts divergents, de « problèmes » qui participent de la constitution du collectif si particulier qui a été amené à s’y intéresser, à le fréquenter, et parfois à y participer. Le collectif de l’EME s’est ainsi formé en tant que public pluriel, un public qui ne s’est jamais totalement aligné avec la proposition et les recommandations de son investigateur principal, ainsi d’ailleurs qu’il le concevait en partie lui-même, dans la présentation de son projet :
Je considère donc que … mon intérêt est différent de celui des contributeurs bien sûr, mais mon intérêt est que les contributeurs mʼaident à remplir mon questionnaire [rires]. Mais vous ne pouvez pas demander aux gens de contribuer. Leur intérêt est donc dʼutiliser lʼargument pour enquêter sur dʼautres types dʼaffaires qui les intéressent très directement.92
Les mécanismes de reconnaissance déjouée décrits ici impliquent également une forme de réflexivité, invitant à interroger les conventions qui seraient invisibilisées par l’habitude. On peut ainsi décrire l’EME à la fois comme l’instrument d’une enquête à la finalité bien définie, et comme une expérimentation ouverte permettant d’interroger les tensions à lʼœuvre dans la déstabilisation des formats contemporains de publication universitaire.
Conclusion
À travers le cas de l’Enquête sur les Modes d’Existence, ce chapitre a été l’occasion d’étudier les effets de démarches de publication expérimentales sur les dynamiques de formation sociale des collectifs de recherche en SHS. La publication a alors été envisagée dans sa capacité à former des publics, c’est-à-dire à assembler un collectif de lecteurs et d’écrivains autour de préoccupations partagées. En ce sens, le public de l’Enquête sur les Modes d’Existence est un public problématique. Il est problématique parce qu’il est construit par un ensemble de problèmes, de préoccupations et d’intérêts hétérogènes qui se forment et s’entrechoquent au contact de son format de publication et impliquent le coûteux aménagement de son infrastructure en cours de route. Il l’est également par sa géographie disputée et hybride, à la frontière entre mondes universitaires et espaces médiatiques, hésitant entre le territoire-continent d’un chercheur emblématique et l’archipel de contributeurs qu’impliquent son projet de formation collective. C’est cette qualité problématique qui conduit le collectif formé par l’EME dans une trajectoire ouverte et vacillante, dans laquelle la « mise en œuvre » du projet établi par un chercheur principal ne se résume pas à l’exécution d’un programme prédéfini dans les termes de son financement et de sa conception initiale.
Tous les paradoxes de l’EME ne pouvaient pas être repérés avant que le projet ne se soit déroulé. Ce faisceau de paradoxes, travaillé et exacerbé par l’énergie très importante investie par toute l’équipe du projet, devait nécessairement provoquer une foule de réactions et de retours contradictoires. Ces réactions, grâce à la surface médiatique couverte par les différentes éditions du projet et la notoriété de son investigateur principal, touchent comme on l’a vu des milieux variés : amateurs et professionnels de la philosophie, des Science and Technology Studies, de l’art et du design numérique, etc. Tous sont venus à l’EME avec des horizons diversifiés et des intérêts divergents, produisant des cadres interprétatifs multiples et les mêlant à travers l’existence publique du projet. Ils ont progressivement découvert son infrastructure, rencontrant ses formats selon une diversité de pratiques et de cultures. Ils ont alors formé un public polymorphique en réagissant à la proposition qui leur était faite selon une diversité de perspectives et d’horizons de pratique qui sont devenus en partie ceux du projet. Ce public est apparu à l’équipe de l’EME de manière parcellaire et plurielle au moyen de rencontres fugaces et de données imparfaites qui permettaient seulement d’en dessiner la silhouette. Dans ce contexte, mon rôle a alors consisté à faire office de « dessinateur », non sans une influence – modeste – rétroactive sur la conduite du projet, et conscient de la dimension récursive et de mise en abîme – jusqu’au vertige – de ma démarche.
Comment un format de publication fabrique-t-il public ? Dans un contexte universitaire où, comme lʼa formulé Andrew Murphie, « les contaminations écologiques entre toutes les formes dʼédition sont nombreuses, de sorte que la publication est maintenant une sorte de ‹ chaosmos › » (Murphie, 2008), lʼexpérience de l’EME nous apprend que les stratégies dʼédition distribuées et ouvertes impliquées par une pratique de la publication comme infrastructuration, favorisent une tension complexe entre lʼagrégation d’un collectif hétérogène et la participation qu’implique la communauté de pratiques qui en résulte. La diversité des éditions mobilisées par les stratégies multimodales de l’EME favorisent alors un jeu de répétition et de différence dans lequel le format dʼun projet – compris comme l’ensemble spécifique de cadres proposés par ses divers équipements – se voit mis en tension avec la reconnaissance et la performance des formats amenés par les nouveaux participants au sein du collectif de recherche ; à travers ces derniers, les participants déploient des horizons de pratique divergents qui s’assemblent pour construire une situation faite de malentendus, de décalages, de déviations, mais également pour inventer des perspectives d’interprétation multiples motivant parfois la transformation de lʼinfrastructure. Pour l’EME, les déplacements impliqués par ces perspectives divergentes ont non seulement conduit à faire participer à la négociation un important éventail de « chercheurs » et de « praticiens » différents, mais aussi à donner lieu à des expérimentations inattendues dans les différentes dimensions du projet – et ainsi ouvrir de nouvelles avenues de recherche sur les plans philosophiques et anthropologiques, mais également technologiques, méthodologiques, et enfin bien sûr sur les questions de design.
Le public de l’EME est également problématique dans la mesure où il est arrivé très tôt dans l’environnement du projet, avant que la conception et la fabrication de son infrastructure ne soient stabilisées, occasionnant un vacillement de l’image du projet pour ses participants et un vacillement dans l’appropriation d’une « infrastructure » encore en cours de construction. Cependant, cette précocité a été aussi la raison pour laquelle les pratiques de fabrication ont joué un rôle si important dans l’assemblage de son collectif. Ainsi, au-delà de l’établissement de l’infrastructure pour les pratiques des participants, les problématiques de conception ingénierique et de design d’interfaces impliquées par le projet ont alors, par leurs hésitations, leurs tâtonnements et leurs inventions aux yeux de tous, participé directement à la structuration des discussions, des débats et des rencontres à lʼœuvre sur le plan de l’évolution conceptuelle de l’enquête au cours de son déroulement. À ce titre, on peut effectivement parler d’infrastructuration dans la mesure où une telle situation d’équipement en train de se faire en même temps que la recherche, a impliqué chez beaucoup des participants une réflexivité accrue vis-à-vis des implications de l’environnement matériel dans lequel se tenait l’enquête. Le design de l’Enquête sur les Modes d’Existence me semble ainsi s’être aussi manifesté sur le registre d’un art de l’enquête qui a laissé « la connaissance croître à la faveur d’une observation et d’un engagement pratique auprès des êtres et des choses qui l’entourent » (Ingold, 2013/2017, p. 31). Dans ce dernier, l’expérimentation matérielle a participé d’une trajectoire d’invention et de découverte plutôt que du seul « test » d’une hypothèse dont les pratiques de fabrication auraient été la simple et transparente instrumentation. L’EME peut en ce sens être décrite comme l’une des itérations de ce que pourrait être une poétique de la métamorphose documentaire dans la publication de recherche, faisant des multiples reformulations d’une trajectoire de recherche – impliquées par les pratiques de l’équipe du projet, et par les multiples réappropriations des participants – le lieu de multiples occasions de production de sens.
Je terminerai ce chapitre sur une note diagnostique en revenant sur la question de « l’évaluation » du projet, dans la perspective d’éventuelles dérivations de cette recherche en direction de nouveaux projets. Ma démarche et ses différentes communications publiques ont en effet souvent été marquées par cette question et mon travail, réinterprété à plusieurs reprises comme celui d’une expérimentation sur les méthodes d’évaluation et d’état des lieux de projets en humanités numériques mêlant sciences humaines et expérimentations matérielles : « L’EME a-t-elle réussie ? Est-ce un succès ? » Tout d’abord, en guise de précaution, il faut d’abord rappeler la position d’observation participante qui a été la mienne et la relation très proche que j’entretiens avec l’environnement du médialab de Sciences Po, faisant à la fois office de lieu d’observation et de collaboration quotidienne pour mes activités pendant et après le temps de mon terrain93 , et interdisant pour moi de prendre la posture d’un quelconque « expert critique » ou « observateur objectif ». Cette posture serait difficilement tenable du fait de ma position si particulière, mais également parce que la question du « succès » de l’EME invite nécessairement à redéfinir au préalable ce que l’on attend d’une recherche en SHS et de sa publication.
Alors, s’agit-il de mesurer le rayonnement « sociétal » du projet à la lueur du nombre de personnes « impliquées » sur la plateforme numérique ? Supposant dans ce cas que la finalité de la mobilisation de dispositifs de communication et de participation expérimentaux résiderait dans sa contribution à une forme de discussion ou de « débat public » – voire d’une démarche de « vulgarisation » auprès de lecteurs « non-spécialistes » – mon enquête sur les traces numériques du projet a fourni quelques indications sur ce point dans le sens d’une participation et d’une implication relativement limitées – par rapport à la quantité de visiteurs et de lecteurs – si l’on se limite à une étude de la plateforme. Cela dit, il ne me semble pas que cet indicateur fasse beaucoup de sens en regard de la si particulière appréhension de la notion de participation impliquée par le projet, et le rôle joué par sa plateforme numérique dans ce cadre. Par ailleurs, une telle perspective nécessiterait probablement de prendre davantage en compte le foisonnement de projets et d’activités parallèles à l’EME mis en œuvre par son investigateur principal, et il manque à la présente enquête un recul historique plus important pour être en mesure de comprendre l’influence de l’EME sur le temps long et « au-delà » du seul cadre universitaire.
S’agit-il alors d’apprécier les « retombées industrielles » impliquées par les expérimentations technologiques et matérielles que le projet EME a occasionné ? Sur ce point, qui entendrait la recherche en termes d’investissements et de retours économiques – fussent-ils par le truchement d’un partage de code en accès libre et « open source » – l’objet du prochain chapitre contribue – de manière incidente – à répondre à cette question de manière positive, puisqu’il présente les nombreuses pratiques et productions que j’ai conduites dans le cadre de cette recherche en m’appuyant sur les premières expériences du projet. Cela dit, il me semble cependant là encore qu’une telle approche ferait, si elle était la seule conclusion apportée à ce projet, bien peu justice à la dimension expérimentale de l’EME et l’intrication méthodologique, théorique et matérielle que j’espère avoir précisément décrite au cours de ce chapitre.
S’agit-il dans ce cas de porter notre attention sur la place de ce projet dans le système de la communication scientifique, notamment à travers les métriques d’« impact » de l’EME dans l’économie de la citation scientifique ? Selon cette dernière perspective, au 10 février 2020, on peut énoncer que Google Scholar enregistre 736 citations pour la version française et 1852 pour la version anglaise de l’édition imprimée de l’Enquête sur les Modes d’Existence. Cela dit, là encore, ces seuls indicateurs quantitatifs nous informent-ils vraiment sur la contribution effective de l’EME d’un point de vue exclusivement universitaire ? Ces citations portent-elles sur le contenu du « rapport préliminaire », sur celui de la « plateforme numérique », sur le « Specbook », ou encore sur l’ensemble du « projet » ? Comme l’étude conduite sur les recensions de l’ouvrage a montré des disparités importantes dans les compte-rendus de l’infrastructure complexe de l’EME, de son format polymorphique et de sa dimension ouverte et processuelle, la réduisant souvent à sa seule édition imprimée, on peut supposer que beaucoup de ces citations feront davantage référence à un ensemble d’« idées » et d’hypothèses – le projet philosophique d’un pluralisme ontologique, le renouveau de la théorie de l’acteur-réseau, ou encore la description d’un mode particulier parmi les autres, etc. – qu’à l’enquête dans son ensemble et sa trajectoire de transformation et de reprises diplomatiques successives. On peut même soupçonner qu’une part de ces citations ne sera en fin de compte que la manifestation d’une association symbolique avec la « pensée » d’un « auteur » emblématique et renommé, faisant planer sur l’EME le destin « signalétique » (Berthelot, 2003a) de tous les textes savants, appelés à être progressivement réduits à un pur signe par les jeux de la citation. Ainsi, aucune des approches précitées ne me semble permettre de faire un bilan satisfaisant du projet.
En fin de compte, c’est peut-être dans sa capacité à désorienter, à faire ralentir, ou encore à faire vaciller des manières de faire et de dire, établies dans la philosophie, l’anthropologie, les méthodes de participation et bien sûr le design, que pourrait s’évaluer le mieux un tel projet. Il ne s’agirait pas alors de raisonner en termes « d’innovation » ou « d’impact » mais plutôt de se rendre attentifs à la capacité d’une expérience à bousculer, à questionner, et donc à rendre visibles les conventions à lʼœuvre dans l’une ou l’autre de ses dimensions. Il faudrait alors prendre de front le caractère pervasif des nombreuses expérimentations dont cette entreprise a été le lieu, à la fois sur les plans de la philosophie, de la méthodologie anthropologique, de l’ingénierie informatique, du design des situations de lecture et d’écriture, de l’organisation d’évènements scientifiques, etc. Édifice tremblant à tous les étages, par ailleurs étayé par le bagage luxuriant et hétéroclite de son investigateur principal, l’instabilité généralisée de l’EME mettrait cependant alors l’évaluateur à rude épreuve, provoquant le sentiment intimidant de vertige et de désorientation que j’ai rencontré au cours de mon terrain.
Évaluer l’EME dans les termes des déstabilisations qu’elle a provoquées implique également une difficulté vis-à-vis de la comparaison possible avec d’autres projets. En effet, à quel point de référence se rattacher alors pour approcher une telle entreprise ? Entre « jeu de rôles » visant à faire la performance d’un argument par un complexe assemblage d’artefacts et de participants, et expérience contributive de reconfiguration des conditions de constitution des collectifs de recherche, l’EME se présente comme un hapax dans le corpus des pratiques des SHS, dont les métaphores opérationnalisées entraînent les participants dans des situations bien peu propices à la comparaison dans les termes de catégories partagées avec d’autres démarches universitaires : on s’y retrouve à « tester » des hypothèses de métaphysique au moyen de protocoles « expérimentaux » en s’appuyant sur la fréquentation de documents artistiques ou ethnographiques ; à négocier au nom des esprits de la métamorphose, des mobiles immuables de la référence scientifique ou des attachements économiques ; à envisager sérieusement une possibilité de succès pour son entreprise de redescription des Modernes visant rien de moins que leur réconciliation avec eux-mêmes et avec les Autres. Et l’on se retrouve à accepter de telles situations, grâce au travail de son investigateur principal bien sûr, mais également à la crédibilité conférée par un cadre institutionnel fortement légitimant, des dispositifs techniques à l’apparence et au fonctionnement aboutis, et des pratiques de mobilisation et de documentation extrêmement denses.
« Évaluer » l’EME en termes de déstabilisation me semble donc être la plus juste attitude pour conclure mon étude de ce projet dans le cadre de cette recherche, même si ses conditions d’élaboration initiales ne permettaient pas forcément d’en présupposer. À la lumière de cette enquête, on peut encore aujourd’hui s’étonner de la naissance d’une entreprise aussi expérimentale dans le contexte de financement européen qui lui a permis d’exister. Comment un tel projet aura-t-il pu être « évalué », puis accepté, dans les termes de la recherche par projets et de son format de travail fait de « milestones » et de « livrables » attendus dans les temps d’un calendrier prédéfini ? Cette question demanderait à elle seule de faire l’objet d’une enquête ultérieure, et dans un entretien publié en 2014, Bruno Latour s’en étonnait lui-même quand il s’exprimait sur le projet alors en cours de stabilisation éditoriale et technique :
Les arbitres, les sept arbitres [évaluateurs de l’European Research Council, nda] qui ont lu ma candidature, ont tous dit quʼelle échouerait, mais quʼelle devait quand même être financée, en priorité. Chacun dʼentre eux a dit quʼil nʼy avait aucune chance que cela fonctionne. Mais quʼils devaient la financer sans même en discuter. Ils ont dit que la plateforme ne fonctionnerait pas, quʼelle est beaucoup trop grande, que la chose diplomatique est impossible, etc. […] Bien sûr quʼils avaient raison ! Cʼest un projet complètement impossible.94 (Latour, 2014)
Une fois mis en œuvre, les paradoxes de ce projet « impossible » n’ont pas pour autant empêché sa productivité en termes de vacillements sur le plan intellectuel et matériel, puisqu’il a donné lieu à de nombreuses continuations sur le plan des pratiques de design et de recherche participative qu’il a occasionnées (Ricci, 2019b), ainsi, bien sûr, que sur la continuation de lʼœuvre de son investigateur principal qui a poursuivi son projet philosophique et politique, par la construction de nouveaux instruments d’orientation face à la catastrophe écologique généralisée en cours (Latour, 2015a).
Quant à la trajectoire de la présente recherche, elle a consisté à faire de cette riche expérience le point de départ de nouvelles expérimentations avec les formats de publication de la recherche, visant à la fois à faire l’expérience de première main de questionnements que mon expérience du projet EME ne touchait pas en propre, et également à tirer du sens de cette séquence d’enquête au moyen de reprises multiples pour en nourrir la présente restitution.
Vis-à-vis de l’étude du vacillement des formats, l’EME présente en effet deux points aveugles qu’il s’agissait d’interroger dans d’autres cadres. Le premier relève de sa relation avec les conventions éditoriales et techniques à lʼœuvre dans la publication contemporaine. En effet, le projet EME n’a été que marginalement engagé dans les efforts collectifs de structuration des humanités numériques, la mise en place « d’infrastructures » éditoriales plus large ou le réinvestissement de ses éléments méthodologiques dans d’autres disciplines et perspectives. Ce point n’a d’ailleurs pas échappé à plusieurs des critiques du projets, qui ont pointé le caractère problématique de son caractère unique, dans la mesure où, comme je l’ai détaillé précédemment dans ce chapitre, ce dernier complique la discussion et la remise en jeu de ses arguments dans les arènes plus « conventionnelles » – et donc plus ouvertes et partagées – de la publication universitaire, telles qu’elles sont fréquentées dans les différentes aires disciplinaires concernées par l’Enquête. L’autre point aveugle, d’ordre contingent et relatif au calendrier de ma recherche doctorale, relevait de la pratique de l’écriture impliquée par de telles expérimentations, que je n’ai pas eu l’occasion d’éprouver de première main dans le cadre de mon terrain et qui me semble pourtant centrale dans la construction d’une infrastructure à même d’autoriser des pratiques de publication-comme-enquête. Il s’agissait alors de remettre en jeu l’intrication entre formats de données, formats socio-techniques d’écriture et formats de publication à travers des expérimentations capables de reconstituer les enjeux d’une publication-comme-enquête depuis ses débuts.
À partir de mon enquête sur l’EME, il s’est donc agi de faire jouer le format d’un projet établi en le remettant au travail dans des situations aux paramètres légèrement différents : d’abord, remobiliser les différentes pratiques et protocoles observés sur ce terrain en y soustrayant l’influence très important de la préposition « Bruno Latour », notamment en s’intéressant à des contextes de recherche disposant de moyens et d’une résonance symbolique, médiatique et socio-scientifique plus modeste. D’autre part, j’ai ressenti la nécessité de mettre en jeu d’autres pratiques de recherche que celles observées sur l’EME, afin d’explorer certains des territoires scientifiques observés lors de mon travail de collection. Enfin, mon projet post-terrain a consisté à étendre le travail « d’infrastructuration » par le design à lʼœuvre dans l’EME à une communauté plus large, dans la perspective diagnostique et pratique de cette recherche inscrite dans les humanités numériques, tout en interrogeant la place de mes expérimentations et du vacillement produit par une telle activité de fabrication d’équipements et d’outils à l’intérieur d’une démarche de recherche doctorale.
Ainsi, le prochain chapitre s’attachera à décrire les trajectoires, les modalités, et le statut des différentes pratiques d’expérimentation en design qui ont nourri l’écriture de cette thèse après l’expérience de terrain du projet EME. Il s’agira de définir ce que ces pratiques de fabrication critique, construites par bifurcations et par stabilisations successives, peuvent apporter à l’étude des formats d’écriture et de publication de recherche en SHS. Via l’expérimentation et la constitution technique et sociale de formats techniques, méthodologiques et éditoriaux, ce dernier mouvement permettra, sur le plan de l’enquête générale de cette recherche, de revenir sur les situations d’écriture et leur cadrage fantomatique par les formats de données, à la lumière des pratiques d’investigation et de publication-comme-enquête étudiées en détail dans ce chapitre. Sur le plan méthodologique, il s’agira de faire suite au présent chapitre en finissant de tracer la trajectoire d’une pratique de la recherche en design entendue comme enquête mobilisant des expérimentations tout autant discursives que matérielles, via la fabrication et l’expérimentation de nouveaux outils pour « l’infrastructuration » de la publication-comme-enquête.