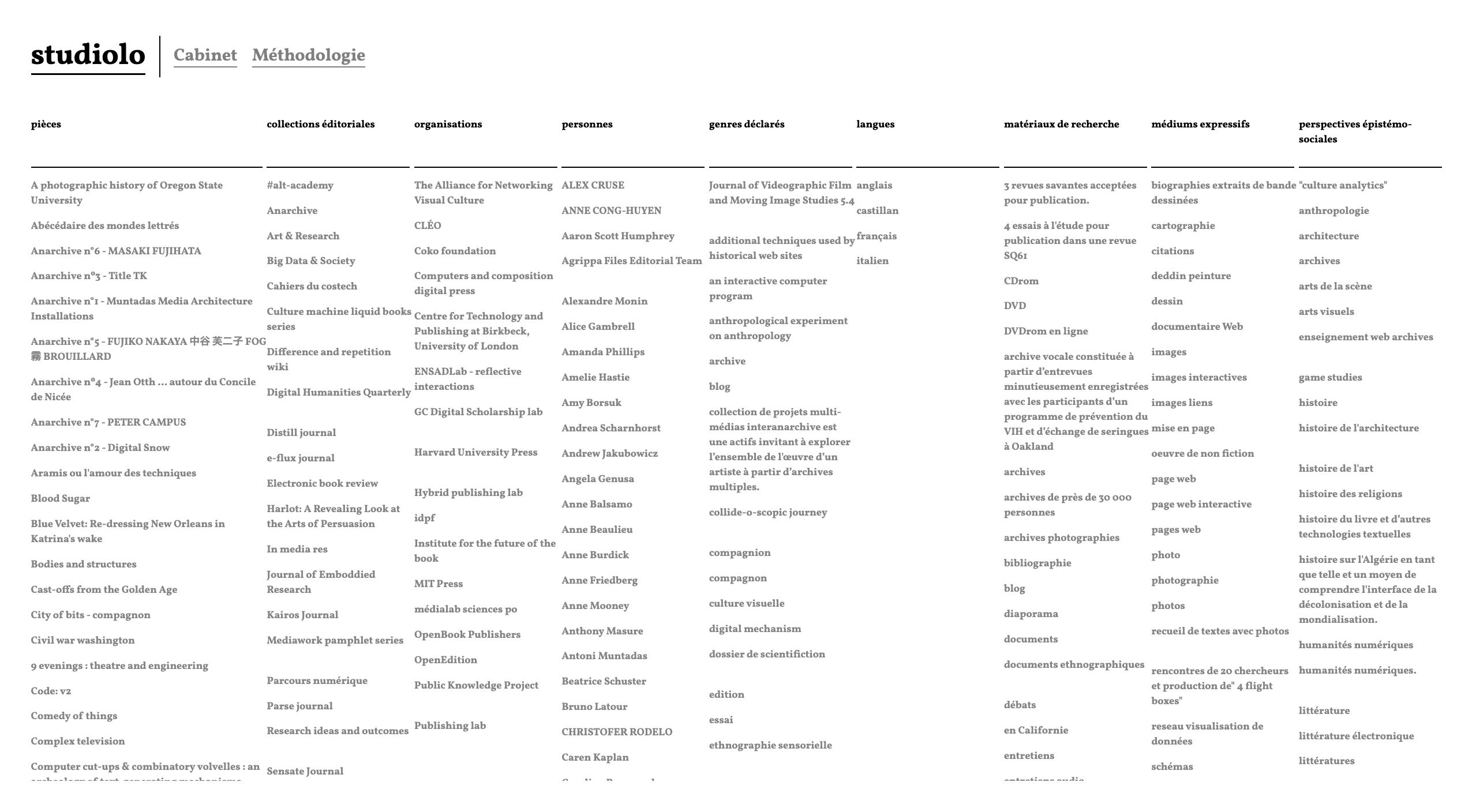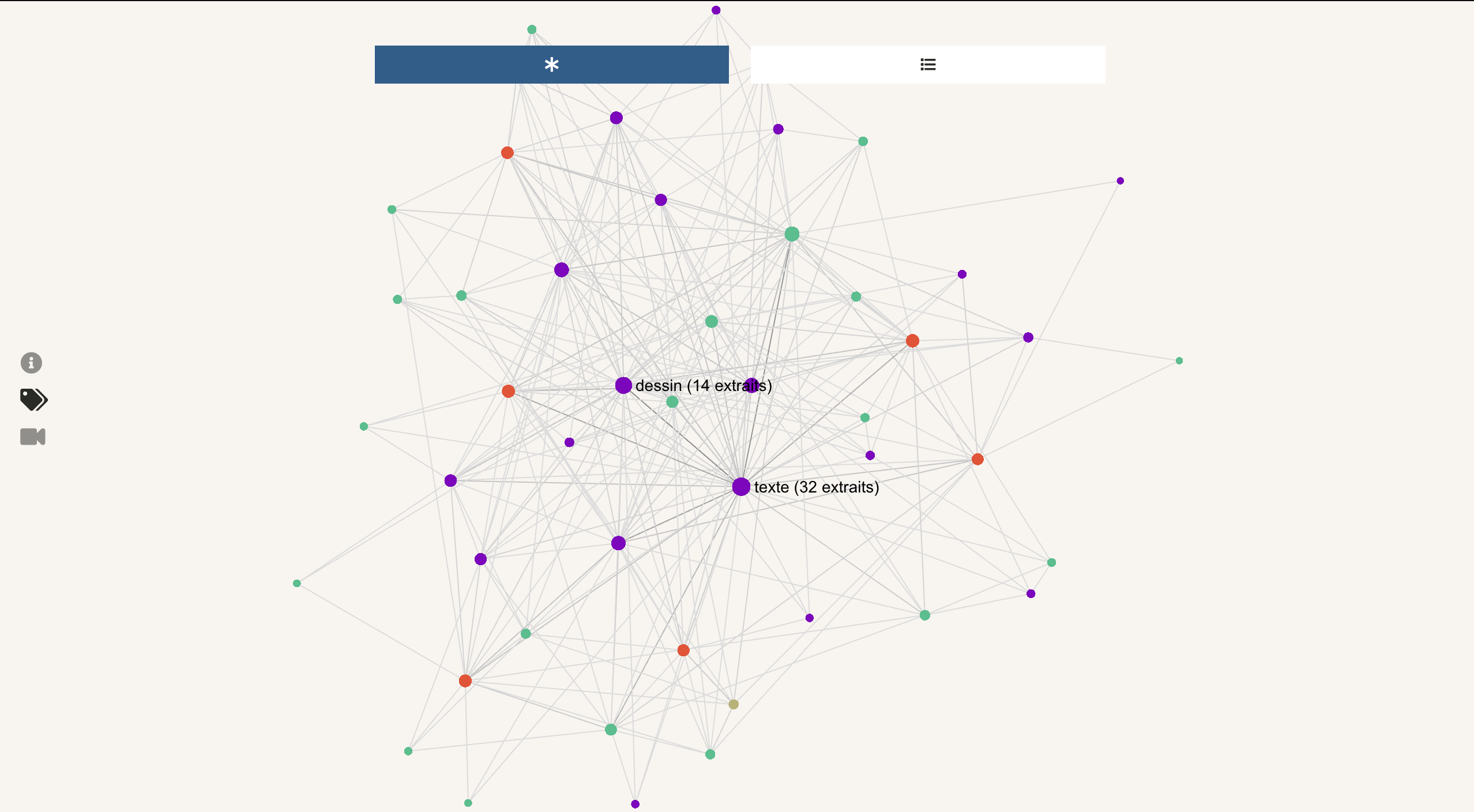Chapitre 3. Les formats d'écriture de l'enquête : de la fréquentation des matériaux de recherche à la formation de collectifs socio-techniques
Sur le fond noir d’une page web ornée d’un cadre gris pâle, une voix fatiguée raconte l’histoire personnelle qui l’a conduite à participer au programme d’échange de seringues et de prévention du VIH d’un centre social à Oakland, en Californie. Alors que l’enregistrement audio se fait entendre via le son émis par la page, sa représentation sous les traits de ce qui ressemble à une « forme de signal sonore » bleutée tournoie à l’écran de manière hypnotique dans un lent mouvement de rotation. Elle est agrémentée de manière intermittente d’une série de mots qui flottent dans l’espace de la page, comme attirés magnétiquement par la forme de la voix. Ces mots traduisent des extraits marquants issus des transcriptions du témoignage en train d’être écouté, mais également des questions telles que « Quelle est la réalité de la démocratie ? ». Ces questions, une fois cliquées, laissent apparaître de courts textes en prose parfois agrémentés de réflexions qui mobilisent des références à des ouvrages de philosophie et d’anthropologie. Un clic sur la « forme de signal sonore », quant à lui, nous fait plonger dans ce qui semble être un noyau organique à la présence écrasante à l’écran. Cette seconde vue plus rapprochée, qui dégage une impression de malaise claustrophobique, laisse voir les thèmes les plus intimes du témoignage, et permet notamment de connecter certains de ces thèmes à d’autres entretiens, et ainsi de naviguer de manière hypertextuelle dans la publication.
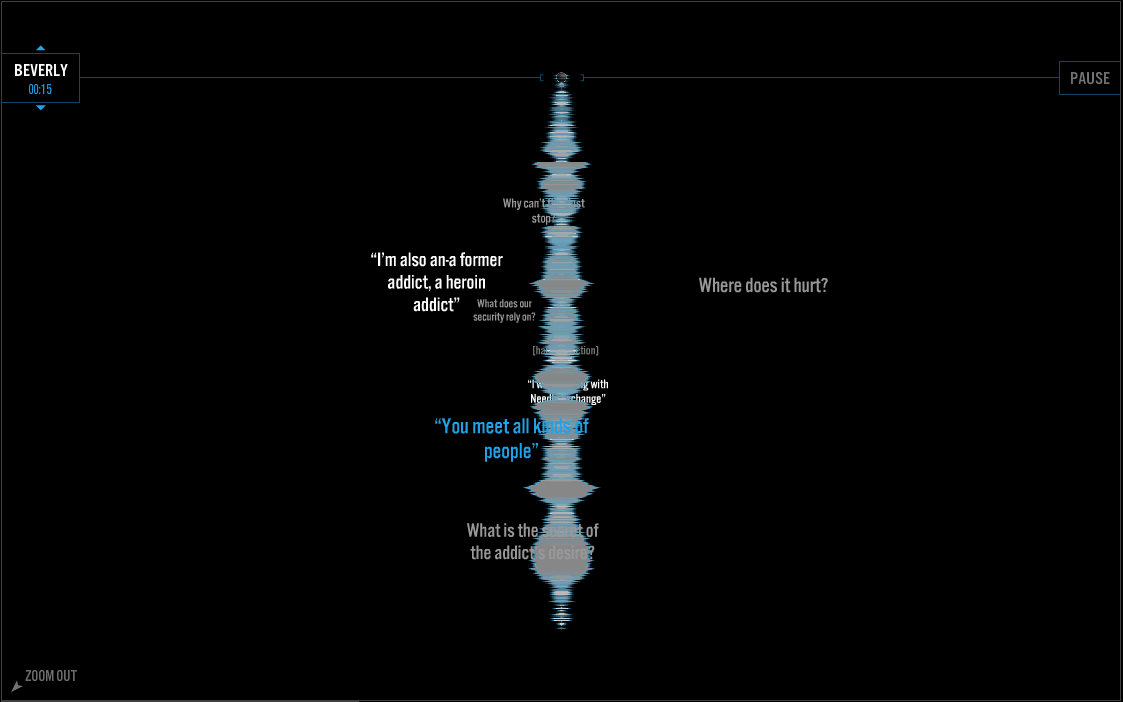
La voix entendue et « vue » sur la page est celle de « Willie », cinquante ans, et nous sommes en train de lire « Blood Sugar »1 , un « article » issue de la revue universitaire en ligne Vectors. Ce dernier met en scène un corpus de vingt enregistrements audio issus d’une série d’entretiens effectués par l’universitaire, artiste et activiste Sharon Daniel. Selon les mots de son initiatrice, en nous laissant écouter l’histoire de « Willie » et d’autres visiteurs du centre social dans lequel elle a mené son enquête, Blood Sugar agit comme l’archive publique – public record – du public secret – secret public – (Daniel, 2011) que constituent les personnes dépendantes de drogues à injection dans la société américaine.
Le rapport de Blood Sugar à la publication universitaire n’est pas sans provoquer une série de troubles vis-à-vis des modèles et des cadres qui structurent les collectifs de recherche. Une requête sur le moteur de recherche spécialisé Google Scholar nous confirme bien que Blood Sugar semble cité par plusieurs articles de revues savantes et autres ouvrages spécialisés. La pièce présente par ailleurs une introduction, une bibliographie, et plusieurs autres éléments péritextuels qui laissent voir son allégeance à certaines conventions éditoriales d’écriture reconnaissables en termes d’apparat critique et d’organisation. Et pourtant, selon l’une des publications de Sharon Daniel, Blood Sugar est un « documentaire de bases de données »2 (Daniel, 2012). Sur le site institutionnel de Vectors, cependant, il est aussi successivement nommé un « projet » et une « pièce » (Anderson, 2010). Sa figure principale – Sharon Daniel – n’est quant à elle pas non plus un descripteur stable pour tenter d’affilier – ou pas – Blood Sugar au champ de la publication universitaire. Professeure au département Film et médias numériques de l’Université de Californie à Santa Cruz, elle se définit, suivant les textes, comme une « érudite » (scholar), une « ethnographe » (Daniel, 2011), une « activiste » ou ou une « artiste » (Daniel, 2012). Chacune de ces étiquettes laisse qualifier différemment la contribution qu’elle serait amenée à proposer au système de la communication scientifique.
D’autre part, selon quelles modalités peut-on qualifier « d’auteure universitaire » celle qui serait à l’origine de la mise à disposition d’une série d’entretiens sous cette forme de mise en scène numérique et audiovisuelle ? Le modèle conventionnel de l’auteure universitaire comme productrice d’un discours original est en effet troublé par l’utilisation extensive de l’image, du son, et de l’interaction, et par la multiplicité des voix convoquées dans la pièce. Par ailleurs, dans ses reprises discursives du projet, Sharon Daniel explique à plusieurs occasions que sa stratégie consiste précisément à faire place pour les personnes et les groupes qu’elle met au centre de ses enquêtes, c’est-à-dire à fabriquer « des moyens, ou des outils qui vont induire les autres à parler pour eux-mêmes, et le contexte dans lequel ils seront écoutés »3 (Daniel, 2012, p. 217). En ce sens, elle insiste aussi sur la nécessité éthique de situer son propre point de vue à l’intérieur de la mise en scène proposée par Blood Sugar, dans laquelle elle intègre sa propre voix et propose des textes qui relatent l’histoire de sa propre « éducation transformatrice » (Daniel, 2012, p. 225). Via le geste de publication qu’elle propose, elle entend ainsi créer une zone de contact entre le public numérique de la revue universitaire Vectors et le public secret de son terrain d’enquête. En mobilisant le travail de Jacques Rancière pour définir la politique comme la force qui extirpe les corps de leurs lieux assignés (Rancière, 2000), elle défend alors que le document-publication issu de ce geste produit « un espace de ‹ dissensus › – non pas une critique, ou une protestation, mais une confrontation du statu quo avec ce qui n’est pas admis, qui est invisible, inaudible et différencié »4 (Daniel, 2011), soit un lieu de représentation (politique) à la composition hétérogène et aux voix multiples.
La question de qui parle – et de qui écrit – dans Blood Sugar n’est pas une question évidente. Au-delà de l’auteure Sharon Daniel, s’agit-il donc des personnes marginalisées enregistrées dans les matériaux audio ? Ou s’agit-il également du designer Erik Loyer, qui s’exprime sur la page du projet dans l’espace de la revue Vectors, racontant le cheminement et les déplacements multiples ayant menés à la réalisation de la pièce numérique et de sa perturbante expérience de lecture spatio-corporelle (Loyer, 2011) ? Ou serait-ce encore l’éditeur Steve Anderson, qui propose, dans son introduction à l’article sur le site de Vectors, d’interpréter la situation de lecture proposée comme celle d’une « injection » durant laquelle les visiteurs seraient pour ainsi dire amenés à pénétrer au plus profond des corps meurtris appelés à témoigner dans la pièce5 ? Par son discours – passage obligé pour quiconque tente d’accéder à la pièce par le truchement d’un moteur de recherche – l’éditeur participe aussi du format de lecture de l’article en proposant des clés d’interprétation et de navigation a priori. En ce sens, dans son texte introductif, on sent également une forme d’hésitation et d’inquiétude face aux « plaisirs viscéraux »6 (Anderson, 2010) provoqués, selon les mots de l’éditeur, par la publication. Son affirmation selon laquelle « le pouvoir des histoires individuelles […] empêche le projet de devenir un exercice de voyeurisme ou de tragédie fétichiste »7 peut alors être lue comme une proposition à vocation performative, peut-être autant destinée à convaincre son public qu’à se convaincre lui-même de l’authenticité et de la légitimité d’une telle publication, dans une situation de manque de repères et d’inconnu face à la réception d’un « article de revue » si singulier.
Blood Sugar n’est pourtant pas une publication de recherche complètement unique en son genre. Elle s’inscrit en effet dans le contexte d’une variété d’expérimentations survenues depuis le début du vingt-et-unième siècle, qui ont tenté de tirer parti des technologies numériques pour remettre en question la relation entre les modalités d’écriture et de publication d’une démarche de recherche et ses spécificités sur les plans épistémologiques, méthodologiques et politiques. À ce titre, les chercheurs en philosophie Christopher Long (Long, 2013) et en media studies Janneke Adema (Janneke Adema, 2018) ont proposé de qualifier de publications performatives les documents-publications qui se présentent comme l’expression matérielle et l’incarnation de processus de recherche spécifiques. Dans de telles démarches de publication performative, ce sont à la fois les documents produits par le processus éditorial et les pratiques d’écriture elles-mêmes qui se voient simultanément travaillés en fonction de la démarche de recherche qu’ils accompagnent, et des matériaux avec lesquels ils dialoguent.
Il faut bien sûr rappeler, comme cela a été étudié dans le chapitre précédent, que toute publication est en un certain sens performative, dans la mesure où sa matérialité, c’est-à-dire l’articulation entre des propriétés physiques, des procédures mécaniques et techniques et des pratiques culturelles et sociales, « performe » continuellement certains modèles du texte, des institutions et des connaissances qui lui sont associées. Cependant, à travers des expérimentations conscientes d’une telle performativité telles que Blood Sugar, les modèles stabilisés de l’éditions scientifique et les cadres pratiques qui dialoguent avec le travail quotidien des chercheurs en SHS se voient tous deux défamiliarisés par leur perturbation, voire parfois remis en question et confrontés à des contre-propositions. La performativité impliquée par l’expérimentation de ces nouvelles manières d’écrire les publications des SHS – et donc, par voie de conséquence, de les lire, de les éditer, de les commenter, etc. – affecte alors, de proche en proche, une série étendue d’articulations, dont le document-publication est pour ainsi dire la trace ou la manifestation identifiable.
Les enjeux de la relation entre enquête, écriture et publication sont alors de quatre ordres : épistémologique, sémiotique, méthodologique, et enfin socio-politique. Sur le plan épistémologique, ils demandent de préciser la relation qui s’établit entre, d’une part, les modèles de la connaissance manipulés par les chercheurs, et, d’autre part, l’assemblage qui s’opère entre les multiples attaches empiriques du travail de recherche et l’activité singulière de l’écriture pour la publication. Dans quelle mesure les méthodes d’investigation et modes de justification épistémologique dialoguent-ils avec des conventions d’écriture ? Comment ces dernières, en retour, traitent-elles les attaches empiriques de tout travail de recherche, et plus particulièrement, la relation des documents-publications à ce qu’on appelle – suivant les divers collectifs des SHS – le « terrain », les « données », les « sources », les « documents », ou encore le « corpus » ? En ce sens, comment les conventions d’écriture dialoguent-elles avec les pratiques de recherche et d’enquête spécifiques à des objets, des approches méthodologiques et épistémologiques situées ? Et à l’inverse, comment des pratiques expérimentales dialoguent-t-elles avec les circuits de formation sociale établis par ces conventions ? Autrement dit, dans quelle mesure les formats-produits issus de chaque situation de publication de recherche dialoguent-ils avec les formats-cadres qui participent de l’institution des collectifs universitaires ?
Sur le plan sémiotique, l’appareillage technique singulier des démarches de publication performative et autres expérimentations d’écriture de la recherche questionne les pratiques que l’on peut considérer comme légitimes dans le cadre d’une publication de recherche. Comment qualifier des pratiques d’écriture qui mobilisent intimement la production d’image, de code, ou d’interactions ? Par extension, cet enjeu sémiotique interroge le rôle des pratiques de fabrication dans l’écriture de recherche, et donc le rôle méthodologique de la collaboration interdisciplinaire avec des artistes, designers et ingénieurs, dans l’élaboration de ces documents-publications. À ce titre, dans son commentaire de Blood Sugar, Sharon Daniel propose l’hypothèse selon laquelle, dans certains cas, « la conception d’interface constitue une forme ‹ d’argument › (comme l’écriture le fait pour un savant), et la navigation de l’utilisateur fonctionne comme une forme ‹ d’enquête › (une distillation et une traduction de la rencontre de recherche vécue par le documentariste) »8 (Daniel, 2012). Mais l’écriture se limite-t-elle à la catégorie unifiée à laquelle semble faire référence Daniel, quand elle l’oppose à la conception ? En quoi, par exemple, la constitution d’une interface numérique, et le code qui la sous-tend, n’est-elle pas également une forme d’écriture ? La question de la multimodalité, à savoir la remise en question du discours comme seule finalité légitime pour le travail d’écriture, pose ici un problème qui est à la fois sémiotique et méthodologique, car il implique souvent la collaboration et la participation du chercheur avec des praticiens de techniques d’écriture variées – graphiques, computationnelles, parfois audiovisuelles, etc. Ce problème a enfin des implications sociales et politiques, parce qu’il a trait à l’acceptation de nouvelles conventions vis-à-vis les manières de lire et d’écrire les publications de recherche.
L’expérimentation de formats éditoriaux inédits perturbe le circuit social de tous les acteurs impliqués dans le geste de publication – lecteurs, éditeurs, évaluateurs, etc. – qui doivent reconnaître un document-publication comme relevant de leur expertise, préoccupation, ou attention. La déstabilisation des manières d’écrire induit en ce sens un vacillement dans ce qui fait public dans un collectif de recherche au sens – le public étant entendu dans un sens deweyien, c’est-à-dire comme la formation dynamique d’un collectif réuni par des préoccupations communes, mais également possiblement des intérêts divergents9 . Comment s’articulent le travail d’enquête, le travail d’écriture, et la formation des publics qui découlent du geste de publication ? Comment des expérimentations sont-elles instituées en pratiques conventionnelles ? Comment des formats-produits – résultats d’une démarche spécifique et située – se transforment-ils en des formats-cadres – stabilisés et vecteurs de normes et d’habitudes – et quels sont les effets de cette transformation ?
Pour aborder ces questions, selon la démarche d’enquête en design de cette recherche qui articule pratiques matérielles et pratiques discursives, ce chapitre mobilise à la fois la fabrication d’un site (web) de documentation, de collection et de classification de cas existants, et un ensemble de propositions conceptuelles fabriquées à partir de ressources bibliographiques issues de plusieurs disciplines. D’une part, ce chapitre se fonde sur des travaux en sciences sociales qui ont étudié la relation entre écriture scientifique et pratiques de recherche. D’autre part, il mobilise les productions écrites des expérimentateurs de diverses formes de publication performative, notamment dans le champ des humanités numériques et des media studies anglo-saxonnes, centrales dans le corpus développé au cours de cette recherche.
Dans ce cadre, l’usage extensif de technologies numériques joue le rôle de point commun entre les différentes pratiques d’expérimentation étudiées à partir de la deuxième partie ce chapitre. Cependant, mon attention aux technologies numériques ne relève toujours pas d’une forme de déterminisme technologique qui verrait la tendance technique du numérique (Bachimont, 2010) comme le vecteur de nouvelles normes d’écriture et de publication. Au contraire, les technologies numériques sont au centre de mon attention parce qu’elles constituent un vecteur de déstabilisation révélateur vis-à-vis de la stabilisation et de la déstabilisation des formats d’écriture de l’enquête.
La première partie de ce chapitre vise à constituer des équipements conceptuels permettant de décrire les relations qui s’établissent entre pratiques d’écriture, pratiques d’enquête, et dynamiques de formation sociale à l’intérieur des collectifs de recherche. À l’opposé d’une approche qui voudrait définir « l’écriture des SHS » sur un mode généralisant, il s’agit plutôt de faire saillir des lignes de tension dans les manières d’écrire qui dialoguent avec les formats éditoriaux stabilisés. Pour ce faire, en tirant notamment parti de recherches en anthropologie des connaissances, en historiographie et en sociologie des sciences, je tente d’élaborer des équipements intellectuels permettant d’étudier comment des « formats d’écriture » se voient stabilisés et, en retour, comment ils deviennent les stabilisateurs de certaines manières d’écrire et de produire des énoncés jugés légitimes, véridiques et authentiques par un collectif de recherche donné.
La deuxième partie du chapitre vise à interroger les reconfigurations qui s’opèrent entre enquête et écriture lorsqu’elles impliquent une expérimentation sur les formats numériques de l’écriture en SHS. Pour ce faire, elle est fondée sur l’analyse d’un corpus d’études de cas d’expérimentations conduites entre 1999 et 2015. Dans ce contexte, il faut d’abord effectuer un point conceptuel sur la nécessité, pour une recherche en design, de requalifier les attaches empiriques de l’écriture de recherche sous l’appellation de matériaux plutôt que de « données ». Je présente ensuite le travail de collection et de fabrication que j’ai effectué afin de recenser et d’analyser ces expérimentations sous la forme d’un site web intitulé Studiolo. Il s’agit alors d’analyser les motivations et les implications de telles expérimentations pour le statut de la publication vis-à-vis des pratiques de recherche, et la manière dont elles font vaciller les liens entre matériaux et écriture. Je reviens enfin sur la question de l’assemblage social opéré par l’expérimentation matérielle dans la publication, et les effets méthodologiques, politiques et épistémologiques d’une écriture collective et multimodale, à partir de l’histoire spécifique de la revue numérique américaine Vectors.
La dernière partie de ce chapitre s’intéresse à la stabilisation des formats d’écriture expérimentaux et les dynamiques qui conduisent des collectifs de recherche à transformer des formats-produits en formats-cadres, c’est-à-dire à sédimenter des manières de faire dans des infrastructures humaines et techniques ainsi que des outils permettant de les reproduire plus facilement. À travers l’étude critique du modèle de ce que les acteurs étudiés nomment le « passage à l’échelle », il s’agit d’interroger la relation qui s’établit entre les pratiques de stabilisation matérielle des techniques d’écriture et leurs effets sur les dynamiques de formation sociale. Je veux décrire comment l’interaction entre fabrication et écriture en SHS conduit à la formation non-déterministe d’horizons de pratique qui sont à la fois épistémologiques, méthodologiques et politiques pour les collectifs de recherche.
Prouver et éprouver : formats d’écriture et pratiques d’enquête dans les SHS
Les pratiques d’écriture qui conduisent à l’élaboration des documents-publications sont enchâssées dans un ensemble vaste et hétérogène de techniques de recherche qui connectent le métier de chercheur en SHS aux horizons éditoriaux de la publication. En ce sens, l’histoire des pratiques savantes et le champ de lʼanthropologie des connaissances ont précisément décrit comment les documents savants ont pu, dans plusieurs collectifs et à plusieurs époques, agir comme un « dispositif matériel participant directement à la production des savoirs » (Lefebvre, 2006). Dans ce cadre, même si les recherches en SHS se fondent sur une diversité extrêmement hétérogène de fondements épistémologiques, elles présentent toutes le point commun de reposer sur un travail empirique – se rendre sur un « terrain », étudier des « documents », fréquenter des « données », consulter des « sources » – qui se voit d’une manière ou d’une autre traduit dans la production de documents-publications. Ainsi que le formule l’historien Jean-François Bert :
Les textes des sciences humaines sont des constructions argumentatives qui tentent de tisser un lien plus ou moins fort entre des observations empiriques et des hypothèses théoriques, parfois à portée générale. (Bert, 2014b)
Les liens ainsi créés entre le travail empirique du chercheur et les documents-publications qu’il écrit prennent alors un rôle très spécifique qui vise à transformer ses hypothèses en énoncés véridiques – la signification exacte d’un tel adjectif dépendant des fondements épistémologiques dans lesquels est ancrée sa recherche – et s’incarne dans des pratiques et des procédures particulières. En ce sens, l’historien Ivan Jablonka a nommé opérations de véridiction les processus qui permettent de conduire une telle transformation. Dans le cadre de son travail – limité aux seules sciences sociales, et concentré sur la discipline Histoire – ces dernières opérations relèvent par exemple de « la distanciation, qui permet de poser le problème ; l’enquête, par laquelle on collecte des sources ; la comparaison, qui dissipe l’illusion de l’unique ; la formulation-destruction d’hypothèses, grâce à des preuves » (Jablonka, 2017). La pratique de l’écriture agit alors comme l’activité de mise en œuvre de ces opérations, mais aussi de leur traduction progressive depuis la pratique privée de « l’écriture qui enquête » vers la pratique publique de « l’écriture qui publie ». C’est la manière d’opérer cette traduction qui la définit une pratique d’écriture comme authentique, c’est-à-dire articulée de manière fidèle avec les pratiques empiriques sur lesquelles il repose.
Le caractère véridique et authentique d’un document-publication dépend également de son jugement comme légitime par un collectif donné, en fonction de certains critères sociaux. Par exemple, l’épistémologue Jean-Pierre Berthelot a en ce sens proposé de décrire le texte « scientifique » comme la conjonction d’un ensemble de critères normatifs de nature épistémologique, sociale et éditoriale – « une intention de connaissance explicite de l’auteur, un apport de connaissance reconnu par une communauté savante, l’inscription dans un espace de publication identifiable comme ‹ scientifique › » (Berthelot, 2003b, p. 33). Ces critères permettent à un texte d’être légitimé comme un texte savant propre à exister dans le champ de la publication de la recherche, mais ils ne sont pas les seuls. En effet, le type d’opérations de véridiction propre à chaque collectif de recherche se traduit aussi par des manières d’écrire spécifiques qui instituent différemment une publication comme légitime. En ce sens, les SHS sont régies par des régimes d’écriture divergents qui façonnent et renforcent les partages qui les constituent comme un ensemble hétérogène et « fractal »10 . L’adoption d’une manière d’écrire pour produire un document-publication relève ainsi d’une prise de position épistémologique et sociale dont il s’agit de qualifier les modalités et les effets.
De l’écriture qui enquête à l’écriture qui publie
Dans le « règne composite » de l’atelier des chercheurs (Waquet, 2015, pp. 165‑207), le travail d’écriture qui préside à la fabrication des documents-publications est une pratique qui mobilise des opérations, des formes et des conventions particulières qui varient suivant les collectifs et les individus. Ainsi que l’a montré Jean-François Bert, il implique « des opérations complexes comme la copie, le listage, le fichage, la rédaction, la correction, la schématisation, le résumé ou la vulgarisation » et demande de « réfléchir […] à la manière dont un auteur construit son argumentation avec l’aide ou non des références qu’il a glanées au fil de ses lectures » (Bert, 2014a). Le sociologue Pierre Achard a, quant à lui, montré comment les sciences humaines et sociales pouvaient déployer un vaste registre de pratiques d’écriture articulant dimensions privées et publiques de la recherche à travers une variété de « formes intermédiaires » (Achard, 1994). Ces « formes intermédiaires » participent alors du patient travail de stabilisation de l’écrit propre à la publication. Les sociologues Jérome Denis et David Pontille parlent en ce sens « d’étapes graphiques de l’enquête » pour désigner les relations qui s’établissent entre les opérations d’inscription relatives à la conduite de la recherche et le texte finalement proposé en tant que « manuscrit » (Denis & Pontille, 2002) par le chercheur à ses partenaires éditoriaux.
La relation entre les pratiques diverses d’écriture attachées au travail de recherche et celle, spécifique, de l’écriture pour la publication, se présente donc celle d’une série continue et ininterrompue de transformations. Pour Jean-Michel Berthelot, le travail d’écriture du texte scientifique est l’expression d’une dynamique de transformation entre des langages successifs visant à approcher ce qu’il nomme « le X de la recherche », soit une inconnue au degré de définition progressif. L’objet de la recherche se donne d’abord dans un langage particulier – ce que Berthelot nomme le « langage de donation » (Berthelot, 2004) pour qualifier, par exemple, la parole d’un enquêté, les formulations d’un document d’archive ou les expressions employées sur un terrain11 . Ce langage de donation est alors transformé en un « langage d’analyse » utilisé par le chercheur pour raisonner de manière privée à son propos, puis finalement en un « langage d’exposition », aux enjeux plus rhétoriques et argumentatifs, qui régit l’écriture du texte destiné à la publication.
De la même manière, Francis Affergan, dans « La fabrique du texte ethnologique » (Affergan, 2003), nous offre un point de comparaison entre ces opérations de transformation et le statut du texte. En effet pour ce dernier, l’attention apportée à la question de lʼaltérité dans une discipline telle que l’ethnologie rend particulièrement visible le fait que « le processus de construction et de reconstruction des objets du savoir subit en permanence des interactions qui les transforment, les réorganisent et les schématisent afin de leur allouer l’aptitude à une connaissance nécessairement limitée par le langage et par la finitude de la raison » (Affergan, 2003, pp. 107‑108). Des pratiques textuelles telles que celle de la description restituent bien ici l’action transformatrice de l’écriture destinée à la publication, dans la mesure où elles invitent à se déprendre de l’immédiateté et de l’irréversibilité de l’expérience vécue des pratiques empiriques pour ménager un « espace d’itération et de réitération nécessaire à la reprise du sens, que la propriété non réversible de la temporalité de terrain n’autoriserait pas » (Affergan, 2003, p. 109). L’écriture est alors le lieu d’une transformation, mais également celui d’une mise en relation entre le « moi qui a vécu » et le « moi qui retranscrit, postérieurement, ce premier vécu ».
Le travail de recherche se présente ainsi comme celui d’une légitimation simultanée – parfois réciproque, parfois conflictuelle – entre la preuve et l’épreuve constituée par le témoignage des pratiques de recherche dans le travail d’écriture. La légitimation de la preuve consiste à témoigner du fait que « j’y étais et donc je l’ai constaté de première main », alors que celle de l’épreuve repose sur le fait que « j’y étais et donc je l’ai vécu à la première personne ». L’opération de véridiction effectuée par ces deux formes de témoignage mobilise alors des fonctions différentes pour la pratique de l’écrit, et la présence du « terrain » dans le texte est possiblement source de divergence entre les collectifs de recherche.
En ce sens, l’appréciation de la légitimité d’une opération de véridiction, et de sa matérialisation dans le document-publication, ne va pas de soi. Francis Affergan propose de nommer les propriétés d’un texte comme les « conditions auxquelles [ce texte] est contraint de satisfaire pour être identifiable comme [un texte ethnologique], et non pas comme un texte sociologique ou historique » (Affergan, 2003, p. 112). C’est ainsi que les manières d’écrire ne conditionnent pas seulement des manières diversifiées de produire des publications jugées comme véridiques dans les SHS, mais qu’elles provoquent également des dynamiques de formation sociale via la réception – ou le rejet – de leur manière de justifier d’une écriture authentique. Dans la mesure où, comme l’ont proposé David Pontille et Jérôme Denis, « la mise en forme textuelle cadre les modalités d’accès aux actes interprétatifs et à leurs fondements empiriques » (Denis & Pontille, 2002, p. 9), il s’agit maintenant d’étudier comment ce cadrage s’opère dans l’histoire des pratiques d’écriture savantes, afin de pouvoir par la suite en dériver des équipements conceptuels pour l’étude de cas contemporains.
Les partages graphiques des collectifs de recherche : figures, notes, plans et formats d’écriture
Les opérations de véridiction qui lient la preuve et l’épreuve du travail de recherche dans le travail d’écriture pour la publication se traduisent dans des différences de manière d’écrire. Ces différences opèrent des partages dans la mesure où elles constituent des collectifs qui reconnaissent des manières distinctes d’écrire des publications véridiques du point de vue de certains présupposés épistémologiques, et authentiques dans leur manière de tisser des liens entre leurs pratiques de recherches et les documents publiés. Ce faisant, elles constituent des communautés qui partagent des manières d’écrire reconnaissables tout en se partageant en une multitude de sous-communautés archipellaires. Ce partage par l’écrit, ou partage graphique, s’opère alors selon au moins deux modes : d’une part, par l’usage ou le non-usage de certaines techniques d’écriture reconnaissables ; d’autre part, par des usages différenciés de la même technique textuelle. Il s’agit donc d’en passer en revue quelques exemples dans l’histoire des SHS afin de pouvoir par la suite reconnaître de nouveaux partages de ce genre dans des objets d’étude moins stabilisés.
L’usage de certaines techniques d’écriture comme mode de reconnaissance se retrouve par exemple dans la mobilisation des « figures », « graphiques » et autres éléments « non textuels » convoqués à l’intérieur des textes en tant que preuves et qu’épreuves des opérations de véridiction via le travail d’écriture. À ce titre, la sociologue Patricia Vannier, en étudiant les pratiques de publication du Centre d’Études Sociologiques à la sortie de la deuxième guerre mondiale (Vannier, 2003), a montré comment les pratiques textuelles de la sociologie française avaient pu progressivement muter en direction d’une « scientifisation » progressive inspirée des sociologies américaines. Cette mutation depuis des traditions essentiellement philosophiques et littéraires vers des approches faisant davantage de place au travail empirique, et notamment à la quantification, s’observe ainsi dans l’augmentation des références bibliographiques et des notes de bas de page, mais également dans l’apparition progressive des « figures » (Vannier, 2003, pp. 234‑245). Ces nouvelles pratiques d’écriture renforcent et précisent la revendication progressive de nouveaux paradigmes méthodologiques et épistémologiques au sein de la discipline sociologique en France.
Les indices des partages graphiques opérés par des manières d’écrire partagées se retrouvent également dans des usages concurrents d’une même technique d’écriture, ainsi que le montre l’exemple de la note de bas de page en Histoire. Dans Les origines tragiques de l’érudition (Grafton, 1998), l’historien Anthony Grafton décrit en effet comment la technique graphique – et éditoriale – de la note a pu fortement structurer l’histoire de la discipline historique au fil du temps. Dans ce cadre, l’histoire de la discipline se présente au premier abord comme indissociable d’un investissement progressif de la note dans le sens d’une « scientifisation » des écrits historiques et l’appel de plus en plus systématique des sources utilisées pour produire telle ou telle affirmation, au point que « tout ouvrage d’histoire sérieux dut désormais prendre la mer sur une carène cuirassée et imprenable. » (Grafton, 1998, p. 53) et qu’au XIXème siècle « les notes perdent le rôle, éminent, du chœur tragique, pour jouer celui, ingrat, d’un peuple d’ouvriers dans une usine immense et sale » (Grafton, 1998, p. 171). Dans son analyse fine des usages de la note, Anthony Grafton révèle cependant que cette dernière n’est pas qu’un mode de légitimation épistémologique mais implique une diversité de pratiques d’ordre social permettant au chercheur d’interagir avec ses pairs et de moduler de diverses manières son rapport aux « sources » qu’il mobilise : attaques et commentaires des pairs, démonstration de probité, hommages et alliances implicites, ou encore digressions à valeur anecdotique, etc. Par ailleurs, la restitution fine des débats et des nuances à l’œuvre autour des usages de la technique de la note révèle en fait une diversité d’articulations entre le récit historique et les notes qui le « soutiennent ». Le rapport entre l’épreuve (littéraire) du récit historique et la preuve (scientifique) de la « source » qui se joue dans la note de bas de page se voit donc négocié de manière diversifiée et hétérogène à l’intérieur d’une même discipline, et contribue à en dessiner des nuances, des bifurcations et des points de dissensus12 . Les implications épistémologiques et méthodologiques des manières de s’approprier cette technique d’écriture conduisent à des dynamiques de partage à l’intérieur du « collectif Histoire » pour le redessiner comme un collectif plus hétérogène qu’il ne paraît au premier abord.
Un dernier exemple des partages graphiques opérés par les manières d’écrire les SHS peut enfin se retrouver dans l’organisation des textes et la récurrence de caractéristiques stylistiques, qui dénote parfois des références à différentes procédures normalisées de validation de lʼauthenticité dʼune contribution de recherche. À ce titre, le sociologue des sciences David Pontille a notamment étudié l’utilisation de modes d’organisation normés des textes dans la discipline sociologique, comme par exemple celle du format IMRAD – pour « Introduction, Méthodes, Recherches, Analyses, Discussion » (Pontille, 2007). Dans ce cadre, la référence à une organisation textuelle normée jouent le rôle de référence à des formes d’authentification relevant des sciences de la nature et des sciences expérimentales. Elle est, par ailleurs, généralement corrélée à des caractéristiques stylistiques spécifiques, notamment vis-à-vis de la place de l’énonciateur dans le texte – son effacement, par exemple sous la forme de tournures passives ou de l’usage du « nous » universitaire (Pontille, 2007). Il a en ce sens constaté, pour le cas de la sociologie, l’expression de plusieurs manières d’écrire identifiables qui dessinent des positions épistémologiques différenciées à l’intérieur de la discipline. D’un côté, certaines publications semblent s’inscrire dans un « régime herméneutique » de l’écriture qui entend justifier de son authenticité via le travail sur la forme même de sa textualité – tournure des phrases, enchaînements logiques, style d’écriture spécifique, etc. D’un autre côté, d’autres semblent obéir à un un « régime expérimental » qui entend le texte comme un « simple compte rendu » des investigations empiriques (Pontille, 2003, p. §20). Ainsi, à travers les régimes « herméneutique » et « empirique » de l’écriture sociologique, des conceptions concurrentes du statut épistémologique du texte – mais également des conceptions différentes de ce qu’est une connaissance légitime pour la sociologie – se reconnaissent dans les manières de lier les pratiques empiriques de l’enquête avec celles de l’écriture de recherche.
Le concept de format d’écriture proposé par David Pontille se présente alors comme un descripteur pertinent pour désigner l’ensemble des formats qui participent de « lʼagencement des éléments textuels, de la structuration du raisonnement, et de la définition des frontières dʼun monde scientifique » (Pontille, 2003, p. §3). Un format d’écriture se situe en ce sens dans lʼarticulation entre des procédures graphiques et littéraires, des opérations de raisonnement et de véridiction particulières, et les dynamiques institutionnelles et sociales qui se forment autour de l’association de ces deux aspects, qui agit comme « un ‹ programme d’action ›, un script reliant par des conventions un réseau de personnes, d’objets, de textes et d’institutions dans lequel il a été produit et dans lequel il est supposé avoir des effets sur le monde » (Pontille, 2007, p. 4). Un format d’écriture est ainsi, pour Pontille, un acteur pour la stabilisation de « mondes scientifiques » qui associent des hypothèses épistémologiques, des méthodes d’enquête, et des manières d’écrire communes. Son action est en ce sens décrite comme un « travail des frontières » dans le sens où l’alignement de modalités de véridiction (dimension épistémologique), de formation sociale (dimension socio-politique) et de matérialisation (dimension esthétique et poétique) du texte de recherche opéré par un format d’écriture s’effectue toujours sur un registre temporaire, partiel et composite, qui travaille les dynamiques de démarcation épistémologique entre les chercheurs et les relations entre leurs pratiques sans jamais les figer complètement.
Les formats d’écriture ne sont jamais des acteurs entièrement stables et exclusifs. En effet, comme tous formats, ils sont toujours soumis à la possibilité de la combinaison, de la traduction, ou de la conversion. Par ailleurs, ainsi que l’avancent Denis et Pontille, « si l’écriture est un acte interprétatif majeur, faire varier les formats et les styles au sein d’un même texte (ou d’un texte à l’autre) peut être un moyen d’enrichir le processus de compréhension » puisque « la diversité des mises en ordre d’éléments théoriques et empiriques, surtout lorsqu’ils sont nombreux et hétérogènes, permet en effet de préserver une part de la complexité de l’objet d’étude » (Denis & Pontille, 2002). En ce sens, toute démarche de publication pour la recherche se voit constamment mise en tension entre la spécificité de ses objets, questions et autres arguments, et les formats d’écriture avec lesquels elle dialogue inévitablement.
Dans le contexte du développement des technologies numériques, les formats d’écriture, développés lors de la rencontre entre une multitude de démarches d’enquête, et de nouvelles techniques scripturales, se multiplient et s’hybrident selon des combinatoires dont il est impossible d’épuiser l’énumération. Cependant, on peut interroger la manière dont dialoguent certaines expérimentations d’écriture numérique de l’enquête avec les dynamiques de formation sociale qui constituent les collectifs de recherche en SHS contemporains.
Pratiques expérimentales et déstabilisation des formats d’écriture de l’enquête dans la publication numérique des SHS
Le développement des technologies numériques offre l’occasion d’une remise en question des pratiques d’écriture normalement associées à la publication. Ces dernières ouvrent en effet la possibilité de nouvelles manières de mobiliser les traces des pratiques de recherche, de mettre en scène une écriture qui se veut plus hybride – constituée par la langue et par l’image, mais également par le code, par le son, ou l’image animée – et de distribuer différemment les pratiques d’écriture entre écrivains et lecteurs des documents-publications. Cette situation conduit à l’élaboration de formats-produits spécifiques à de nombreux égards, qui mettent en œuvre des manières non-conventionnelles d’écrire et de lire les documents-publications. Ces spécificités sont parfois liées aux questions, arguments ou matériaux qu’implique une recherche en particulier. Ce faisant, l’écriture de l’enquête conduit parfois à des démarches d’expérimentation qui agissent sur les conventions de la publication de recherche en proposant des versions alternatives à ces dernières : en cela, ces expérimentations sont performatives. Quels sont alors les régimes d’écriture impliqués par ces pratiques expérimentales ? Comment dialoguent-elles avec des formats d’écriture plus répandus, de manière à justifier de leur légitimité ? Et comment s’institutionnalisent-elles (ou non) sous des formes à leur tour reconnaissables ?
Cette partie a pour objectif d’interroger les reconfigurations qui s’opèrent dans les relations entre enquête et écriture quand ces dernières se voient mobilisées par des pratiques d’expérimentation matérielle aux prises avec les tendances, les possibilités et les contraintes des technologies numériques. De manière corollaire, elle invite également à interroger le rôle de la collaboration interdisciplinaire – notamment entre des chercheurs en SHS, des ingénieurs, des designers et des artistes – dans la constitution de formats-produits spécifiques aux recherches dont ils effectuent la publication.
En ce sens, une grande partie des expérimentations de publication performative en SHS qui furent conduites depuis le développement des technologies numériques s’inscrit dans les traditions et les reprises d’expérimentations antérieures survenues dans les mondes de l’Art et du Design, ainsi qu’à l’intérieur de certaines communautés historiquement stabilisées des SHS. Concernant les filiations de ces expérimentations avec le monde de l’Art, Gary Hall et Janneke Adema (Janneke Adema & Hall, 2013) ont retracé les multiples contributions et continuations de la tradition du livre d’artiste dans les initiatives d’éditions dirigées par des chercheurs (scholar-led publishing) qui tentent de reformuler les pratiques de publication universitaire en contexte numérique sous la forme d’un accès ouvert radical entendant la question de l’accès ouvert aux écrits de recherche en SHS « moins comme un projet et un modèle à mettre en œuvre, et plus comme un processus de lutte continue et de résistance critique »13 (Janneke Adema & Hall, 2013, p. 28). Ils s’inscrivent ainsi dans la continuité des recherches et des initiatives éditoriales portant sur les pratiques du livre d’artiste14 et leur capacité à reconfigurer à la fois les rapports entre les pratiques artistiques et leurs publics ainsi que le caractère démocratique des formes livresques (Brogowski, 2010/2016).
Ces expérimentations s’ancrent également dans l’histoire de la littérature numérique et de ses multiples expérimentations. En ce sens, ils trouvent des précédents dans ce que Katherine Hayles a appelé les technotextes, c’est-à-dire des travaux littéraires qui interrogent les technologies d’inscriptions qui les produisent, et qui incarnent les concepts critiques qui les portent dans leurs modes de fonctionnement et d’inscription matérielle (Hayles, 2002, p. 140). Hayles a par ailleurs été l’une des actrices de la traduction de ces expérimentations sous la forme de ce qu’elle a appelé la « critique multimédia », à savoir un type d’écriture savante qui « utilise lui-même les ressources du multimédia pour construire des arguments, présenter des preuves, et réaliser des conclusions »15 (Hayles, 2005a) comme on le verra plus en détail dans la suite de ce chapitre.
Ces expérimentations trouvent par ailleurs des précédents à l’intérieur de certains collectifs de recherche, et notamment dans l’histoire du film ethnographique puis de l’anthropologie visuelle et filmique. Cette dernière, depuis les travaux fondateurs d’ethnologues comme Jean Rouch, a consisté à interroger les relations de co-définition entre « l’homme filmable – susceptible d’être filmé – mais également celle de l’homme filmé, tel qu’il apparaît mis en scène par le film » et ainsi « expérimenter eux-mêmes de nouveaux instruments et procédés de mise en scène du réel » (France, 2000, p. 7). De telles traditions participent de la tradition expérimentale d’une « écriture alternative des sciences sociales » très vivace aujourd’hui dans le champ des sciences sociales (« lisatemp », 2019) et reconfigurée par les moyens numériques d’écriture audiovisuelle.
Les expérimentations en publication performative s’ancrent enfin dans l’histoire du design éditorial et de la typographie, comme en témoignent par exemple les jeux de traductions entre le théoricien de la communication Marshall McLuhan et le designer Quentin Di Fiore à l’œuvre dans l’ouvrage The medium is the massage (McLuhan & Fiore, 1967/2005). Les continuations de ces différentes histoires se manifestent notamment dans l’introduction de designers et d’artistes dans les collectifs de recherche en SHS contemporains tels que les laboratoires d’humanités numériques et autre medialabs.
Une analyse des démarches de publication performative de l’écriture de l’enquête demande d’abord de requalifier dans les termes d’une enquête en design les enjeux d’une expérimentation sur les manières de lier écriture et enquête. En ce sens, il faut dans un premier temps effectuer un point conceptuel sur la nécessité, pour une recherche en design, de requalifier les attaches empiriques de l’écriture de recherche sous l’appellation de matériaux plutôt que de « données », terme qui semble s’imposer dans la plupart des discours qui tentent de qualifier l’influence des technologies numériques sur la relation écriture-enquête. Je présente ensuite un travail de collection et de fabrication que j’ai effectué afin d’effectuer une catégorisation critique de quelques expérimentations de publication performative existantes rencontrées durant cette recherche, sous la forme d’un site web interprétatif. Il s’agit d’analyser les implications de telles expérimentations pour le statut de la publication dans les pratiques de recherche, et la manière dont elles font vaciller les liens entre « matériaux » et « écriture ». Sur cette base, je reviens enfin sur la question de l’assemblage social opéré par l’expérimentation matérielle dans la publication et les formats d’écriture qu’il produit. Pour ce faire, je propose une analyse des effets méthodologiques, politiques et épistémologiques d’une écriture collective et interdisciplinaire, à partir de l’histoire spécifique de la revue numérique américaine Vectors.
Des données aux matériaux de recherche : requalifier les attaches empiriques de l’écriture numérique des SHS
Les attaches empiriques du travail d’enquête en SHS sont aussi variées que les disciplines, les questions et les objets que les chercheurs peuvent mobiliser. Suivant ces derniers, la remontée des « données » depuis le « terrain », le travail des « sources » dans les « archives », les « documents » récupérés depuis « l’atelier », constituent une variété de relations qui engagent à une variété de manières d’écrire et de négocier la performance de la recherche dans l’écriture du document-publication. Afin de travailler avec un vocabulaire cohérent avec une démarche qui s’intéresse aux tensions entre la spécificité des recherches et les conventions avec lesquelles elles dialoguent, il est donc nécessaire d’interroger la manière dont je me réfère aux attaches empiriques du travail de recherche du point de vue de l’écriture. Ma stratégie, à travers ce choix de vocabulaire, consiste à insister sur la spécificité du travail d’écriture du recherche comme pratique intrinsèquement expérimentale afin de pouvoir en étudier la mise en tension par la stabilisation des formats d’écriture numérique.
Dans le contexte de diffusion de l’informatique et de ces concepts, les différentes formes de mobilisation des pratiques de recherche semblent de plus en plus désignées – du moins de manière croissante dans le langage courant – sous le concept de « données ». Le terme de « données » prend une signification méthodologique précise dans des disciplines identifiées telles que la sociologie ou l’anthropologie : l’utiliser pour désigner les attaches empiriques des SHS en général pose alors le risque d’imposer certaines perspectives épistémologiques à l’ensemble des travaux observés. Par ailleurs, la notion de « donnée » telle qu’elle est manipulée dans les systèmes informatisés16 , entretient nécessairement une ambigüité avec les différentes formes de « donation » auxquelles font face les diverses démarches de recherche en sciences humaines et sociales. Enfin, le terme de « données de recherche » entretient une confusion avec la question des « données de la recherche » qui se présentent comme une problématique d’ordre davantage institutionnel et infrastructurel17 . Les différentes acceptions du terme de « données » dans les pratiques attachées à la publication en SHS posent donc un premier problème.
Les « données » posent ensuite un problème de confusion d’un point de vue épistémologique dans la mesure où elles appellent à une requalification de la mobilisation des pratiques de recherche dans l’écriture d’un point de vue poétique et rhétorique. En ce sens, l’historien D. Rosenberg a étudié lʼévolution du sens du mot « data » dans la pensée anglophone au 18ème siècle, afin de comprendre ses connotations contemporaines dans le contexte des technologies numériques. Il propose une distinction du terme vis-à-vis des notions de fact (fait) ou d’evidence (preuve, témoignage, marque) qui traduisent des fonctions sémantiques différentes (Rosenberg, 2013). Lʼauteur observe que le 18ème siècle a été témoin dʼun glissement de connotation pour le terme, qui au début du siècle signifiait « faits donnés et au-delà de tout questionnement » (principalement dans le cadre de la théologie, et des mathématiques – « étant donné un nombre X… »), vers des « faits déterminés par des expériences, expérimentations ou collection ». Ainsi le terme de données ne désigne plus un présupposé incontestable mais le résultat dʼexpériences. Cela dit, dans les deux cas, lʼauteur souligne la nature rhétorique du concept de donnée, dans la mesure où ce dernier nʼa jamais eu aucune prétention ontologique (décrire ce qui est vraiment comme c’est le cas d’un fait) ou épistémologique (décrire ce qui nous permet de savoir comme c’est le cas d’un indice) mais a toujours été, jusque récemment, employé dans un contexte argumentatif. Les données seraient donc les éléments rhétoriques qui nous permettent de fabriquer une interprétation, plutôt que l’instrument d’un accès direct à un monde donné et immuable.
Par ailleurs, les « données » de recherche sont choisies et mobilisées dans la perspective d’une activité interprétative déterminée, et leur « donation » est en ce sens problématique pour décrire des activités de SHS. Dans une analyse sur les implications épistémologiques d’un travail sur les interfaces numériques dans le champ des sciences humaines et autres humanités, Johanna Drucker fait référence au terme de capta18 pour désigner le caractère construit et incarné des situations qui produisent des expériences interprétatives dans le cadre du contact entre chercheurs et interfaces. Ainsi que le soutient Drucker, « les différences dans les racines étymologiques des termes data et capta rendent claire la distinction entre approches constructivistes et réalistes » en indiquant que « le savoir est construit, pris, pas simplement donné comme une représentation naturelle du fait préexistant »19 (Johanna Drucker, 2011). Si toutes les démarches des SHS ne s’inscrivent pas dans une telle approche de « la connaissance comme interprétation déformante » (J. J. McGann, 1991), la critique de Drucker n’en révèle pas moins le caractère problématique du concept de données.
Les « données » sont enfin bien mal nommées dans la mesure où elles sont toujours intégrées dans les circuits et les chaînes d’opérations qui transforment les pratiques d’enquête en pratiques d’écriture, puis de publication. À ce titre, dans le champ de la sociologie des sciences, Bruno Latour a proposé dans plusieurs de ses travaux de désigner ce qui vient des pratiques de recherche comme des « obtenues » ou des « sublata »20 , plutôt que des données. Il insiste ainsi sur le processus de référence qui lie des pratiques de recherche avec des pratiques d’écriture (pour la plupart des cas de recherche étudiés par cet auteur, en sciences de la nature). Le concept de données agit donc comme une forme d’invisibilisation de la nature processuelle du travail de transformation de l’écriture pour la publication.
Pour décrire de manière préférable ce qui se joue dans la convocation des éléments empiriques de l’enquête dans l’écriture des SHS, je propose d’utiliser le concept de matériau. En considérant les différents éléments issus de l’enquête en SHS comme des matériaux plutôt que comme des « données » – ou des sources, ou des documents – il s’agit alors de considérer les pratiques d’écriture comme un processus de croissance mutuelle entre les écrivains et les différentes traces issus de leurs pratiques de recherche. Pour Tim Ingold, la définition d’un objet comme un matériau relève d’abord d’une perspective relationnelle – par exemple, considérer des ustensiles de cuisines comme des objets quand il s’agit de les déplacer, mais comme des matériaux quand il s’agit de faire la cuisine (Ingold, 2013/2017, pp. 55‑56). L’appellation des éléments issus du travail de recherche permet ainsi d’« avoir une lecture longitudinale de la fabrication comme une rencontre de forces et de matériaux » (Ingold, 2016) qui permet de considérer le travail d’écriture pour la publication comme « un processus morphogénétique » plutôt que comme « l’exploitation de données » ou « la représentation de résultats » par une technique d’écriture ou une autre. Au « x de la recherche » théorisé par Jean-Michel Berthelot comme l’horizon des opérations de traduction de l’écriture en SHS (Berthelot, 2004), répond alors l’énigme des matériaux qui invitent à penser le travail d’écriture comme un dialogue à la finalité ouverte :
Les matériaux sont ineffables. Ils ne peuvent être épinglés par des concepts ou des catégories établis. Décrire un quelconque matériau, c’est se confronter à une énigme dont la clé ne peut être découverte qu’à travers l’observation et la relation active avec ce qui est là. L’énigme donne au matériau une voix et lui permet de dire sa propre histoire : c’est à nous, alors, de nous mettre à l’écoute des indices qu’il nous offre et de découvrir ce qu’il nous raconte. (Ingold, 2013/2017, p. 80)
Considérer la présence des attaches empiriques de l’enquête dans l’écriture sur le registre de matériaux plutôt que de données correspond bien à une approche de la publication comme démarche fondamentalement performative. En effet, il s’agit de s’inscrire dans une approche de l’écriture qui l’entend comme un faire plutôt que comme la représentation d’une démarche, de résultats ou « d’arguments » préexistants. De plus, mobiliser le concept de matériaux permet aussi d’enrichir la notion de publication performative d’une forme d’imprévisibilité créatrice. Cela permet en effet de se rendre attentif aux dynamiques de co-constitution qui s’opèrent entre des pratiques d’enquête et un travail d’écriture, c’est-à-dire de rester disponible à ce que les matériaux font avec l’écriture autant que ce que l’écriture leur fait, dans un processus de formation commune. Cela fait de la pratique de l’écriture non seulement le lieu de la performance matérielle et discursive d’un argument ou d’une idée, mais également celui d’une rencontre dont la finalité n’est pas définie à l’avance. Elle ouvre aussi à une définition élargie et inclusive de l’écriture de recherche en termes d’interdisciplinarité méthodologique, ainsi que l’a également noté la chercheuse Tara McPherson :
Jane Bennett parle du désir de lʼartisan de voir ce quʼun matériau peut faire (par opposition au désir du scientifique dʼapprendre ce quʼun matériau est). Cette curiosité pour la matière, ce désir de comprendre ce que les choses peuvent faire, opère dans un registre différent de la critique. La théoricienne pourrait résister à un tel cadrage, arguant quʼelle travaille avec les mots comme son « matériau », voyant ce quʼils pourraient révéler lorsquʼon les étire au-delà du langage du sens commun. Elle a raison, mais il y a dʼautres matériaux que nous pourrions utiliser, dʼautres agencements à explorer, qui existent au-delà du réel discursif, des agencements qui pourraient nous faire évoluer vers de nouvelles alliances et de nouvelles pratiques.21 (McPherson, 2018, p. 20)
Comment les matériaux de la recherche sont-ils travaillés par les pratiques numériques de l’écriture de recherche, et vice versa ? Et comment ces rencontres participent-elles de l’émergence de nouveaux formats d’écriture (numérique) ? Il s’agit maintenant de visiter quelques unes de ces rencontres dans des expérimentations de publication performative numérique, avant de décrire les modalités et les conséquences de la stabilisation – paradoxale – de certaines d’entre elles dans de nouveaux formats d’écriture pour la publication en SHS.
Constitution et structuration d’un cabinet de curiosités sur quelques expérimentations d’écriture numérique de l’enquête
Les relations qui s’établissent entre les matériaux de recherche, les pratiques d’écriture et les collectifs qu’elles assemblent prennent des formes multiples qu’il s’est agi dans cette recherche de recenser afin de rendre comparables et analysables des expériences vécues de première main. Pour ce faire, j’ai conduit un travail de collection critique portant sur un ensemble d’expérimentations aux prises avec la relation entre pratiques d’enquête et pratiques d’écriture via leur format de publication. Dans le prolongement de pratiques de collection existantes portant sur des expérimentations en édition numérique à l’œuvre dans le champ de l’art et du design (Lorusso, 2013) ou d’expérimentations portant sur la publication performative (Janneke Adema, 2015), je me suis engagé dans un travail de collecte au long cours dont l’objectif visait à identifier des cas d’étude pertinents, mais également à construire un espace de mise en relation entre ces cas souvent issus de contextes nationaux et disciplinaires très variés. Ce travail a abouti à la création d’un site web en accès libre et au code ouvert, intitulé Studiolo22 .
L’objectif de Studiolo était donc double. Il s’agissait de comprendre les motivations qui poussent des chercheurs en sciences humaines et sociales à expérimenter des manières d’écrire spécifiques à leur démarche de recherche dans le cadre de leur publication – soit leurs formats d’écriture. Il s’agissait par ailleurs de documenter les modalités de rencontre sensorielle, pratique et intellectuelle – soit les formats de lecture – en tant que visiteur/lecteur/spectateur, avec ces expérimentations, pour en faire un lieu d’enquête. Le studiolo a donc vocation à être une ressource pour le développement de ce chapitre, mais il est également en lui-même l’une des contributions de cette enquête. En tant que pratique présentant un intérêt méthodologique pour la trajectoire de la recherche23 , il a été le lieu de plusieurs activités critiques : sélectionner quelles pièces à intégrer dans le champ d’investigation ; documenter ces pièces en constituant des images, vidéos, et extraits de texte destinés à en rendre compte ; les décrire au moyen d’un ensemble de catégories plus ou moins partagées, afin d’effectuer un travail comparatif ; enfin, mettre en relation les différentes pièces via l’élaboration d’un format de lecture autorisant la navigation entre des cas d’étude présentant des points communs.
Définir un périmètre d’investigation
J’ai établi de manière itérative un ensemble de critères d’admission pour inclure (ou laisser à la marge) des expérimentations de publication de recherche dans Studiolo. J’ai restreint ma collection aux cas mobilisant au moins un chercheur (au sens d’un professionnel financé par une institution de recherche publique ou privée). J’ai par ailleurs traité la limitation épistémologique de mon investigation aux seules « SHS » de manière très inclusive en bornant ma sélection à des projets traitant de l’expérience humaine – en opposition aux démarches des « sciences de la nature ». J’ai par ailleurs écarté les ressources destinées exclusivement à faire l’objet d’un travail d’exploitation par d’autres publications – telles que des éditions critiques, des sites dédiés au « partage et réutilisation de données de recherche » ou des collections numériques de recherche thématiques. J’ai enfin également écarté les expérimentations concentrées sur le questionnement des institutions et des processus éditoriaux – nouvelles modalités de validation, de diffusion, ou de révision des publications – quand ce questionnement ne présentait pas de lien direct avec la spécificité des recherches, puisque ce type de démarche ne correspondait pas aux questions de ce chapitre24 .
Fidèle à l’ancrage de ma recherche dans le champ aux contours dynamiques des « Sciences Humaines et Sociales », j’ai donc adopté un périmètre d’investigation intermédiaire, ne portant ni sur le champ de la publication universitaire dans son ensemble, ni sur celui d’une communauté savante identifiable par sa discipline ou son pays. Ces deux autres échelles d’analyse possibles passaient en effet à côté de la problématique que j’essaie de traiter. D’une part, une étude sur le système de la communication scientifique dans son ensemble engagerait à se concentrer exclusivement sur les dimensions documentaires, informationnelles et organisationnelles qui font de la publication l’un des facteurs organisateurs de la recherche, dans ses dimensions administrative, organisationnelle et économique, ou encore à toucher à des questions de politique institutionnelle. D’autre part, une étude centrée sur le rapport à la publication d’une discipline particulière, d’une école de pensée ou même d’un chercheur spécifique aurait permis d’explorer davantage les relations qui s’établissent entre pratiques de recherche et d’écriture d’un point de vue épistémologique et méthodologique. Mais elle ne permettrait pas en retour d’interroger l’inscription de ces relations dans des dynamiques de formation sociale. Or c’est bien l’interaction entre des démarches de recherche spécifiques et des conventions plus larges qu’il s’agit ici d’interroger.
Construire une classification critique
Pour chacun des cas d’études du studiolo – pour la plupart destinés inexorablement à être les victimes du destin funeste de l’obsolescence technologique – j’ai effectué un travail de documentation et d’archivage de leur manifestation sensible durant leur lecture, via un archivage web – quand il n’était pas déjà fait – et la capture de copies d’écran et parfois de screencasts.
J’ai adjoint à cette initiative un travail de catégorisation critique visant à produire des typologies de classement et de regroupement des cas d’étude en fonction des questions de recherche de ce chapitre. Ainsi, la question des relations entre matériaux et écriture impliquait de classer les pièces selon les types de « données », « documents » ou « sources » qu’elles mobilisaient ; la question de la relation entre formats d’écriture et formations sociales m’a amené à tenter de les regrouper par « champ » – discipline, domaine, par exemple « histoire du livre » – mais également à repérer les différents qualificatifs utilisés pour tenter de rattacher les expérimentations à des formats éditoriaux reconnus – par exemple « livre/book » ; enfin, la question de la collaboration interdisciplinaire dans les modes d’écriture de ces expérimentations mʼa amené à les regrouper en grandes « techniques » correspondant à des techniques d’écriture particulières – par exemple : « vidéo », « mécanismes d’interactivité », ou « visualisation ».
En complément des pièces, j’ai défini un ensemble « d’objets » périphériques permettant de les mettre en contexte et en relation par le biais de l’interface critique du studiolo. Par exemple, j’ai répertorié les « collections » remarquables faisant place à des formes d’expérimentations dans la publication universitaire – telles des revues comme Vectors, des collections de cédéroms comme la série Anarchives dans le champ des recherches en Arts, ou une collection éditoriale telle que la Mediawork pamphlet Series*proposée par MIT Press. J’ai également fait un travail de récolte portant sur les diverses organisations liées à la construction des pièces25 , ainsi que les technologies et les plateformes utilisées. L’ensemble de ces éléments m’a ainsi permis de construire une scène d’enquête mettant en relation ces diverses expérimentations liant enquête et écriture, il me fallait alors fabriquer un équipement permettant de tirer parti de ce travail.
Stabiliser un format de lecture
Pour construire mon analyse, le dispositif de collecte et d’analyse du studiolo est composé à partir de deux techniques d’écriture complémentaire. La première repose sur la construction d’un tableau en ligne privé 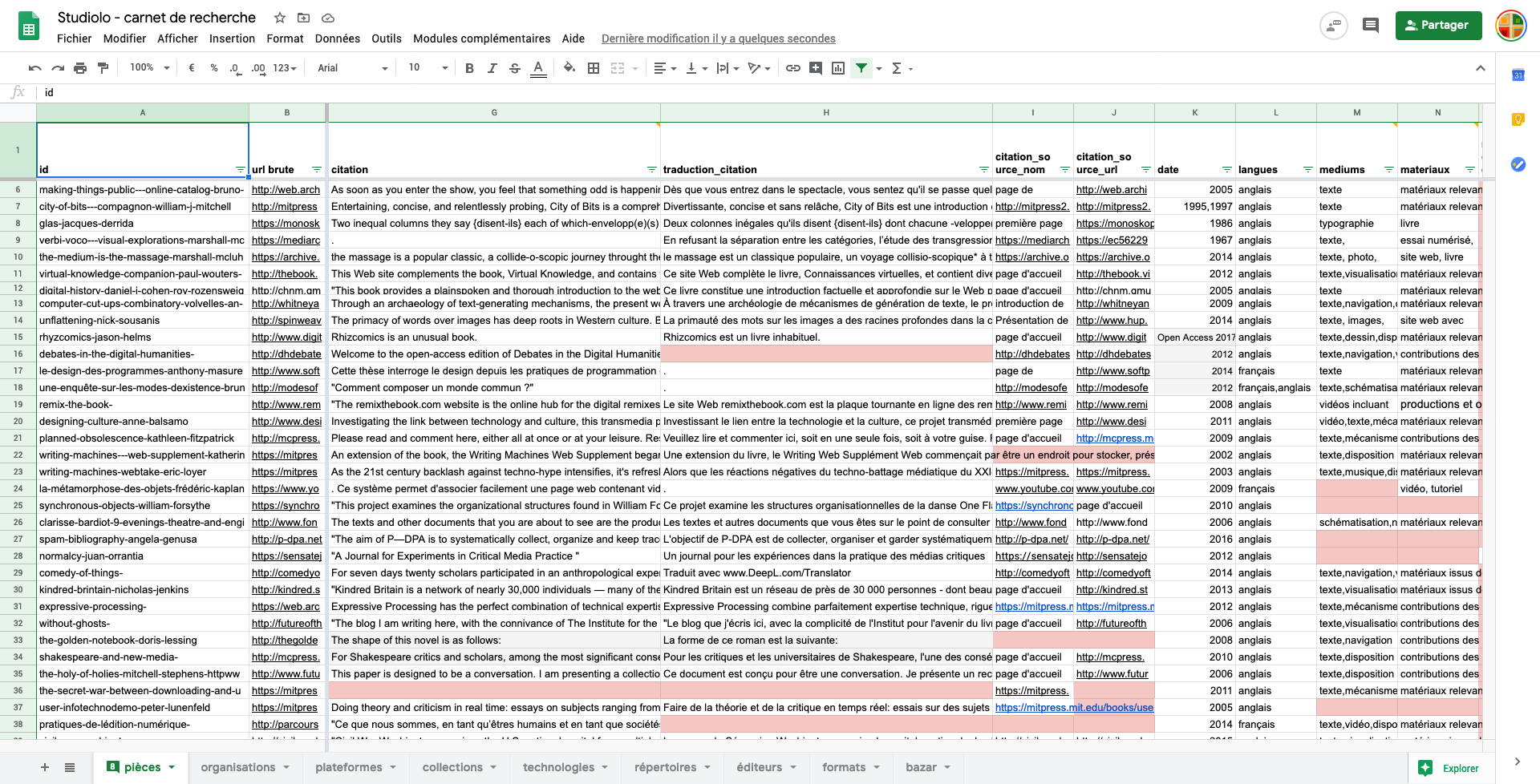 dans lequel j’ai défini un modèle de documentation en accord avec les questions de recherche présentées précédemment. La deuxième technique d’écriture a consisté à concevoir et à programmer le site web public Studiolo. Le choix d’un format tabulaire, à la fois pour le format de données de la base, et pour son format graphique en tant que dispositif de visualisation et de lecture, n’est pas indifférent à l’exploitation d’une certaine forme de « raison graphique » – pour reprendre le terme stabilisé par l’anthropologue de l’écriture Jack Goody (Goody, 1979) – permettant de construire un ensemble de relations porteuses de sens. À celle-ci se combine une forme de pensée navigationnelle, permise par l’hypertextualité numérique, qui autorise une navigation de proche en proche à même de formuler de nouvelles connexions.
dans lequel j’ai défini un modèle de documentation en accord avec les questions de recherche présentées précédemment. La deuxième technique d’écriture a consisté à concevoir et à programmer le site web public Studiolo. Le choix d’un format tabulaire, à la fois pour le format de données de la base, et pour son format graphique en tant que dispositif de visualisation et de lecture, n’est pas indifférent à l’exploitation d’une certaine forme de « raison graphique » – pour reprendre le terme stabilisé par l’anthropologue de l’écriture Jack Goody (Goody, 1979) – permettant de construire un ensemble de relations porteuses de sens. À celle-ci se combine une forme de pensée navigationnelle, permise par l’hypertextualité numérique, qui autorise une navigation de proche en proche à même de formuler de nouvelles connexions.
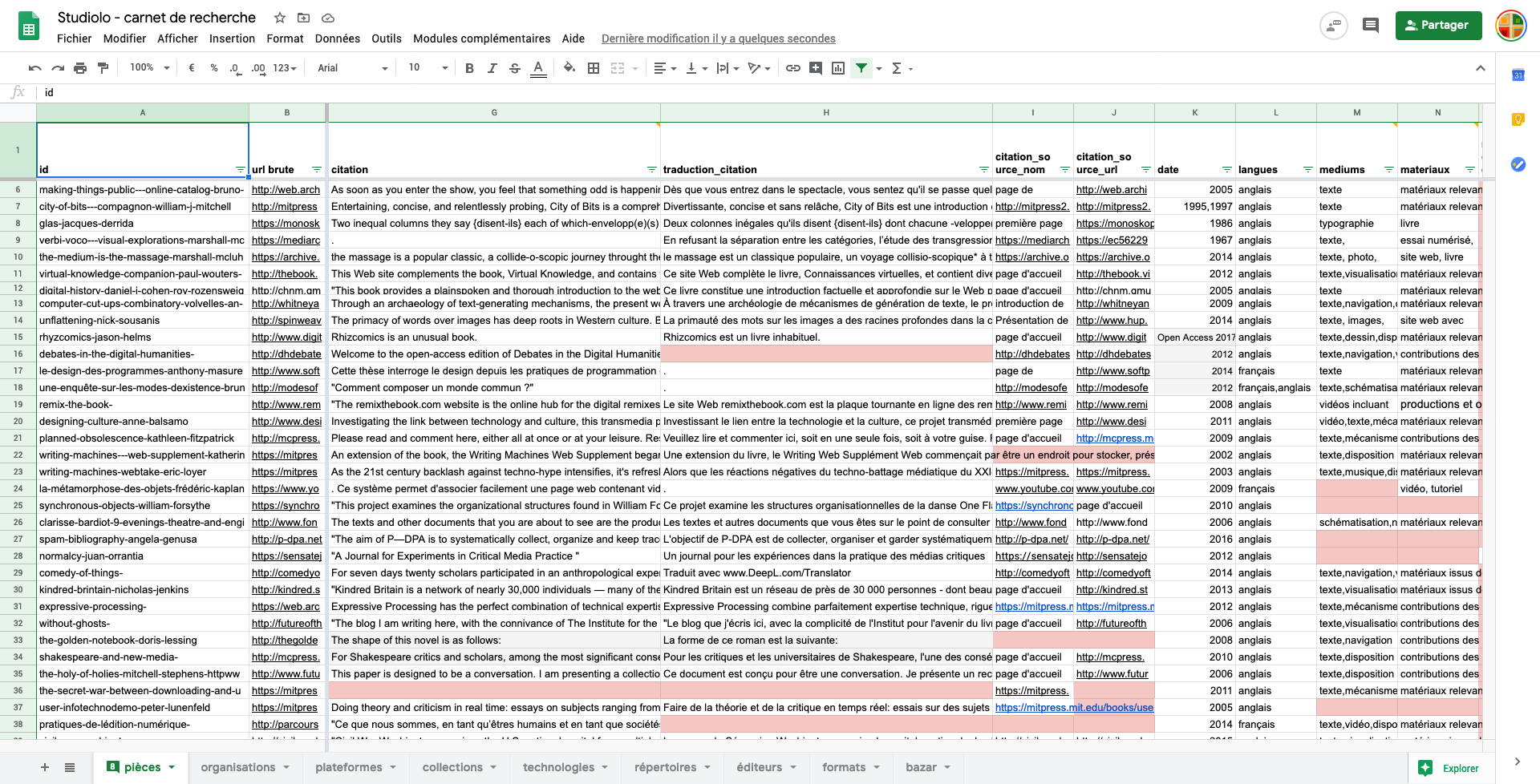 dans lequel j’ai défini un modèle de documentation en accord avec les questions de recherche présentées précédemment. La deuxième technique d’écriture a consisté à concevoir et à programmer le site web public Studiolo. Le choix d’un format tabulaire, à la fois pour le format de données de la base, et pour son format graphique en tant que dispositif de visualisation et de lecture, n’est pas indifférent à l’exploitation d’une certaine forme de « raison graphique » – pour reprendre le terme stabilisé par l’anthropologue de l’écriture Jack Goody (Goody, 1979) – permettant de construire un ensemble de relations porteuses de sens. À celle-ci se combine une forme de pensée navigationnelle, permise par l’hypertextualité numérique, qui autorise une navigation de proche en proche à même de formuler de nouvelles connexions.
dans lequel j’ai défini un modèle de documentation en accord avec les questions de recherche présentées précédemment. La deuxième technique d’écriture a consisté à concevoir et à programmer le site web public Studiolo. Le choix d’un format tabulaire, à la fois pour le format de données de la base, et pour son format graphique en tant que dispositif de visualisation et de lecture, n’est pas indifférent à l’exploitation d’une certaine forme de « raison graphique » – pour reprendre le terme stabilisé par l’anthropologue de l’écriture Jack Goody (Goody, 1979) – permettant de construire un ensemble de relations porteuses de sens. À celle-ci se combine une forme de pensée navigationnelle, permise par l’hypertextualité numérique, qui autorise une navigation de proche en proche à même de formuler de nouvelles connexions.Studiolo est construit comme un système de listes interconnectées. La colonne de gauche représente l’ensemble de pièces qui sont les cas d’étude au centre de la collection. Les autres colonnes représentent un ensemble d’objets liés et de catégories critiques permettant de naviguer entre les pièces mais aussi d’expérimenter les différentes formes de relation utilisées. Depuis la liste, le clic sur le symbole « liens » attaché à chaque élément 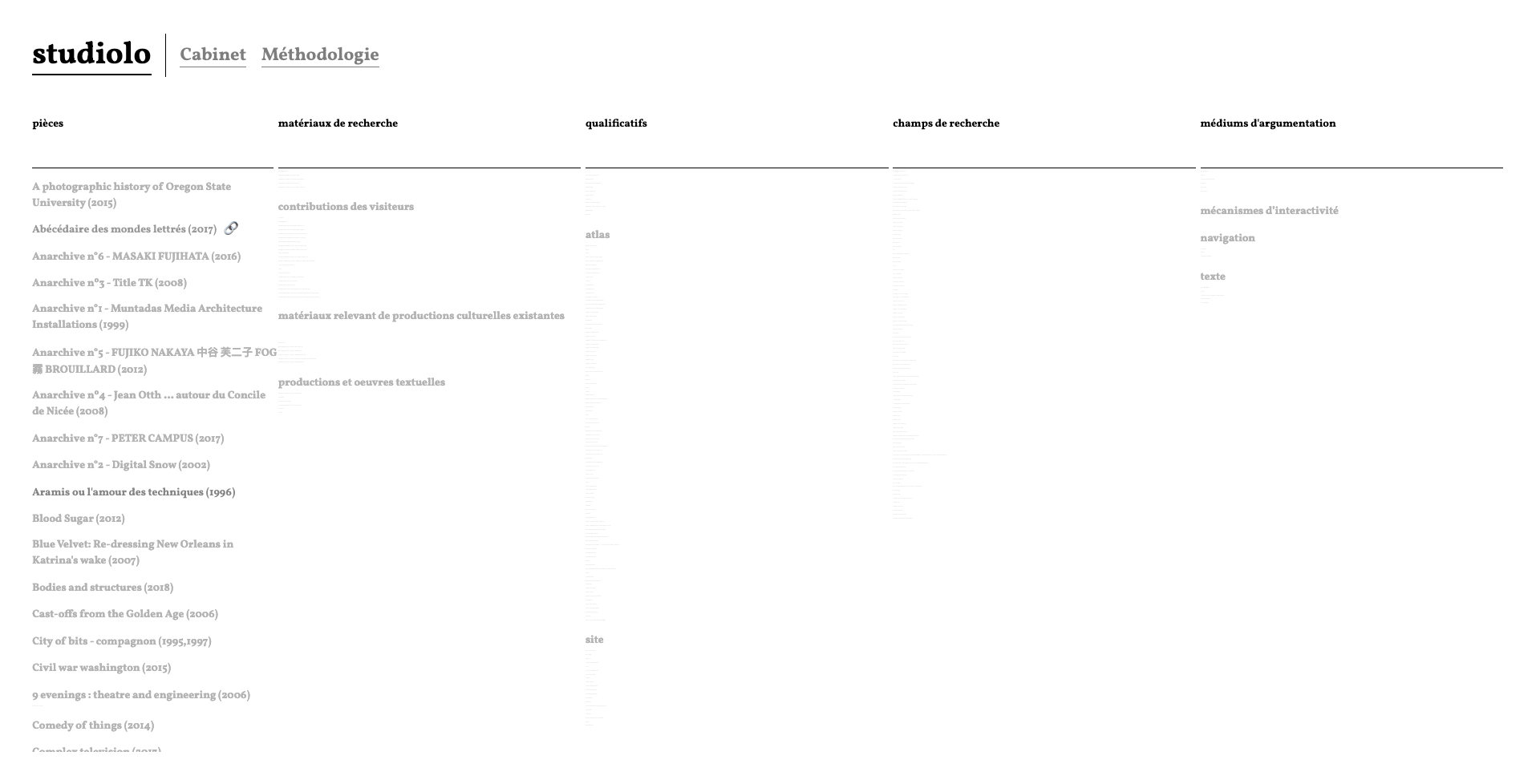 permet de déformer les listes pour mettre en avant les éléments auxquels il est lié. Le clic sur l’un des éléments de la liste
permet de déformer les listes pour mettre en avant les éléments auxquels il est lié. Le clic sur l’un des éléments de la liste 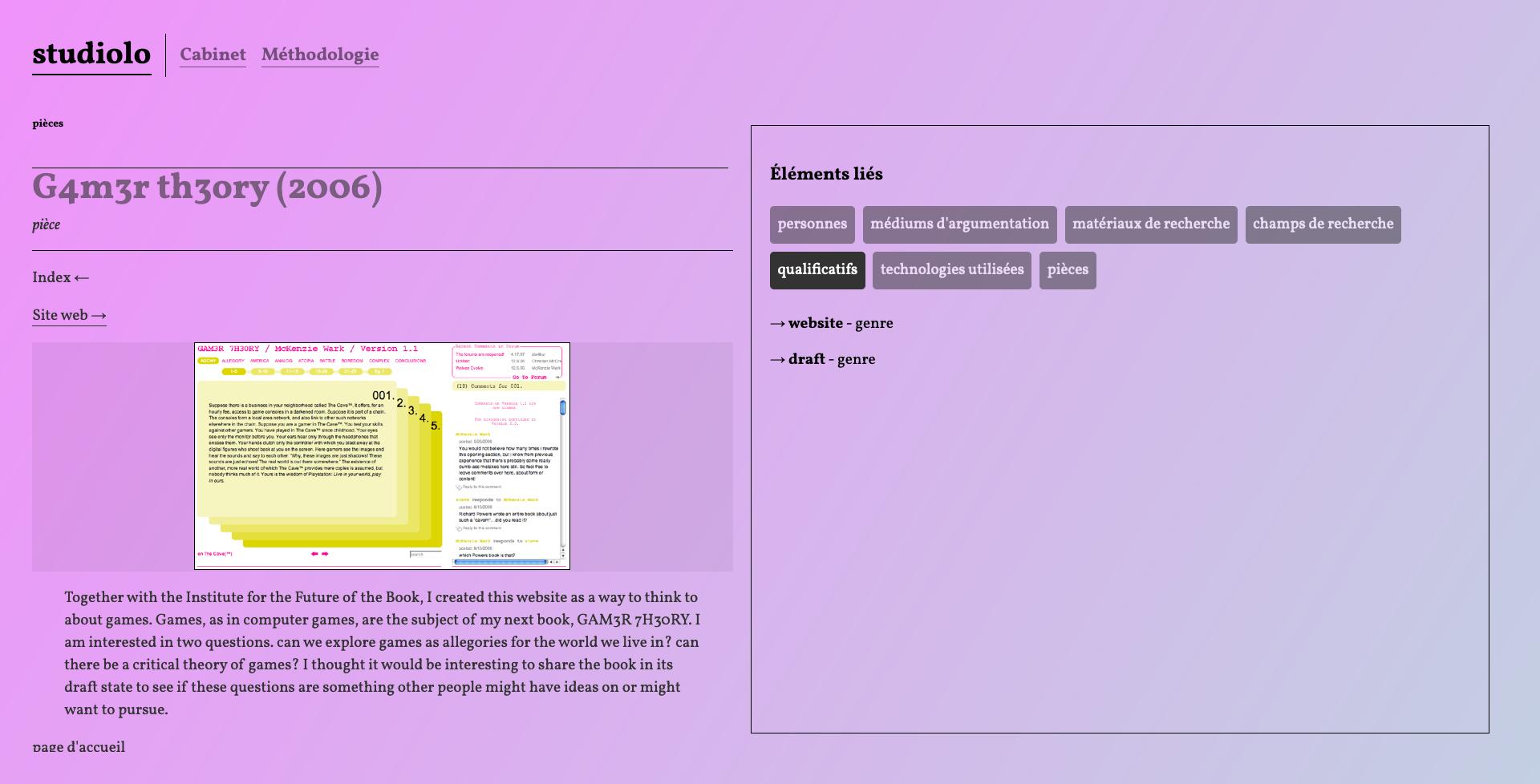 permet d’en voir la documentation associée, mais aussi et surtout de naviguer de manière longitudinale vers d’autres cas liés par des types de matériaux communs, des personnes, ou encore des champs de recherche. Un tel système permet ainsi de faire l’expérience de fréquentation de chaque pièce séparément, mais aussi de la comparer avec d’autres.
permet d’en voir la documentation associée, mais aussi et surtout de naviguer de manière longitudinale vers d’autres cas liés par des types de matériaux communs, des personnes, ou encore des champs de recherche. Un tel système permet ainsi de faire l’expérience de fréquentation de chaque pièce séparément, mais aussi de la comparer avec d’autres.
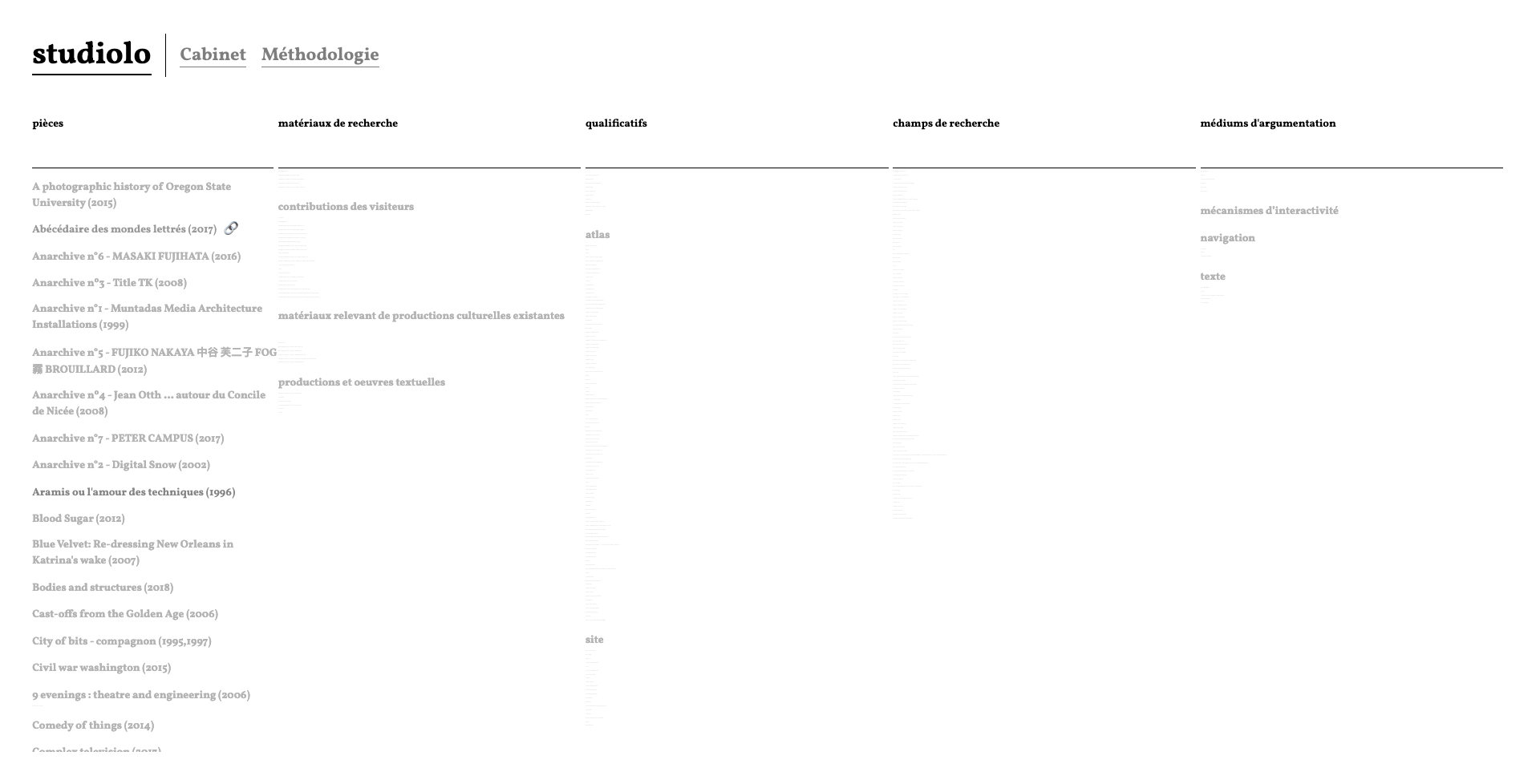 permet de déformer les listes pour mettre en avant les éléments auxquels il est lié. Le clic sur l’un des éléments de la liste
permet de déformer les listes pour mettre en avant les éléments auxquels il est lié. Le clic sur l’un des éléments de la liste 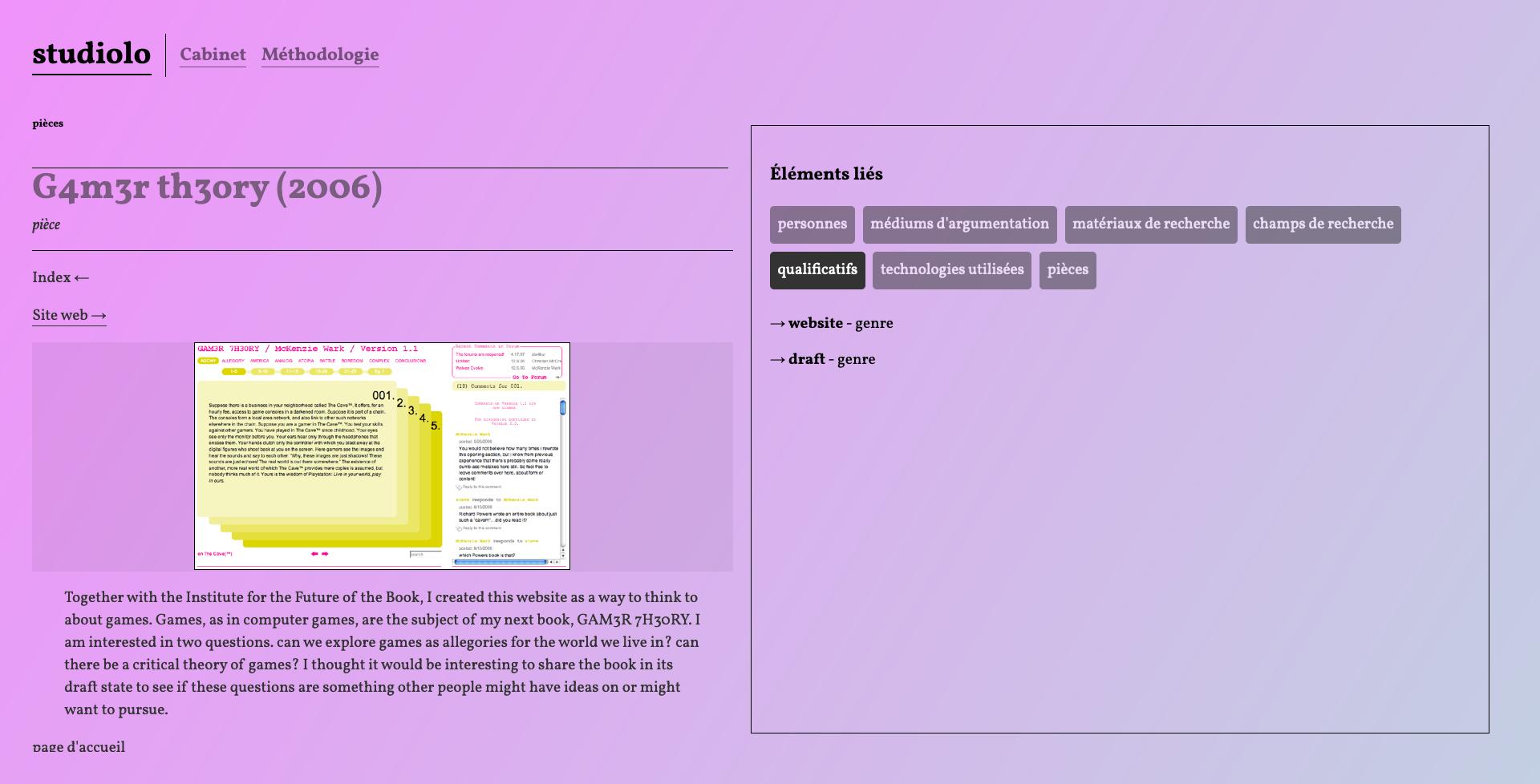 permet d’en voir la documentation associée, mais aussi et surtout de naviguer de manière longitudinale vers d’autres cas liés par des types de matériaux communs, des personnes, ou encore des champs de recherche. Un tel système permet ainsi de faire l’expérience de fréquentation de chaque pièce séparément, mais aussi de la comparer avec d’autres.
permet d’en voir la documentation associée, mais aussi et surtout de naviguer de manière longitudinale vers d’autres cas liés par des types de matériaux communs, des personnes, ou encore des champs de recherche. Un tel système permet ainsi de faire l’expérience de fréquentation de chaque pièce séparément, mais aussi de la comparer avec d’autres.Studiolo permet ainsi d’explorer, sur un registre non-exhaustif et situé, comment des expérimentations articulées avec les technologies numériques peuvent questionner et reconfigurer les relations qui s’opèrent entre des matériaux de recherche et des démarches d’écriture pour la publication. Il s’agit maintenant de désigner quelques modalités possibles de telles relations à partir de certains des cas étudiés.
Quelques régimes émergents d’écriture numérique pour la publication
La constitution de Studiolo a révélé une variété d’articulations entre les matériaux associées aux travaux de recherche et les manières d’écrire à même de constituer un geste de publication numérique avec ces derniers. Pour beaucoup de ces expérimentations, l’introduction des technologies numériques dans la relation entre pratiques d’écriture et pratiques d’enquête s’est accompagnée de la formulation de modèles alternatifs qui ont guidé la formulation progressive de régimes d’écriture émergents. Je me propose d’en présenter rapidement trois différents.
Un premier modèle d’articulation numérique entre écriture et matériaux de recherche relève d’une séparation en « strates » qui iraient depuis les « arguments » ou le « récit » d’une publication vers les matériaux avec lesquels elle dialogue, selon des degrés progressifs de précision, de richesse et de délinéarisation. En ce sens, l’historien Robert Darnton formulait en 2009 l’idée d’une « pyramide informationnelle » offrant aux lecteurs un dispositif leur permettant d’accéder à des versions de plus en plus riches et personnalisées d’un même travail de recherche :
Voici comment cette idée fantaisiste a pris corps. Un « livre électronique », contrairement au codex imprimé, peut contenir de nombreuses strates organisées en forme de pyramide. Les lecteurs pourront télécharger le texte et parcourir la strate supérieure qui sera rédigée comme une monographie classique. Si cela leur suffit, ils imprimeront le texte, le relieront (il est possible aujourd’hui de brancher des relieuses aux ordinateurs et aux imprimantes) et l’étudieront à leur guise sous la forme d’un livre fabriqué sur commande. S’ils tombent sur quelque chose qui les intéresse plus particulièrement, ils cliqueront sur une autre strate et accéderont à un essai ou à un appendice supplémentaire. Ils pourront aussi continuer à s’enfoncer plus profondément dans le livre à travers un corpus de documents – bibliographie, historiographie, iconographie, musique de fond –, tout ce que j’aurai mis à leur disposition pour conduire à la compréhension la plus complète possible de mon sujet. (Darnton, 2012, pp. 248‑249)
Ce modèle de la « pyramide », explicité par Darnton, se retrouve d’une certaine manière, sous une forme simplifiée et légèrement différente en termes d’implémentation, dans la production d’une diversité de « compagnons » numériques pour des publications imprimées, dont Studiolo ne répertorie que quelques exemples. Dans ces derniers – comme par exemple le compagnon numérique de l’ouvrage How we think de Katherine Hayles (Hayles, 2012), l’écriture numérique est le moyen de fournir un accès à des matériaux « complémentaires » – interviews, documents, vidéos – qui ont concouru à l’écriture d’un texte « principal » mais ne sont pas toujours indispensables à sa fréquentation. En traduisant le principe de l’appendice bibliographique sous une forme numérique, il s’inscrit dans un « régime de l’approfondissement » qui anticipe la pratique du lecteur comme une forme de reconstitution de l’épreuve du chercheur lors de la préparation de la publication, appelant à opérer un parcours depuis le récit proposé vers les matériaux qui ont conduit à sa formulation26 .
D’autres expérimentations en SHS exploitent les technologies numériques pour tisser de manière plus intime des textes argumentatifs avec les preuves – diagrammatique, quantitatives, documentaires – qui les soutiennent. Ainsi, par exemple, la publication « Mapping Environmental Debates on Environmental Adaptation » (Baneyx et al., 2015), issue d’une collaboration interdisciplinaire entre un laboratoire de sciences sociales, une école de design et un laboratoire de sciences de la nature, porte sur les débats institutionnels portant sur l’adaptation au changement climatique27 . Elle déploie un mode d’écriture qui associe systématiquement une argumentation écrite et séquentielle avec une variété de documents issus de pratiques d’enquête antérieures – par exemple, des rapports de sessions de négociation et autres traités officiels, ainsi que des visualisations de données construites à partir de méthodes de recherche numériques – histogrammes et autres graphes de réseau. Les manières d’écrire déployées dans ce cas s’inscrivent dans l’émergence d’un « régime de l’évidence » qui repose sur des mécanismes de synchronisation entre les actions du lecteur (cliquer, défiler, etc.), la lecture du texte, et l’interprétation des images et des documents. L’écriture consiste alors à expliquer les matériaux par le truchement du format de lecture numérique. Cependant, les cas d’étude s’inscrivant dans ce régime introduisent également une ambiguité dans la définition même de la modalité d’écriture ici en question : en mêlant intimement production de graphiques, de textes, et de mécanismes d’interactions, ils remettent en question la prédominance du discours textuel comme seule technique d’écriture de recherche.
D’autres travaux, enfin, expérimentent une forme de renversement de la relation entre activités de « constitution des matériaux » et pratiques d’écriture, en combinant le genre de l’archive de recherche en ligne avec la constitution de récits savants. L’un des exemples de cette approche est Kindred Britain, une publication numérique qui vise à rendre compte de travaux de recherche portant sur l’influence historique des grandes familles britanniques sur l’histoire du Royaume Uni. La pièce découle d’un projet consistant à simultanément construire une base de données à fonction archivistique, un argument de recherche, et une communauté d’auteurs historiens intéressés à l’objet traité par la pièce.
Kindred Britain se présente sous la forme d’une série de visualisations interactives pouvant être explorées et configurées par le lecteur, à laquelle peut être juxtaposée à l’écran une collection de « récits » écrits par des chercheurs invités. À la lecture de ces récits, il est possible de cliquer sur certaines parties du texte pour reconfigurer les visualisations du site de manière dynamique afin de mettre en avant une personne particulière, une ligne généalogique spécifique, ou un ensemble de lieux. Kindred Britain se décrit comme un « ouvrage savant interactif » (interactive scholarly work) qui « présente lʼinformation de diverses manières comme une vue dans un modèle, avec de riches annotations mais aussi des mécanismes explicites pour présenter des récits savants qui sont intégrés aux composants de visualisation des données et non pas simplement à côté dʼeux » (Jenkins, 2013). Ce faisant, il expérimente un « régime de l’annotation » qui renverse le rapport entre le « récit » et ses « sources », et provoque un doute vis-à-vis de la prédominance du discours écrit sur les matériaux avec lesquels il dialogue :
Même sans récits formels, la base de données Kindred Britain est une revendication sur la forme et la nature de la culture britannique, et le site tente de formaliser une telle revendication en rendant certains mécanismes explicites. La limite entre la riche conservation dʼune base de données et la production de connaissances est ainsi une zone floue, une sorte de frontière entre les récits traditionnels de la recherche en sciences humaines et les archives interactives.28 (Jenkins, 2013)
Une telle perturbation questionne aussi la limite que les collectifs éditoriaux ont coutume d’établir entre les pratiques de fabrication (par exemple, de bases de données, de visualisations et autres images) et les pratiques d’écriture à l’œuvre dans la publication de recherche. Elle induit par voie de conséquence une remise en question du modèle de « l’auteur universitaire » comme seule personne en charge de l’écriture pour la publication. Il s’agit maintenant d’étudier plus précisément les relations qui s’établissent entre pratiques de fabrication et pratiques d’écriture de recherche dans l’expérimentation de ces nouveaux régimes d’écriture.
La publication comme geste d’écriture collectif et multimodal : le cas de la revue Vectors
Afin d’explorer la relation entre expérimentations de publication numérique et formats d’écriture, un ensemble de cas d’étude remarquable s’est dégagé sous le nom de la revue universitaire Vectors fondée en 2005 et active jusqu’en 2013. Cette dernière porte sur « les enjeux sociaux, politiques et culturelles de nos existences médiatisées par les technologies » 29 (McPherson, Anderson, Loyer, Dietrich, & Kelly, 2009) et se trouve depuis 2018 accompagnée d’un ouvrage en détaillant l’histoire depuis le point de vue de l’une de ses architectes principales, la chercheuse en cinéma et media studies Tara McPherson (McPherson, 2018). Elle est à la fois une entreprise éditoriale et un « laboratoire pour des genres émergents de pratiques savantes » (McPherson, 2010) dédié à la publication de travaux « qui ne peuvent exister que sous une forme multimédia » (McPherson et al., 2009) et qui ne peuvent pas être « contenus dans les conventions […] de l’édition électronique contemporaine » 30 (McPherson, Anderson, Dietrich, & Loyer, 2013) . Dans ce cadre, Vectors regroupe un ensemble de démarches d’écriture et de collaborations entre chercheurs et designers, qui se veulent spécifiques à chacun des « articles » de la revue.
Vectors trouve ses origines dans l’Institute for Multimedia Literacy de l’Université de Californie du Sud, un espace d’expérimentation pédagogique tourné vers la fabrication de projets multimédias (McPherson, 2018, p. 125), lui-même inscrit dans un contexte américain marqué par la prolifération de revues de « rhétorique numérique » et d’initiatives pédagogiques visant à enseigner l’utilisation du web dans les cours d’anglais – par exemple, dès 1985, le Computer Research Lab du département d’anglais de l’Université d’Austin (« The Digital Writing & Research Lab – at the University of Texas at Austin », 2010), puis à partir de 1996 la revue de numérique Kairos (« Kairos », 1991). Parallèlement à ce contexte scientifique et pédagogique, des expériences telles que le projet Labyrinth explorent des premières formes de « récits de base de données » (Kinder, Kang, Comella, & Mahoy, 1997), tandis qu’en 1999 la création de l’Electronic Literature Organization (« About the ELO », 1999) permet de soutenir et de rendre visibles des expérimentations artistiques variées sur les formes d’écriture permises par les technologies de computation et de mise en réseau31 . Puis, en 2001-2003, la création du SpecLab au sein de l’Université de Virginie, animé par Johanna Drucker et Bethany Novwiskie (Johanna Drucker & Nowviskie, 2004), expérimente la fabrication de divers environnements interprétatifs pour les humanities, pendant que les travaux de Katherine Hayles, déjà abordés plusieurs fois dans ce texte, établissent des connexions multiples entre les communautés de la littérature électronique, des études culturelles des médias (media studies), et des disciplines rattachées aux Humanities anglo-saxonnes.
Pour étudier l’histoire de la revue Vectors à travers les traces documentaires disponibles depuis la France, j’ai conduit en 2016 un travail de documentation consistant à effectuer une série de captures vidéos et d’extractions textuelles sur les différentes pièces de la revue. Je les ai ensuite annotées en fonction des catégories générales du studiolo et d’une taxonomie plus libre32 . J’ai par ailleurs effectué la revue qualitative de l’ensemble des articles33 et des différents épitextes qui leur sont associés, et réalisé une revue systématique des différents documents accessibles en ligne traitant du projet.
L’étude des différentes pièces de la revue Vectors révèle d’abord un ensemble très varié d’approches disciplinaires et de matériaux de recherche. Ces derniers se voient mis en scène et assemblés de manières extrêmement diversifiée selon les articles, constituant une collection d’expérimentations qui empruntent et hybrident différentes techniques d’écriture en apparence étrangères à des pratiques de communication savante – telles que la bande dessinée (Wark & Loyer, 2013), le jeu vidéo (Swalwell & Loyer, 2006), la cartographie (Povinelli & Cho, 2012), le documentaire (Sharon Daniel & Erik Loyer, 2007), ou encore le poème typographique (Goldberg, Hristova, & Loyer, 2007). Cette diversité de techniques induit de nouvelles modalités de lecture et de relation avec les publics, mais également un bouleversement dans la manière de lier pratiques d’écriture et matériaux d’enquête. En ce sens, les projets de Vectors se présentent comme une double « défamiliarisation au niveau de la conception esthétique pour le lecteur et au niveau de la collaboration et de la construction pour lʼauteur »34 (McPherson, 2018, p. 147). Quelle est l’influence de cette défamiliarisation sur les pratiques d’écriture à l’œuvre dans la production des « articles » de Vectors ? Comment se négocie la dimension collective d’un tel processus d’écriture multimodal et distribué ? Et quels types d’articulations stabilise-t-il entre pratiques d’écriture, pratiques d’enquête, et dynamiques de formation sociale ?
Un collectif de fabrication tout autant qu’un collectif d’écriture
Vectors est à la fois une revue – le Vectors Journal, dont le premier numéro sort en 2005 – et un laboratoire – le Vectors Lab, initié en 2002 par Tara McPherson et Steve Anderson. Le laboratoire est organisé selon le modèle d’un studio intégré composé d’universitaires en situation d’éditeurs scientifiques, de concepteurs, et de chercheurs, provenant d’une variété de disciplines. La revue se fonde sur un système de « bourses » accordées à certains chercheurs pour collaborer avec l’équipe, selon un processus de candidature dans lequel ces derniers se voient demandés non seulement de présenter leurs objets d’étude, leurs questions et leurs besoins en termes techniques, mais aussi et surtout « de préciser pourquoi les médias numériques étaient importants pour le projet quʼils envisageaient »35 (McPherson, 2018, p. 120). Les candidatures acceptées donnent lieu à des collaborations sur une durée de trois à six mois sur chaque « projet » ou « pièce » de la revue.
Ainsi, Vectors se présente à la fois comme une instance éditoriale et comme un collectif de fabrication. L’équipe éditoriale compte trois designers et développeurs permanents – Raegan Kelly, Craig Dietrich et Erik Loyer – auxquels viennent s’ajouter des collaborations multiples à l’occasion de la production de chacun des « articles ». Ces derniers s’engagent alors avec les chercheurs « boursiers » dans des jeux de triangulation entre pratiques de design, écriture savante et expérimentations computationnelles. Afin de traduire la dynamique collective qu’implique une telle manière d’écrire, l’éditorial général de la revue se présente comme une pièce numérique interactive 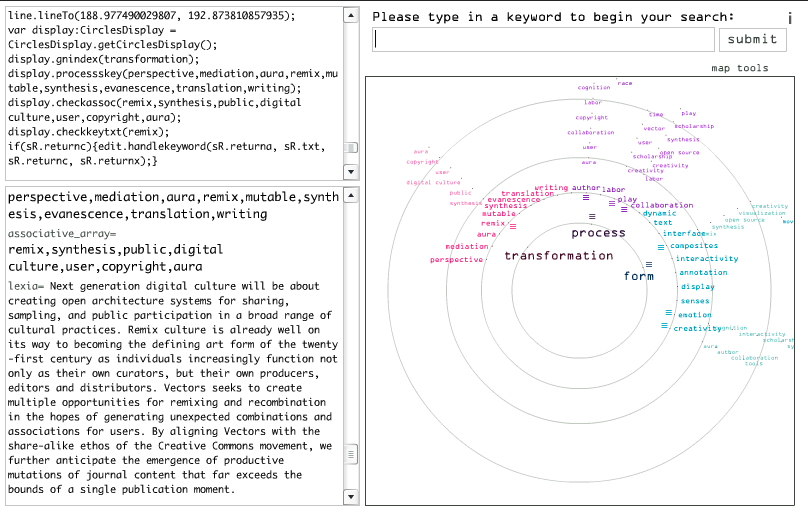 faisant dialoguer trois éléments graphiques distincts avec les activités du visiteur : un diagramme constitué de mots-clés, une fenêtre présentant un code source en train de se dérouler au fur et à mesure des interactions avec le lecteur, et enfin une fenêtre de texte affichant de courts développements textuels attachés à chacun des mots-clés. Ces trois fenêtres « reflètent les processus de ‹ pensée › parallèles de lʼécrivain, du designer et du processeur » auxquelles s’ajoute « la collaboration des utilisateurs »36 (McPherson & Anderson, 2005a). Dans ce contexte, le rapport de collaboration induit une écriture collective qui ne sépare pas les pratiques et les théories. Tara McPherson insiste ainsi sur « les boucles itératives qui existent entre les idées et les expériences » dans un rapport de « tension productive » entre la « théorie » et la « conception de projet » plutôt que sur un registre représentationnel ou instrumental37 .
faisant dialoguer trois éléments graphiques distincts avec les activités du visiteur : un diagramme constitué de mots-clés, une fenêtre présentant un code source en train de se dérouler au fur et à mesure des interactions avec le lecteur, et enfin une fenêtre de texte affichant de courts développements textuels attachés à chacun des mots-clés. Ces trois fenêtres « reflètent les processus de ‹ pensée › parallèles de lʼécrivain, du designer et du processeur » auxquelles s’ajoute « la collaboration des utilisateurs »36 (McPherson & Anderson, 2005a). Dans ce contexte, le rapport de collaboration induit une écriture collective qui ne sépare pas les pratiques et les théories. Tara McPherson insiste ainsi sur « les boucles itératives qui existent entre les idées et les expériences » dans un rapport de « tension productive » entre la « théorie » et la « conception de projet » plutôt que sur un registre représentationnel ou instrumental37 .
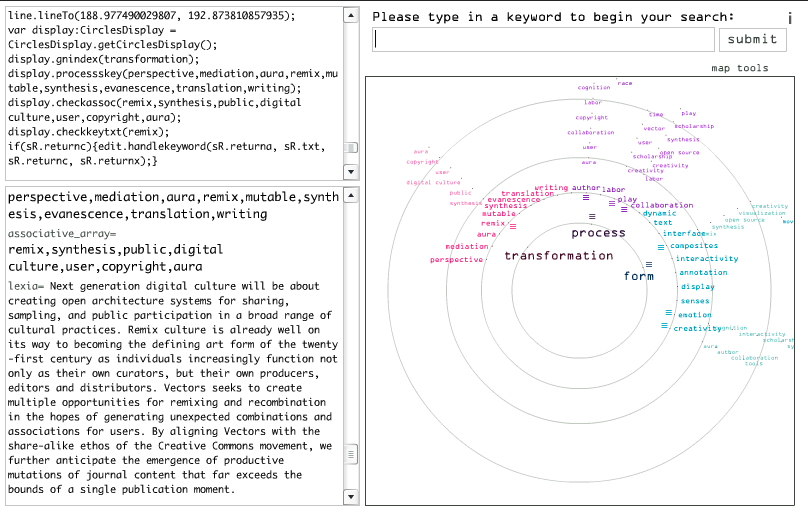 faisant dialoguer trois éléments graphiques distincts avec les activités du visiteur : un diagramme constitué de mots-clés, une fenêtre présentant un code source en train de se dérouler au fur et à mesure des interactions avec le lecteur, et enfin une fenêtre de texte affichant de courts développements textuels attachés à chacun des mots-clés. Ces trois fenêtres « reflètent les processus de ‹ pensée › parallèles de lʼécrivain, du designer et du processeur » auxquelles s’ajoute « la collaboration des utilisateurs »36 (McPherson & Anderson, 2005a). Dans ce contexte, le rapport de collaboration induit une écriture collective qui ne sépare pas les pratiques et les théories. Tara McPherson insiste ainsi sur « les boucles itératives qui existent entre les idées et les expériences » dans un rapport de « tension productive » entre la « théorie » et la « conception de projet » plutôt que sur un registre représentationnel ou instrumental37 .
faisant dialoguer trois éléments graphiques distincts avec les activités du visiteur : un diagramme constitué de mots-clés, une fenêtre présentant un code source en train de se dérouler au fur et à mesure des interactions avec le lecteur, et enfin une fenêtre de texte affichant de courts développements textuels attachés à chacun des mots-clés. Ces trois fenêtres « reflètent les processus de ‹ pensée › parallèles de lʼécrivain, du designer et du processeur » auxquelles s’ajoute « la collaboration des utilisateurs »36 (McPherson & Anderson, 2005a). Dans ce contexte, le rapport de collaboration induit une écriture collective qui ne sépare pas les pratiques et les théories. Tara McPherson insiste ainsi sur « les boucles itératives qui existent entre les idées et les expériences » dans un rapport de « tension productive » entre la « théorie » et la « conception de projet » plutôt que sur un registre représentationnel ou instrumental37 .Afin de permettre la fabrication des articles de Vectors, on retrouve systématiquement trois figures dans la collaboration interdisciplinaire qu’elle implique. D’une part, l’universitaire (ou scholar) appelé à produire des « preuves, arguments et objectifs uniques » (McPherson, 2018, p. 159) à même de nourrir une expérimentation d’écriture collective spécifique. D’autre part, le designer – parfois dédoublé en un développeur informatique et un artiste ou designer interactif – qui fabrique non seulement une pièce web destinée à la consultation par les visiteurs, mais est également en charge de la modélisation et de l’opérationnalisation d’un système d’écriture par base de données pour le chercheur invité. La troisième figure est celle de l’éditeur, qui joue dans le rôle d’un « chef d’orchestre » consistant à aider « à construire des alliances productives entre le boursier et son partenaire de conception et opérant la traduction entre le langage de la théorie et celui de la pratique »38 (McPherson, 2018, p. 112). Le travail d’écriture se présente ainsi comme celui d’une discussion constante entre les trois parties que sont le design, l’édition et l’écriture.
La tripartition des rôles dans les productions de Vectors se retrouve dans la présentation des articles, qui sont tous organisés selon un modèle identique sur le site. Ce dernier fait ainsi systématiquement précéder les pièces d’un péritexte destiné à en préparer la lecture et la mise en contexte. D’abord, une série de « déclarations » (statements) donne successivement la plume à l’éditeur, à l’auteur et au designer de chaque pièce pour lui permettre de raconter l’écriture de l’article telle qu’elle a été vécue de son point de vue39 . Ensuite, une représentation de l’article au format XML permet de récupérer des métadonnées issues de la pièce : les informations générales de l’article, les différentes déclarations des participants, et les discussions et commentaires ajoutés par les lecteurs. Enfin, un clic sur bouton estampillé « Launch Project » permet d’accéder à la publication à proprement parler. La structure de présentation standardisée de chaque article de Vectors apparaît ici comme la double volonté de se référer à des conventions émergentes dans les humanités numériques – comme le signale la publication au format XML. Mais elle incarne également l’affirmation de la dimension collective de l’écriture des articles par la mise en avant des trois statements proposés à la lecture. Cette configuration sociale et méthodologique permet alors d’explorer des démarches de publication performative et leurs implications pour le dialogue avec les matériaux des recherche mobilisés.
Mettre à l’épreuve les modèles des humanités numériques
La revue Vectors questionne continuellement ses propres conditions d’existence dans le double contexte du système de la communication scientifique et de l’essor des digital humanities anglo-saxonnes. Concernant la communication scientifique, le projet met volontairement en œuvre un ensemble d’éléments le signalant comme une « revue universitaire » – par exemple via son découpage en volumes et en numéros – tout en questionnant continuellement des notions naturalisées par l’habitude des pratiques d’écriture savante à ce propos. Ainsi, Vectors entend par exemple « retravailler le concept de numéro [et] l’espace-temps de la revue » (McPherson, 2018, p. 116) à travers ses modalités de collaboration interdisciplinaire. Dans le même sens, elle s’inscrit dans le mouvement de l’édition en accès libre, tout en remettant en question ses modèles, tels que celui de l’ouverture entendu comme horizon normatif et univoque (Christen, Cooney, & Ceglia, 2006a). Vectors peut en ce sens être décrit comme l’un des précurseurs du mouvement contemporain de l’accès ouvert radical qui considère « le libre accès moins comme un projet et un modèle à mettre en œuvre, et plus comme un processus de lutte continue et de résistance critique »40 (Janneke Adema & Hall, 2013, p. 28).
La revue s’inscrit par ailleurs dans une remise en question radicale de la prédominance du « texte » – sous-entendu comme discours désincarné – comme mode d’écriture universitaire unique et indépassable. Dans les différents péritextes qui accompagnent les articles, on retrouve de manière récurrente la figure du « texte » comme un modèle à l’origine de « paradigmes […] rigides » (McPherson et al., 2009) et empêchant le développement de certaines manières de lier l’écriture aux matériaux de recherche. Le mandat de la revue consiste alors à « explorer les dimensions immersives et expérientielles des nouveaux idiomes savants sur les plateformes médiatiques »41 (McPherson et al., 2009).
Par ailleurs, Vectors s’inscrit dans ce qui a été conceptualisé dans le champ des media studies anglo-saxonnes comme une approche « multimodale » de la recherche (McPherson et al., 2013). La notion de multimodalité se rapporte ici à des formes d’expression qui ne s’inscrivent pas exclusivement dans le discours raisonné de la langue parlée et écrite (Hayles, 2016, pp. 96‑98). L’enjeu d’une écriture multimodale n’est donc pas de questionner l’utilisation d’éléments « non-textuels » dans la publication de recherche – ce qui serait plutôt l’indice d’une écriture multimédia, qui n’a rien de nouveau par rapport à des techniques de l’ordre de l’illustration. L’expérimentation de techniques d’écriture multimodales consiste plutôt à adopter ou à répondre aux techniques d’inscription des matériaux mobilisés par des formes d’écriture aussi variées que ces derniers, qu’il s’agisse de produire des vidéos, des sons, des images, ou des programmes, ainsi que l’a développé Kathleen Fitzpatrick (Fitzpatrick, 2011, pp. 85‑87). En ce sens, la pratique de la fabrication numérique mise en œuvre dans Vectors se présente comme une manière d’interroger l’influence des technologies numériques sur la condition humaine en écrivant à propos des technologies numériques par le moyen de la réalisation de programmes en ligne et d’applications interactives. Vectors entend ainsi effectuer un « examen de second ordre de la médiation de la vie quotidienne »42 (McPherson et al., 2009) opérée par les technologies, en empruntant et en transformant les techniques d’écriture utilisées pour constituer les matériaux qu’elle interroge. La dimension performative exacerbée des documents-publications produits dans Vectors peut ainsi être en partie lue comme l’aboutissement d’une attitude multimodale vis-à-vis de l’écriture avec les matériaux de recherche.
La revue interroge également ses conditions d’existence dans la mesure où elle s’inscrit dans les débats des digital humanities américaines en cours durant la décennie des années 2000. À cette époque, le contexte américain des expérimentations numériques en lettre et sciences humaines est marqué par la focalisation des financements et des discours sur des questions telles que l’encodage des textes anciens ou les études computationnelles d’œuvres littéraires numérisées (Schreibman, Siemens, & Unsworth, 2004). Cette concentration est critiquée par plusieurs universitaires comme une approche qui neutralise les implications politiques et sociales des technologies numériques, et motive l’appel à la création d’un « ensemble hybride d’approches combinant les critiques culturelles, rhétoriques et politiques aux pratiques natives des médias numériques » (Hayles, 2016, p. 83). Vectors invite en ce sens explicitement des projets de recherche qui travaillent les problématiques sociétales et politiques contemporaines impliquées par la diffusion des technologies numériques :
Le processus de sélection de Vectors était disposé à favoriser les travaux qui engageaient des questions sociales, en particulier celles liées au féminisme, à la critical race theory et aux cultural or ethnic studies. Cela représentait en partie un effort pour remédier au discours de désincarnation et de dématérialisation de la culture du net à ses débuts et au tournant apolitique des computational humanities des décennies précédentes.43 (McPherson, 2018, p. 129)
En ce sens, la majorité des « projets » de Vectors s’inscrit dans une approche relativement partagée de l’authenticité d’un point de vue méthodologique et épistémologique. Cette dernière s’inscrit notamment en résonance avec les travaux de Johanna Drucker soutenant une approche qui envisage la connaissance comme perspective interprétative, située et « spéculative » (Nowviskie, 2004). L’expérimentation de manières d’écrire numériques est alors appréciée selon sa capacité à « dévier les structures normalisantes de la base de données vers de nouvelles directions » (McPherson, 2018, p. 134). pour « repousser lʼautorité culturelle du rationalisme dans les humanités numériques dans la conception numérique » en mettant en œuvre un « usage non positiviste de la preuve » (McPherson, 2018, p. 147). Elle s’inscrit également dans les multiples courants du matérialisme féministe, établi notamment par les théories de la « coupe agentielle » de Karen Barad (Barad, 2003), qui cherchent tous à « comprendre les relations entre et au-delà de l’objet et du sujet, du discours et de la matière, de l’identité et de la différence »44 (McPherson, 2018, p. 100). Malgré la diversité des disciplines et champs de recherche convoqués, Vectors présente ainsi une forme « d’homogénéité épistémologique », si tant est qu’on puisse définir ainsi son attention aux diverses théories de la différence et de l’altérité dans les SHS. Cette dernière structure alors à la fois les dimensions éditoriales et méthodologiques à l’œuvre dans l’écriture et de la fabrication des « articles » de la revue.
Dans ce cadre, chaque « projet » de Vectors est l’occasion d’un dialogue multimodal spécifique entre des matériaux de recherche et des techniques d’écriture expérimentales. L’article « narrating bits » (Hayles, Loyer, & Stamen design, 2005), par exemple, porte sur la relation entre récit et base de données et est le résultat de la collaboration entre Craig Dietrich, le studio Stamen Design et de N. Katherine Hayles. Il consiste en une (re)mise en scène d’un texte écrit par Hayles pour la revue Comparative Critical Studies (Hayles, 2005b). Dans ce dernier, elle discute les positions du théoricien des médias Lev Manovich quant à l’émergence de la base de données comme « forme culturelle » opposé à celle, plus traditionnelle, du récit (Manovich, 2001/2010). À l’opposition récit/base de données opérée par Manovich pour étudier les productions culturelles numériques, Katherine Hayles substitue une lecture des productions littéraires comme celle d’une co-constitution entre un « espace de possibilité » construit par le récit et une « construction contingente créée par la lectrice compétente, aidée par sa connaissance tacite des codes narratifs et culturels » qu’elle nomme fabula45 (Hayles, 2005b, p. 7). Faisant valoir la nécessité d’une forme de symétrie entre une telle perspective d’analyse savante et ses techniques d’écriture en tant que chercheure, elle appelle en ce sens à l’émergence d’une critique littéraire se présentant comme « une sorte de terrain de jeu sur lequel de nombreux jeux pourraient être joués et (plus significativement) différents genres de jeux pourraient évoluer »46 (Hayles, 2005b, p. 28), et agissant elle-même comme un « espace de possibilité » plutôt que comme un récit ordonné.
L’édition Vectors de l’article « Narrating Bits » traduit le texte de N. K. Hayles sous la forme d’une composition graphique qui juxtapose une liste de mots-clés et une suite horizontale de rectangles correspondant à chacun des paragraphes du texte original 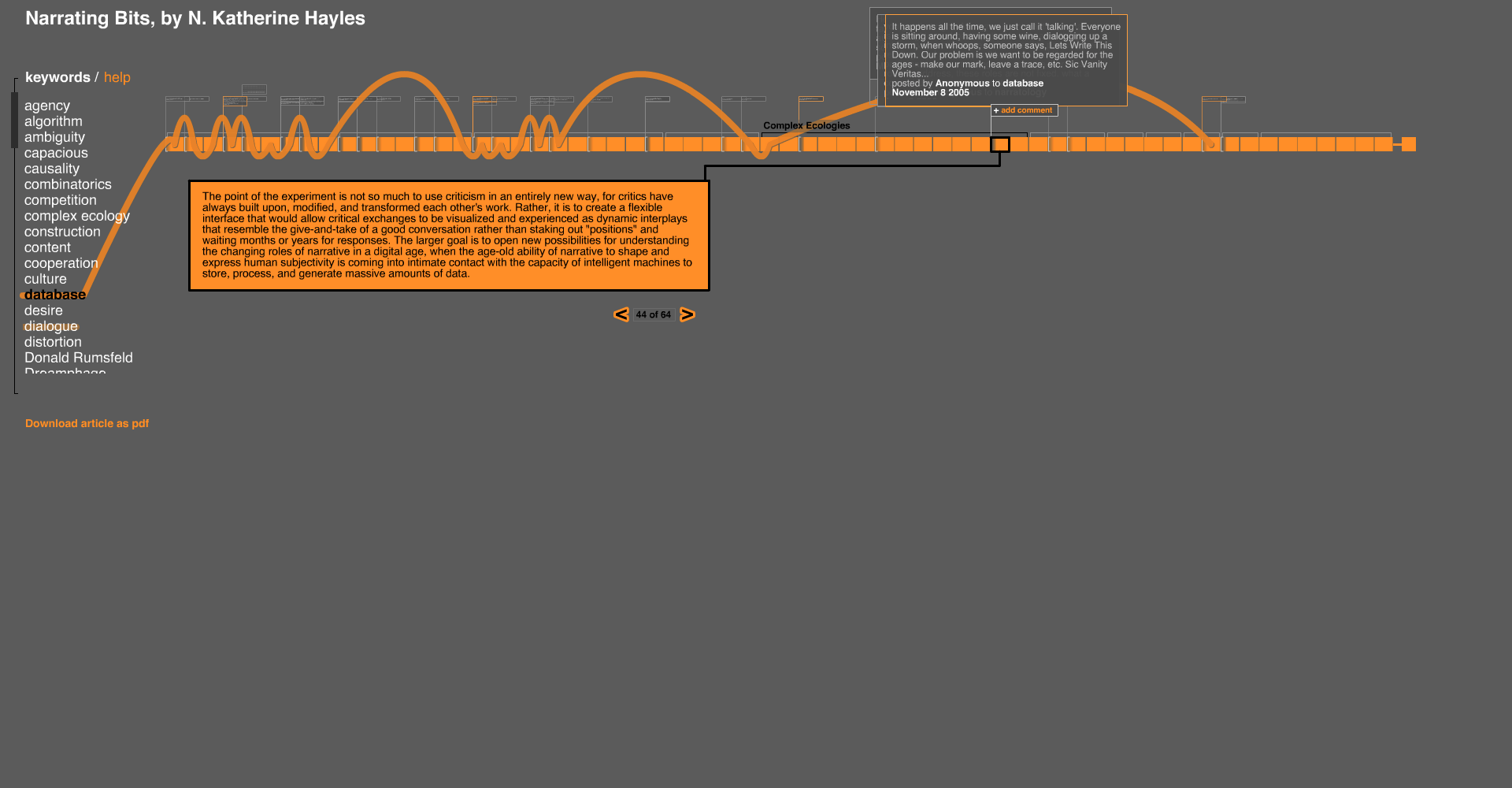 . Le clic sur un morceau affiche un cadre contenant le texte correspondant, ainsi que des commentaires ajoutés par les lecteurs. Le survol des mots-clés permet de tracer des « cheminements » multiples dans le texte et ainsi de suivre le fil de chacun des concepts clés du texte selon une multitude de séquences non-linéaires. En cliquant sur différents morceaux, « l’utilisateur-lecteur » (McPherson & Anderson, 2005b) de l’article peut créer des jeux de superposition, de juxtaposition et de recombinaison entre les paragraphes, reproduisant en actes l’argument de Hayles à propos des capacités de « combinatorique » (Hayles, 2005a) du récit comme « espace de possibilité ». Elle permet par ailleurs aux lecteurs de commenter et de contribuer à chacun de ces éléments, actualisant certains de ces possibles selon une dynamique d’écriture collective.
. Le clic sur un morceau affiche un cadre contenant le texte correspondant, ainsi que des commentaires ajoutés par les lecteurs. Le survol des mots-clés permet de tracer des « cheminements » multiples dans le texte et ainsi de suivre le fil de chacun des concepts clés du texte selon une multitude de séquences non-linéaires. En cliquant sur différents morceaux, « l’utilisateur-lecteur » (McPherson & Anderson, 2005b) de l’article peut créer des jeux de superposition, de juxtaposition et de recombinaison entre les paragraphes, reproduisant en actes l’argument de Hayles à propos des capacités de « combinatorique » (Hayles, 2005a) du récit comme « espace de possibilité ». Elle permet par ailleurs aux lecteurs de commenter et de contribuer à chacun de ces éléments, actualisant certains de ces possibles selon une dynamique d’écriture collective.
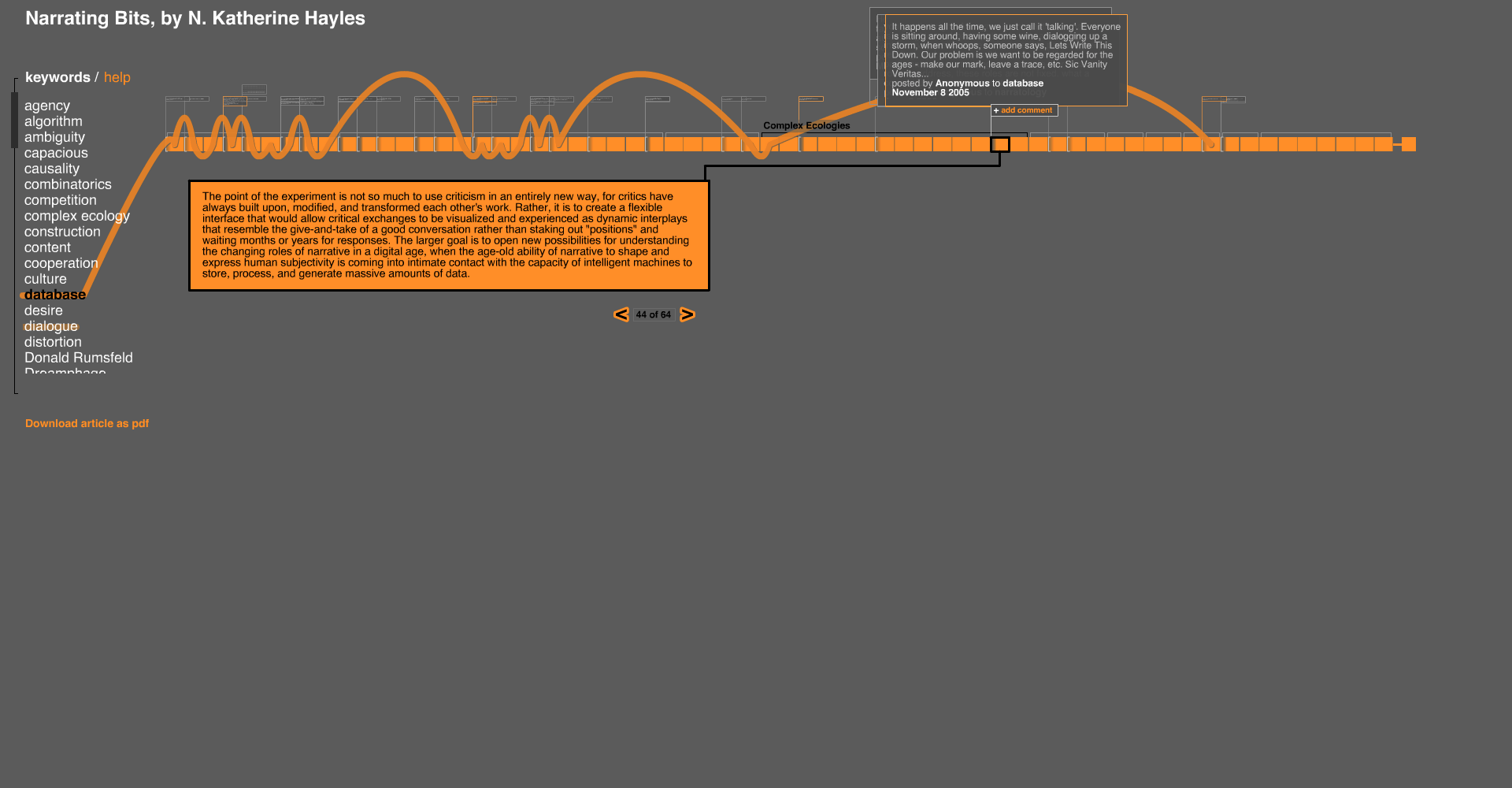 . Le clic sur un morceau affiche un cadre contenant le texte correspondant, ainsi que des commentaires ajoutés par les lecteurs. Le survol des mots-clés permet de tracer des « cheminements » multiples dans le texte et ainsi de suivre le fil de chacun des concepts clés du texte selon une multitude de séquences non-linéaires. En cliquant sur différents morceaux, « l’utilisateur-lecteur » (McPherson & Anderson, 2005b) de l’article peut créer des jeux de superposition, de juxtaposition et de recombinaison entre les paragraphes, reproduisant en actes l’argument de Hayles à propos des capacités de « combinatorique » (Hayles, 2005a) du récit comme « espace de possibilité ». Elle permet par ailleurs aux lecteurs de commenter et de contribuer à chacun de ces éléments, actualisant certains de ces possibles selon une dynamique d’écriture collective.
. Le clic sur un morceau affiche un cadre contenant le texte correspondant, ainsi que des commentaires ajoutés par les lecteurs. Le survol des mots-clés permet de tracer des « cheminements » multiples dans le texte et ainsi de suivre le fil de chacun des concepts clés du texte selon une multitude de séquences non-linéaires. En cliquant sur différents morceaux, « l’utilisateur-lecteur » (McPherson & Anderson, 2005b) de l’article peut créer des jeux de superposition, de juxtaposition et de recombinaison entre les paragraphes, reproduisant en actes l’argument de Hayles à propos des capacités de « combinatorique » (Hayles, 2005a) du récit comme « espace de possibilité ». Elle permet par ailleurs aux lecteurs de commenter et de contribuer à chacun de ces éléments, actualisant certains de ces possibles selon une dynamique d’écriture collective.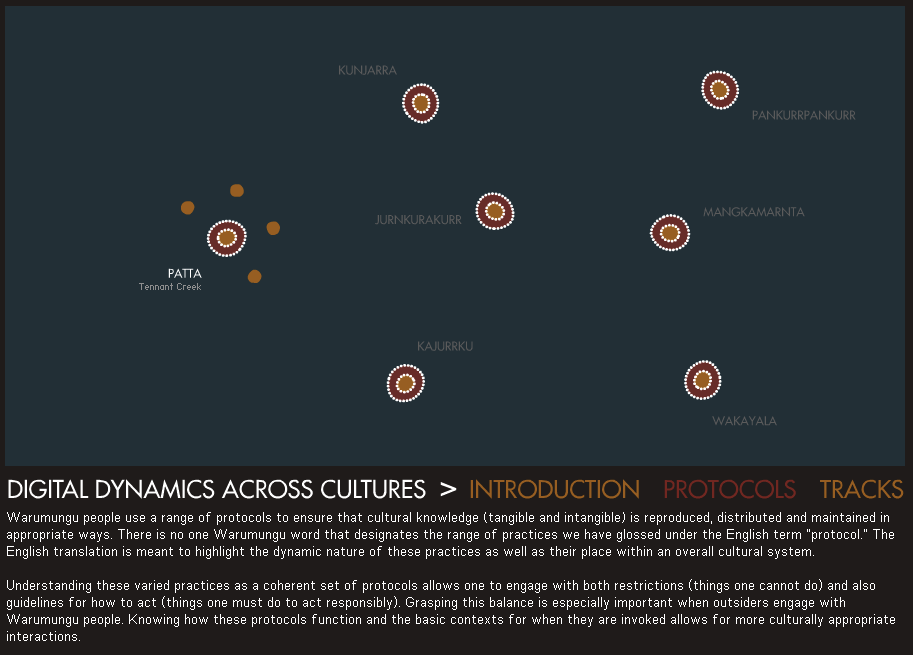
La démarche multimodale et performative de Vectors se traduit ainsi souvent dans une forme de jeu réflexif avec les formats de données qui supportent la mobilisation des matériaux dans l’écriture, et notamment l’utilisation, pour la quasi totalité des articles, d’une base de données relationnelle. À ce titre, l’article « Digital Dynamics Across Cultures » (Christen et al., 2006a) réalisé par Kim Christen, Chris Cooney, et Alessandro Cegia, est consacré à une approche ethnographique des méthodes épistémologiques du peuple Warumungu en Australie. Il est l’occasion de questionner l’enregistrement numérique des « patrimoines immatériels » en général et des matériaux d’enquête ethnographiques en particulier. Pour ce faire, la pièce s’organise comme une forme de cartographie paradoxale qui donne à voir une version partielle et volontairement non « exhaustive » des pratiques et des rituels observés par les chercheurs sur le « terrain ». La pièce réanime ainsi les problématiques, déjà abondamment travaillées dans les sciences humaines et notamment dans le champ de l’anthropologie filmique (France, 2000), du positionnement du point de vue de l’observateur-auteur au moment du compte-rendu d’une expérience de terrain. Mais elle se double d’un questionnement vis-à-vis de la publication en ligne de tels comptes-rendus, en questionnant, par le mode de navigation et de « consultation » des « données » qu’elle propose aux visiteurs, les présupposés d’exhaustivité et de transparence attachés aux technologies numériques en général et à la base de données en particulier. La « consultation » du site par le public devient alors moins une pratique de « transfert de connaissance » ou de « récolte d’informations » qu’une expérience dont les modalités procédurales de fréquentation et de navigation constituent en soi une forme d’argument :
En présentant le « contenu » à travers un ensemble de protocoles culturels Warumungu qui limitent et améliorent (selon qui vous êtes) lʼéchange, la distribution et la création de connaissances, la logique interne du site remet en question les notions occidentales conventionnelles de « liberté » dʼinformation et de « partage » des connaissances ainsi que les exigences légales concernant les œuvres originales, « innovantes » et à auteur unique comme référence pour les définitions de la propriété intellectuelle. En naviguant sur le site, les utilisateurs rencontreront les protocoles qui limitent, définissent et rendent compte dʼune compréhension dynamique et polyphonique de la distribution et de la reproduction des connaissances.47 (Christen, Cooney, & Ceglia, 2006b)
À travers chacune des expérimentations de Vectors, le dialogue entre architecture informationnelle, mécanismes d’interaction, « lexies »48 écrites par les chercheurs, et matériaux de recherche numérisés, fabriquent donc un document-publication issu de pratiques d’écriture collectives, multimodales et performatives.
Cependant, dans plusieurs des textes et discours qui accompagnent les différentes productions de Vectors, on remarque aussi la persistance d’une approche relativement séquentielle et dualiste de la relation entre les pratiques d’écriture « de contenu » apportées par les chercheurs invités, et les pratiques de fabrication « de leur présentation » par les designers, développeurs et artistes rassemblés par le laboratoire-revue. Dans ces discours, le rôle des pratiques de fabrication vis-à-vis du travail d’écriture est alors souvent qualifié sur le registre d’une « rhétorique formelle », selon l’expression proposée par Anthony Masure pour qualifier les courants des humanités numériques américaines qui se sont attachés aux possibilités expressives et interprétatives des technologies numériques (Masure, 2017b, pp. 31‑34) : dans ces courants, le travail de conception et de fabrication de code est alors souvent raconté comme l’incarnation, la matérialisation et la performance – par les designers, artistes et autres développeurs intégrés dans les collectifs de recherche – d’un « argument » ou d’une « idée » qui serait restée préexistante à la collaboration. Un extrait de mail préparatoire écrit par le designer Craig Dietrich à propos de l’article « Narrating bits » et publié dans le livre de Tara McPherson est à ce titre révélateur d’une telle tendance :
En dʼautres termes, jʼaimerais voir une interface où, si lʼon enlève tous les mots, le contenu visuel donnerait encore une impression générale de lʼargument de Kate selon lequel la relation entre le récit et la base de données peut être complexe et à plusieurs niveaux. Vos actions au sein de lʼinterface devraient être lʼexpression de cette idée, non seulement sur le plan fonctionnel, mais aussi viscéralement.49 (McPherson, 2018, p. 169)
Une telle approche, au premier abord, réintroduit de manière paradoxale une forme de division du travail entre « contenu » et « présentation », ainsi qu’une séquentialité dans la relation entre ces deux pôles conceptuels, dans la mesure où elle réduit la dimension multimodale de la recherche aux situations de « lecture » – faire l’expérience de l’argument du chercheur via une expérience procédurale et interactive – mais ne touche pas à priori la relation entre travail d’écriture et travail de recherche à proprement parler. Or, si les manières d’écrire de Vectors se réduisaient à « l’expression d’une idée », elles ne rempliraient peut-être plus le mandat de la revue de produire une « tension productive entre théorie et pratique » (McPherson, 2018, p. 23).
Et pourtant, ces déclarations d’intention « rhétoriques » cohabitent, dans les textes de Vectors, avec de nombreux récits faisant état de décalages productifs, d’adaptations mutuelles, et parfois de tensions fertiles, entre les différents participants de l’écriture des pièces, transformateurs pour les chercheurs autant que pour les designers et artistes impliqués dans la collaboration (McPherson, 2018, pp. 164‑187). La dimension collective de la fabrication des pièces apparaît alors peut-être comme le facteur de déstabilisation le plus important pour les chercheurs dans une telle entreprise. Cette dimension collective demande aussi rapidement à l’équipe de mettre en place des modes d’organisation du travail plus ou moins formalisés afin de négocier la distribution des pratiques qu’elle implique. Malgré sa dimension expérimentale indéniable, la revue est alors confrontée à la nécessité de stabiliser certaines manières d’écrire et d’organiser le travail de son collectif de fabrication, d’écriture et de recherche. Quelle est, alors, l’influence des pratiques de fabrication à l’œuvre dans Vectors sur les pratiques d’écriture des chercheurs ? Comment le collectif négocie-t-il la tension entre ses formats méthodologiques et techniques et son projet politique et épistémologique ?
Vers la stabilisation de manières d’écrire récurrentes
Les articles de Vectors se présentent au premier abord comme l’expression d’une diversité radicale50 qui découle à la fois du positionnement éditorial de la revue et de la composition particulière de ses collectifs d’écriture. En ce sens, une telle diversité interdit à première vue de parler à leur propos d’un quelconque format d’écriture – compris comme l’alignement de certaines manières d’écrire, de présupposés épistémo-méthodologiques, et de dynamiques de stabilisation sociale. Et pourtant, la dimension sérielle de la revue et le choix d’une publication semestrielle invitent rapidement l’équipe à mettre en place des méthodes de travail propres à faciliter et accélérer le processus de production collective impliqué par le projet.
Les collaborations racontées dans les diverses « déclarations » des pièces de Vectors et l’ouvrage de Tara McPherson n’éludent pas les points de tension générés par la dimension collective de l’écriture induite par le design de leurs publications. Ces tensions relèvent de la temporalité contrainte qu’impliquent les aller-retour entre chercheurs et designers, de la dimension collégiale des choix ayant un impact sur l’interprétation et la signification des documents-publications, mais aussi des pratiques d’écriture particulières requises par le format technique des articles Vectors. En effet, la quasi-totalité des pièces est fabriquée au moyen d’une combinaison entre une interface visuelle utilisant la technologie flash51 et une base de données relationnelle stockant les images, vidéos, textes et autres contenus de chacun des articles. Dans ce contexte, une fois le projet d’une publication Vectors esquissé grâce à la collaboration tripartite du chercheur, du designer et de l’éditeur, un modèle de données doit être défini pour accueillir les divers textes, vidéos et autres images qui seront apportés par le chercheur. Puis, une fois ce modèle établi, le travail est divisé entre la conception et le développement d’une application front end52 par les designers, et le « remplissage » de la base de données par les chercheurs. Le processus de « clôture » du modèle de données impliqué par cette méthodologie de travail rend alors difficile les retours en arrière dans la structuration de la base, et invite les chercheurs à un travail de saisie très systématique, qui ne semble pas toujours bien vécu par ces derniers.
À travers les divers récits disponibles, on repère plusieurs mentions du caractère déstabilisant d’un tel format de travail qui demande aux chercheurs de penser l’organisation de leurs écrits et de leurs matériaux de recherche préexistants en fonction de la structure particulière de la base de données relationnelles. Cette dernière leur demande de saisir leurs « contenus » à l’intérieur d’une collection de tableaux interreliés, qui impliquent nécessairement une réduction de l’échelle des « unités de sens » produites pour nourrir le site. Cette réduction semble avoir été parfois difficile car « cela signifiait souvent quʼils devaient ‹ découper › leurs écrits dʼune manière qui semblait assez étrange pour les chercheurs en sciences humaines habitués à produire des travaux dʼérudition de longue haleine »53 (McPherson, 2018, p. 128). Ainsi par exemple, l’un des « boursiers », engagé dans le travail de conversion d’un livre déjà écrit en un article Vectors, « avait lʼimpression que sa forme fragmentée détruisait la subordination prudente de sa prose et affaiblissait sa chaîne linéaire ou son argumentation bien construite »54 (McPherson, 2018, p. 129). Cette déstabilisation, combinée aux initiatives des designers et à la rencontre d’imprévus et de contraintes techniques inattendues, participe alors d’une situation qui relève parfois du « jeu », mais s’avère également parfois problématique :
Alors que nous nous installions dans nos rythmes de travail ces premières années, nous avons remarqué que de nombreux universitaires vivaient parfois le processus de collaboration comme une déqualification, ne serait-ce quʼà des moments particuliers. Les talents traditionnels des chercheurs en humanités – la création dʼune prose longue, la formulation dʼidées solitaires, la priorité donnée au texte – nʼétaient plus le seul terrain de travail.55 (McPherson, 2018, p. 128)
Parallèlement à l’accumulation de ces expériences de collaboration, le collectif de Vectors s’équipe progressivement d’outils qui permettent à ces derniers d’être davantage autonomes dans les choix de structuration et de saisie des « contenus » des publications. En ce sens, à partir de la fin de l’année 2005 – soit juste après la sortie du premier numéro de la revue – l’équipe développe un logiciel intitulé Dynamic Backend Generator (DGB) (McPherson, Anderson, Dietrich, & Loyer, 2010). Ce dernier est décrit par son créateur Craig Dietrich comme un « canevas d’écriture numérique avec SQL » (Dietrich, 2010) qui permet aux chercheurs de définir eux-mêmes le modèle de données de leur article, et d’éditer plus facilement les « contenus » intégrés dans la base de données associée à chaque article de Vectors.
Les arguments avancés par l’équipe de Vectors pour l’introduction du logiciel DGB relèvent tout autant d’une meilleure organisation du travail entre chercheurs et designers, que d’un désir de modifier plus profondément les pratiques d’écriture de leurs auteurs et leur manière de travailler avec les matériaux de leurs enquêtes. Ainsi, d’une part, Tara McPherson décrit la création du DGB comme « une infrastructure partagée pour la revue […] qui signifie que chaque projet nʼa pas besoin dʼêtre entièrement conçu comme un projet unique [...] et permet tout de même un travail personnalisé sur le front end »56 (McPherson, 2018, p. 128). D’autre part, le logiciel DGB est décrit par le designer Erik Loyer comme un « outil de middleware savant » destiné à faire en sorte que « la base de données fonctionne davantage comme un carnet de croquis que comme une grille » et permette « aux chercheurs dʼexpérimenter facilement différentes façons dʼorganiser leurs idées jusquʼà ce quʼils arrivent à une structure qui pourrait servir de base à de futurs travaux » (McPherson, 2018, p. 133). La contribution des concepteurs se déplace alors au niveau de l’outil d’écriture, et la dimension multimodale du projet de Vectors s’inscrit davantage dans le rapport intime des universitaires à l’écriture « numérique » avec leurs matériaux de recherche qu’à la mise en scène de cette dernière pour le public :
En utilisant cet outil, les participants peuvent migrer depuis des formes linéaires de travail (comme lʼécriture pour la page ou la vidéo) vers des formes fragmentées et interreliées. En substance, les chercheurs intègrent des modes de pensée « relationnels » dans leurs projets.57 (Dietrich, 2010)
Le développement de DGB stabilise en ce sens un certain régime relationnel de l’écriture avec les matériaux de recherche, qui opérationnalise l’ancrage épistémologique de la revue dans les théories de la différence et de l’interprétation dans un certain usage du format technique de la base de données relationnelle. Cependant, il stabilise également une certaine répartition des rôles pour la production des pièces spécifiques, dans laquelle chacun se voit associé à une fonction et une modalité technique d’écriture particulière : au chercheur, la définition du modèle de données et le remplissage de la base de données (relationnelle) propre à chaque article au moyen du DGB ; au designer, la charge de produire une interface « flash » à même d’en effectuer la « performance » multimodale. La création du DGB opère ainsi comme le point de départ d’un processus de rationalisation qui amène rapidement l’équipe de Vectors à formuler le projet de constituer une plateforme à même de généraliser les expérimentations de la revue et les rendre accessibles à un plus grand nombre d’universitaires. Quels sont alors les effets de cette stabilisation sur la relation entre enquête, écriture, et formation sociale des collectifs de recherche ? Les démarches expérimentales d’écriture multimodale expérimentées dans Vectors peuvent-elles être industrialisées ?
Stabilisation socio-technique et horizons de pratique
Il s’agit maintenant d’étudier comment les pratiques d’écriture expérimentale étudiées précédemment dialoguent avec des dynamiques d’institutionnalisation et de diffusion via des processus de stabilisation technique et sociale. Pour ce faire, je vais analyser les continuation de l’expérience de la revue-laboratoire Vectors dans la plateforme-organisation Scalar, qui vise à systématiser et transformer certaines des pratiques développées dans la première expérience sous la forme d’un dispositif socio-technique de plus grande échelle et à la configuration sociale plus stable.
De la stabilisation de manières d’écrire à un format d’écriture numérique : le cas de la plateforme Scalar
« Changer d’échelle » : promesses et dilemmes de la stabilisation
La création de l’outil Dynamic Backend Generator dans le cadre du Vectors Lab et du Vectors Journal initie un travail de délégation et de stabilisation de certaines modalités techniques d’écriture. Ce faisant, elle autonomise progressivement les chercheurs dans leur dialogue avec leurs « matériaux de recherche » et déplace progressivement la dimension collective des premières expérimentations multimodales au profit d’un public d’écrivains plus large et plus diversifié. Alors que Vectors semble être à l’arrêt depuis 2014, ce travail de délégation trouve sa suite dans le développement du projet Scalar depuis 2009.
Scalar est d’abord le résultat d’un déplacement de l’attention des initiateurs de Vectors depuis la conception d’expériences de lecture vers la conception d’expériences d’écriture qui se concentre sur les possibilités de structuration informationnelle permises par les bases de données relationnelles (Anderson, 2015, p. 132). Un tel déplacement découle de la volonté de l’équipe d’approfondir son projet initial, c’est-à-dire notamment de favoriser une remise en question des tendances normalisatrices et « discrétisantes » des technologies numériques en général et des bases de données en particulier, au moyen d’une attitude multimodale qui s’autorise à jouer avec les mêmes moyens d’expression que ses objets d’étude et de critique. Ainsi, selon les mots de Tara McPherson, le passage de Vectors à Scalar se présente comme le moyen d’« intégrer [la méthodologie de Vectors] au niveau du design du logiciel, en infectant la base de données avec une intention féministe » (McPherson, 2018, pp. 213‑216). Ce passage a des implications techniques mais aussi sociales, puisqu’il appelle à reconfigurer le rôle de l’équipe vis-à-vis des chercheurs avec lesquels elle collabore.
Le discours d’accompagnement de Scalar est aussi marqué par un projet de démocratisation des pratiques d’écriture expérimentées dans Vectors. Il s’agit d’intégrer « les idées glanées à partir de ces expériences dans la communication scientifique plus générale »58 (McPherson, 2010), et de stabiliser certains « genres adaptés aux plateformes de bases de données » – « archive animée », « argument expérientiel », « documentaire interactif », « essai spatialisé », « simulation et visualisation »59 (McPherson, 2010). Ce faisant, l’équipe entend dépasser ce qu’ils perçoivent comme une difficulté d’adaptation des universitaires (McPherson, 2018, p. 161) en stabilisant des « formes reconnaissables, même si cette demande de reconnaissance peut étouffer lʼexpérimentation créative vers laquelle le matérialisme féministe semble tendre » (McPherson, 2018, p. 161). La notion de reconnaissance est alors à entendre dans un double sens : il s’agit, d’une part, sur un plan méthodologique, de faciliter l’adoption de nouvelles manières d’écrire par les chercheurs en stabilisant des techniques d’écriture récurrentes et les outils qui les équipent ; d’autre part, sur un plan socio-professionnel, l’enjeu est de permettre aux chercheurs de « publier véritablement le travail qu’ils produiraient dans ces espaces et de recevoir le crédit approprié pour leurs efforts »60 (McPherson, 2010). Pour ce faire, il est nécessaire de développer une plateforme « aussi simple qu’un blog » (ANVC, 2009) mais également intégrée dans des circuits institutionnels et politiques légitimants, et dans les systèmes techniques d’indexation qui permettent de rendre les publications « comptables » et « trouvables » dans le système de la communication scientifique.
Les discours des acteurs de Vectors et de Scalar n’éludent cependant pas les dilemmes et et les hésitations par lesquels ils semblent être pris dans ce mouvement de stabilisation. Ainsi, McPherson rappelle le labeur et la main-d’œuvre très importants nécessités par la méthodologie de travail de Vectors, « même après que la DGB ait rationalisé le processus de production » (McPherson, 2018, p. 159), pour justifier la création de Scalar sur le mode d’une réduction des coûts inévitable. Outre cette dimension économique, le modèle collaboratif de Vectors est par ailleurs présenté comme problématique en termes de préservation technique et de durabilité documentaire :
Dans un monde idéal, je continue de croire que chaque projet scientifique devrait trouver le design et la structure les mieux adaptés à ses preuves, arguments et objectifs uniques (et ce format sera parfois un livre imprimé !), mais ce monde serait difficile à financer et peut-être aussi plus difficile à soutenir et à préserver, car chaque projet aurait ses propres capacités, besoins et bizarreries. 61 (McPherson, 2018, p. 161)
Dans les textes de présentation de Scalar, on remarque ainsi une certaine tension entre un discours relevant de la conquête d’une « nouvelle frontière » pour le « futur de la communication scientifique », présentant Scalar comme l’instrument d’une norme d’écriture à venir (McPherson, 2010), et l’ancrage théorique et matériel de l’histoire du projet dans des théories du matérialisme féministe et de la différence (McPherson, 2018), qui ne cesse de scander son attachement à l’altérité et à l’expérimentation. Il s’agit maintenant d’étudier comment ces tensions travaillent-elles la stabilisation des modalités d’écriture explorées dans les expérimentations multimodales de Vectors à travers le processus d’institutionnalisation dont Scalar est la manifestation.
Un processus de stabilisation technique et institutionnelle
Le début du développement de Scalar en 2009 s’accompagne de la création d’une organisation intitulée l’Alliance for Networking Visual Culture62 (ANVC), ancrée dans le soutien de la fondation A. W. Mellon et du Scholarly Communication Institute (Alliance for Networking Visual Culture, 2009), puis le support de l’agence américaine de financement public National Endowment for the Humanities (NEH). LʼANVC se présente comme une infrastructure à la fois humaine et technologique visant à soutenir, entretenir et diffuser l’usage de Scalar.
Scalar est un logiciel accessible en code source ouvert (Alliance for Networking Visual Culture et al., 30 mars 2013/2015) que chacun peut reproduire et réinstaller librement, mais aussi une plateforme d’écriture, de stockage et de publication ouverte à tous63 , et enfin la pierre angulaire de l’ANVC qui vise à l’intégrer dans l’environnement universitaire américain au moyen de diverses associations. Par le truchement des partenariats de l’ANVC, la plateforme est ainsi articulée avec une série d’institutions et d’archives64 dont il est possible d’intégrer directement les matériaux dans les publications réalisées avec la plateforme. Elle est par ailleurs associée avec plusieurs presses universitaires65 qui lui assurent une visibilité dans les circuits de l’édition traditionnelle, et l’occasion de multiples expérimentations à grande échelle consistant à publier systématique un ouvrage imprimé et son « compagnon » en ligne au moyen de Scalar66 .
L’équipe de Scalar propose enfin un ensemble d’initiatives destinées à l’adoption de l’outil par un large public d’universitaires américains, notamment via des webinaires gratuits de formation à l’outil, ainsi que des « Summer Institutes » qui semblent être l’occasion d’ateliers combinant des formations, des phases de co-écriture avec l’outil et des phases de tests permettant à l’équipe de documenter des retours de la part des « utilisateurs ». Ce processus d’institutionnalisation passe également par la mise en place de guides et d’écrits relatifs à la révision et à l’évaluation des travaux multimédia (Anderson & McPherson, 2011) dans les contextes pédagogiques et scientifiques. Scalar se présente ainsi comme un « assemblage » socio-technique qui se compose à la fois d’infrastructures logicielles, d’activités et d’institutions.
Un modèle de données tourné vers l’immanence structurelle et son interface d’écriture
Le logiciel Scalar propose un régime d’écriture articulé autour de la mise en relation de matériaux de recherche « non-textuels » (images, vidéos, etc.) et d’écrits, qui doit anticiper les pratiques de navigation des lecteurs comme des pratiques de production de sens à part entière. Pour ce faire, il vise à fournir au chercheur le moyen de développer une structure hypertextuelle « immanente » (McPherson, 2018, p. 221) construite de manière itérative à partir de relations établies par l’écrivain entre les divers éléments constitutifs de sa recherche. Ainsi, au lieu d’imposer par avance une hiérarchie structurée d’éléments composant la publication – comme le ferait par exemple un logiciel imposant à priori une structuration en « chapitres » composés de « sous-chapitres », ou en « billets de blog » composés de « paragraphes » et « d’images » – Scalar propose un mode d’écriture réticulaire qui consiste à constituer une collection de textes et de matériaux, puis à les connecter au moyen de relations hypertextuelles sans présumer a priori de relations de hiérarchie entre ces derniers.
Pour ce faire, Scalar propose aux chercheurs d’écrire leurs publications en fonction d’un modèle de données qui reste invariant pour toutes les publications de la plateforme, mais qui est conçu pour être le plus souple possible en termes d’organisation des écrits et des autres matériaux à l’intérieur des publications. Ainsi, il offre aux écrivains la possibilité de définir plusieurs genres d’éléments dans leur publication, puis ensuite d’établir des connexions de divers types entre ces derniers. Les deux principaux genres d’éléments manipulés durant l’écriture sont, d’une part, la page, qui correspond à un « contenu structuré » au format HTML et saisi dans l’interface d’écriture au moyen d’une interface de type What you See is What you Get67 ; et, d’autre part, le média, qui désigne une variété de matériaux de recherche pouvant prendre la forme d’images, de vidéos, de documents, ou même d’extraits de code. Ces médias peuvent être importés dans l’interface, décrits précisément en termes de métadonnées, mais aussi annotés dans le détail de leur matérialité (en attachant une portion de texte à une zone d’image ou à une portion de vidéo par exemple). Autour des deux types d’éléments fondamentaux que sont les pages et les médias gravitent d’autres types complémentaires : des « notes » peuvent être insérées dans les contenus, ou encore des « termes » permettent l’usage d’un vocabulaire contrôlé.
Sur la base de ce vocabulaire d’éléments fondamentaux, Scalar propose une grammaire de relations qui permet de créer des publications dont la structure hypertextuelle reflète la « structure interprétative » définie par le chercheur-écrivain. Ces relations peuvent être établies depuis n’importe quel type d’élément vers n’importe quel autre. Par exemple, on pourra, à l’intérieur d’une publication Scalar, « annoter » (selon le terme employé dans l’interface) un « média » avec une « page ». On pourra cela dit également « tagger » un « média » avec un autre « média ». On pourra même « commenter » une « page » avec un « terme », voire transformer un « média » en un « tag » assemblant une diversité de pages, etc. Chacune de ces mises relations opère alors comme un acte d’écriture complémentaire à la définition des éléments en tant que tels, et se traduit ensuite dans l’interface de lecture des publications par une composition graphique appropriée, ou par la proposition au lecteur d’une possibilité de navigation hypertextuelle. Un dernier type d’éléments d’écriture permet enfin de réintroduire une forme de séquentialité dans les pratiques de lecture proposés aux visiteurs. Ainsi, la plateforme permet de transformer certains éléments en « path » (chemins) qui sont des listes d’éléments – pages, médias, tags, etc. – permettant de proposer aux lecteurs plusieurs « parcours hypertextuels » à l’intérieur des publications. Ces derniers ne sont pas limités en nombre, et il est donc possible de proposer dans une publication une diversité de « cheminements » séquentiels qui tissent plusieurs fils distincts à travers le même ensemble de matériaux non-textuels et d’écrits.
Sur la base de son modèle d’écriture très particulier, l’interface d’écriture de Scalar semble au premier abord étonnement « conventionnelle » en terme de procédures d’interaction et d’interface graphique. Visuellement, cette dernière s’apparente en effet beaucoup à un outil de gestion de contenu de type Content Management System (CMS). Elle en reprend la plupart des codes visuels et interactifs (menu de navigation, systèmes de listes et d’onglets multiples permettant de gérer les différents types d’objet, etc.) et met assez peu en avant la dimension réticulaire de l’écriture proposée par l’outil. Ainsi, les différents éléments permettant de « relier » un élément avec d’autres à l’intérieur du projet se présente comme un menu déroulant en bas des contenus 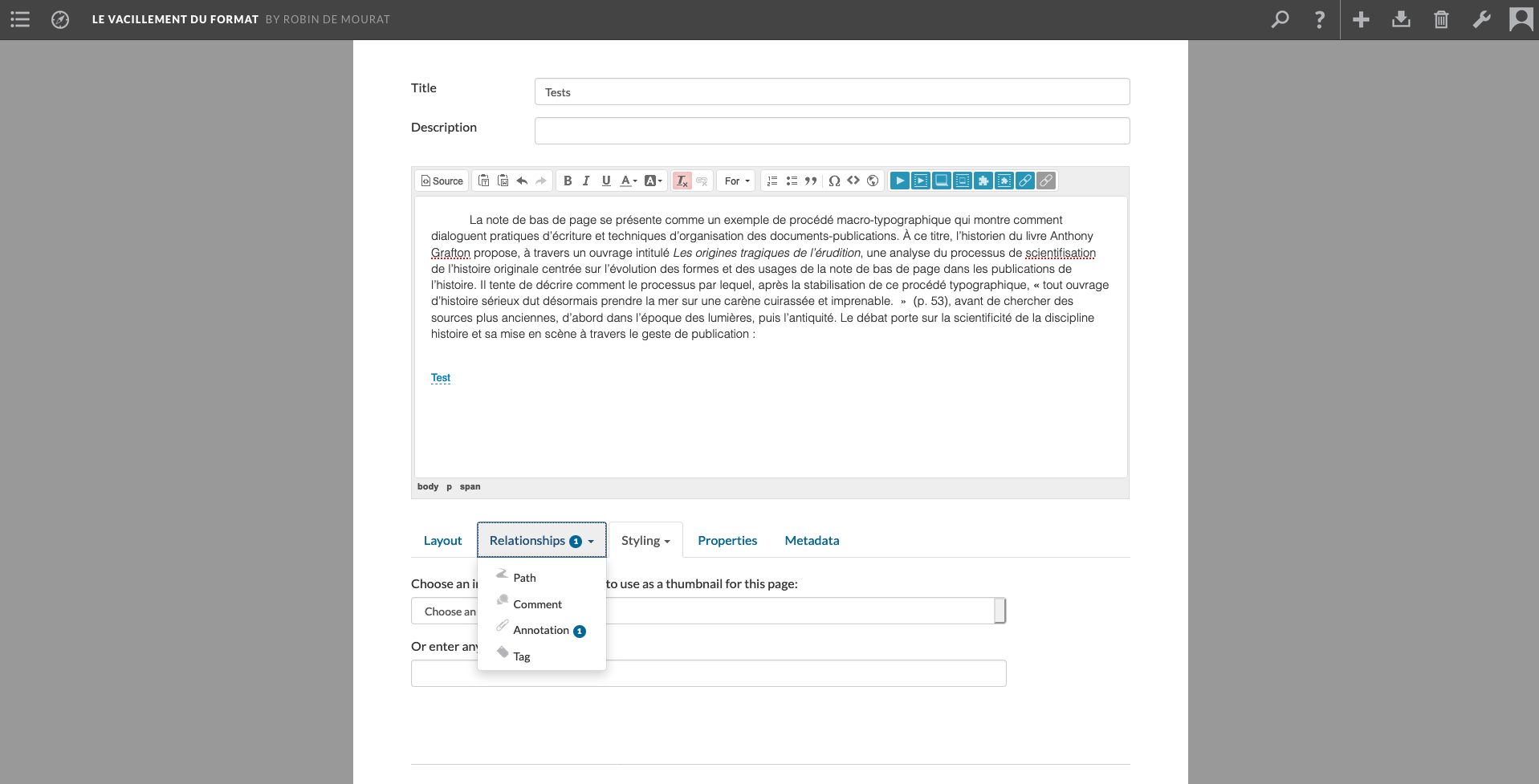 . Au même niveau dans l’interface d’écriture, un système de layouts
. Au même niveau dans l’interface d’écriture, un système de layouts 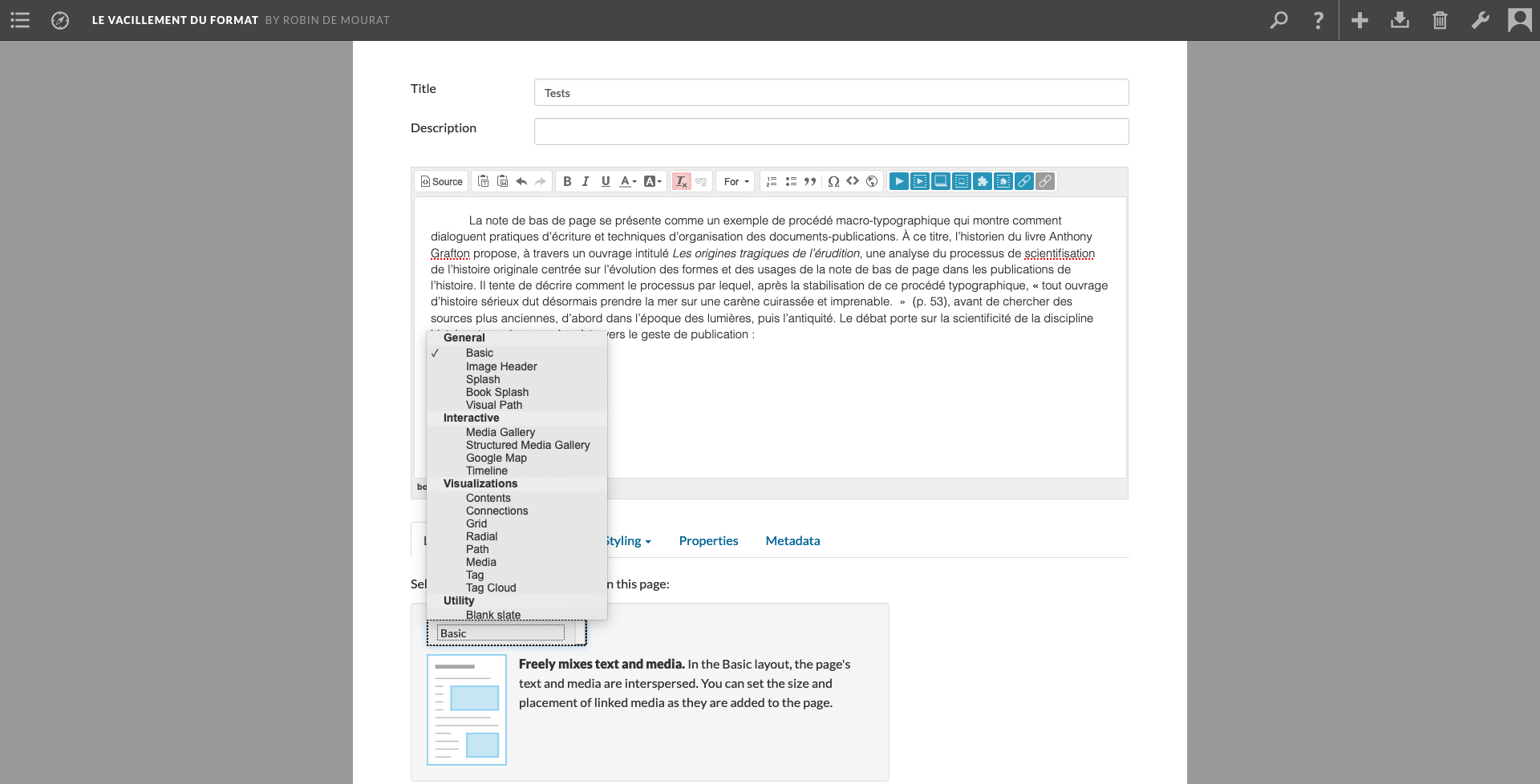 permet par ailleurs de choisir entre différents gabarits d’affichage préfabriqués les relations graphiques qui doivent s’établir entre texte et « figures » (« médias », « widgets », etc.) à l’intérieur des pages. La manière d’écrire spécifique de Scalar entre donc, par le truchement de son interface visuelle d’écriture, en résonance avec nombre d’interfaces de gestion de contenus existantes, facilitant peut-être la prise en main, mais proposant également son propre cadre quant à ce qu’il est pensable et possible de faire à travers la plateforme.
permet par ailleurs de choisir entre différents gabarits d’affichage préfabriqués les relations graphiques qui doivent s’établir entre texte et « figures » (« médias », « widgets », etc.) à l’intérieur des pages. La manière d’écrire spécifique de Scalar entre donc, par le truchement de son interface visuelle d’écriture, en résonance avec nombre d’interfaces de gestion de contenus existantes, facilitant peut-être la prise en main, mais proposant également son propre cadre quant à ce qu’il est pensable et possible de faire à travers la plateforme.
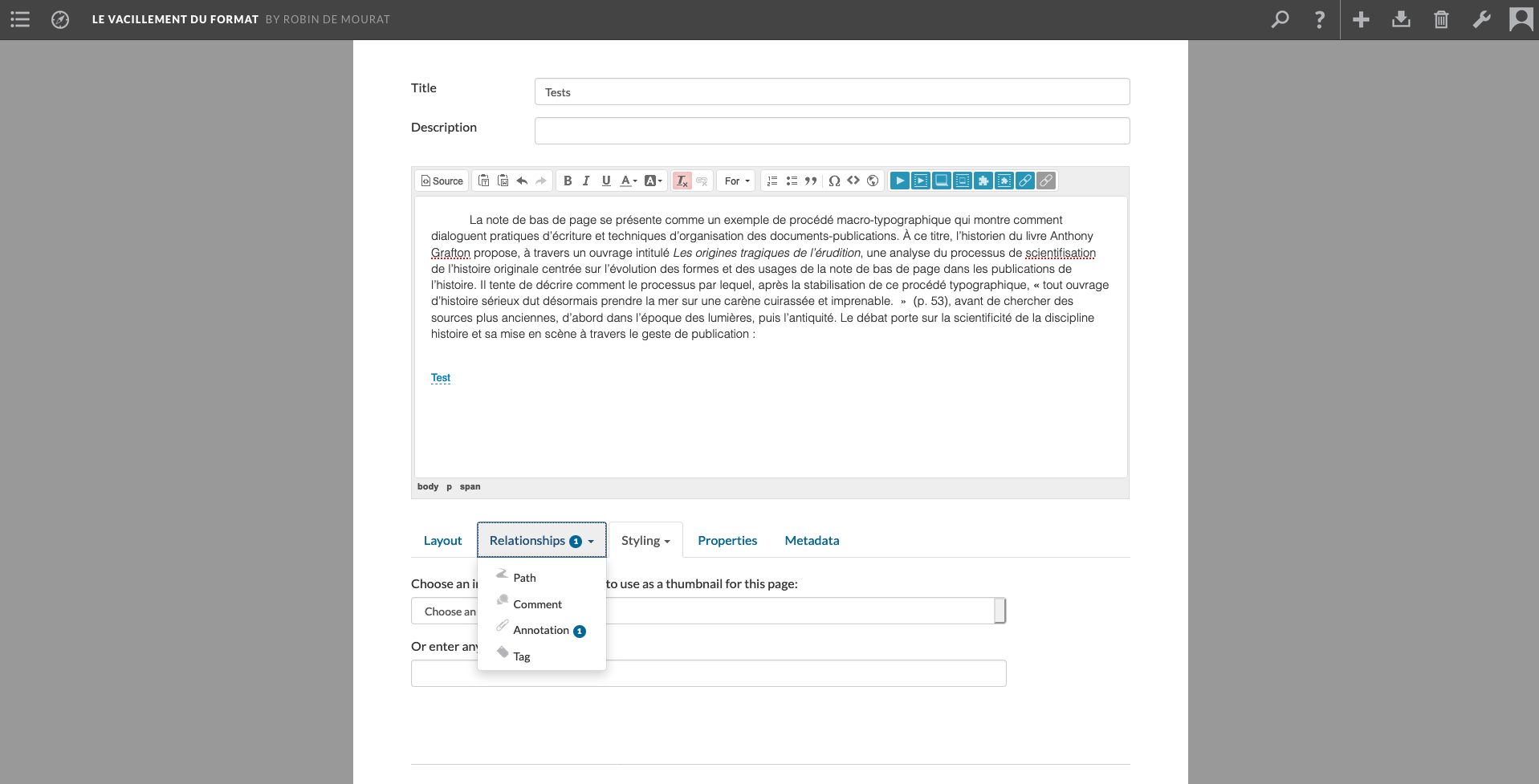 . Au même niveau dans l’interface d’écriture, un système de layouts
. Au même niveau dans l’interface d’écriture, un système de layouts 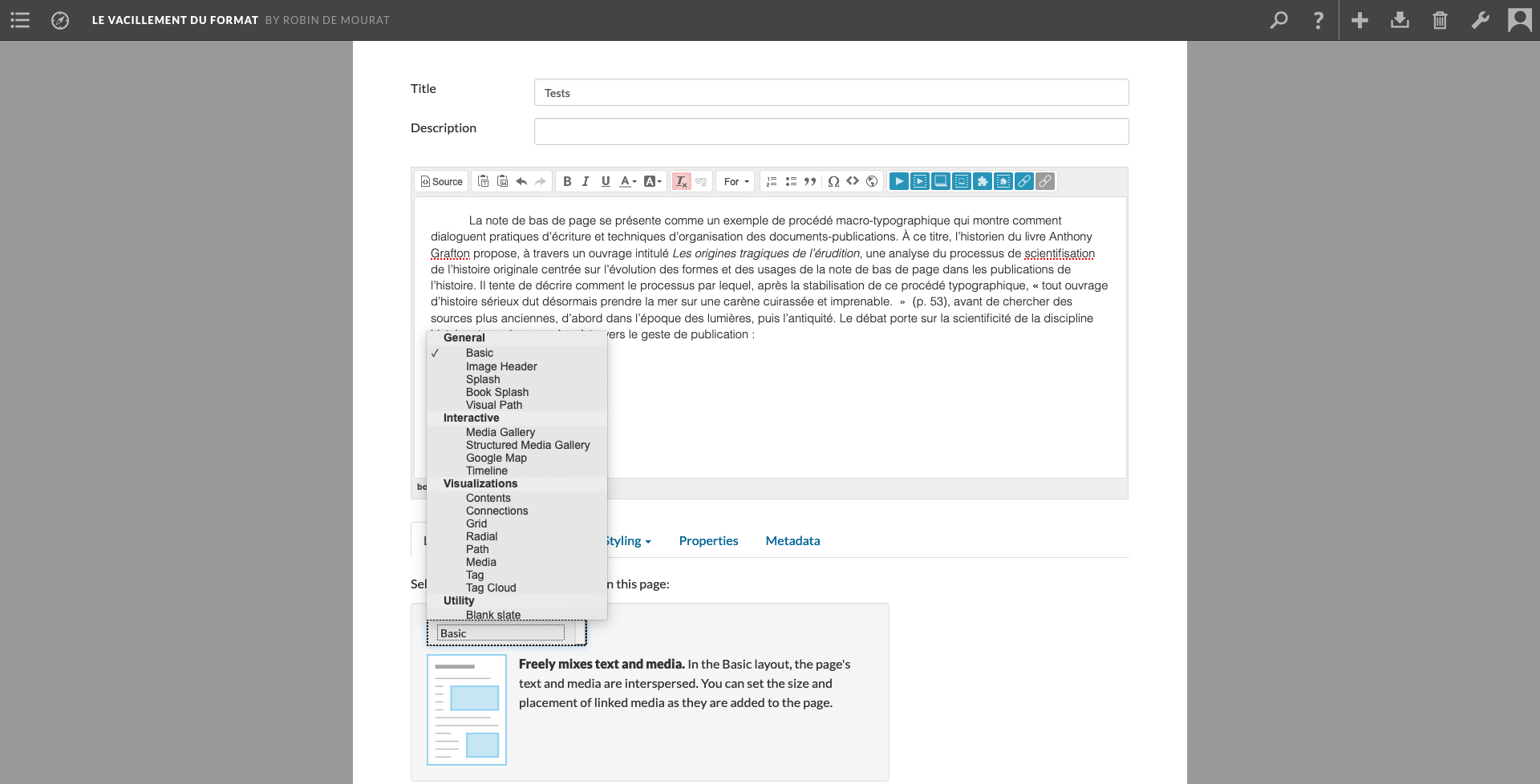 permet par ailleurs de choisir entre différents gabarits d’affichage préfabriqués les relations graphiques qui doivent s’établir entre texte et « figures » (« médias », « widgets », etc.) à l’intérieur des pages. La manière d’écrire spécifique de Scalar entre donc, par le truchement de son interface visuelle d’écriture, en résonance avec nombre d’interfaces de gestion de contenus existantes, facilitant peut-être la prise en main, mais proposant également son propre cadre quant à ce qu’il est pensable et possible de faire à travers la plateforme.
permet par ailleurs de choisir entre différents gabarits d’affichage préfabriqués les relations graphiques qui doivent s’établir entre texte et « figures » (« médias », « widgets », etc.) à l’intérieur des pages. La manière d’écrire spécifique de Scalar entre donc, par le truchement de son interface visuelle d’écriture, en résonance avec nombre d’interfaces de gestion de contenus existantes, facilitant peut-être la prise en main, mais proposant également son propre cadre quant à ce qu’il est pensable et possible de faire à travers la plateforme.L’interface d’écriture Scalar se présente ainsi comme une forme de négociation entre certains éléments reconnaissables la rattachant à des technologies d’écriture partagées – utilisation d’un éditeur de texte graphique, structuration semblable à un CMS – et un modèle de données radicalement réticulaire qui institue la mise en relation hypertextuelle de matériaux écrits et visuels comme opération d’écriture dominante et fondamentale. L’approche multimodale de Vectors tournée vers les dimensions « expérientielles » (McPherson et al., 2009) des technologies numériques est donc relativement délaissée au profit d’un dialogue « en tête à tête » avec la base de données relationnelles et ses modalités d’écriture, ses tendances et ses potentialités. Il s’agit maintenant de voir l’influence de tels choix sur la constitution sociale des collectifs d’écriture.
Délégation technique et stabilisation méthodologique
Le déplacement méthodologique opéré par Scalar s’observe avant tout dans l’apparence des publications numériques que la plateforme permet d’écrire, qui me semblent manifester un relatif désintérêt pour les expériences de lecture qu’elle autorise. En effet, la version publique d’une production réalisée avec Scalar est rendue accessible via un site web à l’interface de lecture extrêmement normalisée visuellement. Dans les pages d’une publication Scalar, les multiples éléments d’un écrit – pages, médias, commentaires, etc. – sont découpés en différentes pages qui se présentent toutes selon un ensemble réduit de gabarits graphiques prédéfinis 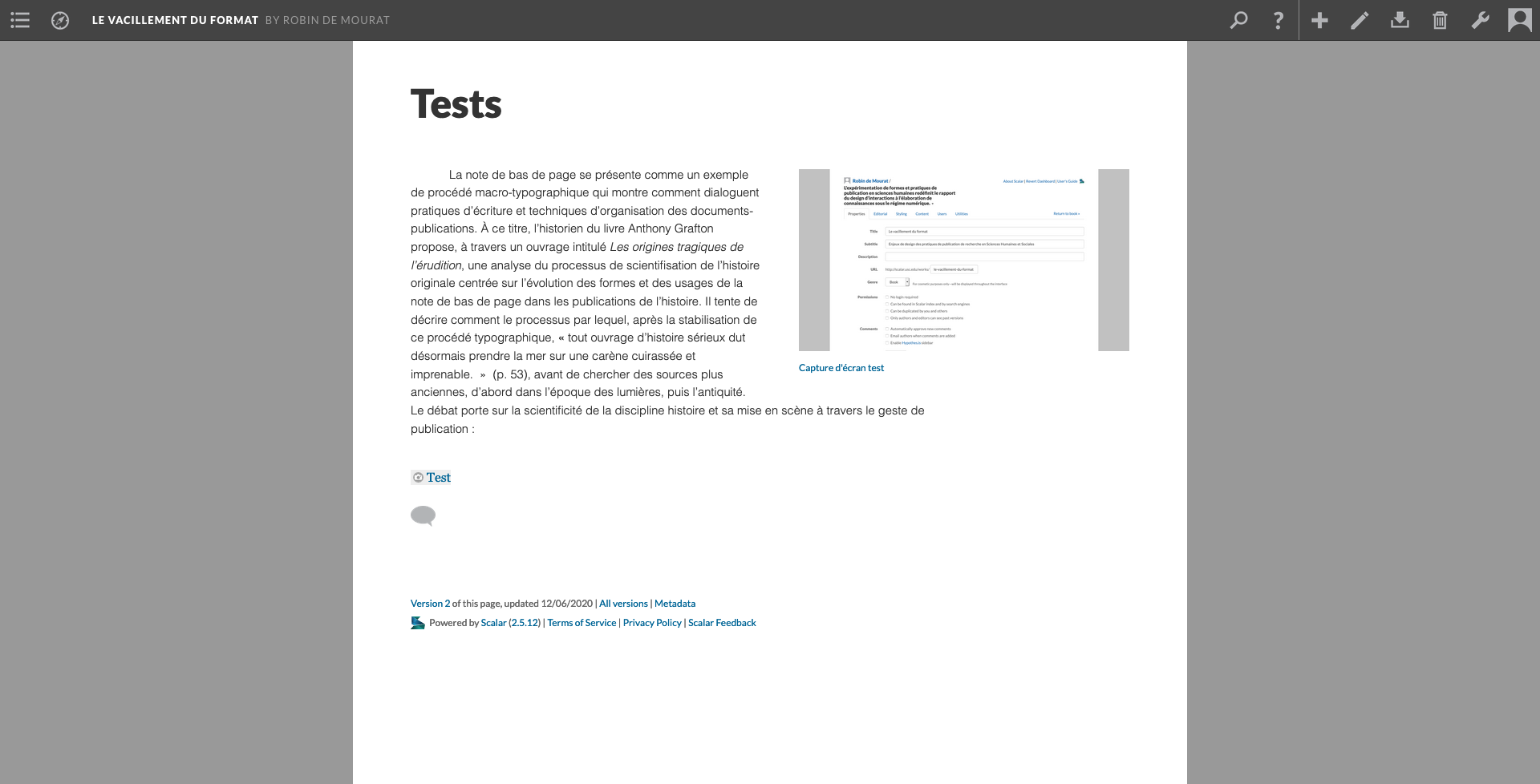 . La structure potentiellement très complexe des publications est par ailleurs atténuée – voire invisibilisée – par le signalement relativement discret des multiples liens attachés à chacun des éléments visités, et par le caractère monotone et répétitif de son format de lecture68 . Il se dégage ainsi, à la lecture d’une publication Scalar, une impression d’homogénéité visuelle très forte qui rend facilement reconnaissables les publications faites avec la plateforme et le logiciel tout en rendant moins spectaculaire sa dimension multimodale.
. La structure potentiellement très complexe des publications est par ailleurs atténuée – voire invisibilisée – par le signalement relativement discret des multiples liens attachés à chacun des éléments visités, et par le caractère monotone et répétitif de son format de lecture68 . Il se dégage ainsi, à la lecture d’une publication Scalar, une impression d’homogénéité visuelle très forte qui rend facilement reconnaissables les publications faites avec la plateforme et le logiciel tout en rendant moins spectaculaire sa dimension multimodale.
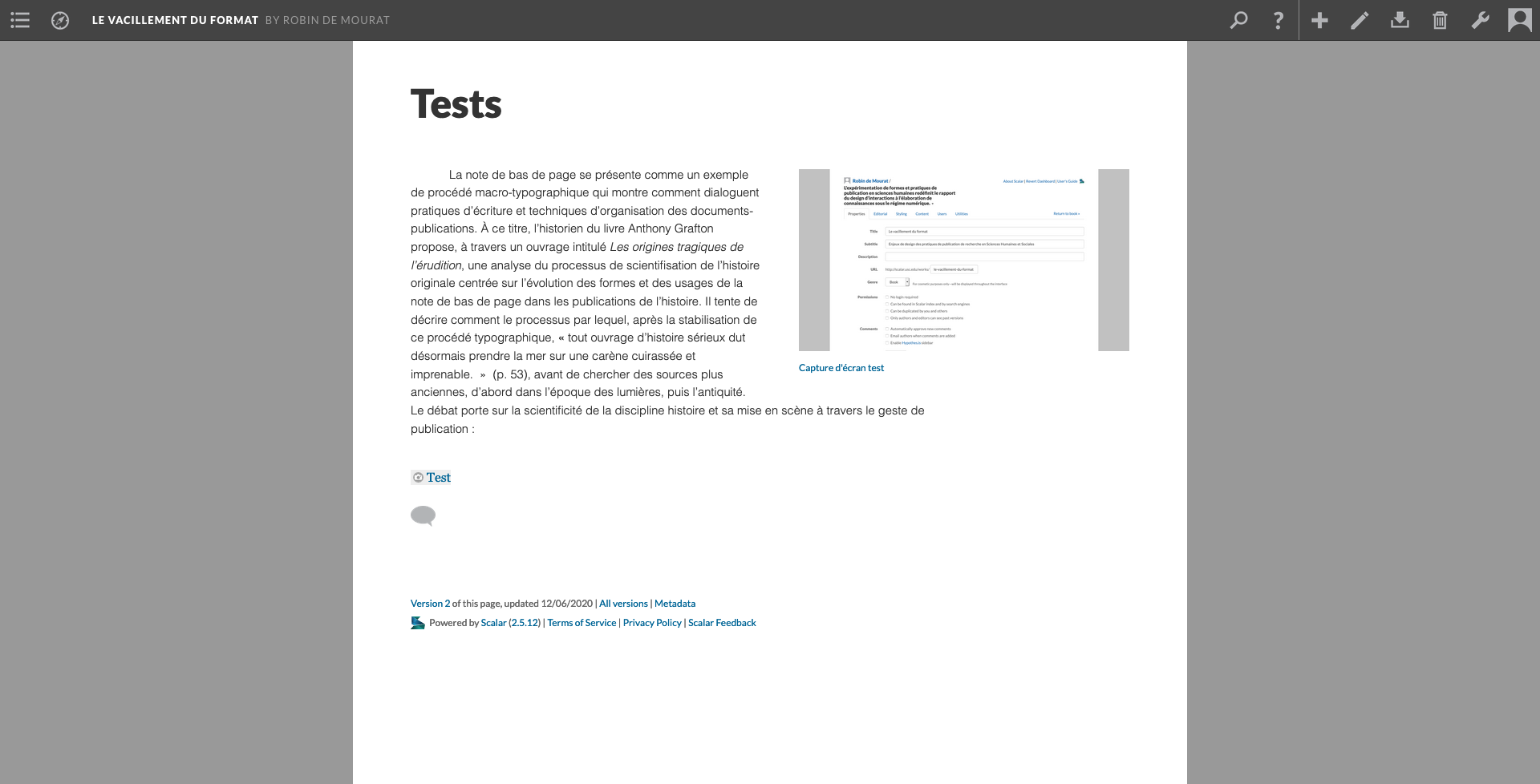 . La structure potentiellement très complexe des publications est par ailleurs atténuée – voire invisibilisée – par le signalement relativement discret des multiples liens attachés à chacun des éléments visités, et par le caractère monotone et répétitif de son format de lecture68 . Il se dégage ainsi, à la lecture d’une publication Scalar, une impression d’homogénéité visuelle très forte qui rend facilement reconnaissables les publications faites avec la plateforme et le logiciel tout en rendant moins spectaculaire sa dimension multimodale.
. La structure potentiellement très complexe des publications est par ailleurs atténuée – voire invisibilisée – par le signalement relativement discret des multiples liens attachés à chacun des éléments visités, et par le caractère monotone et répétitif de son format de lecture68 . Il se dégage ainsi, à la lecture d’une publication Scalar, une impression d’homogénéité visuelle très forte qui rend facilement reconnaissables les publications faites avec la plateforme et le logiciel tout en rendant moins spectaculaire sa dimension multimodale.La stabilisation technique et institutionnelle opérée par Scalar semble par ailleurs s’accompagner de la stabilisation de certaines manières de travailler et d’envisager la relation entre écriture et matériaux de recherche. Les premiers comptes rendus d’usage de l’interface semblent en ce sens indiquer que cette dernière favoriserait une forme de « séquentialité » dans la méthodologie de travail, faisant naturellement précéder la collection, le regroupement, la description et la « curation » des matériaux de la recherche à publier – qu’ils soient des extraits vidéo, des images ou des sites web – puis leur connexion au moyen de la grammaire relationnelle de l’interface, et enfin la rédaction d’éléments textuels et la constitution de « cheminements » particuliers. La fabrication de la plateforme agit ainsi comme la stabilisation d’une modalité particulière de relation entre écriture et matériaux de recherche, ainsi que l’indique ce témoignage :
Dʼune certaine manière, je pense donc que Scalar fonctionne bien en rassemblant votre matériel source et en lʼimportant avant la réalisation de votre publication.69 (Owens, 2018)
Les transformations méthodologiques opérées par la plateforme ont par ailleurs une forte influence sur l’organisation sociale du travail d’écriture qu’elle implique par rapport à Vectors. En effet, l’institution de la plateforme Scalar semble au premier abord déplacer le rôle des designers, artistes et ingénieurs impliqués dans le processus d’écriture collective de Vectors depuis la fabrication de pièces spécifiques vers la fabrication d’environnements d’écriture stabilisés et autonomes. La stabilisation de Scalar opère en ce sens une délégation technique de certains choix, depuis des dialogues issus d’une collaboration interdisciplinaire, vers un outil technique qui les sédimente et les met en œuvre de manière systématique. À partir de l’observation de certaines pratiques – et structures – récurrentes dans la constitution des bases de données des articles Vectors, un modèle général de l’écriture est ainsi formulé et implémenté dans un logiciel qui demande moins de ressources techniques et humaines et le performe procéduralement.
Cependant, on retrouve à l’intérieur de la plateforme des espaces pour une collaboration relevant du design et de l’expérimentation d’autres manières d’écrire les publications que celles initialement proposées – et fortement suggérées – par le fonctionnement de la plateforme. En ce sens, d’une part, les productions Scalar autorisent un travail de « personnalisation » qui permet d’écrire des mécanismes d’interaction et des instructions de mise en forme spécifiques à chaque production au moyen des langages informatiques Javascript et Cascading Style Sheets70 . D’autre part, chaque production de Scalar est accessible sous la forme d’un point d’entrée destiné à la programmation d’interfaces visuelles spécifiques via une Application Programming Interface (API). Cette dernière permet d’exploiter une publication Scalar comme une ressource propre à effectuer un travail d’écriture multimodale plus libre (sur les plans visuel, interactif, sonore, etc.) depuis une autre application. En l’état, rares semblent être les projets qui s’engagent dans un travail supplémentaire de design graphique ou interactif71 , et la plupart des documents produits avec Scalar héritent de son interface de lecture par défaut. Cependant, la relative « jeunesse » de la plateforme rend difficile un quelconque bilan quant à l’actualisation de telles articulations entre la plateforme et des démarches d’écriture expérimentales.
Ainsi, à travers la stabilisation opérée par Scalar, les approches méthodologiques et épistémologiques observées dans Vectors sont à la fois sédimentées dans le dispositif technique de la plateforme – qui implique une fréquentation intime des matériaux de recherche et une attitude relationnelle et « hypertextuelle » vis-à-vis de l’écriture avec ces derniers – et ré-articulées selon de nouvelles modalités d’assemblage social et méthodologique au moyen de son architecture technique particulière et l’exposition d’une interface pour la programmation de formats d’écriture nouveaux et hybrides. La variété des publications Scalar répertoriées dans Studiolo manifeste à ce titre sa capacité à rencontrer une diversité de genres et de contextes éditoriaux et scientifiques, qu’il s’agisse de produire « des compagnons numériques pour des livres imprimés, […] des critiques dʼexposition interactives, des articles scientifiques nativement numériques [...], des manuels interactifs, des expériences médiatiques personnalisées, des livres entiers nativement numériques (parfois multilingues), des devoirs de classe, des fictions électroniques et de nombreux autres projets »72 (McPherson, 2018, p. 193).
La stabilisation méthodologique opérée par la plateforme Scalar semble indéniablement imprimer sur les pratiques d’écriture une « proposition insistante » quant à une certaine manière de dialoguer avec les matériaux de recherche, et favorise de ce fait certaines approches vis-à-vis de la publication et de ses implications épistémologiques (et politiques). En ce sens, elle associe et aligne des manières d’écrire récurrentes avec certaines conceptions de ce qu’est l’authenticité d’une travail de recherche. Cependant, elle autorise aussi la rencontre d’autres formes d’authenticité mobilisées par les « utilisateurs » qui s’approprieront la plateforme et la feront dialoguer avec des pratiques diversifiées73 . Elle n’en reste donc pas moins ouverte à la combinaison et à l’hybridation avec une diversité de manières de faire.
En stabilisant certaines dimensions de l’écriture tout en laissant d’autres ouvertes à l’expérimentation, l’influence de Scalar sur la rencontre entre les matériaux de recherche et les pratiques d’écriture s’opère ainsi selon une relation de causalité non-linéaire, qui reste ouverte à la ré-articulation et qu’il serait incorrect de décrire comme une standardisation ou une généralisation de la démarche expérimentale initiale. Il faut alors essayer de qualifier les effets de cette stabilisation partielle – et réversible – sur les formats d’écriture numériques de la recherche en SHS.
La stabilisation socio-technique des formats d’écriture comme production d’horizons pour les pratiques d’enquête
Vers un régime d’écriture reconnaissable
La plateforme Scalar offre un cas d’étude remarquable pour analyser la manière dont des expérimentations émergeant d’une déstabilisation des technologies d’écriture de l’enquête dialoguent avec la formation institutionnelle et épistémologique de nouveaux collectifs de recherche. À ce titre, les comparaisons effectuées entre Scalar et des instances d’écriture existantes me semblent révélatrices de l’émergence d’un nouveau format d’écriture reconnaissable. En ce sens, le logiciel Scalar est dans de nombreuses recensions rapporté au logiciel Wordpress qui constitue parfois un point de référence facilitant l’adoption – Scalar est ainsi « une plateforme aussi simple à utiliser que WordPress » (Tracy, 2016) – et parfois un point de référence négatif permettant de qualifier, par contraste, les spécificités de Scalar en tant que middleware intellectuel74 , tel que le font Johanna Drucker et Patrick Svensson (Johanna Drucker & Svensson, 2016). Dans ce dernier sens, Tara McPherson mobilise également WordPress plusieurs fois dans ses textes comme une valorisation implicite de la « hiérarchie », là où Scalar se présente sur le registre de « l’immanence » et « peut être considéré comme une reformulation spéculative de structures logiques rigides en structures plus conceptuelles, créant des possibilités de relations nombreuses et variées, tant humaines que machiniques »75 (McPherson, 2018, p. 211). Ce faisant, dans le contexte américain, Scalar semble effectivement construire progressivement un public de chercheurs qui l’utilisent et commencent à se reconnaître mutuellement comme partageant une communauté de pratique. Il semble également commencer à être reconnu comme l’une des manières légitimes de publier un travail de recherche76 .
La dimension dynamique de la stabilisation de Scalar se retrouve par ailleurs dans les discours de ses initiateurs quant à l’avenir du projet. Alors que certains commentateurs décrivaient en 2011 Scalar comme l’instrument d’une forme de « messianisme numérique » prétendant sauver les humanities américaines des coupes budgétaires qui les menacent par un tour technologique, et l’accusaient de se présenter comme le « next big thing » de l’édition universitaire (J. Rogers, 2011), Tara McPherson, elle, en 2018, insiste sur la prétention de Scalar à devenir une infrastructure pour des pratiques expérimentales à venir77 . Elle présente par ailleurs le projet comme soumis au destin inéluctable d’une « dégradation gracieuse »78 (McPherson, 2018, p. 211) et rappelle que « lʼespace à partir duquel [Scalar] a pris forme a encouragé un processus continu de fabrication, dʼitération et de refonte dans lequel la théorie, lʼhomme et la machine se sont remodelés continuellement lʼun lʼautre » et que « nous devons construire davantage dʼespaces pour que de tels reenactments puissent se dérouler »79 (McPherson, 2018, p. 211).
Ainsi, à partir d’un certain modèle de ce que pourrait être un régime d’écriture de l’enquête en SHS, mobilisant de manière extensive et intime une diversité de matériaux à travers leur mise en relation via une base de données, l’institutionnalisation de Scalar me semble conduire nécessairement à la stabilisation progressive d’un format d’écriture, qui aligne partiellement des manières d’écrire, des présupposés épistémologiques et des collectifs sociaux, sans pour autant être fermé à l’articulation et à des hybridations à venir. Ce faisant, il n’établit pas un état de fait définitif, mais opère un partage graphique dynamique et temporaire. Ce dernier consiste en un « travail des frontières » qui est « le résultat d’un travail de négociation et de démarcation […], et non une délimitation statique acquise une fois pour toutes » (Pontille, 2003). Cependant, contrairement aux formats d’écriture décrits dans des travaux précédents, ce format-ci n’est pas exclusivement articulé par des pratiques d’écriture mises en œuvre par les chercheurs à l’intérieur d’un cadre matériel stabilisé, tel que celui des circuits éditoriaux « conventionnels ». Il repose plutôt sur des technologies d’écriture émergentes qui résultent de pratiques de fabrication récentes qui évoluent et réagissent au contact des pratiques d’écriture qu’elles suscitent. Il s’agit donc de qualifier la relation qui s’opère entre la stabilisation de ces pratiques de fabrication et les dynamiques de stabilisation des pratiques d’écriture qui en découlent.
Formats socio-techniques d’écriture et fabrication d’horizons méthodologiques et épistémologiques
Il s’agit maintenant de qualifier comment la stabilisation matérielle de formats d’écriture telle que celle opérée par Scalar dialogue avec les pratiques de l’enquête des collectifs de recherche en SHS. Pour éclairer une telle relation, il est possible de s’aider à nouveau de certains équipements issus de la sociologie, et en particulier de la sociologie des sciences et des techniques (STS). En effet, de nombreux travaux dans le champ des STS ont consisté à étudier les dynamiques de stabilisation socio-technique à l’œuvre dans la formation des connaissances et des « faits » scientifiques – comme on le verra dans le chapitre suivant – mais également des pratiques de communication et de « l’articulation entre contenu et matérialité » à l’oeuvre dans « lʼinteraction entre le contenu symbolique et la signification avec les artefacts, les pratiques, et les arrangements sociaux qui leur sont associés »80 (Boczkowski & Lievrouw, 2007, p. 955). Une telle approche permet d’étudier l’action de ces stabilisations sur les pratiques sans pour autant présupposer d’un déterminisme total des pratiques culturelles sur les pratiques de fabrication (technique) ou vice versa.
Dans ce dernier cadre, à travers une étude portant sur la stabilisation technologique et culturelle du « blog » dans les communautés de publication en ligne, le sociologue Eduardo Siles a décrit comment l’interaction entre des pratiques de fabrication technique et des pratiques culturelles (d’écriture) était en mesure de provoquer un processus de « cristallisation » propre à l’émergence d’un nouveau « format » (Siles, 2011). Dans l’étude de Siles, le processus de « cristallisation » s’incarne dans trois temps : d’abord, un mouvement d’extension de dispositifs matériels d’écriture existants à des nouveaux contenus (dans le cas des blogs, ceux des « diaries » et autres « journaux » en ligne ayant émergé dès la création du web) ; ensuite, la matérialisation et la réarticulation de ces pratiques par le développement de technologies nouvelles à même d’en faciliter la reproduction (dans le cas du blog, l’émergence des Content Management Systems et de plateformes telles que Blogger) ; enfin la stabilisation d’un nouveau « format » à part entière via l’utilisation d’un vocabulaire faisant consensus et la mise en place de formats de lecture nouveaux qui rendent le format reconnaissable, mais aussi appropriable pour de nouvelles pratiques.
En ce sens, le « format » est alors défini par Silès comme une « configuration mutuelle entre un médium et un méta-genre » qui stabilise progressivement des temporalités et des modalités de publication particulières tout en se détachant de « genres » de productions culturelles spécifiques. Le format est alors l’expression d’une stabilisation qui se reconnaît à trois propriétés : d’abord, la standardisation technique à travers des systèmes technologiques de plus en plus automatisés (par exemple, pour le blog, la création de la plateforme Blogger) et l’utilisation de gabarits ; ensuite, la normalisation progressive des discours qui consiste à nommer le format de plus en plus explicitement et à le décrire sans tenir compte des contenus pour lesquels il est utilisé ; enfin, la stabilisation d’un « consensus partiel » sur la signification et les usages les plus appropriés de la technologie parmi les acteurs (lecteurs, écrivains, informaticiens, etc.) (Siles, 2011, p. 753) impliquant des pratiques de lecture, d’édition et d’écriture stabilisées.
Il me semble légitime d’appliquer le cadre descriptif proposé par Silès à l’étude de la stabilisation opérée par Scalar. En effet, on observe bien le même processus de standardisation technique, de désignation émergente, et de diffusion des pratiques impliquées par la dimension institutionnelle de l’organisation ANVC et de ses multiples partenariats. Cependant, dans le cadre des pratiques de publication de recherche, la dimension socio-technique de la cristallisation des formats s’accompagne aussi d’une stabilisation méthodologique, qui a des implications épistémologiques. Comme on l’a vu, ces implications ne s’expriment pas sur le registre d’un déterminisme strict, puisque le format d’écriture d’une plateforme comme Scalar relève de la proposition ou de la facilitation de certaines manières de faire plutôt que de leur imposition définitive. Le redéploiement de nouveaux genres à partir de l’exemple de Scalar révèle par ailleurs qu’une fois un format socio-technique stabilisé, il ré-articule des pratiques existantes et devient alors l’infrastructure pour de nouvelles expérimentations.
Je propose en ce sens de nommer format socio-technique d’écriture le résultat de la stabilisation partielle d’expérimentations touchant à l’articulation entre écriture et enquête. Le format socio-technique d’écriture a alors beaucoup à voir avec le concept de genre si on comprend ce dernier comme un processus de stabilisation ancré dans des dynamiques de reconnaissance partielles et instanciées dans les pratiques. Je m’inscris ici dans l’approche du concept de genre proposée par la théoricienne des médias Lisa Gitelman, qui ne comprend pas le genre comme la reconnaissance d’une série d’attributs formels ou de caractéristiques immuables, mais plutôt comme un « mode de reconnaissance » qui dépend « dʼun nombre peut-être infini de choses que de grands groupes de personnes reconnaissent, reconnaîtront ou ont reconnu comme l’un des usages des écrits »81 (Gitelman, 2014, p. 2). Ainsi, les genres ne sont pas fixes mais sont des « pratiques dʼexpression et de réception continues et changeantes, reconnaissables dans une myriade de circonstances constitutives variables à la fois et aussi dans le temps » qui articulent les « horizons d’attente » d’une diversité d’acteurs et leurs pratiques82 . En ce sens, le genre d’un format socio-technique d’écriture opère comme un acteur qui fait dialoguer des articulations épistémo-méthodologiques sédimentées dans des outils et des infrastructures matérielles avec les nouvelles articulations opérées par les pratiques d’écriture que ces dernières autorisent.
La stabilisation socio-technique impliquée par la production d’un format socio-technique d’écriture touche ainsi l’ensemble de la chaîne qui transforme « l’écriture qui enquête » en « écriture qui publie », mais également des pratiques et des acteurs associés à la publication de la recherche. Je propose d’emprunter à la chercheure en littérature Rachel Malik le concept d’horizon (Malik, 2008) pour désigner le dialogue des formats socio-techniques d’écriture avec les diverses pratiques associées à la publication. Pour Malik, l’horizon se présente comme ce qui « précède l’écriture et gouverne les possibilités de lecture » et d’écriture (Malik, 2008), agissant sur variété de pratiques – composition, design, distribution, etc. – dans les processus éditoriaux sur le registre de la potentialité plutôt que sur celui d’une détermination. L’action d’un format socio-technique d’écriture pourrait se définir en ce sens comme la production d’horizons de pratique qui opèrent sur la relation entre pratiques d’enquêtes et pratiques d’écriture. Les formats socio-techniques d’écriture articulent en ce sens des dimensions poétiques, épistémologiques et méthodologiques. Entre reconnaissance de régimes d’écriture partagés et rencontre des matériaux spécifiques à une recherche, les horizons de pratique qu’ils déploient opèrent ainsi comme les médiateurs souples d’une relation de croissance mutuelle entre pratiques d’écriture et pratiques d’enquête.
Conclusion
Ce chapitre a consisté à étudier les articulations qui s’opèrent entre pratiques de recherche et pratiques d’écriture et leur reconfiguration au contact de la déstabilisation opérée par les technologies numériques de fabrication des documents-publications. Après avoir décrit les dynamiques de partage graphique qui découlent de la relation de transformation qui s’opère depuis la fréquentation empirique des matériaux de recherche vers l’écriture pour la publication, il s’est agi d’analyser les effets méthodologiques, épistémologiques et politiques provoquées par des approches expérimentales de l’écriture de l’enquête convoquant de manière importante la fabrication d’artefacts numérique. Dans un troisième temps, à travers l’étude de la stabilisation des expériences du laboratoire-revue Vectors dans l’organisation-plateforme Scalar, j’ai décrit comment de telles déstabilisations pouvaient à leur tour faire format en stabilisant partiellement une infrastructure technique et sociale à même de favoriser certaines pratiques d’écriture et de travail avec les matériaux de recherche. Sur cette base, j’ai esquissé la proposition conceptuelle du format socio-technique d’écriture pour décrire la dynamique de stabilisation non-linéaire et relative impliquée par la production de nouveaux horizons pour des pratiques de lecture, d’écriture et d’édition à venir.
Vis-à-vis de l’étude des formats conduite dans cette recherche, ce chapitre a permis d’aborder un double vacillement. Le premier se situe dans la relation entre les formats d’enquête et les formats d’écriture, qui a été redéfinie comme une dynamique de transformation mettant en jeu des matériaux de recherche hétérogènes et leur rencontre à travers une variété de pratiques. Les matériaux agissent alors comme un élément perturbateur pour l’articulation entre enquête et écriture, et remettent toujours en jeu les manières stabilisées de lier les attaches empiriques de la recherche avec la production des documents-publications. Dans ce cadre, le développement des multiples expérimentations numériques liées à la publication en SHS ont été étudiées dans la mesure où elles ont permis de réarticuler et de reconfigurer la relation entre pratiques d’écriture et pratiques d’investigation universitaire.
Le deuxième vacillement approfondi dans ce chapitre a été celui de la relation entre les formats-produits issus de diverses expérimentations matérielles d’écriture de l’enquête, et les formats-cadres qui résultent de la stabilisation de certaines de ces expérimentations dans des technologies d’écriture réutilisables, et les institutions qui les portent. Présenté sous l’angle initial d’une tension entre la spécificité des situations de rencontre avec les matériaux de recherche dans l’écriture, et le besoin de modalités de publication reconnaissables, ce vacillement a été requalifié sur le registre d’une stabilisation partielle qui solidifie les relations entre des manières d’écrire, des présupposés épistémologiques et des collectifs particuliers, tout en instituant une infrastructure pour des expérimentations à venir à même de la déjouer et de la remettre en question. À travers la proposition du concept d’horizon de pratique, il s’est donc agi de qualifier à nouveaux frais le régime de structuration latente et non-déterministe qu’impliquent les formats pour les pratiques de recherche.
Par ailleurs, ce chapitre a été l’occasion d’esquisser de nouvelles pistes pour des pratiques de design des publications en SHS relevant d’une poétique de la métamorphose documentaire, telle que proposée dans le chapitre précédent. En recentrant notre attention depuis la conception d’expériences multimodales de lecture vers des pratiques de design attachées à dialoguer avec des manières d’écrire multimodales et collectives, il s’est agi d’étudier des pratiques de design portant sur les pratiques de recherche et d’investigation mêmes des SHS, plutôt que sur l’expression rhétorique des idées que ces dernières seraient en mesure d’énoncer. Ensuite, en analysant le déplacement de pratiques, telles que celles du collectif Vectors, depuis la fabrication de pièces uniques vers la production d’infrastructures dédiées à l’expérimentation, ce chapitre a permis de décrire une première fois des pratiques de design relevant davantage de l’équipement technique, méthodologique et social des parties prenantes de la publication en vue d’une pratique expérimentale, collective et participative – plutôt que des pratiques de design qui s’inscriraient dans une pure instrumentation à visée industrielle, ou dans une forme de division cloisonnée du travail d’écriture entre le « contenu » (pour les chercheurs en SHS) et la « présentation » (pour les designers).
La méthodologie et les objectifs de ce chapitre laissent cependant dans l’ombre deux perspectives. D’abord, ils ne permettent que marginalement d’étudier en détail les conditions d’appropriation des formats socio-techniques d’écriture déployées à partir d’expérimentations stabilisées (telles que Scalar), et les modalités de rencontre avec les publics de lecteurs et d’écrivains qu’elles impliquent. Le dialogue entre, d’une part, le régime d’écriture très spécifique d’une infrastructure telle que Scalar et, d’autre part, les pratiques des chercheurs qui viennent à sa rencontre, n’a pas pu être étudié au-delà de discours publics et de l’étude de documents-publications finis. Dans ce cadre, la dimension expérimentale des pratiques de fabrication a, notamment à la fin de ce chapitre, surtout été étudiée dans sa relation avec des processus de stabilisation (partielle) pour les collectifs de recherche. Et pourtant, ces pratiques de fabrication – et les formats qu’elles génèrent – peuvent aussi agir comme le vecteur de frictions, de bifurcations et de reconfigurations sociales et épistémologiques imprévues, qui donnent une nouvelle épaisseur intellectuelle et réflexive au geste d’une publication expérimentale et performative qui fait rencontrer un format-produit avec un public. Il s’agit d’observer de plus près ce dialogue et les dynamiques de formation sociale qu’il peut occasionner dans la suite de cette thèse.
Par ailleurs, une grande partie des expérimentations étudiées dans ce chapitre ont porté sur des contextes de recherche américains, qui furent, encore une fois, étudiés à distance et par le truchement de documents publics bien stabilisés dans leur discours et leur récit. Et pourtant, au moment où se formule la plateforme Scalar, un nombre important d’expériences se déroulent simultanément dans le contexte européen et français. Parmi ces dernières, le projet Enquête sur les Modes d’Existence, démarré par un colloque en 2009 et débuté effectivement en 2012, offre la possibilité d’explorer plus intimement les implications épistémologiques et sociales de l’expérimentation d’un format d’écriture spécifique et de sa rencontre avec des collectifs de recherche préexistants. J’ai été amené à m’immerger dans ce projet sur une période de dix mois durant laquelle j’ai été en situation d’engagement observationnel, contribuant à la documentation et à l’analyse de la relation entre l’histoire de son développement et les modalités d’appropriation dont il a fait l’objet. Il s’agit donc, dans le prochain chapitre, d’étudier une autre relation à l’œuvre dans le vacillement des formats des publications en SHS, qui relève alors de l’articulation entre un format socio-technique d’écriture et ses publics.